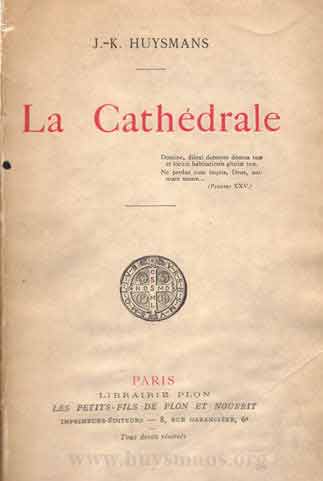DURTAL avait prié Mme Mesurat, sa bonne, de porter le café dans le cabinet de travail. Il espérait ainsi ne plus l’avoir devant lui, debout, comme pendant le déjeuner, lui demander si sa côtelette de mouton était bonne.
Et bien que cette viande sentît le gilet de flanelle, Durtal avait ébauché un vague geste affirmatif, sachant fort bien que, s’il hasardait la moindre remarque, il devrait subir d’incohérents rabâchages sur tous les bouchers de la ville.
Aussi, dès que cette femme, despotique et servile, eut placé, sur sa table, la tasse, il se plongea le nez dans un livre, la força, par son attitude rechignée, à fuir.
Ce livre qu’il feuilletait, il le connaissait presque par coeur, car il l’avait souvent lu, en dehors des heures des offices, dans la cathédrale ; il y était si bien dans son cadre avec sa foi naïve et ses élans ingénus qu’il semblait être la voix familière de l’église même.
Ce petit volume contenait le recueil des oraisons de Gaston Phoebus, comte de Foix, au quatorzième siècle ; Durtal en possédait deux éditions, l’une, imprimée, telle quelle, dans son authentique langage et son ancienne orthographe, par l’abbé de Madaune, l’autre rajeunie, mais d’experte façon, par M. de la Brière.
Et, en tournant au hasard les pages, Durtal tombait sur ces dolentes et humbles prières : « Toi qui m’as formé dans le ventre de ma mère, ne me laisse pas choir... Sire, je te confesse ma pauvreté... ma conscience me mord et m’expose les secrets de mon coeur. Avarice me contraint, luxure me souille, gloutonnerie me déshonore, colère me trouble, inconstance m’abat, paresse m’opprime, hypocrisie me leurre... et voilà, Sire, avec quels compagnons j’ai vécu ma jeunesse, ce sont là les amis que j’ai eus, ce sont là les seigneurs que j’ai servis... »
Et plus loin, il s’écriait : « Péchés sur péchés, toujours j’ai amassés et les péchés que, de fait, je ne pouvais commettre, par mauvaise cogitation, je les faisais... »
Durtal referma le volume et déplora qu’il fût si parfaitement inconnu des catholiques. Ils en étaient tous à remâcher le vieux foin déposé en tête ou en queue des journées du chrétien ou des eucologes, à lapper des oraisons solennelles, issues de la lourde phraséologie du dix-septième siècle, des suppliques où l’on ne percevait aucun accent sincère, rien, ni un appel qui partît du coeur, ni un cri pieux !
Étaient-elles assez loin, toutes ses rapsodies fondues dans le même moule, de ce langage si pénitent et si simple, de ce colloque si aisé et si franc de l’âme avec Dieu ! et Durtal parcourait encore, çà et là, quelques passages, lisait :
« Mon Dieu et ma miséricorde, je suis confus de te prier par vergogne de ma mauvaise conscience... donne à mes yeux fontaine de larmes et à mes mains largesses d’aumônes... donne-moi foi convéniente, espérance et continuelle charité... Sire, tu n’as horreur d’aucun, sinon du fou qui te nie... ô mon Dieu, don de mon salut et mon receveur, j’ai péché et tu l’as souffert ! »
Et, tournant encore quelques feuillets, il arrivait à la fin du volume, à certains textes recueillis par M. de la Brière, entre autres à des pensées sur l’Eucharistie, tirées d’un manuscrit du quinzième siècle.
« Cette viande ne s’assimile pas à chacun ; il y en a qui ne la mâchent point, mais qui l’engloutissent à la hâte. On doit y mordre au plus profond que l’on peut, des dents de l’entendement, pour que la suavité de sa saveur en soit exprimée au dehors et qu’en sorte la saveur. Vous avez entendu dire que, dans la nature, ce qui mieux est trituré, mieux nourrit ; la trituration des dents, ce sont les profondes et aiguës méditations sur le sacrement lui-même. »
Puis après avoir expliqué le sens personnel de chaque dent, l’auteur ajoutait à propos de la quinzième, « que le sacrement est à l’autel non seulement comme viande pour nous saouler et nous resaouler, mais, qui plus est, pour nous déifier. »
Seigneur, murmura Durtal, en fermant le livre, Seigneur, si l’on se permettait maintenant d’user de comparaisons aussi matérielles, d’expressions aussi réalistes, pour parler de votre suradorable Corps, quelles clabauderies ce serait dans le clan des épiciers du Temple et dans le bataillon sacré des dévotes qui ont des prie-Dieu de luxe, des places réservées près de l’autel, ainsi qu’au théâtre près de la rampe, dans la maison de tous.
Et Durtal ruminait des réflexions qui l’assaillaient chaque fois qu’il regardait une feuille cléricale ou l’un de ces ouvrages précédés, ainsi que d’un permis de visiter, par l’approbation sanitaire d’un prélat.
Et sa surprise ne cessait point de cette ignorance inouïe, de cette haine instinctive de l’art, de cette appréhension des idées, de cette terreur des termes, si particulières aux catholiques.
Pourquoi ? Car enfin, il n’y avait pas de raisons pour que les croyants fussent plus ignares et plus bêtes que les autres ; ce devrait même être le contraire...
Cet état d’infériorité, à quoi tenait-il ? Et Durtal se répondait : au système d’éducation, aux cours de timidité intellectuelle, aux leçons de peur qu’on leur donne dans une cave, loin de la vie ambiante et loin du jour ; il semblait qu’il y eût, en effet, dessein d’évirer les âmes, en ne les nourrissant que de ratatouilles sans suc, que de viandes littéraires blanches, parti pris de détruire, chez les élèves, toute indépendance, toute initiative de l’esprit, en les comprimant, en les planant sous le même rouleau, en restreignant le cercle des pensées, en les laissant dans une ignorance volontaire de la littérature et de l’art.
Tout cela pour éviter les tentations du fruit défendu dont on évoquait l’image, sous le prétexte d’en inspirer la crainte. A ce jeu, la curiosité de cet inconnu dont il était toujours question en des phrases d’autant plus dangereuses qu’elles produisaient l’effet de gazes plus ou moins transparentes, en restant voilées, troublait les cervelles et éveillait les sens ; l’imagination ne pouvait que s’exacerber à ronger son désir de savoir et sa frayeur et elle était prête à se désordonner au moindre mot.
Dans ces conditions, l’oeuvre même la plus anodine devenait un péril par ce seul fait qu’il y était question d’amour et qu’on y dépeignait, sous un aspect avenant, une femme ; et dès lors tout s’expliquait, l’ignorance inhérente aux catholiques, car on la vantait comme le remède préventif des séductions ; la haine instinctive de l’art, car toute oeuvre écrite et observée devenait par cela même, pour ces âmes timorées, un véhicule de péchés, un excipient de fautes !
Vraiment, est-ce qu’il n’eût pas été plus habile, plus sage d’ouvrir les fenêtres, d’aérer les piècès, de traiter virilement ces âmes, de ne pas leur apprendre à trembler ainsi devant leur chair, de leur inculquer l’audace, la fermeté nécessaires pour résister ; car enfin, c’est un peu l’histoire du chien qui jappe après vous et qui vous saute aux chausses, si on feint de le redouter et de fuir et qui recule si l’on marche, décidé à le repousser, sur lui.
Toujours est-il que ces procédés de culture pieuse avaient abouti, d’une part, à l’emprise charnelle de la majeure partie des gens élevés de la sorte, et lancés après, dans la vie du monde, et de l’autre, à un épanouissement de sottise et d’effroi, à l’abandon des territoires de l’esprit, à la capitulation de toutes les forces catholiques se rendant, sans coup férir, à l’invasion de la littérature profane s’installant sur des positions qu’elle n’avait même pas eu la peine de conquérir !
C’était fou cela ! L’Église qui avait créé, qui avait allaité l’art pendant tant de siècles, elle avait été, de par la lâcheté de ses fils, reléguée dans un rancart ; tous les grands mouvements qui se succédèrent dans cet âge, le romantisme, le naturalisme, avaient été faits sans elle ou contre elle.
Il avait suffi qu’une oeuvre ne se contentât plus de raconter de simples historiettes ou d’aimables mensonges se terminant par des conclusions de vertu récompensée et de vice puni, pour qu’aussitôt la pudeur de la bedeaudaille se mit à braire !
Le jour où cette forme, si souple et si large, de l’art moderne, le roman, aborda les scènes de la vie réelle, dévida le jeu des passions, devint une étude de psychologie, une école d’analyse, ce fut le recul de l’armée des dévôts sur toute la ligne. Le parti catholique, qui paraissait mieux préparé que tout autre pour lutter sur ce terrain que la théologie avait longuement exploré, se replia en désordre, se bornant, pour assurer sa retraite, à faire canarder, avec les vieilles arquebuses à rouets de ses troupes, les oeuvres qu’il n’avait ni inspirées, ni conçues.
En retard de plusieurs ères, n’ayant pas suivi, à travers les siècles, l’évolution du style, il tourna au rustre qui sait à peine lire, n’entendit plus la moitié des vocables dont les écrivains se servaient, se mua, disons le mot, en un camp d’illettrés ; incapable de discerner le mauvais du bon, il engloba dans la même réprobation les ordures de la pornographie et les oeuvres de l’art ; bref, il finit par lâcher de telles gaffes, par débiter de si monstrueuses sottises, qu’il tomba dans le plus parfait discrédit et ne compta plus.
Il eût été si facile pourtant de travailler, de tâcher de rester au courant, de comprendre, de s’assurer si, dans un ouvrage, l’auteur chantait la chair, la célébrait, la louait, pour tout dire ; ou bien si, au contraire, il ne la montrait que pour la bafouer et la haïr ; il eût fallu se convaincre aussi qu’il existe un nu lubrique et un nu chaste, que, par conséquent, tous les tableaux où s’affirment des nudités ne sont pas à honnir. Il eût surtout fallu admettre qu’on devait exhiber les vices et les décrire pour en susciter le dégoût et en suggérer l’horreur.
Car enfin, ce fut là la grande théorie du moyen âge, la méthode de la théologie sculpturale, la dogmatique littéraire des moines de ce temps ; et c’est là la raison d’être de ces statues, de ces groupes qui alarment encore la scandaleuse pudeur de nos momiers. Elles abondent ces scènes inconvenantes, ces images choisies des stupres, à Saint-Benoît-sur-Loire, à la cathédrale de Reims, au Mans, dans la crypte de Bourges, partout où se dressent des églises ; et celles où nous n’en voyons pas sont celles qui n’en ont plus, car le bégueulisme, qui sévit plus spécialement dans les époques impures, les a brisées à coups de pierres, détruites au nom d’une morale opposée à celle qu’enseignaient les saints, au moyen âge !
Ces tableaux ont fait, depuis bien des années, la joie des libres-penseurs et le désespoir des catholiques ; les uns y distinguant une satire des moeurs des évêques et des moines, les autres déplorant que de pareilles turpitudes souillassent les parois du temple. L’explication de ces scènes était facile à proclamer pourtant ; loin de chercher à excuser la tolérance de l’Église qui les voulut, l’on devait admirer l’ampleur de son esprit et sa franchise. En agissant ainsi, elle témoignait de sa résolution d’aguerrir ses enfants, en leur présentant le ridicule et l’odieux des vices qui les assiègent ; c’était, pour parler le langage des classes, la démonstration au tableau et aussi une invite à l’examen de conscience, avant de pénétrer dans le sanctuaire que précédait, ainsi que d’un mémento de confession, l’énuméré des fautes.
Ce plan rentrait dans son système d’éducation, car elle entendait façonner des âmes viriles, et non des âmelettes comme en modèlent les orthopédistes spirituels de notre temps ; elle désignait et fouaillait le vice où qu’il se trouvât, n’hésitait pas à promulguer l’égalité des hommes devant Dieu, exigeait que les évêques, que les moines qui défaillaient fussent exposés ainsi que sur un pilori, dans ses porches ; elle les étalait même de préférence aux autres, pour donner l’exemple.
Ces scènes, elles étaient, en somme, une glose du Vle commandement de Dieu, une paraphrase sculptée du catéchisme ; elles étaient les griefs de l’Église et ses leçons, mis bien en évidence, à la portée de tous.
Et ces recommandations et ces reproches, notre Mère ne se borna point à les exprimer dans un seul idiome ; elle emprunta, pour les répéter, la voix des autres arts ; et forcément ce fut la littérature et la chaire qui lui servirent de truchements pour vitupérer les masses.
Et elles ne furent ni moins braves, ni plus prudes que la statuaire ! Il n’y a qu’à ouvrir les oeuvres saintes, à commencer par les livres inspirés, par la Bible que l’on n’ose plus lire qu’en des traductions françaises affaiblies, car quel prêtre se hasarderait à recommander, aux esprits débilités de ses ouailles, la lecture du XVIe chapitre d’Ézéchiel ou du Cantique des Cantiques, cet épithalame de Jésus et de l’âme ! — jusqu’aux Pères, jusqu’aux Docteurs, pour s’assurer de la violence des mots dont l’Église usait pour lacérer le péché de chair.
Comme ils réprouveraient, nos modernes pharisiens, l’intransigeance de saint Grégoire le Grand criant : « Dites la vérité, mieux vaut le scandale que le mensonge » ; la carrure de saint Épiphane discutant la Gnose et dépeignant par le menu les abominations de cette secte, discourant tranquillement devant ses auditeurs :
« Pourquoi craindrais-je d’énoncer ce que vous ne craignez pas de faire ? en parlant ainsi, je veux inspirer l’horreur des turpitudes que vous commettez. »
Que penseraient-ils de saint Bernard, appuyant, dans sa IIIe Méditation, sur d’affreux détails de physiologie pour démontrer l’inanité de nos ambitions corporelles et l’ignominie de nos joies ? de sainte Hildegarde dissertant, avec quelle placidité ! sur les épisodes variés de la luxure ; de saint Vincent Ferrier traitant librement dans ses serinons du vice d’Onan et du péché de Sodome, employant des termes matériels, comparant la confession à une médecine, déclarant que le prêtre doit inspecter les urines de l’âme et la purger ? quelle réprobation soulèverait cet admirable passage d’Odon de Cluny, cité par Remy de Gourmont, dans son Latin mystique, le passage où ce terrible moine prend les appas de la femme, les retourne, les dépiaute, les rejette, tels qu’un lapin vidé sur l’étal ; — et cet autre de Clément d’Alexandrie qui résume toute la question en deux phrases :
« Je nomme sans honte ces parties du corps où se forme et se nourrit le foetus ; comment, en effet, aurais-je honte de les nommer puisque Dieu n’a pas eu honte de les créer ? »
Aucun des grands écrivains de l’Église ne fut bégueule. Cette pruderie qui nous abêtit depuis si longtemps, elle, remonte justement aux âges impies, à cette époque de paganisme, à ce retour de classicisme avarié que fut la Renaissance ; et ce qu’elle s’est développée depuis ! Elle eut son grand terrain de culture dans les pompeuses et les lubriques années du soi-disant grand siècle ; le virus janséniste, le vieux suint protestant s’infiltra dans le sang des catholiques et ils l’ont encore !
— Eh bien, vrai ! ils sont jolis les résultats de cette syphilis de la décence, — et Durtal éclata de rire, en songeant à la cathédrale de Chartres.
Ici, il sied de tirer l’échelle, se dit-il, car le summum de l’imbécillité pieuse est atteint. Parmi les sculptures qui cernent le pourtour du choeur de cette basilique, figure le groupe de la Circoncision, saint Joseph tenant le bambin, tandis que la Vierge prépare un linge et que le grand prêtre s’approche pour opérer l’enfant.
Et il s’est trouvé un sacriste effaré, un sacerdote épimane, pour juger cette scène libertine et coller un morceau de papier sur le ventre de Jésus !
L’impudeur de Dieu, l’obscénité de l’enfant à peine né, c’est un comble !
Fichtre, reprit-il, avec toutes ces réflexions, le temps passe et l’abbé m’attend. Il descendit quatre à quatre les escaliers, fila vers la cathédrale devant le portail Nord de laquelle l’abbé Plomb se promenait, de long en large, en récitant son bréviaire.
— Le côté des pécheurs et des démons est celui de la Vierge qui sauve les uns et écrase les autres, dit l’abbé. Les porches septentrionaux sont généralement les plus mouvementés des basiliques ; pourtant, ici, les scènes sataniques sont au sud et encore parce qu’elles font partie du Jugement dernier sculpté sur la baie du Midi ; sans quoi Chartres n’aurait point, ainsi que ses soeurs, de tableaux de ce genre.
— Alors le treizième siècle avait pour principe de loger la Madone au nord ?
— Oui, pour les hommes de ce temps, le septentrion représentait la tristesse des hivers, la mélancolie des ténèbres, la misère du froid ; l’hymne glacé des vents était pour eux le souffle même du mal ; le nord, c’était la zone du Diable, l’enfer de la nature, tandis que le sud en était l’Éden.
— Mais c’est absurde ! s’écria Durtal ; c’est la plus grave erreur que la symbolique des éléments ait commise ! Le moyen âge s’est trompé, car les neiges sont pures et les frimas sont chastes ! c’est le soleil, au contraire, qui est l’agent le plus actif pour développer le germe des pourritures, le ferment des vices !
Ils ont donc oublié que le 3e psaume des complies cite le démon de l’heure chaude, de midi, tel que le plus harcelant et le plus dangereux de tous ; ils ont donc perdu de vue l’horreur des suées et des moiteurs fauves, le péril des amollissements nerveux, le risque des vêtements entr’ouverts, toute l’abomination des nuages en tôle et des ciels bleus !
Les effluves diaboliques sont dans l’orage et les temps où l'air vente des trombes de calorifère, suscitent des ruts, mettent l’essaim hurlant des mauvais anges en branle.
— Rappelez-vous les textes d’Isaïe et de Jérémie qui assignent pour demeures à Lucifer les rafales de l’aquilon, puis songez que les grandes cathédrales ne sont pas nées dans le sud, mais bien dans le centre et le nord de la France ; par conséquent, après avoir adopté la symbolique des saisons et des climatures, les architectes religieux firent le rêve des gens bloqués dans les neiges qui aspirent après un rayon de soleil et un jour gai ; forcément, ils crurent que le levant était une succursale du vieux paradis et regardèrent ces contrées comme plus douces, comme plus clémentes que les leurs.
— N’empêche que cette théorie est contredite par Notre-Seigneur même.
— Où avez-vous vu cela ? s’écria l’abbé Plomb.
— Sur le Calvaire ; Jésus mourant tournait le dos au midi qui le crucifiait et il étendait ses bras sur la croix pour bénir, pour embrasser le nord. Il semblait retirer à l’Orient ses grâces pour les transmettre à l’Occident. Si donc il y a des régions maudites et habitées par Satan, c’est le midi et non le nord !
— Vous exécrez les pays du sud et ses populations, cela se sent, dit, en riant, l’abbé.
— Je ne les aime guère. Leurs paysages encanaillés par une lumière crue et leurs arbres poudreux se découpant sur un fond de bleu à laver le linge ne m’attirent pas ; quant à leurs indigènes bruyants et velus qui ont, lorsqu’ils se rasent, une rampe d’azur sous les narines, je les fuis...
— Enfin, nous sommes en présence d’un fait accompli, auquel toutes les discussions ne changeront rien. Cette façade est vouée à la Vierge ; voulez-vous que nous l’étudions dans son ensemble, puis dans ses détails ?
Ce porche qui s’avance, tel qu’un perron couvert, tel qu’une sorte de véranda devant les portes, est une allégorie du Sauveur désignant l’entrée de la Jérusalem céleste ; il a été commencé vers 1215, sous Philippe Auguste, et fini en 1275, sous Philippe le Hardi ; sa construction a donc duré près de soixante ans et s’est poursuivie pendant la majeure partie du treizième siècle. Il se divise en trois fractions correspondant aux trois portes qu’il abrite ; il renferme près de 700 statues et statuettes appartenant, pour la plupart, aux personnages de l’Ancien Testament.
Il se creuse en trois gorges profondes ou trois baies.
La baie centrale devant laquelle nous sommes, et qui mène à l’huis du milieu, a pour sujet : la Glorification de Notre-Dame.
La baie latérale de gauche est consacrée à la vie et aux vertus de la Vierge.
La baie latérale de droite aux figures mêmes de Marie.
D’après une autre exégèse imaginée par le chanoine Davin, ce portail, bâti à l’époque où saint Dominique inaugura le rosaire, serait la reproduction illustrée de ses mystères.
Dans ce système, le porche de gauche qui contient les scènes de l’Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, répondrait aux mystères joyeux ; — le porche central, qui nous montre l’Assomption et le couronnement de la Vierge, aux mystères glorieux ; — le porche de droite qui encadre un relief de Job, héraut du Crucifié dans l’antique Loi, aux mystères douloureux.
— Il y a encore une troisième interprétation, mais celle-là est absurde, fit Durtal ; celle de Didron qui considère cette façade ainsi que la première page du livre de Chartres. Il l’ouvre sur ce portail et constate que les sculpteurs commencent la traduction de l’Encyclopédie de Vincent de Beauvais, en narrant la création du monde ; mais où se cachent-ils donc, ces fameux simulacres de la Genèse ?
— Là, dit l’abbé, en avisant un cordon de statuettes perdues sur le bord, dans la dentelle même du porche.
— Attribuer une telle importance à d’infimes figurines qui ne sont, au demeurant, que des remplissages et des bouche-trous, c’est insensé !
— Certes ! mais abordons maintenant le portail.
Vous remarquerez avant tout, que, contrairement au rituel suivi par la plupart des basiliques de ce temps, par celles d’Amiens, de Reims, de Paris, pour en nommer trois, ce n’est pas la Vierge qui se dresse sur le pilier entre les deux vantaux de la porte, mais bien sainte Anne, sa mère, et il en est de même dans les verrières, à l’intérieur de l’église, où sainte Anne, en négresse, la tête enveloppée d’un foulard bleu, presse dans ses bras Marie, tannée telle qu’une moricaude.
— Pourquoi ?
— Sans doute parce que cette cathédrale fut gratifiée par l’empereur Beaudouin, après le sac de Constantinople, du chef de cette sainte.
Ces dix statues colossales, placées à chacun de ses côtés dans les ébrasements de l’entrée, vous les connaissez, car elles accompagnent notre Mère dans tous les sanctuaires du treizième siècle, à Paris, à Amiens, à Rouen, à Reims, à Bourges, à Sens. Les cinq, rangées à gauche, tiennent une image figurative du Fils ; les cinq, disposées à droite, une effigie de Notre-Seigneur même.
Ce sont, cantonnés dans l’ordre chronologique, les personnages qui ont prototypé le Messie, ou prophétisé sa Naissance, sa Mort, sa Résurrection, son Sacerdoce éternel.
A gauche : Melchissédech, Abraham, Moïse, Samuel et David.
Adroite : Isaïe, Jérémie, Siméon, saint Jean-Baptiste et saint Pierre.
— Mais, observa Durtal, pourquoi le fils de Jona est-il au milieu de l’Ancien Testament ? sa place n’est pas là, mais dans les Évangiles.
— Oui, mais considérez que saint Pierre avoisine dans ce portail saint Jean-Baptiste, que les deux statues sont côte à côte et se touchent. Dès lors, ne percevez-vous pas le sens que ce rapprochement indique ? l’un a été le précurseur et l’autre le successeur ; le premier anticipe et le second parachève la mission du Christ. Il était naturel qu’on les reliât, qu’on les réunit et que le prince des Apôtres apparût comme une conclusion aux prémisses posées sur les autres hôtes du porche.
Enfin, pour parfaire la série des Patriarches et des Prophètes, vous pouvez voir là, dans les angles rentrants des pilastres, deux statues placées en pendant, de chaque côté de la porte, Elie de Thesbé et Élysée, son disciple.
Le premier diagnostique l’Ascension du Rédempteur par son enlèvement, en plein ciel, sur un char de feu ; le second, Jésus ressuscitant et sauvant l’humanité en la personne du fils de la Sunamite.
— Il n’y a pas à dire, murmura Durtal qui réfléchissait : les textes messianiques sont confondants. Toute l’argumentation des rabbins, des protestants, des libres-penseurs, toutes les recherches des ingénieurs de l’Allemagne pour trouver une fissure et saper le vieux roc de l’Église sont demeurées vaines. Il y a là une telle évidence, une telle certitude, une telle démonstration de la vérité, un si indestructible bloc, qu’il faut vraiment être atteint d’amaurose spirituelle pour oser le nier.
— Oui, et pour qu’il n’y ait pas d’erreur, pour qu’il ne soit pas possible d’alléguer que les textes inspirés sont postérieurs à la venue du Messie qu’ils annoncent, pour prouver qu’ils n’ont été, ni inventés, ni retouchés après coup, Dieu a voulu qu’ils fussent traduits en grec, dans la version des Septante, répandus, connus dans le monde entier plus de deux cent cinquante années avant la naissance du Christ !
— En supposant, par impossible, que les Évangiles disparaissent, l’on pourrait, n’est-ce pas, les reconstituer, narrer en abrégé l’existence du Sauveur qu’ils racontent, rien qu’en consultant les révélations messianiques des Prophéties ?
— Sans aucun doute, car enfin, on ne saurait trop le répéter, l’Ancien Testament est l’histoire avant la lettre du Fils de l’homme, et de l’établissement de son Église ; ainsi que l’atteste saint Augustin, « toute l’administration du peuple juif fut une prophétie continuelle du Roi qu’il attendait ».
Tenez, en dehors des effigies annonciatrices du Rédempteur que vous découvrez à chaque pas dans la Bible, Isaac, Joseph, Moïse, David, Jonas, pour enciter, au hasard, cinq ; en dehors aussi des animaux ou des choses chargés de le personnifier, dans l’ancienne Loi, tels que l’agneau pascal, la manne, le serpent d’airain, etc., etc., nous allons, si vous le voulez, en recourant seulement aux Prophètes, tracer la vie de l’Emmanuel, en ses grandes lignes, condenser, en quelques mots, les Évangiles. Écoutez :
Et l’abbé se recueillit, la main sur les yeux :
— Sa naissance d’une Vierge, elle est pronostiquée par Isaïe, Jérémie, par Ézéchiel ; — son arrivée que devait précéder un envoyé spécial, saint Jean, elle est notée par Malachie qu’Isaïe complète, ajoutant, pour plus de précision, que la voix de l’annonciateur retentira dans le désert.
Le lieu de sa nativité, Bethléem, nous est fourni par Michée ; l’adoration des Mages offrant l’or, la myrrhe et l’encens, elle est marquée par Isaïe et par le psaume dit de Salomon.
Sa jeunesse et son apostolat sont clairement indiqués par Ézéchiel qui le montre cherchant les brebis perdues, par Isaïe qui relate d’avance les miracles qu’il opère sur les aveugles, sur les sourds et les muets, qui déclare finalement qu’il sera un sujet de scandale pour les juifs.
Mais c’est surtout lorsqu’ils abordent sa Passion et sa mort, que les oracles deviennent d’une netteté toute mathématique, d’une clarté inouïe. L’ovation du jour des Palmes, la trahison de Judas et le prix des 30 pièces d’argent sont signalés par Zacharie ; et Isaïe prend à son tour la parole et décrit les opprobres, les hontes du Calvaire. Entendez-le : Il a été couvert de plaies pour nos iniquités et il a été brisé pour nos crimes... Dieu l’a chargé de toutes nos fautes et il l’a frappé à cause des crimes de son peuple... il est devenu le dernier des hommes, un homme de douleurs et tout défiguré... il a été conduit à l’occision, comme un agneau, comme une brebis qui est muette devant celui qui la tond...
Et David renchérit sur l’affreuse scène « Il est plus semblable à un ver qu’à un homme, l’opprobre des hommes et le rebut du peuple... »
Puis, les détails se multiplient. Voilà que les plaies des mains surgissent dans Zacharie ; que David énumère, mot à mot, les épisodes de la Passion, les mains et les pieds percés, le partage des habits, la robe tirée au sort. Les huées des juifs l’invitant à se sauver Lui-mème, s’il est le Fils de Dieu, sont spécifiées dans le chapitre II du livre de la Sagesse et dans l’oeuvre de David ; le fiel, le vinaigre présentés sur la croix, le cri même de Jésus rendant l’âme sont consignés dans les psaumes.
Et là ne s’arrête pas l’ensemble des révélations consenties par le Vieux Livre.
La mission prophétique est menée jusqu’au bout ; l’établissement de l’Église substituée à la Synagogue est également prédit par Ézéchiel, Isaïe, Joël, Michée, et la messe, le sacrifice eucharistique formellement auguré par Malachie avérant que « les sacrifices de l’Ancienne Loi, offerts jusqu’alors dans le seul temple de Jérusalem, seront remplacés par une oblation toute pure que l’on offrira en tous lieux et chez tous les peuples », — par des prêtres choisis dans toutes les nations, continue Isaïe, — selon l’ordre de Melchissédech, achève David.
Pascal l’a justement affirmé, « l’accomplissement de toutes les prophéties est un miracle perpétuel et il ne faut pas d’autres preuves pour reconnaître la divinité de la religion chrétienne ».
Durtal s’était approché des statues entourant sainte Anne et il regardait la première de gauche, coiffée d’un bonnet pointu, d’une sorte de tiare papale dont le bas formait couronne, vêtue d’une aube, ceinte, à la taille, d’une cordelette à noeuds et d’un pluvial à franges ; la face était grave, presque soucieuse et l’oeil se fixait, absorbé au loin. Ce personnage tenait d’une main un encensoir et, de l’autre, un calice couvert d’une patène sur laquelle posait un pain ; et ce portrait du roi de Salem, Melchissédech, suscitait de longues rêveries.
Il est, en effet, un des types les plus mystérieux des Livres Saints, ce monarque qui apparaît dans la Genèse, Prêtre du Très-Haut, consomme le sacrifice du pain et du vin, bénit Abraham, reçoit de lui la d’âme et s’évanouit aussitôt après dans les ténèbres de l’histoire. Puis subitement, son nom retentit dans un psaume de David, déclarant que le Messie est prêtre selon l’ordre de Melchissédech et il s’enfuit de nouveau sans laisser de traces.
Et le voilà qui tout à coup jaillit dans le Nouveau Testament et les renseignements que décèle sur lui saint Paul, en son Épitre aux Hébreux, le rendent plus énigmatique encore. Il le dit sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, étant ainsi l’image du Fils de Dieu qui demeure pontife pour toujours. Saint Paul insiste pour faire comprendre sa grandeur... et la vague lumière qu’il projetait sur cette ombre s’éteint.
— Avouez qu’il est inouï, ce roi de Salem ; qu’est-ce que les commentateurs en pensent ? demanda Durtal.
— Peu de chose. Saint Jérôme observe cependant qu’en employant ces termes : sans parents, sans aïeux, sans commencement et sans fin, saint Paul n’a pas entendu énoncer que Melchissédech fût descendu du ciel ou créé directement comme le premier homme par l’Ancien des jours. Sa phrase signifie simplement qu’il est introduit dans le récit sur Abraham sans que l’on sache d’où il vient, qui il est, en quel temps il est né, à quelle époque il est mort.
Au fond, l’incompréhensible rôle que joue cette préfigure de Jésus dans les pages du Canon a suggéré les légendes et les hérésies les plus baroques.
Les uns ont soutenu qu’il était Sem, fils de Noé, les autres qu’il était Cham. Pour Simon Logothète, Melchissédech est un Égyptien ; pour Suidas, il appartient à la race maudite de Chanaan et c’est à cause de cette origine que la Bible se tait sur ces ancêtres.
Les gnostiques l’on révéré tel qu’un Éon supérieur à Jésus et au troisième siècle, Théodore le Changeur prétendait, lui aussi, qu’il n’était pas un homme, mais une Vertu céleste surpassant le Christ, parce que le sacerdoce de Celui-ci n’était qu’une copie du sien.
Suivant une autre secte, il n’était ni plus, ni moins, que le Paraclet ; mais, voyons ; à défaut des Écritures, que révèle la voyance ? La soeur Emmerich en a-t-elle parlé ?
— Elle ne nous apprend rien de net, répondit Durtal. Pour elle, il était une sorte d’ange sacerdotal, chargé de préparer le grand oeuvre de la Rédemption.
— C’est un peu l’avis d’Origène et de Didyme qui lui ont, eux aussi, attribué la nature angélique.
— Puis elle l’aperçoit, bien avant l’arrivée d’Abraham, sur différents points déserts de la Palestine ; il ouvre les sources du Jourdain et elle divulgue, dans un autre passage de la vie du Christ, qu’il aurait enseigné aux Hébreux la culture du froment et de la vigne ; bref, elle ne débrouille pas cette indéchifrable énigme.
Si nous nous plaçons maintenant au point de vue de l’art, Melchissédech est une des bonnes statues de ce porche, poursuivit Durtal ; mais quel masque bizarre a son voisin, Abraham, avec ce visage vu de trois quarts, ces cheveux en herbes couchées, cette barbe fluviale, ce nez allongé qui ne fait qu’un avec le front, descend sans point de suture entre les yeux et simule le mufle d’un tapir, ces joues où pousse une fluxion, cet air, comment dirai-je ? de vague prestidigitateur qui paraît escamoter la tête perdue de son fils.
— La vérité, c’est qu’il écoute l’ordre d’un ange que nous ne distinguons point ; — remarquez en dessous, sur le socle, le bélier dans un buisson et le symbole s’accuse :
Il est le Père céleste qui livre son Fils et Isaac qui porte le bois pour allumer son bûcher, comme Jésus porta sa croix, est l’image de ce Fils ; le bélier même, qui va être sacrifié, devient à son tour un modèle du Sauveur, et le buisson dans lequel s’enchevêtrent ses cornes est le calque de la couronne d’épines. Mais il eût fallu, pour exprimer de ce sujet tout le suc exemplaire qu’il contient, mettre dans un coin du support les deux femmes du Patriarche, Agar et Sara, et son autre enfant Ismaël.
Car, vous le savez, ces deux femmes sont l’emblème, Agar de l’Ancien Testament et Sara du Neuf ; la première disparaît pour céder la place à la seconde, la Vieille Loi n’étant que la préparation de la Nouvelle ; et les deux garçons issus chacun de l’une de ces deux femmes sont par analogie les enfants des deux Livres et manifestent par conséquent l’un, Ismaël les Israélites, et l’autre, Isaac, les chrétiens.
Après Abraham, le père des croyants, voici Moîse qui allégorise le Christ, car la délivrance d’Israël est le prodrome de l’humanité arrachée par le Sauveur au démon, de même que le passage de la mer Rouge est la promesse du baptême. Il tient la table de la Loi et la colonne sur laquelle s’enroule le serpent d’airain ; puis Samuel, type multiple de Notre-Seigneur, fondateur du sacerdoce royal et de la royauté sacerdotale, enfin, David présentant la lance et le diadème du Calvaire. Inutile de vous remémorer que, plus que tout autre, ce roi-prophète a présagé les tribulations du Messie et qu’il eut, pour plus de ressemblance avec lui, son Judas, en la personne d’Architophel qui, semblable à l’autre traître, s’est pendu.
— Avouez, dit Durtal, que ces statues devant lesquelles les historiographes de la cathédrale se pâment et qu’ils assurent en choeur être le chef-d’oeuvre de la statuaire au treizième siècle, sont singulièrement inférieures aux statues du douzième qui parent le porche Royal. Comme la descente dans l’étiage divin est sensible ! Sans doute, les mouvements sont plus souples et le jeu des vêtures s’est élargi ; les côtes de rhubarbe des étoffes se sont espacées et elles fléchissent ; mais où est la grâce de l’âme sculptée du grand portail ? toutes ces statues-ci, avec leurs caboches énormes, sont mastoques et muettes, sans vie qui pénètre ; ce sont de pieuses oeuvres, belles si vous voulez, mais sans au delà ; c’est de l’art, mais ce n’est déjà plus de la mystique. Voyez sainte Anne, avec son air morose, ses traits désagréables ou souffrants, est-elle assez loin de la fausse Radegonde ou de la fausse Berthe !
A l’exception de deux, de celle de saint Jean et de celle de Joseph situées là-bas, au bout de la baie, les autres, nous les connaissons. Elles sont également à Amiens et à Reims ; et rappelez-vous le Siméon, la Vierge, la sainte Anne de Reims ! la Vierge, d’un charme si ingénu, si chastement exquis, tendant l’enfant à Siméon doux et pensif, dans sa tenue solennelle de grand prêtre ; sainte Anne, dont le genre de figure est le même que celui de saint Joseph et de l’un des deux anges qui avoisinent, sur ce même portail Royal, le saint Nicaise au crâne tranché à la hauteur du front ; sainte Anne avec sa physionomie riante et fûtée et pourtant vieillote, sa tête à petit menton pointu, à grands yeux, à nez effilé, s’allongeant en cornet, son visage de jeune duègne, maligne et aimable. Au reste, les imagiers excellèrent dans ces créations de mines indécises, étranges. Vous souvenez-vous de Notre-Dame de Paris qui leur est postérieure d’un siècle, je crois ? Elle est à peine jolie, mais si bizarre avec son sourire joyeux éclos sur de mélancoliques lèvres ! Aperçue d’un certain côté, Elle sourit à Jésus, attentive, presque railleuse. Il semble qu’Elle attende un mot drôle de l’Enfant pour se décider à rire ; Elle est une nouvelle mère pas encore habituée aux premières caresses de son fils. Regardée d’un autre point, sous un autre angle, ce sourire, si prêt à s’épanouir, s’efface. La bouche se contracte en une apparence de moue et prédit des pleurs. Peut-être qu’en parvenant à empreindre en même temps sur la face de Notre-Dame ces deux sentiments opposés, la quiétude et la crainte, le sculpteur a voulu lui faire traduire à la fois l’allégresse de la Nativité et la douleur prévue du Calvaire. Il aurait alors portraituré, en une seule image, la Mère des Douleurs et la Mère des Joies, devancé, sans le savoir, les Vierges de la Salette et de Lourdes.
Mais tout cela ne vaut point l’art si vivant et si altier, si personnel et si mystérieux du douzième siècle, l’art du portail Royal de Chartres !
— Ce n’est pas moi qui vous contredirai, fit l’abbé Plomb. Maintenant que nous avons examiné la série figurative installée à la gauche de sainte Anne, voyons la série prophétique logée à sa droite.
D’abord, Isaïe posant sur un socle formé par un Jessé qui dort ; et la fameuse tige prend racine, file entre les pieds du prophète et les branches des ancêtres de la Vierge, selon la chair et l’esprit, montent, remplissent, en se déroulant, les quatre cordons de la voussure du centre. A côté de lui, Jérémie qui, songeant à la Passion du Christ, écrivit cette lamentable plainte qu’on récite dans la cinquième leçon, au deuxième nocturne du samedi saint : « O vous qui passez par le chemin, considérez et voyez s’il est une douleur pareille à la mienne » ; puis Siméon caressant l’enfant Jésus dont il a pressenti, en même temps que la douleur de la Vierge, les souffrances du Golgotha ; saint Jean-Baptiste ; enfin saint Pierre dont le costume est intéressant à scruter, car il est copié sur celui des Papes du treizième siècle.
Avec quel soin ces accessoires sont ciselés ! louez le rendu de ces sandales, de ces gants, de l’amict paré, de l’aube, du manipule, de la dalmatique, de ce pallium signé de six croix, de ce trirègne, de cette tiare conique, en soie brochée d’or, du rational ; tout y est repoussé, guilloché, comme par un orfèvre.
— Sans doute, mais ce que le saint Jean s’atteste supérieur à ses congénères sur cette façade ! Quelle maîtrise se révèle dans cette face creuse, émaciée, aussi expressive que les autres sont mornes. Lui, sort du convenu et de la redite. Il se dresse, doux et farouche, avec sa barbe en dents de fourchette tordues, son maigre corps, son vêtement en poils de chameaux ; et on l’entend, il parle, alors qu’il montre l’agneau soutenant une croix hastée, enfermé dans un nimbe qu’il serre contre sa poitrine, de ses deux mains ; cette statue-là est superbe, et elle n’est pas, à coup sûr, du sculpteur qui nous tailla l’Abraham, voire même son voisin de piédestal, Samuel. Celui-ci a l’air d’offrir, à un David indifférent, l’agneau qu’il manie, la tête en bas ; il est un boucher qui fait l’article, soupèse sa marchandise, invite à la tâter, hésite avant de la céder au meilleur prix. Quelle différence avec le saint Jean !
— Le tympan de la porte ne nous séduira guère, reprit l’abbé. La mort de Marie, son Assomption, son Couronnement, sont plus curieux à lire dans la Légende dorée que dans ces bas-reliefs qui n’en sont qu’une traduction abrégée.
Allons à la baie latérale de gauche.
Celle-là est mutilée, dans un déplorable état, toute en ruine. La plupart des grandes pièces ont disparu. Il y avait, paraît-il, ainsi qu’à Paris, sur le portail Royal, et à Reims, sur le portail du Sud, les figures de l’Église et de la Synagogue ; puis Lia et Rachel, la Vie active et la Vie contemplative, dont nous lirons les épisodes notés dans la voussure.
Parmi les personnages qui restent, ces trois, la Vierge, sainte Élisabeth et Daniel, sont considérés tels que des chefs-d’oeuvre.
— C’est beaucoup dire, s’écria Durtal ; ils sont maussades, drapés d’une façon froide ; l’agencement de leurs robes est celui des peplums grecs ; ils ont déjà un vague fumet de Renaissance.
— Si vous voulez, mais ce qui est surtout prenant, ce sont les idées exprimées par les filets en arc tiers-point de la baie. Quant au tympan même qui arbore la naissance de Jésus, le réveil des bergers de Bethléem, le songe et l’adoration des Mages, il est détrité et rongé par le temps ; il n’est pas d’ailleurs d’un art qui nous angoisse !
Mais suivez bien les ogives des voussures, ces quatre cordons d’images qui les dessinent. D’abord là, sur le premier, une haie de dix anges céroféraires ; puis sur le deuxième, la parabole des Vierges sages et des Vierges folles ; sur le troisième, la traduction de la Psychomachie ou le combat des vertus et des vices ; sur le quatrième, douze reines incorporant les douze fruits de l’Esprit ; maintenant arrêtons-nous devant la nervure qui borde la voûte même du porche et admirez les adorables statuettes qui nous décrivent les occupations de la Vie contemplative et de la Vie active.
A gauche, la Vie active, conçue sous les traits de la femme forte du dernier chapitre des Proverbes. Elle lave la laine dans une cuve, — la peigne, — tille le lin dont elle brise les tiges, — le ratisse, — le file en quenouille, — le met en écheveau.
A droite, la Vie contemplative : une femme prie, tenant un livre clos, — elle l’ouvre, — le lit, — le ferme et médite, — enseigne, — entre en extase.
Enfin, ici, dans cette dernière moulure, qui longe extérieurement l’arcade du porche, et qui est la plus rapprochée de nous, la plus visible, quatorze statues de reines, appuyées sur des boucliers armoriés et portant autrefois des étendards. On a longtemps discuté sur le sens de ces figurines, surtout sur la seconde, à gauche, qui est désignée par cette inscription, gravée dans la pierre, Libertas. Didron y a vu les Vertus domestiques et les Vertus civiles ou sociales, mais la question a été définitivement tranchée par la symboliste la plus érudite et la plus perspicace de notre temps, par Mme Félicie d’Ayzac, qui, dans une très nutritive brochure, parue en 1843, sur ces statues et sur les animaux du Tétramorphe, a péremptoirement démontré que ces souveraines ne sont autres que les quatorze Béatitudes célestes, telles que les a décrites saint Anselme : la Beauté, la Liberté, l’Honneur, la joie, la Volupté, l’Agilité, la Force, la Concorde, l’Amitié, la Longévité, la Puissance, la Santé, la Sécurité, la Sagesse.
En somme, cette baie, hérissée de sculptures, n’est elle pas une des plus ingénieuses, des plus intéressantes qui soient, au point de vue de la théologie et de la mystique ?
— Et aussi au point de vue de l’art ; vous avez absolument raison, ces femmes qui travaillent et méditent sont si délicates et si vivantes qu’on déplore qu’elles soient ainsi enfouies dans l’ombre d’une grotte. Quels artistes que ceux qui oeuvrèrent, de la sorte, pour la gloire de Dieu et pour eux-mêmes, qui créèrent des merveilles tout en sachant que personne ne les verrait !
— Et ils n’avaient point la vanité de la signature ; ils gardaient l’anonyme !
— Ah ! c’étaient d’autres hommes que nous... des âmes autrement fières et autrement humbles.
— Et autrement saintes aussi, ajouta l’abbé. Voulez-vous que nous abordions l’iconographie de la baie de droite ; celle-là est moins endommagée et l’on peut la parcourir en quelques mots.
Cette caverne aux pans sculptés, elle est, vous le savez, consacrée aux figures de Marie, mais nous pourrions peut-être plus justement dire qu’elle est dédiée aux antécesseurs de Jésus, car dans cette baie, ainsi que dans les deux autres, du reste, les imagiers du treizième siècle ont pris à tâche d’identifier le Fils avec la Mère.
— Le fait est que la plupart des personnages qui défilèrent devant nous relatent surtout le Christ. Quels sont alors les types qui se rapportent plus spécialement à la fille de Joachim, dans l’Ancienne Loi, et qui ont été transposés en caractères de pierre sur cette page ?
— Les allégories de la Vierge dans les Écritures sont innombrables ; des ouvrages entiers, tels que le Cantique des Cantiques et le livre de la Sagesse font allusion, à chaque phrase, à sa beauté et à sa sapience. Les symboles inhumains qui s’adaptent à sa Personne, vous les connaissez : l’arche de Noé dans laquelle s’interne le Sauveur ; l’arc-en-ciel, signe d’union entre le Seigneur et la terre ; le buisson ardent d’où sortit le nom de Dieu ; le nuage lumineux guidant le peuple dans le désert ; la verge d’Aaron qui, seule, fleurit parmi celles des douze tribus que recueille Moïse ; l’arche d’alliance ; la toison de Gédéon ; puis toute la série, plus divulguée encore, s’il se peut : la tour de David, le trône de Salomon, le jardin fermé et la fontaine scellée du Cantique ; l’horloge d’Achaz, la nue salvatrice d’Élie, la porte d’Ézéchiel — et je ne vous cite que les interprétations certifiées par le seing des Docteurs et des Pères.
Quant aux êtres animés qui la précédèrent ici-bas, pour l’annoncer, ils abondent ; tenez, au reste, que la plupart des femmes renommées de la Bible ne sont que l’ombre antécédée de ses grâces : Sara, à laquelle un Ange prédit la naissance d’un fils qui est lui-même un référend du Fils ; Marie, soeur de Moîse, qui libère, en sauvant son frère des eaux, les juifs ; la fille de Jephté, la prophétesse Débora ; Jahel qui fut appelée comme la Vierge « bénie entre toutes les femmes » ; Anne, mère de Samuel, dont le chant de gloire semble une première version du Magnificat ; Josabeth qui a soustrait Joas à la fureur d’Athalie, comme plus tard la Vierge a dérobé l’enfant Jésus au courroux d’Hérode ; Ruth, qui incarne à la fois la vie contemplative et la vie active ; Rebecca, Rachel, Abigaïl, la mère de Salomon, la mère des Macchabées qui assiste au supplice de ses fils ; puis encore celles de ces figures qui sont alors inscrites sous ces arcades, Judith et Esther, dont l’une est synonyme de la chasteté courageuse et l’autre de la miséricorde et de la justice.
Mais, pour ne pas nous embrouiller, suivons l’ordre des statues nichées sur les parois de la porte ; nous en comptons de chaque côté trois :
A gauche Balaam, la reine de Saba et Salomon.
A droite Jésus, fils de Sirach, Judith ou Esther, et Joseph.
— Balaam, c’est ce bon paysan, aimable et confit, qui rit dans sa barbe, un bâton à la main et est coiffé d’un couvercle de tourte, et la reine de Saba, cette femme, un peu penchée en avant, qui a l’air d’interroger et d’ergoter sur des actes qu’elle incrimine. En quoi ces deux personnes tiennent-elles à la vie de la Vierge ?
— Mais Balaam est un des types du messianisme ; c’est lui qui a notifié qu’une « étoile sortirait de Jacob et qu’une tige s’élèverait d’Israël ». Quant à la reine de Saba, elle est, d’après la doctrine des Pères, une image de l’Église, l’épouse de Salomon, ainsi que l’Église est l’épouse du Christ.
— Eh bien, murmura Durtal, ce n’est pas encore le treizième siècle qui nous aura donné un portrait de cette souveraine que l’on se représente, follement parée, se balançant, à dos de chameau dans le désert, marchant en tête d’une caravane, sous l’incendie du firmament, dans le feu des sables. Elle a tenté les écrivains et non les moindres, cette reine Balkis, Makéda ou Candaule, Flaubert, pour en citer un ; mais elle n’a pu s’incorporer dans la Tentation de saint Antoine qu’en une créature puérile et falote, en une marionnette qui sautille, en zézayant ; au fond, il n’y a que le peintre des Salomés, Gustave Moreau, qui pourrait la rendre, cette femme vierge et lubrique, casuiste et coquette ; lui seul pourrait, sous l’armature fleurie des robes, sous le gorgerin flambant des gemmes, aviver la chair épicée de cet être, son chef diadémé, étrange, son sourire de sphynge innocente, venue de si loin pour poser des énigmes et fermenter dans le lit d’un roi. Celle-là, elle est trop compliquée pour l’àme et pour l’art ingénus du moyen âge.
Aussi l’oeuvre de l’imagier n’est-elle ni mystérieuse ni troublante. A peine jolie, cette princesse n’a que l’allure attentive d’une plaideuse. Salomon, lui, me fait l’effet d’un gai compère ; les deux autres statues, situées de l’autre côté de la porte, retiendraient peut-être si elles n’étaient complètement écrasées par la troisième. Une question encore : à quel titre l’auteur de ce livre admirable, l’Ecclésiastique, se rattache-t-il à cette panégyrie ?
— Jésus, fils de Sirach, prédestine le Messie, en tant que Prophète et que Docteur. Quant à l’effigie qui l’avoisine, elle peut tout aussi bien mimer Judith qu’Esther ; son identité est incertaine, rien ne nous autorise à la fixer.
En tout cas, ainsi que je viens de vous l’attester, l’une et l’autre sont des hérauts de la Vierge dans les Écritures ; pour Joseph, persécuté, vendu, captif puis sauveur providentiel d’un peuple, il préordine le Christ.
Durtal s’arrêtait devant ce jeune homme imberbe, aux cheveux bouclés et coupés en rond. Il était vêtu d’une cotte, sous une housse brodée autour du col et il tenait, immobile, un sceptre. On eùt dit d’un très jeune moine, humble et simple, si avancé dans la voie mystique qu’il l’ignore. Cette statue était certainement un portrait et l’on pouvait assurer qu’un délicat et candide novice avait servi de modèle à l’artiste ; c’était une oeuvre d’âme chaste et joyeuse, bien à part. Celui-là, plus encore que le saint Jean, quel rêve, hein ? fit Durtal, en regardant l’abbé qui approuva d’un geste et reprit :
Les cordons des voussures sont inaccessibles, car il faut se démancher le cou pour les contempler ; d’ailleurs, l’art qu’ils décèlent n’exalte point. Seuls, les sujets valent. Ils renferment, — outre une série d’anges qui brandissent des astres et des torches, — les hauts faits prophétiques de Gédéon ; les annales de Samson qui, prisonnier au milieu de la nuit, arrache les portes de Gaza et sort de la ville, de même que le Christ brise les portes de la mort et sort, vivant, de sa tombe ; l’histoire de Judith et d’Esther ; celle de Tobie qui est un divin parangon de miséricorde et de patience ; puis nous découvrons dans ce coin la réplique du portail Royal, les signes du zodiaque et un calendrier de pierre.
Le tympan du portail se divise, vous le voyez, en deux zones.
Dans l’une, figure le Jugement de Salomon qui est l’image du Soleil de Justice, du Christ.
Dans l’autre, Job, étendu sur son fumier et auquel le Messie, dont il est un des prototypes les plus connus, remet, accompagné de deux anges, une palme.
Il ne nous reste plus, pour avoir passé en revue la symbolique de ces porches, l’iconographie entière de cette façade, qu’à jeter un coup d’oeil sur les trois arcades des perrons qui la précèdent. Ici, logent surtout les bienfaiteurs de la cathédrale et des saints du diocèse ; puis, mêlés à eux, quelques prophètes qui n’ont pu trouver place dans l’ébrasement des baies. Ce vestibule est une sorte de post-scriptum, de supplément ajouté à l’oeuvre.
Ici où nous sommes, dans l’arcade de droite, saint Potentien, premier apôtre de Chartres, et sainte Modeste, fille de Quirinus, gouverneur de la ville, qui la tua parce qu’elle refusait de renier le Christ ; là, Ferdinand de Castille ; il donna des vitraux reconnaissables à ses armes, châteaux d’or sur champ de gueules, qui côtoient l’écu d’azur fleurdelisé de France, dans la grande vitrerie du transept Nord. Près de lui, cette figure, intelligente et sévère, serait celle du juge Baruch, et voici, pieds nus et grevé d’un sac de pénitence, saint Louis qui combla de présents et inaugura la cathédrale.
Sous l’arcade du portique du milieu, nous avons deux socles vides sur lesquels s’érigeaient autrefois Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion, deux des plus insignes protecteurs de l’église ; puis d’autres socles pleins, qu’habitent le comte et la comtesse de Boulogne, une luronne à la face virile, coiffée d’une barrette ; un prophète inconnu, mais qui doit être Ézéchiel, car il manque dans la série prévoyante de ce porche ; Louis VIII, père de saint Louis, enfin la soeur de ce roi, Isabelle, qui fonda sous la règle de sainte Claire l’abbaye de Longchamp, elle est vêtue en moniale et à côté d’elle, dans l’ombre, un personnage de l’Ancienne Loi tient, ainsi que Melchissédech, un encensoir. Voyez la ferme et la solennelle allure de ce prêtre qui est le père de saint Jean-Baptiste, Zacharie, celui dont le cantique Benedictus prédit l’avènement du Christ.
Et nous avons terminé la revue de cet étonnant promptuaire du Vieux Testament et de ce mémento historique des bienfaiteurs qui permirent de faire la traduction imagée de ce Livre, par leurs largesses.
Durtal alluma une cigarette et ils se promenèrent devant la grille de l’évêché.
— Question d’art écartée, dit Durtal ; dans le défilé de ces ancêtres, il en est un, David, qui vraiment m’ébloùit, car il est le plus complexe de tous : si auguste à la fois et si petit, qu’il déconcerte !
— Pourquoi ?
— Pensez donc à la vie de cet homme qui fut, tour à tour, berger, guerrier, chef de proscrits, roi toutpuissant, fugitif sans feu ni lieu, poète extraordinaire, et prophète admirable, précis ; mais le caractère de ce souverain n’est-il pas, lui aussi, plus que son existence même, une énigme ?
Il fut doux et indulgent, sans rancune et sans haine, et il fut en même temps féroce. Rappelez-vous le sort qu’il infligea aux Ammonites ; sa vengeance fut effroyable ; il les fit scier entre des planches, hacher sous des herses de fer, couper par des vols de faulx, cuire dans des fours.
Il fut loyal, tout dévoué au Seigneur ; et il commet le crime d’adultère et ordonne d’occire le mari qu’il trompe. Quels contrastes !
— Pour bien comprendre David, dit l’abbé Plomb, il faut ne pas le séparer de son milieu, ne pas le distraire du temps où il vécut, autrement vous le jugez avec les idées de notre âge et c’est absurde ; dans la conception de la royauté asiatique, l’adultère était presque permis à un être que ses sujets considéraient comme au-dessus de l’humanité et, d’ailleurs, la femme était alors une espèce de bétail qui lui appartenait presque en sa qualité de despote, de maître suprême. Il y avait là l’exercice d’un droit régalien, ainsi que l’a très bien démontré M. Dieulafoy, dans son étude sur ce monarque. D’autre part, les supplices et le sang dont on l’accuse, mais tout l’Ancien Testament en déborde ! Jéhovah, lui-même, le verse à flots, extermine les hommes, tels que des mouches. Il convient de ne pas oublier que l’on vivait alors sous le régime de la Loi de crainte. Il n’y a donc rien de bien surprenant à ce que, dans le but de terrifier ses ennemis dont les moeurs n’étaient pas d’ailleurs plus douces que les siennes, il ait martyrisé les habitants de Rabba et rissolé les Ammonites.
Mais, en comparaison de ces violences et de ces péchés qu’il expia, voyez combien cet homme fut généreux envers Saül et admirez la grandeur d’âme, la charité de celui que les renanistes nous dépeignent sous l’aspect d’un chef de bandits et d’un forban ! Songez aussi qu’il apprit au monde qui les ignorait les vertus que devait, plus tard, enseigner le Christ, l’humilité dans ce qu’elle a de plus touchant, le repentir dans ce qu’il a de plus âpre. Quand le prophète Nathan lui reproche son homicide, il avoue, en pleurant, ses torts, accepte courageusement les plus terribles des pénitences : l’inceste et le meurtre dans sa famille, la révolte et la mort de son fils, la trahison, la misère et la fuite éperdue dans les bois. Et avec quels accents il implore dans le Miserere son pardon ! avec quel amour et quelle contrition il demande au Dieu qu’il offensa, merci !
Il était un homme avec des vices, restreints, rares si on les compare à ceux des monarques de son temps, et des vertus admirables, nombreuses, si on les rapproche de celles des souverains de toutes les époques, de tous les âges. Comment, dès lors, ne pas concevoir que Dieu l’ait choisi entre tous pour l’annoncer ? Jésus venait pour rédimer les pécheurs, il avait pris sur lui tous les crimes du monde : n’était-il pas naturel qu’il se fit préfigurer par un homme qui, semblable aux autres, avait péché ?
— C’est, en effet, juste.
Et le soir, quand loin de l’abbé Plomb qu’il avait quitté sur le seuil de l’église, Durtal s’étendit sur sa couche, il se remémora cette théorie des personnages de la Bible, ces sculptures des portails.
Pour récapituler cette façade du Nord, on peut garantir, murmura-t-il, qu’elle est l’histoire abrégée de la Rédemption préparée si longtemps à l’avance, une table de l’histoire sainte, un résumé de la loi mosaïque et partant une estompe de la loi chrétienne.
Toute la vocation du peuple juif se déroule sous la trinité de ces porches, une mission qui va d’Abraham à Moïse ; de Moïse à l’exil de Babylone ; de l’exil à la mort du Christ et qui se divise en trois périodes : la formation d’Israël, — son indépendance, — sa vie au milieu des gentils.
Et ce que cette fonte de foules s’est péniblement et lentement faite ! avec quels déchets et quelles scories ! Ce qu’il a fallu d’égorgements pour discipliner ces rapaces nomades, pour dompter la cupidité et la luxure furieuses de cette race ! — Et, en une série d’images folles, il voyait l’irruption dans la Judée des nabis hurlants, tumultueux et farouches, des imprécations contre les crimes des rois et les scélératesses de ce peuple versatile toujours tenté par les cultes voluptueux de l’Asie, toujours grommelant, prêt à briser le mors de fer dont le brida Moïse.
Et dans ce groupe de vociférateurs et de justiciers dominant de leur haute taille les têtes, apparaissait Samuel, l’homme des contradictions, allant où Dieu le pousse, accomplissant des tâches qu’il doit détruire, créant une monarchie qu’il réprouve, sacrant roi un énergumène, une sorte d’insensé qui passe derrière le transparent de l’histoire, avec des gestes de démence et de menaces ; et il faut que Samuel assomme cet étonnant Saül, sous le poids de ses malédictions, qu’il proclame roi David, auquel un autre prophète jettera à la face ses crimes ; et ces êtres inspirés se succèdent, continuent, d’années en années, le rôle de gardiens de l’âme publique, de guetteurs de la conscience des juges et des rois, de vigies attendant et criant au-dessus des multitudes les ordres divins, annonçant les catastrophes, finissant souvent dans le martyre, s’échelonnant tout le long des annales saintes, disparaissant avec saint Jean que décolle une Hérodiade.
Et c’était Élie, maudissant le culte de Baal, luttant contre la terrible Jézabel, Élie qui fut le premier fondateur des moines, le seul homme de l’Ancien Testament qui, avec Énoch, ne mourut point ; c’était Élysée, son disciple, les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, la série des moindres nabis, mandant l’arrivée du Fils, se dressant, comminatoires ou éplorés, menaçant ou consolant les masses.
Toute cette histoire d’Israël, elle grondait dans un torrent d’imprécations, dans des ruisseaux de sang, dans des fleuves de larmes !
Ce lamentable défilé finissait par ahurir Durtal ; les yeux clos, il apercevait soudain un patriarche qui S’arrêtait devant lui et il reconnaissait, intimidé, Moïse, un vieillard à barbe de cataracte, à cheveux balayant les dalles, un maître ouvrier dont les puissantes mains avaient pétri ces rudes Hébreux et coagulé leurs hordes confuses ; il était, en somme, le père et le législateur de ce peuple.
Et la scène du Sinaï émergeait en face de la scène du Calvaire, ouvrant et fermant la grande chronique de cette nation que son crime dispersa, enserrant le but même de sa vie, dans l’espace compris entre ces deux monts.
L’effrayant spectacle ! Moïse, seul, sur le pic qui fume, tandis que les éclairs fêlent les nues et qu’au son d’invisibles trompettes, la montagne tremble. En bas, la populace terrifiée prend la fuite. Et, immobile dans le roulement des tonnerres et les décharges répétées des foudres, Moïse écoute Celui qui est et qui dicte les conditions de son alliance avec Israël ; et la face resplendissante, Moïse descend de ce Sinaï qui représente, d’après Jean Damascène, le sein de la Vierge, comme la fumée qui en sort symbolise ses désirs et les flammes le Saint-Esprit !
Et subitement, ce tableau s’éteint, et près du patriarche qui reste, se montre, celui que les sculpteurs ont omis d’inscrire sur la page extérieure du portique, mais dont les verriers ont peint le portrait dans le vitrail de la même façade, le grand cohène Aaron, le premier Pontife du culte, celui que consacra Moïse.
Et cette cérémonie pendant laquelle Moïse institue, en la personne et en la descendance de son frère aîné, le sacerdoce, surgit devant Durtal, affreuse. Les détails autrefois lus sur cette ordination qui dura sept jours lui reviennent. Après les ablutions corporelles et l’onction des huiles, l’holocauste des victimes commence. Des viandes grésillent sur les braises, mêlant la puanteur noire des graisses aux vapeurs bleues de l’encens ; et le patriarche enduit de sang l’oreille, le pouce, le pied droits d’Aaron et de ses fils ; puis saisissant les chairs du sacrifice, il les dépose dans les mains des nouveaux prêtres qui se balancent sur un pied, puis sur un autre, berçant ainsi, au-dessus de l’autel, ces offrandes.
Ensuite tous baissent la tête sous une pluie d’huile mélangée de sang dont le consécrateur les inonde. Ils ont l’air de tueurs d’abattoirs et de lampistes, criblés qu’ils sont de plaques de boue rouge sur laquelle nagent des yeux d’or.
De même qu’en un verre de lanterne magique qui change, cette scène sauvage, ce symbole fruste d’une splendide et subtile liturgie alors balbutiée d’une voix rauque, disparaît et fait place à la théorie des lévites et des prêtres processionnant dans le temple, sous la conduite d’Aaron, magnifique sous son turban cerclé d’or, dans sa toge violette au bas de laquelle s’ouvrent des grenades d’écarlate et d’azur et sonnent des clochettes d’or ; et il porte l’éphod de lin, serré par une ceinture couleur d’hyacinthe, de cramoisi et de pourpre, retenu en haut par des épaulières agrafées d’une sardoine, la poitrine en feu, crépitant d’étincelles que sa marche attise dans les douze pierreries du pectoral.
Tout s’efface encore. Et un inconcevable palais se dresse, abritant sous des dômes vertigineux des arbres en fleurs des tropiques plantés près de bassins tièdes ; des singes gambadent, se pendent en grappes aux branches, tandis que traînent des mélodies patelines grattées sur des instruments à cordes, et que les sons retentissants des tambourins font trembler les roues bleues des paons.
Dans cette étrange pépinière, pleine de touffes de femmes et de fleurs, dans ce harem immense où vaguent ses sept cents princesses et ses trois cents concubines, Salomon regarde le tourbillon des danses, contemple ces haies vivantes de femmes dont les corps se détachent sur l’or plaqué des murs, vêtues seulement avec le voile transparent des fumées que déroulent les résines brûlant sur des trépieds.
Il apparaît comme le type des monarques de l’Orient, comme une sorte de kalife, de sultan, de rajah de contes de fée, ce roi prodigieux, tout à la fois polygame effréné, assoiffé de luxe, et aussi, savant et artiste, pacifique, sage entre tous. En avance sur les idées de son temps, il a été la grand bâtisseur de la race et le commerce d’Israël est son oeuvre. Il a laissé une réputation de sapience, de justice, telle qu’il a fini par passer pour un enchanteur et un sorcier. Déjà Josèphe raconte qu’il écrivit un grimoire, un livre d’incantations pour conjurer les esprits du mal ; au moyen âge, on lui attribue un anneau magique, des amulettes, des recueils d’évocations, des secrets d’exorcismes ; et sa figure se brouille dans ces légendes.
Il subsisterait surtout, tel qu’un personnage des Mille et une nuits, si, au déclin de sa gloire, ne se levait avec lui l’image grandiose de la mélancolie de l’existence, de l’inanité de la joie, du néant de l’homme.
Sa vieillesse fut sombre. Épuisé par les femmes et dominé par elles, il renie son Dieu et sacrifie aux idoles. L’on aperçoit, en lui, de larges clairières, de vastes abats d’âme. Revenu de tout, las d’allégresse et saoul de fautes, il écrit d’admirables pages, précède le pessimisme le plus noir de nos temps, résume en de définitives phrases la souffrance de l’être qui subit la peine infligée de vivre. Quelle détresse que celle de l’Ecclésiaste !... « Tous les jours de l’homme ne sont que douleur et son occupation n’est que déplaisir »... « mieux vaut le jour de la mort que celui de la naissance »... « tout n’est que vanité et affliction de l’esprit »...
Et après son décès, le vieux roi reste à l’état d’énigme. A-t-il expié son apostasie et sa chute ? a-t-il été reçu, ainsi que ses pères, dans le sein d’Abraham ? et les plus grands écrivains de l’Église ne peuvent s’entendre.
Selon saint Irénée, saint Hilaire, saint Cyrille de Jérusalem, saint Ambroise et saint Jérôme, il a fait pénitence et il est sauvé.
Selon Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, il n’est pas revenu à résipiscence et il est damné.
Et Durtal se retourne dans son lit et ne cherche plus à rien savoir. Tout se brouille dans sa cervelle et il finit par dormir un sommeil concassé, traversé par d’affreux cauchemars, dans lesquels il voit Mme Mesurat s’installer à la place de la reine de Saba, sur le socle du porche ; et sa laideur désole Durtal qui s’emporte contre les chanoines auxquels il demande en vain d’ôter sa femme de ménage et de ramener la reine.
XII
CETTE symbolique des églises, cette psychologie des cathédrales, cette étude de l’âme des sanctuaires si parfaitement omise depuis le moyen âge par ces professeurs de physiologie monumentale que sont les archéologues et les architectes, intéressait assez Durtal pour qu’il parvînt à oublier avec elle, pendant quelques heures, ses bagarres d’esprit et ses luttes ; mais dès qu’il ne s’évertuait plus à chercher le sens réel des apparences, tout reprenait. Cette sorte de mise en demeure que lui avait brusquement adressée l’abbé Gévresin de clore ses litiges, de se prononcer dans un sens ou dans l’autre, l’affolait en l’apeurant.
Le cloître ! ce qu’il fallait longuement réfléchir avant de se résoudre à s’y écrouer ! Et le pour et le contre se pourchassaient, à tour de rôle, en lui.
Me voilà, comme avant mon départ pour la Trappe, se disait-il, et la décision que je dois adopter est encore plus grave, car Notre-Dame de l’Atre n’était qu’un refuge provisoire ; je savais, en y allant, que je n’y permanerais point ; c’était un moment pénible à supporter, mais ce nétait qu’un moment, tandis qu’il s’agit, à l’heure actuelle, d’une détermination sans retour, d’un lieu où, si je m’y incarcère, ce sera jusqu’à la mort ; c’est la condamnation à perpétuité, sans remise de peine, sans décret de grâce ; et il en parle, ainsi que d’une chose simple, l’abbé !
Que faire ? Renoncer à toute liberté, n’être plus qu’une machine, qu’une chose entre les mains d’un homme que l’on ne connaît point, mon Dieu, je le veux bien ! mais il y a des questions plus gênantes que celle-là pour moi ; d’abord celle de la littérature ; ne plus écrire, renoncer à ce qui fut l’occupation et le but de ma vie ; c’est douloureux, et cependant j’accepterais ce sacrifice, mais ... mais écrire et voir sa langue épluchée, lavée à l’eau de pompe, décolorée par un autre qui peut être un savant et un saint, mais n’avoir, de même que saint Jean de la Croix, aucun sentiment de l’art, c’est vraiment dur ! Les idées, je comprends bien qu’au point de vue théologique, on vous les monde, rien de plus juste ; mais le style ! Et, dans un monastère, autant que je puis le savoir, rien ne s’imprime sans que l’abbé l’ait lu et il a le droit de tout reviser, de tout changer, de tout supprimer, s’il lui plaît. Il vaudrait évidemment mieux ne plus écrire, mais là encore, le choix n’est pas permis puisqu’il faut s’incliner, au nom de l’obéissance, devant un ordre, traiter tel ou tel sujet de telle ou de telle façon, selon que l’abbé l’exige.
A moins de tomber sur un maître exceptionnel, quelle pierre d’achoppement ! Puis, en sus de cette question qui est pour moi la plus anxieuse de toutes, d’autres valent aussi qu’on les médite. D’après le peu que m’ont raconté mes deux prêtres, le bienfaisant silence des cisterciens n’existe pas chez les moines noirs. Or, si perfectionnés que puissent être les cénobites, ils n’en sont pas moins des hommes ; autrement dit, des sympathies et des antipathies se heurtent en un incessant côte à côte et forcément, à ne remuer que les sujets restreints, à vivre dans l’ignorance de ce qui se passe au dehors, la causerie tourne aux potins ; on finit par ne plus s’intéresser qu’à des futilités, qu’à des vétilles qui prennent une importance d’événements dans ce milieu.
On devient vieille fille, et ce que ces conversations ��������������������������������������������������������������������sans imprévu doivent au bout de quelque temps vous lasser !
Enfin, il y a le point de vue de la santé. Dans le couvent, c’est le triomphe des ragoûts et des salades, le détraquement de l’estomac à bref délai, le sommeil limité, l’écrasante fatigue du corps malmené... ah ! tout cela n’est ni engageant, ni drôle ! — Qui sait si, après quelques mois de ce régime matériel et mental, l’on ne croule pas dans un ennui sans fond, si l’acedia des geôles monastiques ne vous terrasse point, ne vous rend pas complètement incapable de penser et d’agir ?
Et Durtal concluait : c’est folie que de rêver de la vie conventuelle ; je ferais mieux de demeurer à Chartres ; et il était à peine résolu à ne pas bouger, que l’autre côté de la médaille se montrait.
Le cloitre ! mais c’est la seule existence qui soit logique, la seule qui soit propre ! ces souleurs qu’il se suggérait étaient vaines. D’abord, la santé ? mais il ne se rappelait donc plus la Trappe où l’alimentàtion était autrement débilitante, où le régime était autrement rigoureux ! pourquoi dès lors d’alarmer d’avance ?
D’autre part, il ne comprenait donc pas la nécessité des entretiens, la sagesse des devis, rompant la solitude de la cellule juste au moment où l’ennui s’impose ? c’était un dérivatif aux rabâchages intimes et les promenades en commun assuraient l’hygiène de l’âme et tonifiaient le corps ; puis à supposer que les colloques monastiques fussent puérils, est-ce que les racontars entendus dans un autre monde étaient plus nutritifs ? enfin, la fréquentation des moines n’était-elle pas très supérieure à celle des gens de tout état, de toute condition, de tout poil, qu’il faut, dans la vie externe, subir ?
Qu’est-ce, au surplus, que ces bagatelles, que ces petits détails dans l’ensemble magnifique du cloître ? que pesaient ces menuailles, ces riens, en comparaison de la paix, de l’allégresse de l’âme exultant dans la joie des offices, dans le devoir accompli des louanges ? est-ce que le flot des liturgies ne lavait pas tout, n’emportait pas, tels que des fétus, les minimes défauts des êtres ? n’était-ce point aussi l’histoire de la paille et de la poutre, les rôles renversés, les imperfections aperçues chez autrui, lors que soi-même on lui est si inférieur ?
Toujours, au bout de mes raisonnements, je découvre mon manque d’humilité, se disait-il. Il réfléchissait. — Que d’efforts, reprit-il, pour s’enlever la crasse de ses vices ! peut-être que, dans un couvent, je me dérouillerais ; et il rêvait une existence épurée, une âme imbibée de prières, se dilatant dans la compagnie du Christ, qui pourrait peut-être alors, sans trop se salir, descendre dans ses aîtres et s’y loger ; c’est le seul destin qui soit enviable ! se cria-t-il ; décidons-nous.
Et comme une douche d’eau froide, une réflexion l’abattait. Ce n’en sera pas moins la vie collective, le lycée qui recommencera ; ce sera la garnison monastique qu’il faudra tenir !
Il gisait atterré, puis voulait réagir et perdait patience. Ah çà, grogna-t-il, on ne se séquestre pas dans une abbaye, pour y chercher ses aises ; un monastère n’est pas une Sainte-Périne pieuse ; l’on s’y interne, je suppose, pour expier ses fautes, pour se préparer à la mort ; dès lors, à quoi bon discuter sur le genre de tribulations qu’il convient d’endurer ? le tout c’est d’être résolu à les accepter, à ne pas faiblir !
Mais avait-il bien le désir de la douleur et de la pénitence ? et il tremblait de se répondre. Au fond de lui, timidement, un oui se levait, couvert aussitôt par les clameurs de ses lâchetés et de ses transes. Alors, pourquoi partir ?
Décidément, il s’embrouillait, finissait, lorsque cessait ce désordre, par songer à un sursis, à un moyen terme, à des tracas inoffensifs, d’une certaine sorte, à des soucis assez supportables pour n’en être plus.
Je suis idiot, concluait-il, car je me bats dans le vide ; je m’emballe sur des mots, sur des coutumes que j’ignore. La première chose à faire serait d’aller dans un couvent bénédictin, dans plusieurs même pour les comparer, et de me rendre compte ainsi de l’existence qu’on y mène. Ensuite la question de l’oblature est à éclaircir ; si j’en crois l’abbé Plomb, le sort de l’oblat est subordonné au bon vouloir du père abbé qui, selon son tempérament plus ou moins impérieux, serre le garrot ou le desserre ; mais est-ce bien sûr ? il y a eu, pendant le moyen âge, des oblats ; par conséquent des dispositions séculaires les régissent !
Et puis tout cela est humain, tout cela est vil ! car il ne s’agit pas d’ergoter sur des textes, sur des clauses plus ou moins débonnaires ; il s’agit de se concéder sans réticences, de se jeter bravement à l’eau ; ce qu’il faut, c’est s’offrir tout entier à Dieu. Le cloître autrement envisagé est une maison bourgeoise et c’est absurde. Mes appréhensions, mes advertances, mes compromis, sont une honte !
Oui, mais où puiser la force nécessaire pour balayer hors de soi ce poussier d’âme ? — et, finalement, lors-qu’il était trop obsédé par ces alternatives d’appétences et de craintes, il allait se réfugier auprès de Notre-Dame de Sous-Terre. Dans l’après-midi les celliers étaient clos, mais il y pénétrait par une petite porte ouverte à l’entrée de la sactistie, dans la cathédrale, et c’était une descente en pleines ténèbres.
Arrivé dans la crypte même, à côté de l’autel, il retrouvait l’incertaine et la pacifiante odeur de ces voûtes fumées par les cires, avançait dans ce doux et tiède parfum d’oliban et de cave. Il faisait moins clair encore que le matin, car les lampes n’étaient pas allumées et, seules, les veilleuses brûlant comme au travers de peaux amincies d’oranges éclairaient de lueurs de vermeil qui se dédore la suie des murs.
En tournant alors le dos à l’autel, il voyait filant devant lui l’allée basse de la nef, au bout de laquelle on apercevait, ainsi qu’en un fond de tunnel, la lumière du jour, — malheureusement, car elle permettait de distinguer de hideuses peintures, des scènes célébrant la gloire ecclésiale de Chartres : la visite de Marie de Médicis et de Henri IV à la cathédrale, Louis XIII et sa mère, M. Olier présentant à la Vierge les clefs du séminaire de Saint-Sulpice et une robe brochée d’or, Louis XIV aux pieds de Notre-Dame de Sous-Terre ; par une grâce du ciel, les autres fresques semblaient mortes, se diluaient, en tout cas, dans l’ombre.
Mais ce qui était vraiment exquis, c’était de se rencontrer seul avec la Vierge qui vous regardait de sa noire figure sortant de la nuit, lorsque les mèches des veilleuses crépitaient, dardant des jets de flammes brèves.
A genoux devant Elle, Durtal se déterminait à lui parler, à lui dire :
J’ai peur de l’avenir et de son ciel chargé et j’ai peur de moi-même, car je me dissous dans l’ennui et je m’enlise. Vous m’avez toujours mené par la main jusqu’ici, ne m’abandonnez pas, achevez votre oeuvre. Je sais bien que c’est folie de se préoccuper ainsi du futur, car votre Fils l’a déclaré : « A chaque jour suffit sa peine » ; mais cela dépend des tempéraments, ce qui est facile aux uns est si difficile pour les autres ; j’ai l’esprit remuant, toujours inquiet, toujours aux écoutes, et, quoi que je fasse, il bat la campagne à tâtons et il s’égare ! Ramenez-le, tenez-le près de vous en laisse, bonne Mère, et accordez-moi, après tant de fatigues, un gîte !
Ah ! ne plus être ainsi divisé, demeurer impartible ! avoir l’âme assez anéantie pour ne plus ressentir que les douleurs, ne plus éprouver que les joies de la liturgie ! ne plus être requis chaque jour que par Jésus et par Vous, ne plus suivre que votre propre existence se déroulant dans le cercle annuel des offices ! se réjouir avec la Nativité, rire à Pâques-fleuries, pleurer pendant la semaine sainte, être indifférent au reste, pouvoir ne plus se compter, se désintéresser complètement de sa personne, quel rêve ! ce qu’il serait simple alors de se réfugier dans un cloître !
Mais est-ce possible quand on n’est pas un saint ? quel dénuement cela suppose de l’âme vidée de toutes les idées profanes, de toutes les images terrestres ; quel apprivoisement cela présume de l’imagination devenue docile, ne s’élançant plus que sur une seule piste, n’errant plus, comme la mienne, à l’aventure !
Et pourtant, ce que les autres soins sont inutiles, car tout ce qui n’a pas trait au ciel, sur la terre, est vain ! oui, mais quand il s’agit de mettre ces pensées en pratique, elle se cabre, ma rosse d’âme, et j’ai beau la tirer, elle rue et n’avance pas !
Ah ! Sainte Vierge, ce n’est point pour m’excuser de mes faiblesses et de mes fautes ! mais cependant, je vous l’avoue, c’est décourageant, c’est navrant de ne rien comprendre, de ne rien voir ! Ce Chartres où je végète, est-il un lieu d’attente, une transition entre deux monastères, un pont jeté entre Notre-Dame de l’Atre et Solesmes ou une autre abbaye ? est-ce au contraire l’étape dernière, celle où vous voulez que je sois enfin assis, mais alors ma vie n’a plus de sens ; elle est incohérente, bâtie et détruite au hasard des sables ! à quoi bon, s’il en est ainsi, ces souhaits monastiques, ces appels vers une autre destinée, cette quasi-certitude que je suis en panne à une station, que je ne suis pas arrivé au lieu où je dois me rendre ?
Si c’était encore, ainsi qu’autrefois où je vous sentais près de moi, où, lorsque je vous interrogeais, vous répondiez, si c’était de même qu’à la Trappe où j’ai tant souffert pourtant ! mais non, maintenant, je ne vous entends plus, vous ne m’écoutez pas.
Durtal se tut, puis : j’ai tort de vous parler de la sorte, dit-il, vous ne nous pressez dans vos bras que lorsque nous sommes incapables de marcher ; vous soignez, vous caressez la pauvre âme qui naît dans une conversion ; puis quand elle peut se tenir sur ses jambes, vous la déposez à terre et la laissez essayer par elle-même ses propres forces.
C’est utile et c’est juste, mais n’empêche que le souvenir de ces célestes allégeances, de ces premières liesses perdues, désespère !
Ah ! sainte Vierge, sainte Vierge, prenez pitié des âmes rachitiques qui se traînent si péniblement quand elles ne sont plus sous votre lisière ; prenez pitié des âmes endolories pour lesquelles tout effort est une souffrance, des âmes que rien ne dégrève et que tout afflige ! prenez pitié des âmes sans feu ni lieu, des âmes voyagères inaptes à se grouper et à se fixer, prenez pitié des âmes veules et recrues, prenez pitié de toutes ces âmes qui sont la mienne, prenez pitié de moi !
Et souvent avant de se séparer de la Mère, il voulait la visiter encore dans ses réduits, là où, depuis le moyen âge, les fidèles ne vont plus ; et il allumait un bout de cierge, quittait la nef même, longeait les murs tournants du couloir d’entrée jusqu’à la sacristie de cette cave, et en face, dans la lourde muraille, s’enfonçait une porte treillagée de fer. Il descendait par un petit escalier dans un souterrain qui était l’ancien martyrium où l’on cachait jadis, en temps de guerre, la sainte châsse. Un autel avait été édifié, sous le vocable de saint Lubin, au centre de ce trou. Dans la crypte, l’on percevait encore le bourdon lointain des cloches, le bruissement sourd de la cathédrale, s’étendant au-dessus d’elle ; là, plus rien ; l’on était enfoui dans une tombe ; malheureusement, d’ignobles colonnes carrées, blanchies au lait de chaux, érigées pour consolider le groupe de Bridan, placé dans le choeur de la basilique, sur l’autel, gâtaient l’allure barbare de cette oubliette, égarée dans la nuit des âges, au fond du sol.
Et il en sortait quand même, soulagé, s’accusait d’ingratitude, se demandant comment il songeait à s’évader de Chartres, à s’éloigner ainsi de la Vierge avec laquelle il pouvait si facilement, quand il le désirait, causer seul.
D’autres jours, quand il faisait beau, il choisissait pour but de promenade un couvent dont Mme Bavoil lui avait révélé la présence à Chartres. Un après-midi, il l’avait rencontrée sur la place et elle lui avait dit :
— Je vais voir le petit Jésus de Prague qui est au Carmel de cette ville ; venez-vous avec moi, notre ami ?
Durtal n’aimait guère ces dévotionnettes, mais l’idée de pénétrer dans la chapelle des carmélites qu’il ne connaissait pas l’incita à accompagner la gouvernante et elle l’emmena dans la rue des Jubelines située derrière la chaussée du railway, après la gare. L’on franchissait pour y accéder un pont qui grondait sous le poids roulant des trains et l’on entrait, à droite, dans une sente qui zigzaguait, bordée d’un côté par le talus du chemin de fer, de l’autre par des bicoques, coiffées de chaume, par d’anciennes granges et aussi par des maisons moins minables, mais closes, bouclées, dès la fin de l’aube. Mme Bavoil l’avait conduit au fond de la ruelle, là où s’ébrase l’arche d’un autre pont. Au-dessus était établie une voie de garage, avec des disques ronds et carrés, rouges et jaunes et des poutrelles à escalier de fonte ; et, toujours à la même place, une locomotive chauffait ou marchait, en sifflant, à reculons.
Mme Bavoil s’arrêta devant une porte cintrée près de laquelle, formant avec le remblai de la ligne de l’Ouest la pointe d’un cul-de-sac, se dressait un mur immense en pierres meulières, couleur d’amande grillée, pareil à ceux des réservoirs de Paris ; c’était là que résidaient les moniales de sainte Térèse.
En femme qui a l’habitude de ces couvents, Mme Bavoil poussa la porte laissée contre et Durtal aperçut devant lui une allée pavée, sablée de cailloux de rivières sur les bords, tranchant par le milieu un jardin dans lequel s’élevaient des arbres fruitiers et des géraniums. Deux ifs, en boule et découpés en croix à leurs sommets, donnaient à cette closerie de curé une odeur de cimetière.
L’allée montait, creusée de marches ; quand il les eut grimpées, Durtal vit une construction en briques et en plâtre, percée de fenêtres armées de grilles noires et d’une porte grise, nantie d’un judas, au-dessus duquel se lisait cette inscription, en lettres blanches : « O Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à vous. »
Il regardait, surpris de n’aviser personne, de ne rien entendre, mais Mme Bavoil l’appela d’un signe, contourna la maison, l’introduisit dans une sorte de vestibule le long duquel serpentait une vigne, emmaillotée de gaze, et de là dans une petite chapelle où elle s’agenouilla, sur les dalles.
Durtal humait, mal à l’aise, la tristesse qui s’épandait de ce sanctuaire nu.
Il était dans un édifice de la fin du dix-huitième siècle ; au milieu, précédé de huit marches, posait un autel en bois ciré de la forme d’un tombeau, muni d’un tabernacle couvert d’un rideau broché de soie, et paré d’un tableau de l’Annonciation, une peinture, aux tons flasques, tendue dans un cadre d’or.
A gauche et à droite, deux médaillons en relief se faisaient pendant, saint Joseph, d’un côté, et sainte Térèse, de l’autre ; et, au-dessus du tableau, près du plafond, se détachaient les armes sculptées des Carmels : un écu avec croix et étoiles, sous une couronne de marquis traversée par un bras brandissant un glaive, maintenu par de gras angelots, tel qu’en enfla la statuaire de ce temps, et sillonné en l’air d’une banderole arborant la devise de l’ordre : Zelo, zelatus sum, pro Domino Deo exercituum.
Enfin, à droite de l’autel, la grille en fer noir de la clôture se creusait dans le mur taillé en ogive et, sur les marches de l’autel, en deçà de la rampe de communion, émergeait, sous un dais doré, une irritante statue de l’enfant Jésus, diadémée, soupesant une boule dans une main et levant l’autre en un geste qui réclame l’attention, une statue de précoce jongleur, en plâtre colorié, honorée dans cette chapelle solitaire par deux pots d’hortensias et une veilleuse allumée de verre rouge.
Ce que ce rococo est morne et gelé, pensa Durtal. Il s’agenouilla sur une chaise et, peu à peu, ses impressions changèrent. Sursaturé de prières, ce sanctuaire fondait ses glaces, devenait tiède. Il semblait que, par la grille de la clôture, des oraisons filtrassent et répandissent des bouffées de poêle dans la pièce. On finissait par avoir chaud à l’âme, par se croire bien chez soi, dans cet isolement, à l’aise.
L’étonnement demeurait seul d’entendre, si loin de tout, des sifflements de convois et des ronflements de machines.
Durtal sortit, tandis que Mme Bavoil achevait d’égrener son rosaire. Sur la porte, juste en face de lui la cathédrale se profilait, au loin, mais ne possédait plus qu’un clocher ; le vieux se cachant derrière le neuf. Par ce temps un peu voilé, elle s’affinait dans le firmament, verte et grise, avec son toit oxydé de cuivre et le ton de pierre ponce de sa tour.
Elle est extraordinaire, se disait Durtal, se commémorant les divers aspects qu’elle revêtait, suivant les saisons, suivant les heures ; comme l’épiderme de son teint changeait !
En son ensemble, par un ciel clair, son gris s’argente et si le soleil l’illumine, elle blondit et se dore ; vue de près, sa peau est alors pareille à un biscuit grîgnoté, avec son calcaire siliceux rongé de trous ; d’autres fois, lorsque le soleil se couche, elle se carmine et elle surgit, telle qu’une monstrueuse et délicate châsse, rose et verte, et, au crépuscule, elle se bleute, puis paraît s’évaporer à mesure qu’elle violit.
Et ses porches ! continua Durtal — celui de la façade Royale est le moins versatile ; il se conserve, d’un brun de cannelle, jusqu’à mi-corps, d’un gris de pumicite, lorsqu’il s’élève ; celui du Midi, le plus mangé de tous par les mousses, s’éverdume ; tandis que les arches du Nord, avec leurs pierres effritées, bourrées de coquillages, suscitent l’illusion d’une grotte marine, à sec.
— Eh bien, vous rêvez, notre ami ? fit Mme Bavoil, qui lui frappa sur l’épaule.
Voyez-vous, reprit-elle, c’est un très austère couvent que celui de ces carmélites et vous ne doutez pas que les grâces n’y abondent ; — et Durtal murmurant : quel contraste entre ce lieu mort et ce chemin de fer, toujours en émoi, qui le longe ! — elle s’écria :
— Pensez-vous qu’il y ait autre part, côte à côte, un semblable symbole de la vie contemplative et de la vie active ?
— Oui, mais que doivent imaginer les moniales, en écoutant ces continuels départs pour le monde ? Évidemment celles qui ont vieilli dans le monastère méprisent ces appels, ces invites à la vie et la quiétude de leur âme s’accroît de se savoir pour toujours à l’abri de ces périls qu’évoque, à chaque heure du jour et de la nuit, la fuite bruyante des trains ; elles se sentent plus enclines à prier pour ceux que les hasards de l’existence emportent à Paris ou refoulent, rejetés par cette ville, sur la province ; mais les postulantes et les novices ? Dans ces moments de sécheresse, d’incertitude sur leur vocation qui les accablent, n’est-il pas affreux, ce souvenir constamment ravivé de la famille, des amis, de tout ce que l’on a abandonné pour s’enfermer à jamais dans un cloître ?
N’est-ce pas, lorsqu’on est encore mal aguerrie, brisée par les fatigues, lorsqu’on se tâte pour connaître si l’on pourra résister aux veilles et aux jeùnes, la tentation permanente de ne pas se laisser murer vivante, dans une tombe ?
Je songe aussi à cet aspect de réservoir que la construction de ses murs prête au Carmel. La figure est exacte, car ce couvent est bien un réservoir où Dieu plonge et pêche des oeuvres d’amour et de larmes, afin de rétablir l’équilibre de la balance où les péchés du monde pèsent si lourds !
Mme Bavoil se mit à sourire.
— Une très vieille carmélite, fit-elle, qui était entrée dans cette communauté, avant l’invention de cette ligne de chemin de fer, est décédée, il y a quelques mois à peine. Jamais elle n’était sortie de la clôture et jamais elle n’avait vu une locomotive et un wagon. Sous quelle forme pouvait-elle se représenter ces convois dont elle entendait les roulements et les cris ?
— Évidemment sous une forme diabolique, puisque ces attelages mènent aux péchés scélérats et joyeux des villes, répondit, en souriant, Durtal.
— Remarquez bien, en tout cas, ceci : cette soeur aurait pu monter dans le grenier de la maison qui domine la voie et, de là, regarder, une fois pour toutes, un train. On l’y autorisa et elle ne le fit point justement parce qu’elle en mourait d’envie ; elle s’imposa, par esprit de mortification, ce sacrifice.
— Une femme qui peut châtier ses désirs et vaincre sa curiosité, ça c’est fort !
Durtal se tut, puis, changeant de conversation, il dit :
— Vous causez toujours avec le ciel, madame Bavoil ?
— Non, répliqua-t-elle tristement. Je n’ai plus ni colloques, ni visions. Je suis sourde et aveugle. Dieu se tait.
Elle hocha la tête et, après une pause, elle poursuivit, s’entretenant avec elle-même :
— Il faut si peu de chose pour ne point lui plaire. S’Il perçoit un soupçon de vanité dans l’âme qu’il éclaire, Il se retire. Et comme me l’a déclaré le père, le fait seul d’avoir parlé des grâces spéciales que Jésus m’accordait prouve que je ne suis pas humble ; enfin que sa volonté s’accomplisse ! Et vous, notre ami, pensez-vous encore à vous réfugier dans une abbaye ?
— Moi, j’ai l’esprit qui bat la chamade, j’ai l’âme en vrague !
— Parce que, sans doute, vous n’y allez pas franc jeu ; vous avez l’air de traiter une affaire avec Lui ; ce n’est pas ainsi qu’on doit s’y prendre !
— Vous feriez quoi à ma place ?
— Je serais généreuse ; je Lui dirais : me voici, usez de moi, selon votre dessein ; je me donne sans conditions ; je ne vous demande qu’une chose, c’est de m’aider à vous aimer !
— Si vous croyez que je ne me les suis pas déjà reprochées, mes ladreries de coeur !
Ils cheminèrent en silence. Arrivés devant la cathédrale, Mme Bavoil proposa de rendre visite à Notre-Dame du Pilier.
Ils s’installèrent dans l’obscurité de ce bas-côté du choeur dont les sombres vitraux étaient encore voilés par une boiserie de camelote dessinant une niche dans laquelle la Vierge se tenait, noire, telle que son homonyme de la crypte, que Notre-Dame de Sous-Terre, sur un pilier, entourée de grappes de coeurs en métal et de veilleuses suspendues à des cerceaux au plafond. Des herses de cierges dardaient leurs amandes de flammes et des femmes prosternées priaient, la tête entre les mains, ou la face tournée vers le visage d’ombre que les lueurs n’atteignaient point.
Il parut à Durtal que les douleurs contenues, le matin, se répandaient dans le crépuscule ; les fidèles ne venaient plus seulement pour Elle, mais pour eux ; chacun apportait le paquet de ses maux et l’ouvrait ; la tristesse de ces âmes vidées sur les dalles, de ces femmes appuyées, prostrées, contre la grille qui protégeait le pilier que toutes embrassaient, en partant !
Et la noire statue, sculptée dans les premières années du seizième siècle, écoutait, la face invisible, les mêmes gémissements, les mêmes plaintes, qui se succédaient, de générations en générations, entendait les mêmes cris se répercutant à travers les âges, affirmant l’inclémence de la vie et la convoitise de la voir se prolonger pourtant !
Durtal regarda Mme Bavoil ; elle priait, les yeux clos, renversée sur ses talons, par terre, les bras tombés, les mains jointes. Était-elle heureuse de pouvoir s’absorber ainsi !
Et il voulut se forcer à réciter une supplique très courte, afin de parvenir à l’achever, sans se distraire ; et il commença à répéter le Sub tuum. « Nous nous réfugions sous votre abri, sainte Mère de Dieu, ne méprisez pas... » Au fond, ce qu’il était nécessaire d’obtenir du père abbé dans le cloître duquel il se détiendrait, c’était le droit d’amener au monastère ses livres, de garder au moins quelques bibelots pieux dans sa cellule ; oui, mais comment faire comprendre que des volumes profanes sont nécessaires dans un couvent, qu’au point de vue de l’art, il est indispensable de se retremper dans la prose d’Hugo, de Baudelaire, de Flaubert... Voilà que je m’évague encore, se dit tout à coup Durtal. Il essaya de balayer ces distractions et reprit : « Ne méprisez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins... » et il repartit, bride abattue, dans son rêve ; en admettant que cette proposition ne soit pas la cause de difficultés, il resterait encore la question des manuscrits à soumettre, de l’imprimatur à se procurer ; et cette question-là, comment la résoudre ?
Mme Bavoil rompit ces phantasmes en se levant. Il revint à lui, acheva en hâte sa prière... « mais délivrez-nous toujours de tous les périls, Vierge glorieuse et bénie, ainsi soit-il » ; et il quitta la gouvernante sur le seuil de l’église et se dirigea, irrité contre ses débauches d’imagination, vers son logis.
Il y trouva une lettre du directeur de la Revue qui avait inséré son étude sur le Fra Angelico du Louvre ; on lui commandait un nouvel article.
Cette diversion le réjouit ; il pensa que ce travail l’empêcherait peut-être de rêvasser ainsi sur ses désarrois de Chartres et ses souhaits de clôture.
Donner quoi à la Revue ? se dit-il, puisqu’ils veulent surtout de la critique d’art religieux, je pourrais leur rédiger quelques aperçus sur les Primitifs de l’Allemagne. J’ai mes notes détaillées, prises sur place, dans les musées de ce pays, voyons-les. Il les feuilleta, s’attarda sur un calepin contenant ses impressions de voyage ; le résumé de ses remarques sur l’école de peinture de Cologne l’arrêta.
A chaque page du carnet, sa surprise s’attestait en des termes plus véhéments, de la fausseté des idées acquises, des rengaines débitées depuis tant d’années sur ces peintures.
Tous les écrivains, sans exception, s’extasiaient à qui mieux mieux sur l’art pur, religieux, de ces Primitifs, en parlaient tels que d’artistes séraphiques, ayant peint des figures surhumaines, des Vierges effilées, blanches, toutes en âme, se découpant, ainsi que des visions célestes, sur des fonds d’or.
Et Durtal, prévenu quand même par l’unanimité de ces lieux communs, s’attendait à rencontrer des anges blonds presque impalpables, des madones flamandes, en quelque sorte éthérées, débarrassées de leur coque charnelle, de vagues Memling avec des yeux encore clarifiés et des corps qui n’en sont plus... et il se rappelait son ahurissement, en entrant dans les salles du musée de Cologne.
A dire vrai, ses désillusions avaient commencé dès sa descente du train ; transporté en une nuit de Paris dans cette ville, il avait traversé d’insignifiantes rues dont tous les soupiraux expiraient des odeurs de choucroutes et il était arrivé sur la grand’place, décorée par les enseignes des Farina, devant la fameuse cathédrale ; et il avait bien dû s’avouer que cette façade, que cet extérieur était un ressemelage et un leurre. Tout était retapé, tout était neuf ; et cette basilique n’arborait aucune sculpture sous ses évents ; elle était symétrique et bâtie au cordeau ; elle offensait par ses contours secs, par ses lignes dures.
L’intérieur valait mieux, malgré le feu d’artifice de barrière que tiraient, entre ses murs, d’ignobles vitraux modernes ; c’était là, dans une chapelle, près du choeur, que s’exhibait, moyennant finance, le tableau célèbre de l’école allemande, le Dombild de Stéphan Lochner, un tryptique représentant l’Adoration des Rois Mages, sur son panneau du milieu ; sainte Ursule, sur le volet de gauche ; saint Géréon, sur le volet de droite.
Et l’ahurissement de Durtal avait alors dépassé le possible. Cette oeuvre était ainsi agencée sur fond d’or : une Vierge diadémée, rousse, à tête ronde, drapée de bleu, tenait sur ses genoux un enfant qui bénissait ces Mages dont deux agenouillés de chaque côté du trône ; l’un, un vieux à barbiche d’officier en retraite, aux cheveux roulés en copeaux sur l’oreille, était somptueusement accoutré de velours rouge broché d’or, et joignait les mains ; l’autre, un bellâtre à longs cheveux et à grande barbe, habillé d’une étoffe verte, orfrazée, et bordée de fourrures, élevait entre ses doigts un vase d’or. Et derrière chacun de ces deux hommes, d’autres personnages debout, brandissant des épées et des étendards, prenaient des attitudes cavalières, posaient pour le public, s’occupaient beaucoup plus des visiteurs que de la Vierge.
Alors, c’était ça, les Madones en fil de harpe, les Vierges sublimées de Cologne ! celle-là était bouffie, redondante, mafflue ; elle avait un cou de génisse et des chairs en crème, en tôt-fait, qui tremble quand on y touche. Jésus, dont l’expression était seule intéressante dans ce tableau, par une certaine gravité de petit homme, s’accusant sans dénaturer néanmoins le caractère de l’enfance, était, lui aussi, mol et replet ; et la scène se cantonnait sur un gazon semé de fleurs, de primevères, de violettes, de fraises, traitées par un miniaturiste, à petites lèches.
Il était tout ce que l’on voulait, ce tableau, de l’art lisse et ciré, froid sous sa couleur vive ; il était une oeuvre méticuleuse et brillante, adroite, mais nullement religieuse ; il sentait la décadence, le travail fignolé, le compliqué, le joli, et non le Primitif.
Cette Vierge commune et tassée n’était qu’une bonne allemande bien vêtue et honnêtement campée, mais jamais elle n’avait été la Mère exiasiée d’un Dieu ! — puis, ces gens agenouillés ou debout ne priaient pas : aucun recueillement dans ce panneau ; ces gens pensaient à autre chose, en croisant les mains et en regardant du côté du peintre qui les portraiturait. Quant aux volets, mieux valait ne pas les décrire. Que penser d’ailleurs de cette sainte Ursule, au front renflé tel qu’un verre de ventouse, au ventre de femme enceinte, flanquée d’autres créatures, déhanchées comme elle et trouant, avec des nez en pied de marmite, les vessies de graisse blanche qui leur servaient de face ?
Et cette impression réitérée, nette, de l’insens mystique, Durtal la retrouvait au musée de la ville. Là, il étudiait le devancier de Stephan Lochner, maître Wilhelm, le premier des Primitifs allemands dont on croit connaître le nom ; et il découvrait encore ce même côté rondouillard et appliqué du Dombild. La Vierge de Wilbelm était moins vulgaire que celle de la cathédrale, mais elle était d’intention fade, pourléchée, d’une joliesse plus résolue encore ; elle était le triomphe du délicat et du coquet, avait l’air d’une petite soubrette de théâtre, avec ses cheveux ondés sur le front ; et l’Enfant était tordu en une allure efforcée, caressant le menton de sa Mère, tournant la tête de notre côté, pour se mieux faire voir.
Somme toute, cette Vierge n’était ni humaine, ni divine ; elle n’avait même pas le côté trop réel de celle de Lochner, et pas plus qu’elle, elle ne pouvait être la Génitrice élue d’un Dieu.
Ils sont quand même surprenants ces Primitifs qui débutent par où la peinture finit, par la mignotise et le fondant, ces gens qui sucrent dès le premier jour le vin vert, qui se révèlent, sans énergie, sans impétuosité, sans naïveté, sans simplesse, sans foi qui jaillisse de leurs oeuvres ! Ils sont l’à rebours de toutes les écoles, car partout, en Italie, en Flandre, en Hollande, en Espagne, en Bourgogne, les panneaux commencèrent par être gauches et frustes, barbares et durs, mais ardents et pieux !
A scruter les autres toiles de ce musée, la masse des morceaux anonymes, les tableaux désignés sous le nom du maître de la Passion de Lyversberg, du maître de Saint-Bartholomé, Durtal arrivait à cette conclusion que l’école de Cologne n’avait acquis le sentiment mystique qu’après avoir subi l’influence des Flandres. Il avait fallu Van Eyck et surtout cet admirable Roger Van der Weyden pour insuffler une âme céleste à ces peintres. Ils avaient alors changé leur manière, imité la candide rigueur des Flamands, s’étaient assimilé leur tendre pitié, leur franchise et, en des hymnes ingénus, ils avaient, à leur tour, célébré la gloire de la Mère et pleuré le martyre du Fils.
Cette école colonaise, on peut la résumer ainsi, fit Durtal : elle est l’incontinence du capiton et du satiné, l’apothéose du roublard et du bouffi ; et cela n’a rien à voir avec l’art mystique, proprement dit.
Si l’on veut vraiment se rendre compte du tempérament personnel, entier, de la peinture religieuse allemande, ce n’est pas cette école, la seule dont on nous entretienne, la seule qui soit toujours vantée, qu’il sied de voir. Il convient de fouiller les maîtrises moins anciennes de la Franconie et de la Souabe ; là, c’est l’opposé ; l’art est abrupt et farouche, mais il vibre ; il pleure, il hurle même, mais il prie ! Il faut aller visiter des sauvages de génie, tels que Grünewald dont les Christ, tumultueux et féroces, crissent des dents à se les briser ou Zeitblom dont le voile de Véronique, au musée de Berlin, déplaît, avec ses anges qui ont des buffleteries noires sur la poitrine, et la tête terrible, atroce, de son Supplicié ; mais il est, malgré tout, si énergique, si décidé, si cru, celui-là, qu’il s’impose par la sincérité de sa laideur même !
Au fond, reprit Durtal, en négligeant au besoin de fiers peintres comme Grünewald, je préfère encore aux saindoux sucrés de Cologne, des inconnus dont le talent ne domine guère, dont les oeuvres sont plus bizarres que belles, mais qui sont mystiques au moins ! — Tel, cet anonyme qui figure à Gotha dans la collection du grand-duc et qui a tracé l’une de ces messes étranges que le moyen âge appelait, on ne sait trop encore pourquoi, messes de saint Grégoire.
Et Durtal, fouillant dans son calepin, parcourait la description notée de cet ouvrage dont le souvenir lui revenait ainsi qu’un mémorial de brutalité pieuse.
Cette peinture était ainsi ordonnée sur un champ d’or : un peu au-dessus d’un autel, le dépassant à peine, un tombeau de bois, une sorte de baignoire carrée s’élevait dont les deux bords étaient rejoints par une planche ; et, sur ce pont, un Christ aux jambes disparues dans ce sépulcre, était assis sur une fesse et tenait une croix. Il avait la face hâve et creuse, cernée d’une couronne d’épines vertes et le corps décharné était criblé de piqûres de puces par des points de verges. Autour de lui, en l’air, planaient dans le ciel d’or les instruments de sa torture : les clous, une éponge, un marteau, une lance ; puis, à gauche, tout petits, les bustes coupés de Jésus et de Judas, près d’un socle sur lequel s’alignaient en trois files des pièces d’argent.
Et, devant l’autel, adorant ce Sauveur vraiment affreux, conçu suivant les descriptions anticipées d’Isaïe et de David, le pape saint Grégoire à genoux, les mains jointes, était flanqué d’un cardinal grave, les bras sous sa robe, et d’un rude évêque debout, dans un manteau d’un vert foncé brodé d’or et portant une croix.
C’était énigmatique, et c’était sinistre, mais les visages impérieux et austères vivaient. Un accent de foi, fauve et têtue, sortait de ces faces : c’était âpre au goût, c'était le vin bleu de la mystique, mais ce n’était pas le sirop de flon des premiers peintres de Cologne !
Ah ! le souffle mystique qui fait que l’âme d’un artiste s’incorpore dans de la couleur, sur une toile, dans de la pierre sculptée, dans de l’écriture, et parle aux âmes des visiteurs aptes à le comprendre, combien le possédèrent ? ruminait Durtal, en fermant son carnet de voyage. En Allemagne, il a surgi chez les bandits de la peinture ; en Italie, si nous laissons, avec son élève Benozzo Gozzoli, le dernier peintre du moyen âge l’Angelico dont les oeuvres reflètent ses aîtres de saint, sont des projections colorées de sa vie intime ; si nous écartons aussi ses précurseurs, Cimabue, les restes figés de l’école byzantine, Giotto qui dégèle ces images immobiles et confuses, les Orcagna, Simone di Martino, Taddeo Gaddi, les vrais Primitifs, combien d’adroites supercheries de grands peintres singeant la note religieuse, l’imitant, à force de ruse, à s’y méprendre !
Plus que tous, les Italiens de la Renaissance ont excellé dans cet art de feindre ; et ils sont relativement rares, ceux qui, comme Botticelli, ont la franchise d’avouer que leurs Vierges sont des Vénus et leurs Vénus des Vierges. Le musée de Berlin, où il s’atteste en d’exquises et de triomphantes toiles, nous renseigne sur ce point, en nous montrant, côte à côte, les deux genres.
D’abord une Vénus extraordinaire, nue, aux cheveux d’or pur ramenés par une main sur le ventre, détache, sur un fond de noir d’encre de Chine, des chairs blanches, et nous regarde avec des yeux gris, noyés dans une eau qui se gâte, liserés par des paupières de petit lapin, des paupières roses ; elle a dû beaucoup pleurer et ce regard inconsolable, cette attitude navrée, suggèrent de lointaines pensées sur la lassitude inassouvie des sens, sur l’immense détresse des abominables souhaits que rien n’apaise.
Puis, non loin d’elle, une Vierge qui lui ressemble, qui est elle-même, avec son nez mobile un peu retroussé, sa bouche en forme de feuille repliée de trèfle, ses yeux saumâtres, ses paupières roses, ses cheveux d’or, son teint de chlorose, son corps robuste et ses mains fortes. La physionomie est pareille, dolente et fatiguée, et il est évident que le même modèle a posé les deux femmes. L’une et l’autre sont paîennes ; la Vénus se conçoit, mais la Vierge !
L’on peut constater aussi que, dans cette toile, une rangée d’anges céroféraires rend le sujet moins chrétien encore, s’il est possible, car ces êtres charmants, avec leurs sourires incertains et leurs gràces trop souples, ont les attraits dangereux des mauvais anges. Ils sont des Ganymèdes, issus de la mythologie, non de la Bible.
Ce que nous sommes avec le paganisme de Botticelli loin de Dieu ! se dit Durtal ; quelle différence, entre ce peintre et ce Roger Van der Weyden dont la Nativité resplendit dans une des salles voisines de cette superbe collection qu’est le vieux musée de Berlin.
Cette Nativité !
Peinte en tryptique, elle tenait, sur son volet de droite, à côté de quelques gens émerveillés et debout, un vieillard prosterné, encensant la Vierge, vue par la fenêtre ouverte, au-dessus d’un paysage fuyant en des allées qui ondulent, à l’infini ; et une femme, le chef coiffé d’une cornette, presque d’un turban, la face extasiée, touche d’une main l’épaule du vieillard et lève l’autre, en un indéfinissable geste de surprise et de joie. — Sur le volet de gauche, les trois Mages à genoux, les mains tendues, les yeux au ciel, contemplent un enfant qui rayonne dans une étoile et rien n’est plus beau que ces trois visages qui se transforment, qui prient de tout coeur, ceux-là, et sans s’occuper de nous !
Mais ces deux parties ne sont que les accessoires et le sujet central qu’elles assistent est régi de la sorte :
Au centre, devant un vague palais démoli, une espèce d’étable à colonnes dont le toit est en ruine, une Vierge prie, agenouillée devant l’Enfant ; à droite, dans la même posture, le donateur de l’oeuvre, le chevalier Bladelin et, à gauche, saint Joseph portant un petit cierge allumé, considèrent Jésus. Ajoutons six petits anges, trois en bas, à l’entrée de l’étable, et trois en l’air. Telle se combine, en son entier, la scène.
Il faut remarquer tout de suite que les orfèvreries, les teintures ramagées des tapis de l’Orient, les brocarts ourlés de vair et parsemés de gemmes dont Van Eyck et Memling usèrent si largement pour leurs vêtures de donateurs et de Vierges, n’existent pas dans ce panneau. Les étoffes sont de trame magnifique, mais sans les éclats des soies brugeoises et des laines persanes. Roger Van der Weyden semble avoir voulu réduire le décor à sa plus simple expression et il n’en a pas moins réussi à créer, en employant des couleurs dont la discrétion ne cherche pas à s’imposer, un chef-d’oeuvre de coloris clair et lucide.
Sans diadème, sans féronnière, sans un bracelet, sans un bijou, Marie, la tête simplement auréolée par quelques rais d’or, apparaît enveloppée d’une robe blanche montant jusqu’au col, d’un manteau d’azur dont les ondes se déroulent à terre et les manches de son habit de dessous, serrées aux poignets, sont d’un violet nourri de bleu, plus près du noir que du rouge. La figure est intraduisible, d’une beauté surhumaine sous ses longs cheveux roux ; le front est haut, le nez droit, les lèvres fortes et le menton petit ; mais les mots ne disent rien ; ce qui ne se peut rendre, c’est l’accent de candeur et de mélancolie, c’est la surgie d’amour qui jaillit de ces yeux baissés sur l’enfant minuscule et gauche, sur le Jesulus dont le chef est ceint d’un nimbe rose étoilé d’or.
Jamais Vierge ne fut et plus extra-terrestre et plus vivante. Ni Van Eyck, avec ses types un peu populaciers, laids en tout cas ; ni Memling, plus tendre et plus raffiné, mais confiné dans son rêve de femme à front bombé, à tête en cerf-volant, large du haut et mince du bas, n’ont atteint cette noblesse délicate de formes, cette pureté de la femme que l’Amour divinise et qui, même retirée du milieu où elle se trouve, même privée des attributs qui la font reconnaître, ne pourrait pas être une autre que la Mère d’un Dieu.
Près d’elle, le chevalier Bladelin, tout vêtu de noir, avec sa face chevaline, ses joues rases, son air à la fois sacerdotal et princier, s’abîme dans la contemplation, loin de tout ; ce qu’il prie bien, celui-là ! — et le saint Joseph qui lui sert de pendant, représenté sous les traits d’un vieillard chauve, à barbe courte et à manteau d’incarnat, — absolument pareil à celui que Memling a peint dans cette Adoration des Mages que possède l’hôpital Saint-Jean, à Bruges, — s’approche, étonné de son bonheur, n’osant croire que le moment soit venu d’adorer le Messie enfin né ; et il sourit, si déférent, si doux, marche avec des précautions presque maladroites de bon vieux qui voudrait bien être utile, mais craint de gêner.
Enfin, pour parachever la scène, au-dessus de Pierre Bladelin, un paysage merveilleux s’étend, coupé par la grande rue de la ville de Middelbourg, que ce seigneur fonda, une me bordée de châteaux à murs crénelés, de clochers d’églises, se perdant dans une campagne qu’éclaire un firmament léger, un jour limpide de printemps bleu ; — au-dessus de saint Joseph, une prairie et des bois, des moutons et des pâtres et trois anges exquis, en robes d’un jaune saumoné, d’un violet de campanule, d’un citrin tirant sur le vert, trois êtres vraiment immatériels, n’ayant aucun rapport avec ces pages si perversement candides qu’inventa la Renaissance.
Évidemment, si l’on résume l’impression de cette oeuvre, l’on est amené à conclure que l’art mystique demeurant encore sur la terre, ne se passant plus seulement en plein ciel, comme le voulut dans son Couronnement de la Vierge l’Angelico, a produit, avec le tryptique de Roger Van der Weyden, l’exoration colorée la plus pure qui soit dans la peinture. Jamais la Théophanie n’a été plus splendidement célébrée et, l’on peut dire aussi, plus naïvement et plus simplement rendue ; le chef-d’oeuvre de la Noël est à Berlin, de même que le chef-d’oeuvre de la descente de croix est à Anvers, dans la douloureuse, dans la splendide page de Quentin Metsys !
Les Primitifs des Flandres ont été les plus grands peintres du monde, se dit Durtal ; et ce Roger Van der Weyden ou ce Roger de la Pasture, ainsi que d’autres le nomment, écrasé entre le renom de Van Eyck et de Memling, comme le furent également, plus tard, Gérard David, Hugues Van der Goes, Juste de Gand, Thierry Bouts, est, suivant moi, supérieur à tous ces peintres.
Oui, mais après eux, si nous exceptons le dernier des gothiques flamands, ce délicieux Mostaert dont les deux Épisodes de la vie de saint Benoît magnifient, à Bruxelles, les salles du musée, quelle décadence ! ce sont les crucifixions théâtrales, les grosses viandes de Rubens que Van Dyck s’efforce d’alléger en les dégraissant. Il faut sauter en Hollande pour retrouver l’accent mystique et alors il s’avère en une âme de protestant hébraïsé, sous un jour, si mystérieux, si fantasque, que l’on se tâte tout d’abord pour savoir si, en j ugeant cette peinture religieuse, l’on ne se trompe pas.
Et point n’est besoin de remonter jusqu’à Amsterdam pour se certifier la vérité de son impression. Il suffit d’aller voir les Pèlerins d’Emmaüs, au Louvre.
Et Durtal, parti dans son sujet, se mit à rêver sur l’étrange conception d’esthétique chrétienne de Rembrandt. Évidemment, dans les scènes qu’il traduit des Évangiles, ce peintre exhale surtout une odeur de Vieux Testament ; son église, même s’il voulait la peindre telle qu’elle fut de son temps, serait une synagogue, tant la caque juive sent fort dans son oeuvre ; les préfigures, les prophéties, tout le côté solennel et barbare de l’Orient le hantent. Et cela s’explique si l’on sait qu’il fréquenta des rabbins dont il nous a laissé les portraits, qu’il fut l’ami de Menasseh-ben-Israël, l’un des hommes les plus savants de son siècle ; l’on peut admettre, d’autre part, que, sur ce fond de science cabaliste et de cérémonies mosaïques, se greffe chez ce protestant l’étude attentive, la lecture assidue de l’Ancien Livre, car il possédait une Bible qui fut, avec ses meubles, vendue à la criée, pour payer ses dettes.
Ainsi se justifierait le choix de ses sujets, l’agencement même de ses toiles, mais l’énigme n’en subsiste pas moins des résultats obtenus par un artiste que l’on ne s’imagine pas, malgré tout, priant, tel que l’Angelico et Roger Van der Weyden, avant de peindre.
Quoi qu’il en soit, avec son oeil de visionnaire, son art ardent et pensif, son génie à condenser, à concentrer de l’essence de soleil dans de la nuit, il a atteint des effets grandioses, et dans ses scènes bibliques, parlé un langage que personne n’avait même balbutié avant lui.
Les Pèlerins d’Emmaüs ne sont-ils pas, à ce point de vue, typiques ? Décomposez l’oeuvre, elle devrait être plate et monotone, sourde. Jamais ordonnance ne fut plus vulgaire : une sorte de caveau de pierres de taille, une table en face de nous, derrière laquelle Jésus, les pieds nus, les lèvres terreuses, le teint sale, les vêtements d’un gris rosâtre, rompt le pain, tandis qu’à droite un apôtre étreint sa serviette, le regarde, croit le reconnaître, — qu’à gauche, un autre apôtre le reconnaît, lui, et joint les mains ; et celui-là pousse un cri de joie que l’on entend ! — Enfin, un quatrième personnage, au profil intelligent, ne voit rien et sert, attentif à sa besogne, les convives.
C’est un repas de pauvres gens dans une prison ; les couleurs se confinent dans la gamme des gris tristes et des bruns ; à part l’homme qui tord sa serviette et dont les manches sont empâtées d’un rouge de cire à cacheter, les autres semblent peints avec de la poussière délayée et du brai.
Ces détails sont exacts et cependant rien de tout cela n’est vrai, car tout se transfigure. Le Christ s’illumine, radieux, rien qu’en levant les yeux ; un pâle éblouissement remplit la salle. Ce Jésus si laid, à la mine de déterré, aux lèvres de mort, s’affirme en un geste, en un regard d’une inoubliable beauté, le Fils supplicié d’un Dieu !
Et l’on demeure abasourdi, n’essayant même plus de comprendre, car cette oeuvre d’un réalisme surélevé est hors et au-dessus de la peinture et personne ne peut la copier, ne peut la rendre...
Après Rembrandt..., poursuivit Durtal, c’est l’irrémédiable déchéance de l’impression religieuse dans l’art. Le dix-septième siècle n’a d’ailleurs laissé aucun panneau dont l’aloi de mâle dévotion soit sûr, sauf cependant, au temps de sainte Térèse et de saint Jean de la Croix, en Espagne, car alors le naturalisme mystique de ses peintres enfanta de farouches et de ferventes oeuvres ; et Durtal se remémorait un tableau de Zurbaran qu’il avait autrefois admiré au musée de Lyon, un saint François d’Assise, droit, dans une robe de bure grise, la tête encapuchonnée, les mains ramenées dans ses manches.
Le visage paraissait modelé, creusé dans de la cendre et la bouche béait, livide, sous des yeux en extase, blancs, comme crevés. L’on se demandait comment ce cadavre qui n’avait plus que les os tenait debout et l’effroi venait, en songeant aux exorbitantes macérations, aux épouvantables pénitences qui avaient exténué ce corps et labouré les traits douloureux et ravis de cette face.
Cette peinture dérivait évidemment de l’âpre et de la terrible mystique de saint Jean de la Croix ; c’était de l’art de tortionnaire, le delirium tremens de l’ivresse divine, ici bas ; oui, mais quel accent d’adoration, quel cri d’amour, étouffé par l’angoisse, jaillissaient de cette toile !
Quant au dix-huitième siècle, il n’y avait même pas à s’en occuper ; ce siècle fut une époque de bedon et de bidet et, dès qu’il voulut toucher au culte, il fit d’un bénitier une cuvette.
Dans le moderne, il n’y a non plus rien à chercher ; les Overbeck, les Ingres, les Flandrin furent de blêmes haridelles attelées à des sujets de commande pieux ; dans l’église Saint-Sulpice, Delacroix écrase tous les peinturleurs qui l’entourent, mais son sentiment de l’art catholique est nul.
Et il en est de même de ceux de nos artistes contemporains qui peignent indifféremment des Junon et des Vierges, qui décorent, tour à tour, des plafonds de palais et de cabarets et des chapelles ; la plupart n’ont pas la foi et, à tous, le sens de la mystique manque.
Il n’y a donc pas à se soucier, ici, de ces intermittents, pas plus qu’il n’y a à tenir compte des plaisanteries intéressées et des panneaux pour gobemouches des Rose-Croix, pas plus encore qu’il n’y a même à noter la petite imagerie fabriquée par de jeunes roublards ou de bons jeunes gens qui se figurent qu’en dessinant des femmes trop longues ils sont mystiques.
En restreignant alors nos recherches aux spécialistes assermentés de l’Église, nous découvrons quoi ? Hélas ! la situation est au premier abord telle : Signol est mort, mais Olivier Merson nous reste ; c’est le néant sur toute la ligne. Mieux vaudrait donc se taire, si subitement l’idée n’était venue à un éditeur bien pensant de mobiliser les forces du parti clérical pour faire acclamer, comme peintre d’un renouveau chrétien, James Tissot, dont la biographie de Notre-Seigneur est une des oeuvres les moins religieuses qui soient ; et, en effet, son Christ fleure je ne sais quelle odeur de protestantisme, quel relent de temple, — pis même, — car dans cet ouvrage Il n’est plus qu’un homme. Il y a certainement maldonne ; ces aquarelles, ces croquis, devraient illustrer la Vie de Jésus de Renan et non les Évangiles.
Sous prétexte de réalité, de renseignements pris sur les lieux, de costumes authentiques, le tout fort discutable, puisqu’il faudrait admettre que, dans dix-neuf siècles, en Palestine, rien n’a changé, M. Tissot nous a présenté la mascarade la plus vile que l’on ait encore osé entreprendre des Écritures. Voyez cette dondon, cette fille de la rue qui, éreintée de crier : « A la moule, à la barque ! » se trouve mal, c’est le Magnificat, c’est la Sainte Vierge ; ce môme épileptique qui bat l’air avec ses bras, c’est l’Enfant au Temple ; ces larves qui veillent auprès d’un médium en transe, ces apparitions que l’on pourrait croire issues des agissements de la sorcellerie et des pratiques du spiritisme, ce sont des Anges assistant le Sauveur. — Voyez le Baptême du Messie, le Pharisien et le Publicain, le Massacre des Innocents ; voyez tout le côté ganache et mélo de son Calvaire ; voyez-les toutes, ces planches, elles sont d’une platitude, d’une veulerie, d’une indigence de talent que rien n’égale ; elles sont dessinées par n’importe qui, peintes avec de la fiente, de la sauce madère, du macadam !
La maison Mame — il est bon de le dire à la fin — a témoigné de son insens irréductible de l’art, en aidant à propager, à force d’argent, la basse faconde de ce peintre.
Il n’y a donc rien, plus rien à l’actif de l’Église ! se cria Durtal. Cependant, l’on comptait quelques essais d’ascèse picturale dans ce siècle. Il y avait de cela un certain nombre d’années, la congrégation bénédictine de Beuron, en Bavière, avait tenté une rénovation de l’art ecclésial, et Durtal se souvenait d’avoir feuilleté des reproductions de fresques peintes par ces moines sur les murs d’une tour du Mont-Cassin.
Ces fresques reportaient à l’imagerie de l’Assyrie et de l’Égypte, avec leur Dieu tiaré, leurs anges à bonnets de sphinx, à ailes ramenées en éventail derrière la tête, leurs vieillards à barbes nattées, jouant des instruments à cordes ; puis les moines de Beuron avaient délaissé ce genre hiératique dans lequel ils s’étaient montrés, il faut bien le déclarer, médiocres et, dans de nouvelles oeuvres, principalement dans un Chemin de croix publié en album à Fribourg-en-Brisgau, ils avaient adopté une étrange combinaison d’autres styles.
Les soldats romains qui figuraient sur ces pages étaient d’affligeants pompiers, originaires de l’école de Guérin et de David ; mais subitement, sur quelques feuilles, là où paraissaient la Magdeleine et les saintes femmes, une formule plus jeune intervenait, mêlant à la rengaine des groupes, des types de femmes grecques de la Renaissance, élégantes et jolies, visiblement échappées des oeuvres des préraphaélites, se recommandant surtout de Walter Crane.
L’idéal de Beuron était alors devenu un alliage de l’art français du premier Empire et de l’art anglais moderne.
D’aucunes de ces planches frisaient le ridicule, celle de la neuvième station, pour en citer une ; le Christ couché de son long, sur le ventre, était relevé par les mains jointes, soutenu par une corde ; il avait l’air d’apprendre à nager ; mais pour des parties banales et faibles, pour des détails gauches et prévus, quels morceaux curieux se détachaient soudain de cet ensemble ! — La Véronique à genoux devant Jésus était vraiment pâmée de douleur et d’amour, vraiment belle ; les copies, les décalques des autres personnages disparaissaient et, même dans les pages les moins originales, le dessin pataud et déplaisant de ces moines se mettait à parler une langue presque éloquente ; c’est qu’il sortait de cette oeuvre une foi et une ferveur intenses. Un souffle passait sur ces visages et les vivifiait ; une émotion, un accent de prière animaient le silence de ces poncifs ; ce Chemin de croix était, à ce point de vue, sans égal ; la piété monastique apportait un élément inattendu, affirmait la mystérieuse puissance dont elle dispose, en imprégnant, d’une saveur personnelle, d’une senteur particulière, une oeuvre qui n’eût même pas existé sans elle. Plus que des artistes d’une autre envergure, ces bénédictins suggéraient la sensation de l’à-genoux, évoquaient le parfum des Évangiles.
Seulement leur tentative était restée sans issue et, à cette heure, l’école, à peu près morte, ne produisait plus que de débiles images de pieusarderie, fabriquées par des convers.
Comment, d’aîlleurs, cet essai eût-il pu naître viable ? L’idée de vouloir faire pour l’Occident ce que Manuel Panselinos avait fait pour l’Orient, supprimer l’étude d’après nature, exiger un rituel uniforme de couleurs et de lignes, vouloir forcer des tempéraments d’artistes à entrer tous dans le même moule, dénotait, chez celui qui risqua cet effort, une incompréhension absolue de l’art. Ce système devait aboutir à l’ankylose, à la paralysie de la peinture et tels furent, en effet, les résultats atteints.
Presque au même temps que ces religieux, un artiste inconnu vivant en province et n’exposant jamais à Paris, Paul Borel, peignait des tableaux pour les églises et pour les cloîtres, travaillait pour la gloire de Dieu, ne voulant accepter, des prêtres et des moines, aucun salaire.
Au premier abord, ses panneaux n’étaient ni juvéniles, ni prévenants ; les locutions dont il usait eussent fait quelquefois sourire les gens épris de modernisme ; puis il convenait, pour bien juger son oeuvre, d’en écarter résolument une partie et de ne conserver que celle qui s’exonérait des formules par trop éventées d’une onction connue, et alors quel souffle de mâle zèle, d’ardente dévotion, la soulevait, celle-là !
Son oeuvre principale était enfouie dans la chapelle du collège des dominicains à Oullins, dans un coin perdu de la banlieue de Lyon. Parmi les dix tableaux qui paraient la nef, figuraient : Moïse frappant le rocher, les Disciples d’Emmaüs, la Guérison d’un possédé, de l’aveugle-né, de Tobie; mais malgré la placide énergie de ces fresques, l’on était quand même déçu par la lourdeur de l’ensemble, par l’aspect soporeux et désuet des tons. Il fallait arriver au choeur et franchir la barre de communion pour admirer des oeuvres d’un concept très différent, surtout des portraits magnifiques de saints de l’ordre des frères-prêcheurs, étonnant par la force de prières, par la puissance de sainteté qui rayonnaient d’eux.
Là aussi, se trouvaient deux grandes compositions, une Vierge remettant le rosaire à saint Dominique et une autre effigiant saint Thomas d’Aquin, à genoux devant un autel, sur lequel un crucifix darde des lueurs ; et jamais, depuis le moyen âge, l’on n’avait ainsi compris et peint des moines ; jamais l’on n’avait montré, sous l’écorce rigide des traits, une sève plus impétueuse d’âme. Borel était le peintre des saints monastiques ; son art, d’habitude un peu lent, s’essorait dès qu’il les approchait et planait avec eux.
Mieux encore, peut-être, que dans le pensionnat des élèves d’Oullins, l’on pouvait, à Versailles, se rendre compte de la peinture si probe, si foncièrement religieuse de ce Borel.
A l’entrée de la chapelle des Augustines de cette ville, dont il avait décoré le vaisseau et le choeur, une abbesse du quatorzième siècle, sainte Claire de Montefalcone, se découpait, debout, vêtue du noir costume des Augustines, sur les murs en pierre d’une cellule, entre un livre ouvert et une lampe de cuivre, placés derrière elle, sur une table.
Dans ce visage baissé sur le crucifix qu’elle porte à ses lèvres, dans cette physionomie tout à la fois douce et avide, dans le mouvement de ces bras ramenés sur la poitrine, remontés jusqu’à la bouche, dessinant euxmemes, par la position des mains, une sorte de croix, il y avait l’anéantissement ravi de l’épouse, l’allégresse absorbée de l’amour pur et aussi quelque chose de l’inquiète affection d’une mère dorlotant, comme un enfant qui souffre, ce Christ qu’elle baisait et semblait bercer sur son giron.
Et cela ordonné, sans attitude théàtrale, sans gestes efforcés, très simplement. Elle n’a point, de même que sainte Madeleine de Pazzi, des élans et des cris, elle ne s’élève pas dans le vol de l’ébriété divine, cette sainte Claire ! L’emprise céleste se manifeste chez elle à l’état muet ; ses transports se contiennent et son ivresse est grave; elle ne s’épand pas au dehors, mais se creuse, et Jésus qui descend en elle la marque à son coin, la poinçonne avec l’image de ce crucifix qu’elle tient et dont on aperçut l’empreinte gravée dans son coeur, lorsqu’on l’ouvrit après sa mort.
La peinture religieuse la plus surprenante de notre temps était là ; et elle avait été obtenue sans pastiche des Primitifs, sans tricheries de corps gauches cernés par des fils de fer, sans apprêt et sans dols. Mais quel catholique pratiquant, quel artiste éperdu de Dieu devait être l’homme qui avait peint une telle oeuvre !
Et après lui, tout se taisait. Dans la jeunesse religieuse d’aujourd’hui, on ne voit personne qui soit de taille à se mesurer avec les sujets de l’Église ; un seul paraît pourtant donner quelques espérances, dit Durtal qui réfléchissait, car celui-là sort de ses congénères, a du talent au moins. Et il se mit à feuilleter dans ses cartons, regarda les lithographies de Charles Dulac.
Ce peintre s’était révélé avec une suite de paysages, d’une nature idéalisée, encore hésitante, pleine de bassins agrandis et de futaies dont les feuillages étaient pareils à des tignasses brouillées par un coup de vent ; puis, il avait entrepris une interprétation du Cantique du Soleil ou des Créatures et, en neuf planches tirées en des états différents de tons, il avait efflué ce sentiment mystique qui demeurait encore latent et confus dans son premier recueil.
La définition un peu fatiguée que le paysage est « un état d’âme » s’adaptait cependant très justement à cette oeuvre ; l’artiste avait imprégné de sa foi ces sites, copiés sans doute sur nature, mais vus surtout, en dehors des yeux, par une âme éprise, chantant dans le grand air, le cantique de Daniel et le psaume de David, redits par saint François, et, répétant, à son tour, après eux, ce thème que les éléments doivent célébrer la gloire de Celui qui les créa.
Parmi ces planches, il en était deux vraiment expansives, celle désignée par ce titre : Stella matutina, l’autre, par cette indication : Spiritus sancte Deus, mais une troisième, la plus ample, la plus délibérée, la plus simple de toutes, celle inscrite sous l’intitulé : Sol Justitiae, résumait mieux encore l’apport personnel de ce peintre.
Elle était ainsi conçue :
Un paysage blond, clair, transparent, fuyait à l’infini, un paysage de péninsule, d’eau solitaire, sillonné de plages, de langues de terre plantées d’arbres que réfléchissait le miroir couché des lacs ; au fond le soleil dont l’orbe, tranché par l’horizon, rayonnait, réverbéré par la nappe de ces eaux ; c’était tout et une tranquillité, un calme, une plénitude extraordinaires s’épandaient de ce site. L’idée de la justice à laquelle répond comme un inévitable écho l’idée de la miséricorde se symbolisait dans la gravité sereine de ces étendues qu’éclairaient les lueurs d’une saison indulgente, d’un temps doux.
Durtal se recula pour mieux saisir l’oeuvre, dans son ensemble. Il n’y a pas à dire, fit-il, cet artiste a l’instinct, le tact, des surfaces aériennes, des espaces ; la compréhension des ondes reposées coulant sous d’immenses ciels ! et puis, il s’échappe, de cette planche, des effluves d’âme catholique, qui s’insinuent en nous et lentement nous pénètrent...
Avec cela, reprit-il, en fermant le carton, me voici loin de mon sujet et je ne vois pas du tout l’article à brasser pour la Revue. Préparer une étude sur les Primitifs allemands, cela rentrerait bien dans son cadre, oui, mais quel aria ! il me faudrait développer mes notes, et après maître Wilhelm, Stephan Lochner, Grünewald, Zeitblom, aborder Bernard Strigel, un maître presque inconnu, Albert Dürer, Holbein, Martin Schongauer, Hans Baldung, Burgkmaier, combien d’autres ! il me faudrait expliquer ce qui a pu rester d’impression orthodoxe en Allemagne après la Réforme, parler au moins, au point de vue luthérien, de cet étonnant Cranach dont les Adam sont des Apollon barbus à teint de peau-rouge, et les Ève des courtisanes maigriotes et bouffies, avec des têtes rondes à petits yeux de crevettes, des lèvres modelées dans de la pommade rosat, des seins en pommes remontées près du cou, des jambes déliées, longues, fines, avec mollets hauts et pieds à chevilles fortes, grands et plats. Ce travail m’entraînerait trop loin. C’est amusant à rêver mais pas à écrire ; je ferais mieux de chercher un autre sujet moins panoramique et plus bref ; mais lequel ? je verrai cela plus tard, conclut-il, en se levant, car Mme Mesurat annonçait, joviale, que le dîner était prêt.