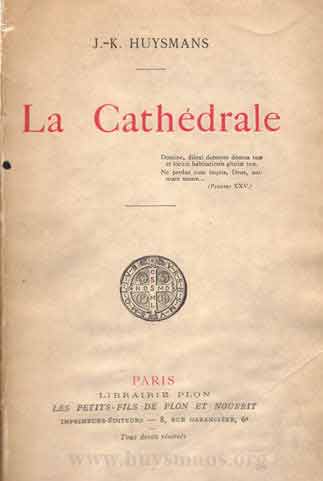CET entretien fut utile à Durtal ; il le sortit des généralités sur lesquelles il s’entêtait à rêvasser depuis son arrivée à Chartres. L’abbé l’avait orienté, en somme, en lui montrant une voie navigable précise, menant à un but désigné, à un port connu de tous. Le cloître resté dans l’imagination de Durtal à l’état confus, hors du temps, sans lieu ni date, n’empruntant au souvenir vécu de la Trappe que la sainteté de son obédience, pour leur adjoindre aussitôt la chimère d’une abbaye, plus littéraire, plus artiste, régie par des règles conciliantes, dans un milieu plus doux, ce cloître idéal, fabriqué de bric de réalité et de broc de rêve, se définissait maintenant. En parlant d’un ordre qui existait, en le citant par son nom, en spécifiant même une maison de son observance, l’abbé Gévresin fournissait à Durtal une substantielle pâture, pour la manie raisonneuse de son verbiage ; il le mettait en mesure de ne plus mâcher, ainsi qu’il le faisait depuis si longtemps, à vide.
L’état d’incertitude et de vague dans lequel il vivait cessa ; il discernait une fin à ses collisions ; le choix se limitait : ou demeurer à Chartres ou s’en aller à Solesmes ; et, sans arrêt, il se mit à relire, à méditer l’oeuvre de saint Benoît.
Cette règle, qui se compose surtout de paternelles injonctions et d’affectueux conseils, était une merveille de mansuétude et d’adresse. Tous les besoins de l’âme y étaient tracés et les misères du corps prévues. Elle savait si bien, tout en demandant beaucoup, ne pas exiger trop, qu’elle avait pu plier sans se rompre, satisfaire aux nécessités des diverses époques, se conserver au dix-neuvième siècle, telle qu’au moyen âge.
Puis ce qu’elle était compatissante et sage, lorsqu’elle présageait des débiles et des infirmes. « On servira les malades comme s’ils étaient le Christ en personne », dit saint Benoît ; et le souci qu’il prend de ses fils, les pressantes recommandations qu’il adresse aux abbés, de les aimer, de les visiter, de ne rien négliger pour alléger leurs maux, décèle tout un côté de maternité vraiment touchant chez le patriarche.
Oui, mais.... murmura Durtal, il y a, dans cette règle, d’autres articles qui paraissent moins accessibles à des mécréants de ma sorte, celui-ci par exemple : « Que personne n’ait la témérité de donner ou de recevoir quelque chose sans l’autorisation de l’abbé, d’avoir quoi que ce soit en propre, aucune chose absolument, ni un livre, ni des tablettes, ni un poinçon, en un mot rien du tout, puisqu’il ne leur est même pas permis de posséder ni leurs corps, ni leurs volontés. »
C’est le terrible verdict du renoncement et de l’obéissance, soupira-t-il ; seulement, cette loi qui gouverne les pères et les convers, atteint-elle aussi rigoureusement les oblats, ces égrotants de l’armée bénédictine dont je pourrais peut-étre faire partie, mais dont le texte ne parle point... ce serait à voir ; puis il siérait aussi de connaître la manière dont on l’applique, car elle est, dans son ensemble, si habile et si souple, si large, qu’elle sait être, au choix, très clémente ou très dure.
Ainsi, dans les Trappes, ses ordonnances sont si serrées qu’on y étouffe ; chez les bénédictins, au contraire, elles sont assez aérées pour que l’âme parvienne à y respirer à l’aise. Les uns s’en tiennent scrupuleusement à la lettre, les autres, au contraire, s’inspirent surtout de l’esprit du saint.
Avant de s’aiguiller sur cette voie, il faut consulter l’abbé Plomb, conclut Durtal. Il se rendit chez le vicaire, mais il était absent pour plusieurs jours.
Par précaution contre l’oisiveté, par mesure d’hygiène spirituelle, il voulut se ruer à nouveau sur la cathédrale et il tenta, maintenant qu’il était moins obsédé par des songeries, de la lire.
Le texte de pierre qu’il s’agissait de comprendre était sinon difficile à déchiffrer, au moins embarrassant par des passages interpolés, par des répétitions, par des phrases disparues ou tronquées ; pour tout dire, aussi, par une certaine incohérence qui s’expliquait du reste, quand on constatait que l’oeuvre avait été poursuivie, altérée ou augmentée, par différents artistes, pendant un espace de plus de deux cents ans.
Les imagiers du treizième siècle n’avaient pas toujours tenu compte des idées déjà exprimées par leurs devanciers et ils les reprenaient, les émettaient dans leur langue personnelle, doublaient, par exemple, les signes des saisons et du zodiaque. Les statuaires du douzième siècle avaient sculpté, sur la façade royale, un calendrier de pierre ; ceux du treizième en gravèrent un également dans la baie de droite du porche nord, justifiant sans doute cette réduplication d’une même scène sur une même église, par ce fait que le zodiaque et les saisons peuvent avoir, au point de vue symbolique, plusieurs sens.
D’après Tertullien, l’on distinguait, dans le cercle mourant et renaissant d’années, une image de la Résurrection, à la fin du monde. Suivant d’autres versions, le soleil entouré de ses douze signes était la figure du Soleil de Justice entouré de ses douze apôtres. L’abbé Bulteau croit, de son côté, reconnaître, dans ces almanachs lapidaires, la traduction du passage de saint Paul affirmant aux Hébreux que « ce Jésus, qui était hier, est encore aujourd’hui et sera toujours dans tous les siècles des siècles », tandis que l’abbé Clerval donne cette explication plus simple : « que tous les temps appartiennent au Christ et doivent le glorifier. »
Mais cela n’est qu’un détail, se disait Durtal ; l’on peut vérifier dans l’ensemble même de la cathédrale de doubles emplois.
En somme, l’oeuvre architectonique de Chartres se divise, extérieurement, en trois grandes parties qui sont décrétées par trois grands porches. Le porche de l’Occident, dit porche Royal, qui est l’entrée solennelle du sanctuaire, entre les deux tours ; le porche du Nord attenant à l’évêché et précédé de la flèche neuve ; le porche du Midi, flanqué de la vieille tour.
Or, les sujets traités par le porche Royal et par le porche Sud sont similaires ; l’un et l’autre célèbrent le triomphe du Verbe, avec cette différence qu’au portail Méridional, Notre-Seigneur n’est plus seulement exalté par Lui-même, ainsi qu’au portail de l’Occident, mais aussi dans la personne de ses élus et de ses saints.
Si, à ces deux sujets qui peuvent se réunir en un seul, le Sauveur glorifié en Lui-même et dans les siens, nous ajoutons le panégyrique de la Vierge que prononce le portail du Nord, nous aboutissons à ces fins : à un poème chantant la louange de la Mère et du Fils, publiant la raison d’être de l’Église même.
En étudiant de près les variantes des portiques de l’Occident et du Sud, on observe que si Jésus bénit, d’un geste uniforme, dans l’un comme dans l’autre, la terre, que si tous deux se confinent presque exclusivement dans la reproduction des Évangiles, abandonnant la traduction de l’Ancien Testament aux baies du Nord, ils n’en varient pas moins entre eux et sont également distincts des porches des autres cathédrales.
Contrairement aux rituels mystiques presque partout suivis, à Notre-Dame de Paris, à Bourges, à Amiens, pour en citer trois, le Jugement dernier, qui pare l’entrée principale de ces basiliques, est relégué sur le tympan de la porte du Midi, à Chartres.
De même, pour la tige de Jessé ; à Amiens, à Reims, à la cathédrale de Rouen, elle s’élève au portail Royal, mais elle pousse au septentrion, ici ; et combien d’autres déplacements que l’on pourrait encore noter ! Mais ce qui n’est pas moins étrange, c’est que le parallélisme des scènes qui se remarque si souvent à l’envers et à l’endroit de la même muraille, ciselé dans la pierre, d’un côté, et peint sur vitre de l’autre, n’existe pas régulièrement à Chartres. Ainsi, l’arbre généalogique du Christ est planté dans une verrière interne du porche Royal, tandis que son espalier s’étend en sculpture, sur les parois externes du portique Nord. Seulement, si parfois les sujets ne concordent point au recto et au verso de la même page, souvent ils se complètent ou se suppléent. Tel le Jugement dernier qui ne se déroule pas au dehors de la façade Royale, mais qui resplendit à l’intérieur, dans la grande rosace évidée dans le même mur. Il n’y a donc point, dans ce cas, cumul, mais appoint, histoire commencée dans un dialecte et achevée dans un autre.
Enfin, ce qui domine tous ces dissentiments ou ces ententes, c’est l’idée maîtresse du poème, disposée ainsi qu’un refrain après chacune des strophes de pierre, l’idée que la cathédrale appartient à notre Mère ; l’église reste fidèle à son vocable, féale à sa dédicace. Partout la Vierge est suzeraine. Elle occupe tout le dedans et à l’extérieur même, dans ces deux portails de l’Occident et du Sud qui ne lui sont pas réservés, Elle apparaît encore, dans un coin, sur un dessus de porte, dans des chapiteaux, en haut d’un fronton, en l’air. La salutation angélique de l’art a été répétée sans interruption par les imagiers de tous les temps. Jamais cette pieuse filière ne fut rompue. La basilique de Chartres est bien le fief de Notre-Dame.
En somme, se dit Durtal, malgré les dissidences de quelques-uns de ses textes, la cathédrale est lisible.
Elle contient une traduction de l’Ancien et du Nouveau Testament ; elle greffe en plus sur les Écritures Saintes les traditions des apocryphes qui ont trait à la Vierge et à saint Joseph, les vies des saints recueillies dans la Légende dorée de Jacques de Voragine et les monographies des Célicoles du diocèse de Chartres.
Elle est un immense dictionnaire de la science du moyen âge, sur Dieu, sur la Vierge et les élus.
Aussi Didron a-t-il presque raison d’avancer qu’elle est un décalque de ces grandes encyclopédies, telles que le treizième siècle en composa ; seulement, la thèse qu’il étaie sur cette observation véridique, dévie, devient, dès qu’il tâche de la développer, inexacte.
Il finit, en effet, par imaginer que la basilique est une simple version du Speculum Universale, du Miroir du monde de Vincent de Beauvais, qu’elle est surtout, de même que ce recueil, un précis de la vie pratique et un commentaire de la race humaine à travers les âges. Le fait est, se dit Durtal qui alla chercher dans sa bibliothèque l’Iconographie chrétienne de cet auteur, le fait est qu’à l’entendre, nos feuillets de pierre doivent se tourner de la sorte : s’ouvrir par le chapitre du Nord pour se fermer sur les alinéas du Sud. Alors, l’on y trouve, selon lui, narrés : d’abord la Genèse, la cosmogonie biblique, la création de l’homme et de la femme, l’Éden ; ensuite, après l’expulsion du premier couple, le récit de son rachat et de ses peines.
De là, assure-t-il : « le sculpteur prit occasion d'enseigner aux Beaucerons la manière de travailler des bras et de la tête. Donc, à droite de la chute d’Adam, il sculpte sous les yeux et pour la perpétuelle instruction de tous, un calendrier de pierre, avec tous les travaux de la campagne, puis un catéchisme industriel avec les travaux de la ville ; enfin, pour les occupations intellectuelles, un manuel des arts libéraux. »
Et alors, ainsi instruit, l’homme vit, de générations en générations, jusqu’à la fin du monde, notifiée par le tableau placé au sud.
Ce répertoire de sculpture comprendrait donc un mémorial de l’histoire de la nature et de la science, un glossaire de la morale et de l’art, une biographie de l’être humain, un panorama du monde entier. Il serait bien, en conséquence, une image du Miroir du monde, un tirage sur pierre de l'oeuvre de Vincent de Beauvais.
Il n’y a qu’un malheur à cela, c’est d’abord que le Spéculum Universale de ce dominicain serait postérieur de plusieurs années à la construction de cette cathédrale, ensuite, que Didron ne s’inquiète nullement des valeurs et des distances de la statuaire, dans sa thèse. Il attribue à une statuette enfouie dans le cordon d’une voussure une importance égale à celles des grandes statues qui émergent bien en évidence et accompagnent l’image en relief de Notre-Seigneur et de sa Mère. On peut même affirmer que ce sont justement ces statues-là qu’il omet, comme il délaisse également tout le portique de l’Occident qu’il ne pouvait insérer de force dans son système.
Au fond, les idées de cet archéologue titubent. Il subordonne le principal aux accessoires et il aboutit à une espèce de rationalisme, en complet désaccord avec la mystique de ces temps. Il médit du moyen âge, en rabaissant le niveau du divin à l’étiage terrestre, en rapportant à l’homme ce qui revient à Dieu. L’oraison de la sculpture, chantée par des siècles de foi, ne devient plus, dans l’introduction de son volume, qu’une encyclopédie de renseignements industriels et moraux quelconques.
Examinons cela de près, poursuivit Durtal, qui descendit fumer une cigarette sur la place. Ce portail Royal, ruminait-il en chemin, il est l’entrée de la façade d’honneur, celui par lequel pénétraient les rois. Il est également le premier chapitre du livre et il résume, à lui seul, l’édifice !
Elles sont tout de même bizarres, ces conclusions précédant les prémisses, cette récapitulation disposée au commencement de l’ouvrage, alors qu’elle devrait, en bonne logique, être à l’abside, être à la fin.
Au fond, se dit-il, cette question-là mise à part, la façade ainsi conçue occupe, dans cette basilique, la place que le second des Livres sapientiaux tient dans la Bible. Elle correspond au Psautier qui est en quelque sorte un abrégé, une somme de tous les volumes du Vieux Testament et, par conséquent, aussi, un memento prophétique de la religion révélée tout entière.
Telle la partie de la cathédrale située à l’Occident ; seulement, elle, elle est un compendium non plus des Anciennes Écritures, mais des Nouvelles ; elle est un épitome des Évangiles, un concis des livres de saint Jean et des synoptiques.
Et, en la bâtissant, le douzième siècle a fait plus. Il a ajouté de nouveaux détails à cette glorification du Christ, suivi de sa naissance à travers la Bible et mené, jusque après sa mort, à son apothéose telle que la promulgue l’Apocalypse ; il a complété les Écritures par les apocryphes, en nous racontant l’histoire de saint Joachim et de sainte Anne, en nous confiant maint épisode du mariage de la Vierge et de Joseph, tiré de l’évangile de la Nativité de sainte Marie et du protévangile de Jacques le Mineur.
Au reste, tous les sanctuaires d’antan employèrent ces légendaires et aucune église n’est lisible, quand on les néglige.
Ce mélange d’Évangiles réels et de fabliaux n’a d’ailleurs rien qui étonne. En refusant aux évangiles de l’Enfance, de la Nativité, de saint Thomas l’Israélite, de Nicodème, au protévangile de Jacques le Mineur, à l’histoire de Joseph, de leur reconnaître une certitude canonique, une origine divine, l’Église n’a pas entendu les rejeter en bloc et les assimiler à des fatras d’illusions et de mensonges. Malgré certaines de leurs anecdotes qui sont pour le moins ridicules, il peut se trouver en effet, dans ces textuaires, des indications exactes, des récits authentiques que les évangélistes, si sobres de renseignements, n’ont pas jugé à propos de nous dire.
Le moyen âge n’était donc nullement hérésiarque, en accordant à ces livres purement humains une valeur de fictions vraisemblables, un intérêt de mémoire pieux.
En somme, reprit Durtal qui était arrivé devant les portes sises entre les deux tours, devant le porche Royal de l’Occident, en somme, cet immense palimpseste, avec ses sept cent dix-neuf figures, est facile à démêler si l’on se sert de la clef dont usa, dans sa monographie de la cathédrale, l’abbé Bulteau.
En partant du clocher neuf et en longeant la façade jusqu’au clocher vieux, l’on feuillette l’histoire de Notre-Seigneur narrée par près de deux cents statues, perdues dans les chapiteaux. Elle remonte aux aïeux du Christ, prélude de la biographie d’Anne et de Joachim, traduit, en de microscopiques images, les apocryphes. Par déférence peut-être pour les Livres inspirés, elle rampe le long des murs, se fait petite pour ne pas être trop aperçue, nous relate, comme en cachette, en une curieuse mimique, le désespoir du pauvre Joachim, lorsqu'un scribe du temple, nommé Ruben, lui reproche d’être sans postérité et repousse, au nom d’un Dieu qui ne l’a point béni, ses offrandes ; et Joachim navré quitte sa femme, s’en va pleurer au loin sur la malédiction qui le frappe ; et un ange lui apparaît, le console, lui ordonne de rejoindre son épouse, qui enfantera de ses oeuvres une fille.
Puis c’est le tour d’Anne qui gémit seule sur sa stérilité et son veuvage ; et l’ange la visite, elle aussi, lui prescrit d’aller au-devant de son mari qu’elle rencontre à la porte Dorée. Ils se sautent au cou, retournent ensemble au logis et Anne accouche de Marie qu’ils consacrent au Seigneur.
Des années s’écoulent ; l’époque des fiançailles de la Vierge est venue. Le grand prêtre invite tous ceux qui, nubiles et non mariés, sont issus de la maison de David, à s’approcher de l’autel, une baguette à la main. Et pour savoir quel est celui des prétendants auquel se fiancera la Vierge, le pontife Abiathar consulte le Très-Haut qui répète la prophétie d’Isaïe, avérant qu’il sortira de la tige de Jessé une fleur sur laquelle se posera l’Esprit.
Et aussitôt la baguette de l’un d’eux, de Joseph le charpentier, fleurit, et une colombe descend du ciel pour se nicher dessus.
Marie est donc livrée à Joseph et le mariage a lieu ; le Messie naît, Hérode trucide les Innocents et alors l’évangile de la Nativité s’arrête, laissant la parole aux Lettres saintes qui reprennent Jésus, et le conduisent jusqu’à sa dernière apparition, après sa mort.
Ces scènes servent de bordure au bas de la grande page qui s’étend entre les deux tours, au-dessus des trois portes.
C’est là que se placent les tableaux qui doivent séduire, par de plus claires, par de plus visibles apparences, les foules ; là, que resplendit le sujet général du porche, celui qui concrète les Évangiles, qui atteint le but assigné à l’Église même.
A gauche, l’Ascension de Notre-Seigneur, montant glorieusement dans des nues que frime une banderole ondulée tenue de chaque côté, suivant le mode byzantin, par deux anges, tandis qu’au-dessous, les apôtres lèvent la tête, regardent cette Ascension que d’autres anges qui descendent, en planant au-dessus d’eux, leur désignent de leurs doigts tendus vers le ciel.
Et le cadre arqué de l’ogive enferme un almanach de pierre et un zodiaque.
A droite, le triomphe de Notre-Dame, encensée par deux archanges, assise le sceptre au poing sur un trône, est accompagnée de l’Enfant qui bénit le monde ; puis en bas les sommaires de sa vie : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, l’Appel des bergers, la Présentation de Jésus au grand prêtre ; et la voussure qui serpente, se dressant en pointe de mitre, au-dessus de la Mère, est décorée de deux cordons, l’un, garni d’archanges thuriféraires, aux ailes cloisonnées, comme imbriquées de tuiles, l’autre habité par les figures des sept arts libéraux, symbolisés, chacun, par deux statuettes représentant, la première, l’allégorie et la seconde le personnage de l’antiquité qui fut l’inventeur ou le parangon de cet art ; c’est le même système d’expression qu’à l’église de Laon et la paraphrase imagée de la théologie scolastique, la version sculpturale du texte d’Albert le Grand, affirmant, lorsqu’il cite les perfections de la Vierge, qu’Elle possédait la science parfaite des sept arts : la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique, tout le savoir du moyen age.
Enfin, au milieu du porche central, contenant le sujet autour duquel ne font que graviter les annales des autres baies, la Glorification de Notre-Seigneur, telle que la conçut à Pathmos saint Jean ; le livre final de la Bible, l’Apocalypse ouverte, en tète de la basilique, au-dessus de l’entrée solennelle de la cathédrale.
Jésus est assis, le chef ceint du nimbe crucifère, vêtu de la talaire de lin, drapé dans un manteau qui retombe en une cascade serrée de plis, les pieds nus posés sur l’escabeau, emblème affecté à la terre par Isaïe. Il bénit, d’une main, le monde et tient le livre fermé des sept sceaux de l’autre. Autour de lui, dans l’ovale qui l’environne, le Tétramorphe, les quatre animaux évangéliques, aux ailes papelonnées d’écailles, l’homme empenné, le lion, l’aigle, le boeuf, symboles de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Jean et de saint Luc.
Au-dessous, les douze apôtres arborent des rouleaux et des livres.
Et, pour parfaire la scène de l’Apocalypse, dans les cordons des voussures, les douze anges et les vingt-quatre vieillards que saint Jean nous décrit, accoutrés de blanc et couronnés d’or, jouent des instruments de musique, chantent, en une adoration perpétuelle, — que quelques âmes, isolées dans l’indifférence de notre siècle, reprennent, — les gloires du Très-Haut, se prosternant quand, aux ardentes et solennelles oraisons de la terre, les bêtes évangéliques répondent, dominant de leurs voix le fracas des foudres, l’unique mot qui concentre en ses quatre lettres, qui résume en ses deux syllabes, les devoirs de l’homme envers Dieu, l’humble et l’affectueux, l’obéissant Amen.
Le texte a été serré de près par les imagiers, sauf pour le Tétramorphe, car un détail manque ; les animaux ne sont point ocellés de ces milliers d’yeux dont le prophète parle.
En le récapitulant, ce tableau, divisé tel qu’un tryptique, comprend, dans son volet de gauche : l’Ascension encadrée dans les moulures d’un zodiaque ; au milieu : le triomphe de Jésus tel que le raconte le Disciple ; sur le volet de droite : le triomphe de Marie, accompagné de quelques-uns de ses attributs.
Et le tout constitue le programme réalisé par l’architecte : la Glorification du Verbe. Il y a, en effet, dit dans son substantiel opuscule sur Chartres, l’abbé Clerval, « les scènes de sa vie qui ont préparé sa gloire ; il y a son entrée proprement dite dans la gloire, puis sa glorification éternelle par les anges, les saints et la sainte Vierge ».
Au point de vue de la facture, l’oeuvre est claire et splendide, dans son grand sujet, obscure et mutilée dans les petits. Le panneau de Marie a souffert et il est, de même que celui de l'Ascension, singulièrement fruste et barbare, bien au-dessous du tableau central qui détient, le plus vivant, le plus obsédant qui soit des Christ.
Nulle part, en effet, dans la statuaire du moyen âge, le Rédempteur ne s’atteste plus mélancolique et plus miséricordieux, sous un aspect plus grave. Examiné de profil, avec ses cheveux coulant dans le dos, plats et divisés par une raie sur le front, le nez un peu retroussé, la bouche forte, couverte d’une épaisse moustache, la barbe courte et tordue, le cou long, il suggère, malgré la rigidité de son attitude, non l’impression d’un Christ byzantin, tel qu’en peignirent et qu’en sculptèrent des artistes de ce temps, mais d’un Christ de Primitif, issu des Flandres, originaire de la Hollande même, dont il a ce vague relent de terroir qui reparaîtra plus tard, en un type moins pur, vers la fin du quinzième siècle, dans le tableau de Cornelis Van Oostzaanen, du musée de Cassel.
Et il surgit, presque triste, dans son triomphe, bénissant, inétonné, avec une résignation qui s’attendrit, ce défilé de pécheurs qui, depuis sept cents ans, le regarde curieusement, sans amour, en passant sur la place ; et tous lui tournent le dos, se souciant peu de ce Sauveur qui diffère du portrait qu’ils connurent, ne l’admettant qu’avec une tête ovine et des traits aimables, pareil, il faut bien le dire, au bellâtre de la cathédrale d’Amiens devant lequel se pâment les gens amoureux d’une beauté facile.
Au-dessus de ce Christ, s’ouvrent les trois fenêtres privées de regards du dehors, et au-dessus d’elles, la grande rose morte, semblable à un oeil éteint, ne se rallumant, comme les verrières des croisées, qu’au dedans, brûlant en de claires flammes, en de pâles saphirs sertis dans des chatons de pierre ; enfin, au-dessus de la rose, s’étend la galerie des rois de Juda que domine un pignon dressant son triangle entre les deux tours.
Et les deux clochers dardent leurs flèches ; le vieux, taillé dans un calcaire tendre, squammé d’écailles, s’effusant d’un seul jet, s’effilant en éteignoir, chassant dans les nuages une fumée de prières par sa pointe ; le neuf, ajouré ainsi qu’une dentelle, ciselé tel qu’un bijou, festonné de feuillages et de rinceaux de vignes, monte avec de lentes coquetteries, tâchant de suppléer à l’élan d’âme, à l’humble supplique de son aîné, par de riantes oraisons, par de jolis sourires, de séduire, par de joyeux babils d’enfant, le Père.
Mais, pour en revenir au porche Royal, reprit Durtal, malgré l’importance de sa grande page narrant le triomphe éternel du Verbe, l’intérêt des artistes va forcément au rez-de-chaussée de l’édifice, là où jaillissent dans l’espace compris entre les bases des deux tours, le long du mur et dans l’ébrasement des trois portes, dix-neuf statues colossales de pierre.
A coup sûr, la plus belle sculpture du monde est en ce lieu. Elle se compose de sept rois, de sept prophètes ou saints et de cinq reines. Ces statues s’élevaient autrefois au nombre de vingt-quatre, mais cinq ont disparu sans laisser de traces.
Toutes sont nimbées, sauf les trois premières qui résident autour du clocher neuf, et toutes sont abritées sous des dais à claire-voie, délinéant des chaumines et des chapelles, des manoirs et des ponts, dessinant une minuscule ville, une Sion pour bébés, une Jérusalem céleste naine.
Toutes sont debout, posant sur des colonnes guillochées, sur des socles taillés en amande, en pointe de diamant, en côte d’ananas ; sculptés de méandres, de frettes crénelées, de carreaux de foudre ; creusés comme des damiers dont les cases alternées seraient, les unes vides et les autres pleines ; pavés d’une sorte de mosaïque, de marqueterie qui, de même que les bordures des verrières de l’église, évoquent les souvenirs d’une orfèvrerie musulmane, décèlent l’origine de formes rapportées de l’Orient par les Croisades.
Cependant les trois premières statues de la baie de gauche, voisines de la flèche neuve, ne se juchent pas sur des ornements ravis aux infidèles ; celles-là foulent aux pieds d’inexplicables êtres. L’une, un roi dont la tête perdue fut remplacée par celle d’une reine, marche sur un homme enlacé de serpents ; un autre souverain pèse sur une femme qui saisit, d’une main, la queue d’un reptile et caresse, de l’autre, la tresse de ses cheveux ; la troisième enfin, une reine, le chef couronné d’un simple cercle d’or, le ventre proéminent d’une personne enceinte, la figure avenante mais vulgaire d’une bonne, a pour piédestal deux dragons, une guenuche, un crapaud, un chien et un basilic à visage de singe. Que signifient ces rébus ? nul ne le sait ; pas plus qu’on ne sait, du reste, les noms des seize autres statues, alignées le long du porche.
Les uns veulent y voir les ancêtres du Messie, mais cette assertion ne s’étançonne sur aucune preuve ; les autres croient y distinguer un mélange des héros de l’Ancien Testament et des bienfaiteurs de l’église, mais cette présomption est également illusoire. La vérité est que si tous ces gens ont eu à la main des sceptres et des rouleaux, des banderoles et des eucologes, aucun n’arbore l’un de ces attributs personnels qui servent à les spécifier, dans la nomenclature sacrée du moyen âge.
Tout-au plus, pourrait-on baptiser du nom de Daniel un corps sans tête, parce qu’au-dessous de lui se tord un vague dragon, emblème du Diable que le prophète vainquit à Babylone.
Les plus admirables de ces statues sont celles des reines.
La première, celle de la maritorne royale, au ventre bombé, n’est qu’ordinaire ; la dernière, celle qui est l’opposé de cette princesse, à l’autre extrémité de la façade, près du clocher vieux, a le visage amputé d’une moitié et la tranche qui subsiste ne séduit guère ; mais les trois autres, debout, près de la baie principale, dans la voùte d’entrée, sont inouïes !
La première, longue, étirée, tout en hauteur, a le front cerné d’une couronne, un voile, des cheveux pliés de chaque côté d’une raie et tombant en nattes sur les épaules, le nez un peu retroussé, un tantinet populaire, la bouche prudente et décidée, le menton ferme. La physionomie n’est plus jeune. Le corps est enserré, rigide, sous un grand manteau, aux larges manches, dans la gaine orfévrie d’une robe sous laquelle aucun des indices de la femme ne paraît. Elle est droite, asexuée, plane ; et sa taille file, ceinte d’une corde à noeuds de franciscaine. Elle regarde, la tête un peu baissée, attentive à l’on ne sait quoi, sans voir. A-t-elle atteint le dénuement parfait de toute chose ? vit-elle de la vie unitive au delà des mondes, dans l’absence des temps ? On peut l’admettre, si l’on remarque que, malgré ses insignes royaux et le somptueux apparat de son costume, elle conserve l’attitude recueillie et l’air austère d’une moniale. Elle sent plus le cloître que la cour. L’on se demande alors qui la plaça en sentinelle près de cette porte et pourquoi, fidèle à une consigne qu’elle seule connaît, elle observe, de son oeil lointain, jours et nuits, la place, attendant, immobile, quelqu’un qui depuis sept cents ans ne vient point ?
Elle semble une figure de l’Avent, qui écoute, un peu penchée, sourdre de la terre les dolentes exorations de l’homme ; un éternel Rorate chante en elle ; elle serait, dans ce cas, une reine de l’Ancien Testament, morte bien avant la naissance du Messie qu’elle annonça peut-être.
Comme elle tient un livre, l’abbé Bulteau insinue qu’elle pourrait être un portrait en pied de sainte Radegonde. Mais il y a d’autres princesses canonisées et qui tiennent, elles aussi, des livres ; cependant, l’attitude claustrale de cette reine, ses traits émaciés, son oeil perdu dans l’espace des rêves intérieurs, s’appliqueraient assez justement à la femme de Clotaire qui s’interna dans un cloître.
Mais elle serait en attente de quoi ? de l’arrivée redoutée du roi voulant l’arracher de son abbaye de Poitiers pour la replacer sur le trône ? en l’absence de tout renseignement, il n’est aucune de ces conjectures qui ne demeure vaine.
La seconde statue représente encore une femme de monarque, portant un livre. Celle-là est plus jeune, elle n’a ni manteau, ni voile ; les seins sont remontés, moulés dans un étroit corsage, très tiré, ajusté tel qu’un linge mouillé sur le buste, ondulant en plis menus, en rides, un corsage pareil au roque carolingien s’agrafant sur le côté. Elle a les cheveux couchés en deux bandeaux sur le front, couvrant les oreilles, descendant en tresses enrubanées, se terminant en mèche de fouet.
Le visage est volontaire et déluré, un peu hautain. Celle-là regarde au dehors d’elle ; elle est d’une beauté plus humaine et le sait ; sainte Clotilde ? hasarde l’abbé Bulteau.
Il est certain que cette élue ne fut pas toujours un modèle d’aménité et ce qu’on peut appeler une personne commode. Avant que d’avoir été reprise et châtiée, elle se révèle dans l’histoire, vindicative, sans dédit de pitié, avide de représailles. Elle serait alors la Clotilde d’avant la pénitence, la reine avant la sainte.
Est-ce bien elle ? ce nom lui fut attribué parce qu’une statue de la même époque qui lui ressemble et qui appartint jadis à Notre-Dame de Corbeil fut placée sous ce vocable. Mais il a été reconnu, depuis, que cette statue portraiturait la reine de Saba. Sommes-nous donc en présence de cette souveraine ? pourquoi, alors, quand elle n’est pas inscrite au livre de vie, une auréole ?
Il est très probable qu’elle n’est, ni la femme de Clovis, ni l’amie de Salomon, cette étrange princesse qui se décèle à la fois plus charnelle et plus spectrale que ses autres soeurs, car le temps l’a dévisagée, lui mâchurant l’épiderme, lui picotant le menton de grêle, encanaillant la bouche, rongeant le nez, le trouant en as de trèfle, mettant l’image de la mort sur cette vivante face.
Quant à la troisième, elle s’étire en un frêle fuseau, s’émince en un gracile cierge dont la poignée serait damassée, gaufrée, gravée en pleine cire ; elle monte magnifiquement vêtue d’une robe roide, cannelée, rayée de fibres telle qu’une tige de céleri. Le corsage est passementé, brodé au petit point ; le ventre est entouré d’une cordelière à noeuds lâche et précieuse ; la tête est couronnée, les deux bras sont cassés ; l’un reposait sur la poitrine, l’autre tenait un sceptre dont on aperçoit encore un vestige.
Et celle-là rit, ingénue et mutine, charmante. Elle considère de ses deux grands yeux ouverts, aux sourcils très relevés, les visiteurs. Jamais, en aucun temps, figure plus expressive n’a été ainsi façonnée par le génie de l’homme ; elle est le chef-d’oeuvre de la grâce enfantine et de la candeur sainte.
Dans l’architecture pensive du douzième siècle, au milieu de ce peuple de statues recueillies, symbolisant en quelque sorte le naïf amour de ces âges que troublèrent les craintes d’un éternel enfer, elle semble placée devant l’huis du Seigneur, comme l’exorable image des Rémissions. Pour les âmes timorées de ces habitudinaires qui n’osent plus, après de persévérantes chutes, franchir le seuil de l’église, elle se fait prévenante, chasse les réticences et vainc les regrets, apaise, par les familiarités de son rire, les transes.
Elle est la grande soeur de l’Enfant prodigue, celle dont saint Luc ne parle point, mais qui dut, si elle exista, plaider la cause de l’absent, insister auprès du père pour qu’il tuât le veau gras, quand revint le fils.
Ce n’est point sous cet aspect indulgent que la connaît Chartres ; suivant la tradition locale, elle serait Berthe aux grands pieds, mais outre que cette allégation ne s’appuie sur aucun argument, elle est inane par ce seul fait que la statue a le halo d’un nimbe. Or, ce signe de la sainteté ne saurait ceindre le chef de la mère de Charlemagne dont le nom est inconnu des hagiologes de l’Église triomphante.
Elle serait alors, d’après la thèse des archéologues qui voient dans la panégyrie sculptée du porche les ancêtres du Christ, une princesse du Vieux Testament ; mais laquelle ? ainsi que le remarque justement Hello, les larmes sont fréquentes dans les Écritures, mais le rire y est si rare que celui de Sara ne pouvant s’empêcher de se gaudir lorsque l’ange lui annonce qu’elle concevra, malgré sa grande vieillesse, un fils, reste célèbre. Vainement, l’on cherche à quelle personne du livre de l’ancienne alliance peut se rapporter l’innocente joie de cette reine.
La vérité, c’est qu’elle demeure à jamais mystérieuse, cette créature angélique, fluide, parvenue sans doute aux pures délices de l’âme qui s’écoule en Dieu, et avec cela, elle est si avenante, si serviable, qu’elle nous laisse l’illusion d’un salutaire geste, le mirage d’une bénédiction visible pour ceux qui la désirent. En effet, son bras droit est brisé à la hauteur du poignet et sa main n’est plus ; mais cette main paraît exister encore, à l’état de reflet, d’ombre, quand on la cherche ; elle est très nettement formée par le renflement léger du sein qui simule la paume, par les plis du corsage qui dessinent distinctement les quatre doigts effilés et le pouce, levés, pour tracer le signe de la croix sur nous.
Quelle exquise préfiguratrice de la benoîte Mère que cette gardienne royale du seuil, que cette souveraine invitant les égarés à rentrer dans l’église, à s’approcher de cette porte qu’Elle garde et qui est elle-même un des symboles de son Fils ! s’écria Durtal ; et il embrassa, d’un coup d’oeil, ce vis-à-vis de femmes si différentes : l’une, plus moniale que reine, qui baisse un peu la tête ; l’autre, exclusivement reine, qui la redresse ; la troisième, saintement gamine, dont le col n’est ni penché, ni haussé, mais se tient dans la position naturelle, modérant le port auguste d’une reine par l’humble et la riante attitude d’une sainte.
Peut-être pourrait-on discerner aussi, se dit-il, dans la première, une image de la vie contemplative, comme l’on pourrait alléguer que la seconde implique l’idée de la vie active et que la dernière incarne, ainsi que Ruth, dans l’Écriture, les deux ?
Quant aux autres statues de prophètes, coiffés de la calotte juive à côtes et de rois tenant des missels ou des sceptres, elles sont, elles aussi, indéchiffrables ; l’une d’elles, sise dans l’arche du milieu, au coin de la porte, à droite, séparée par un monarque de la fausse Berthe, intéressait plus spécialement Durtal, car elle ressemblait à Verlaine. Elle en avait la tête plus velue, il est vrai, mais aussi bizarre, le crâne cabossé, le masque un peu épaté, le poil hirsute, l’air commun et bonhomme.
La tradition assigne à cette effigie le nom de saint Jude ; et elle est suggestive, cette similitude des traits de l’Apôtre le plus négligé de tous par les Chrétiens, de celui qui fut si peu prié pendant tant de siècles, qu’on s’avisa, un beau jour, pensant qu’il avait moins que les autres épuisé son crédit auprès de Dieu, de l’invoquer pour les causes désespérées, pour les causes perdues, et du poète si complètement ignoré ou si bêtement honni de ces mêmes catholiques auxquels il apportait les seuls vers mystiques éclos depuis le moyen âge !
Ils furent les malchanceux, l’un de la sainteté et l’autre de la poésie, conclut Durtal qui se recula pour mieux voir l’ensemble de la façade.
Elle s’attestait inouie, avec des ciselures de flore dessinée sur les carreaux par le gel, avec ses nappes d’église, ses rochets aux fines mailles, ses guipures en fils de la Vierge, courant jusqu’au premier étage, servant de cadres ajourés aux grands sujets des porches. Puis, elle montait, d’allure érémitique, sobre d’ornements, cyclopéenne, avec l’oeil colossal de sa rose morte, entre les deux tours, l’une, fenestrée, niellée comme le portail, l’autre nue comme l’étage qui surplombait le porche.
Mais ce qui dominait, ce qui absorbait Durtal, c’était quand même les statues de reines.
Et il finissait par ne plus se soucier du reste, par ne plus goûter que l’éloquence divine de leur maigreur, par ne plus les envisager que sous l’aspect de longues tiges baignant dans des tubes guillochés de pierre, s’épanouissant en des touffes de figures embaumant des fragrances ingénues, des senteurs naïves, et le Christ bénissant, attendri et attristé, le monde, se penchait de son trône, au-dessus d’elles, pour humer le tendre parfum qui s’effusait de ces calices élancés d’âmes !
Durtal songeait : quel irrésistible nécromant pourrait évoquer l’esprit de ces royales Ostiaires, les contraindre à parler, nous faire assister à l’entretien qu’elles ont peut-être, quand elles paraissent se reculer sous la voûte, se retirer chez elles, le soir, derrière un rideau d’ombre ?
Que se disent-elles, elles qui ont vu saint Bernard, saint Louis, saint Ferdinand, saint Fulbert, saint Yves, Blanche de Castille, tant d’élus, défiler devant elles, alors qu’ils entrèrent dans les ténèbres étoilées de la nef ? Causent-elles de la mort de leurs compagnes, de ces cinq statues qui disparurent pour jamais de leur petit cénacle ? écoutent-elles, au travers des vantaux fermés de la porte, souffler le vent désolé des psaumes et mugir les grandes eaux de l’orgue ? Entendent-elles les exclamations saugrenues des touristes qui rient de les voir si roides et si longues ? Sentent-elles, ainsi que tant de saintes, l’odeur des péchés, le relent de vase des âmes qui les frôlent ? Alors ce serait à ne plus oser les regarder... Et Durtal les regardait quand même, car il ne pouvait se séparer d’elles ; elles le retenaient par le charme constant de leur énigme ; en somme, reprenait-il, elles sont, sous une apparence réelle, extra-terrestres. Leurs corps n’existent pas, leurs âmes habitent à même dans les gangues orfévries des robes ; elles sont en parfait accord avec la basilique qui s’est, elle-même, désincarnée de ses pierres et s’enlève, dans le vol de l’extase, au-dessus du sol.
Le chef-d’oeuvre de l’architecture et de la statuaire mystiques sont ici, à Chartres ; l’art le plus surhumain, le plus exalté qui fut jamais, a fleuri dans ce pays plat de la Beauce.
Et maintenant qu’il avait contemplé l’ensemble de cette façade, il se rapprochait encore pour la scruter dans ses infimes accessoires, dans ses menus détails, pour examiner de plus près la parure des souveraines et il vérifiait ceci : aucune draperie n’était pareille ; les unes tombaient sans cassures brusques, ridulées, semblables à un friselis ondulant d’eau, les autres descendaient en lignes parallèles, en fronces serrées, un peu en relief, telles que les côtes des bâtons d’angélique, et la dure matière se pliait aux exigences des habilleurs, s’assouplissait pour les crêpes historiés, pour les fûtaines et les fils de pur lin, s’alourdissait pour les brocarts et les orfrois ; tout était spécifié ; les colliers étaient ciselés, grains à grains, les noeuds des ceintures auraient pu se dénouer, tant les cordelettes étaient naturellement entrelacées ; les bracelets, les couronnes étaient forés, martelés, sertis de gemmes montées dans leurs chatons, comme par des gens de métier, par des orfèvres.
Et souvent le socle, la statue, le dais avaient été taillés d’une seule pièce, dans un même bloc ! quels étaient donc les gens qui avaient sculpté de telles oeuvres ?
On peut croire qu’ils vivaient dans les cloîtres puisque la culture de l’art ne se pratiquait alors que dans les clos de Dieu. Et ils rayonnèrent, à cette époque, dans l’Ile-de-France, l’Orléanais, le Maine, l’Anjou, le Berry ; nous remarquons dans ces provinces des statues de ce genre ; mais il faut bien le dire, toutes sont inférieures à celles de Chartres. A Bourges, par exemple, d’analogues prophètes et de semblables reines rêvent dans l’une de ces extraordinaires baies latérales où le souvenir du trèfle arabe s’impose. A Angers, ces statues sont effritées, presque détruites, mais on peut les juger surtout rapetissées, devenues seulement humaines ; ce ne sont plus des Célicoles aux corps chastement effilés, mais de simples reines ; au Mans, où elles sont mieux conservées, elles s’efforcent vainement de surgir de leurs fourreaux droits ; elles sont quand même désallongées, dénervées, appauvries, presque vulgaires. Nulle part, ce n’est de l’âme sculptée comme à Chartres ; et si, au Mans, on étudie la façade comprise ainsi que celle de la cathédrale chartraine, avec un Christ glorifié, bénissant, assis, entre les bêtes ailées du Tétramorphe, quelle descente l’on constate dans le niveau divin ! Tout est étriqué et poussif. Jésus, mal débruti, reste farouche. Ce sont évidemment des élèves sans génie des maîtres souverains de Chartres qui adornèrent ces portiques.
Était-ce une compagnie de ces imagiers, de ces confrères de l’oeuvre sainte qui allaient d’un pays à l’autre, adjoints aux maçons, aux ouvriers logeurs du bon Dieu, par les moines ? Venaient-ils de cette abbaye bénédictine de Tiron fondée près du Marché, à Chartres, par l’abbé saint Bernard dont le nom figure parmi les bienfaiteurs de l’église dans le nécrologe de Notre-Dame ? Nul ne le sait. Humblement, anonymement, ils travaillèrent.
Et quelles âmes ils avaient, ces artistes ! Car nous le savons, ils ne besognaient que lorsqu’ils étaient en état de grâce. Pour élever cette splendide basilique, la pureté fut requise, même des manoeuvres.
Cela serait incroyable, si des documents authentiques, si des pièces certaines ne l’attestaient.
Nous possédons des missives de l’époque, insérées dans les annales bénédictines, une lettre d’un abbé de Saint-Pierre-sur-Dive retrouvée par M. Léopold Delisle, dans le manuscrit 929 du fonds français à laBiblîothèque nationale ; un livre latin des miracles de Notre-Dame, découvert dans la Bibliothèque du Vatican, et traduit en français par un poète du treizième siècle, Jehan le Marchant. Tous racontent comment, après la ruine des incendies, fut rebâti le sanctuaire dédié à la Vierge noire.
Ce qui advint alors atteignit le sublime. Ce fut une Croisade, telle que jamais on n’en vit. Il ne s’agissait plus d’arracher le saint Sépulcre des mains des infidèles, de lutter sur un champ de bataille contre des armées, contre des hommes, il s’agissait de forcer Notre-Seigneur dans ses retranchements, de livrer assaut au ciel, de le vaincre par l’amour et la pénitence ; et le ciel s’avoua battu ; les anges, en souriant, se rendirent ; Dieu capitula et, dans la joie de sa défaite, il ouvrit tout grand le trésor de ses grâces pour qu’on le pillât.
Ce fut encore, sous la conduite de l’Esprit Saint, le combat contre la matière, sur des chantiers, d’un peuple voulant, coûte que coûte, sauver la Vierge sans asile, de même qu’au jour où naquit son Fils.
La crèche de Bethléem n’était plus qu’un tertre de cendres. Marie allait être réduite à vagabonder, sous le fouet des bises, dans les plaines glacées de la Beauce. Le même fait se renouvellerait-il, à douze cents ans de distance, de familles sans pitié, d’auberges inhospitalières, de chambres pleines ?
L’on aimait alors, en France, la Madone, comme l’on aime sa génitrice naturelle, sa véritable mère. A cette nouvelle qu’Elle erre, chassée par l’incendie, à la recherche d’un gîte, tous, bouleversés, s’éplorent ; et non seulement dans le pays chartrain, mais encore dans l’Orléanais, dans la Normandie, dans la Bretagne, dans l’Ile-de-France, dans le Nord, les populations interrompent leurs travaux, quittent leurs logis pour courir à son secours, les riches apportant leur argent et leurs bijoux, tirant avec les pauvres des charrettes, convoyant du blé, de l’huile, du vin, du bois, de la chaux, ce qui peut servir à la nourriture des ouvriers et à la bâtisse d’une église.
Ce fut une migration ininterrompue, un exode spontané de peuple. Toutes les routes étaient encombrées de pèlerins, traînant, hommes, femmes, pêle-mêle, des arbres entiers, charriant des faisceaux de poutres, poussant de gémissantes carrioles de malades et d’infirmes qui constituaient la phalange sacrée, les vétérans de la souffrance, les légionnaires invincibles de la douleur, ceux qui devaient aider au blocus de la Jérusalem céleste, en formant l’arrière-garde, en soutenant, avec le renfort de leurs prières, les assaillants.
Rien, ni les fondrières, ni les marécages, ni les forêts sans chemins, ni les rivières sans gués, ne purent enrayer l’impulsion de ces foules en marche, et, un matin, par tous les points de l’horizon, elles débouchèrent en vue de Chartres.
Et l’investissement commença ; tandis que les malades traçaient les premières parallèles des oraisons, les gens valides dressèrent les tentes ; le camp s’étendit à des lieues à la ronde ; l’on alluma sur des chariots des cierges et ce fut, chaque soir, un champ d’étoiles dans la Beauce.
Ce qui demeure invraisemblable et ce qui est pourtant certifié par tous les documents de l’époque, c’est que ces hordes de vieillards et d’enfants, de femmes et d’hommes, se disciplinèrent en un clin d'oeil ; et pourtant ils appartenaient à toutes les classes de la société, car il y avait parmi eux des chevaliers et de grandes dames ; mais l’amour divin fut si fort qu’il supprima les distances et abolit les castes ; les seigneurs s’attelèrent avec les roturiers dans les brancards, accomplirent pieusement leur tâche de bêtes de somme ; les patriciennes aidèrent les paysannes à préparer le mortier et cuisinèrent avec elles ; tous vécurent dans un abandon de préjugés unique ; tous consentirent à n’être que des manoeuvres, que des machines, que des reins et des bras, à s’employer sans murmurer, sous les ordres des architectes sortis de leurs couvents pour mener l’oeuvre.
Jamais il n’y eut organisation plus savante et plus simple ; les celleriers des cloîtres devenus, en quelque sorte, les intendants de cette armée, veillèrent à la distribution des vivres, assurèrent l’hygiène des bivacs, la santé du camp. Hommes, femmes n’étaient plus que de dociles instruments entre les mains de chefs qu’ils avaient eux-mêmes élus et qui obéissaient à des équipes de moines, subordonnés, à leur tour, à l’être prodigieux, à l’inconnu de génie qui, après avoir conçu le plan de la cathédrale, dirigeait les travaux d’ensemble.
Pour obtenir un tel résultat, il fallut vraiment que l’âme de ces multitudes fût admirable, car ce labeur si pénible, si humble, de gâcheur de plâtre et de charretier, fut considéré par chacun, noble ou vilain, ainsi qu’un acte d’abnégation et de pénitence, et aussi comme un honneur ; et personne ne fut assez téméraire pour toucher aux matériaux de la Vierge, avant de s’être réconcilié avec ses ennemis et confessé. Ceux qui hésitèrent à réparer leurs torts, à s’approcher des sacrements, furent enlevés des traits, chassés tels que des êtres immondes, par leurs compagnons, par leur famille même.
Dès l’aube, chaque jour, la besogne indiquée par les contremaîtres s’opère. Les uns creusent les fondations, déblaient les ruines, dispersent les décombres, les autres se transportent en masse aux carrières de Berchère-l’Évêque, à huit kilomètres de Chartres, et là, ils descellent des blocs énormes de pierre, si lourds que parfois un millier d’ouvriers ne suffisait pas pour les extraire de leurs lits et les hisser jusqu’au sommet de la colline sur laquelle devait planer la future église.
Et quand, éreintés, moulus, ces troupeaux silencieux s’arrêtent, alors on entend monter les prières et le chant des psaumes ; d’aucuns gémissent sur leurs péchés, implorent la compassion de Notre-Dame, se frappent la poitrine, sanglotent dans les bras des prêtres qui les consolent.
Le dimanche, des processions se déroulent, bannière en tête, et le hourra des cantiques souffle dans les rues de feu que tracent, au loin, les cierges ; les heures canoniales sont écoutées à genoux, par tout un peuple, les reliques sont présentées en grande pompe aux malades...
Pendant ce temps, des béliers d’oraisons, des catapultes de prières ébranlent les remparts de la cité divine ; les forces vives de l’armée se réunissent pour foncer sur le même point, pour enlever d’assaut la place.
Et c’est alors que, vaincu par tant d’humilité et par tant d’obéissance, écrasé par tant d’amour, Jésus se rend à merci, remet ses pouvoirs à sa Mère et, de toute part, les miracles éclatent. Bientôt, le clan des malades et des infirmes est debout ; les aveugles voient, les hydropiques désenflent, les perclus se promènent, les cardiaques courent.
Le récit de ces miracles qui, quotidiennement, se répètent, qui précèdent même parfois l’arrivée des pèlerins à Chartres, nous a été conservé par le manuscrit latin du Vatican.
Ici, ce sont les habitants de Château-Landon qui remorquent une voiture de froment. Arrivés à Chantereine, il s’aperçoivent que leurs provisions de bouche sont épuisées et ils demandent du pain à des malheureux qui se trouvent eux-mêmes dans une extrême gêne. La Vierge intercède et le pain de la misère se multiplie. Là, ce sont des gens partis du Gâtinais, avec un haquet de pierres. N’en pouvant plus, ils font halte près du Puiset ; et des villageois, venus à leur rencontre, les invitent à se reposer, tandis qu’eux tireront le fardier, mais ils refusent. Alors, les paysans du Puiset leur offrent une pièce de vin, la transvasent dans un tonneau qu’ils juchent sur le camion. Cette fois, les pèlerins acceptent, et, se sentant moins las, ils continuent leur route. Mais ils sont rappelés pour constater que le muid vide s’est rempli de lui-même d’un délicieux vin. Tous en boivent et les malades guérissent.
D’autre part, un habitant de Corbeville-sur-Eure, qui s’employait à charger une voiture de bois de construction, a trois doigts coupés par une hache et il pousse des cris affreux. Les compagnons lui conseillent de trancher complètement les doigts qui ne tiennent plus que par un fil à la chair, mais le prêtre qui les conduit à Chartres s’y oppose. On implore Marie et la blessure disparaît, la main devient intacte.
Ce sont encore des Bretons égarés, la nuit, dans les plaines de la Beauce et qui sont subitement guidés par des brandons de feu ; c’est la Vierge, en personne, qui un samedi soir, après complies, descend dans son église quand elle est presque terminée et l’illumine d’éblouissantes lueurs...
Et il y en a comme cela des pages et des pages... ah ! l’on comprend, ruminait Durtal, pourquoi ce sanctuaire est si plein d’Elle ; sa reconnaissance pour l’affection de nos pères s’y sent encore... puis Elle veut bien, maintenant, ne pas se montrer trop dégoûtée, ne pas regarder de trop près...
C’est égal, aujourd’hui l’on érige d’une autre façon les temples ! quand je songe au Sacré-Coeur de Paris, à cette morne et pesante bâtisse édifiée par des gens qui ont inscrit leur nom en rouge sur chaque pierre ! comment Dieu s’accommode-t-il d’une église dont les murs sont des moellons de vanité, scellés par un ciment d’orgueil, des murs où l’on voit des noms de commerçants connus, affichés en bonne place, tels que des réclames ! Il était si simple de construire une église moins somptueuse et moins laide et de ne pas loger ainsi Notre-Seigneur dans un monument de péchés ! Ah ! les bonnes foules qui les charriaient, autrefois, en priant, ces pierres, l’idée ne leur serait pas venue d’exploiter l’amour, de l’affilier à leurs besoins de superbe, à leur faim de lucre !
Un bras se posa sur le sien et Durtal reconnut l’abbé Gévresin qui s’était approché tandis qu’il réfléchissait devant la cathédrale.
— Je vous quitte aussitôt, car je suis attendu, dit le prêtre. Je profite simplement de cette rencontre pour vous dire que j’ai reçu une lettre de l’abbé Plomb.
— Ah ! et où est-il ?
— A Solesmes, mais il rentre après-demain. Il semble singulièrement emballé sur la vie bénédictine, notre ami !
Et l’abbé sourit, tandis que Durtal, un peu interdit, le regardait tourner le coin du clocher neuf.
X
DURTAL Se mit, un matin, à la recherche de l’abbé Plomb. Il ne le trouva, ni chez lui, ni à la cathédrale, finit, sur l’indication d’un bedeau, par se diriger vers la maison occupée au coin de la rue de l’Acacia par la maîtrise.
Il tomba derrière une porte cochère entr’ouverte dans une cour, encombrée de baquets avariés et de gravats. Le bâtiment, situé au fond, était atteint de la maladie cutanée des plâtres, rongé de lèpre et damassé de dartres, fêlé du haut en bas, craquelé comme la couverte en émail d’un vieux pot. La tige morte d’une ancienne vigne écartelait, tout le long de la façade, ses bras tordus de bois noir. Durtal regarda par un châssis vitré, aperçut un dortoir avec des rangées de couchettes blanches et des séries de vases alignés dessous ; et il s’étonna, car jamais il n’avait vu des lits plus petits et des thomas plus grands.
Il avisa un garçon, dans cette salle, l’appela en frappant au carreau, lui demanda si l’abbé Plomb était encore dans ce logis et le domestique l’affirma d’un signe et conduisit Durtal dans une salle d’attente.
Cette chambre ressemblait au bureau d’un hôtel de dernier ordre, pieux. Elle était meublée d’une table d’un rose de chair de rouget, en acajou, surmontée d’un cache-pot sans fleurs ; de fauteuils à oreillettes, de concierge ; d’une cheminée garnie de statues de saints ponctués par les mouches et fermée par un paravent de papier peint exaltant l’Apparition de Lourdes. Aux murs, un tableau de bois noir avec clefs pendues à des numéros, servait de vis-à-vis à un chromo dans laquelle le Christ montrait, d’un air aimable, un coeur mal cuit, saignant dans des ruisseaux de sauce jaune.
Mais ce qui caractérisait cette loge de portier qui fait ses Pâques, c’était une odeur nauséabonde, atroce, l’odeur de l’huile de ricin tiède.
Incommodé par ces relents, Durtal s’apprêtait à fuir, quand l’abbé Plomb entra, lui prit le bras et ils sortirent.
— Alors, vous arrivez de Solesmes ?
— Mais oui.
— Vous êtes satisfait de votre voyage ?
— Enchanté, et l’abbé sourit de l’impatience qu’il sentait sourdre dans le ton de Durtal.
— Et que pensez-vous de ce monastère ?
— Je pense qu’il est très intéressant à visiter, au point de vue du monachisme et de l’art. Solesmes est un grand couvent, maison mère de l’ordre bénédictin en France, et il est pourvu d’un noviciat qui prospère. Au fait, que désirez-vous savoir, au juste ?
— Mais... tout ce que vous savez !
— Eh bien, je vous dirai d’abord que l’art de l’Église, arrivé à son point culminant, fascine, dans ce cloître. Personne ne peut se rendre compte de l’extrême splendeur de la liturgie et du plain-chant, s’il n’a passé par Solesmes ; au cas où Notre-Dame des Arts posséderait un sanctuaire privilégié, soyez sûr qu’il est là.
— La chapelle est ancienne ?
— Il subsiste une partie de la vieille église et les fameuses sculptures des « Saints de Solesmes » qui remontent au seizième siècle ; malheureusement, il existe dans l’abside de consternantes vitres, une Vierge entre saint Pierre et saint Paul, la verrerie moderne dans toute sa criarde inclémence ! Mais aussi où acquérir un vitrail propre ?
— Nulle part ; si nous examinons maintenant les carreaux historiés, insérés dans les murs des églises neuves, nous constatons l’inaltérable sottise des peintres construisant des cartons de verrières comme des sujets de tableaux ; et quels sujets et quels tableaux ! Le tout fabriqué à la grosse par de bas vitriers dont les feuilles minces de verres sèment les nefs de confettis, lancent des pastilles de couleur dans tous les sens.
En vérité, ne serait-il pas plus simple d’accepter le système du vitrail incolore de Cîteaux dont le décor était obtenu par les dessins réticulés des plombs ou de copier ces belles grisailles, nacrées par le temps, qui restent encore à Bourges, à Reims, ici même, dans la cathédrale ?
— Certes, mais pour en revenir à notre monastère, nulle part, je le répète, l’on ne célèbre les offices avec autant de pompe. Il faut voir cela un jour de grande fête ! Imaginez au-dessus de l’autel, là où fulgure d’habitude le tabernacle, une colombe pendue à une crosse d’or et volant, les ailes déployées dans des nues d’encens ; puis, une armée de moines, évoluant, en une marche solennelle et précise ; et l’abbé debout, le front ceint d’une mitre pavée de gemmes, la crosse d’ivoire blanche et verte à la main, la queue de sa traîne tenue par un convers lorsqu’il s’avance, tandis que l’or des chapes s’allume au feu des cierges, que le torrent des orgues entraîne toutes les voix, emporte, jusqu’aux voûtes, le cri de douleur ou de joie des psaumes !
C’est admirable ; ce n’est plus l’austérité pénitentielle des offices, tels qu’ils se pratiquent chez les franciscains ou dans les Trappes ; c’est le luxe pour Dieu, la beauté qu’il créa, mise à son service, et devenue, par elle-même, une louange, une prière...
Mais si vous voulez voir resplendir le chant de l’église dans toute sa gloire, c’est surtout dans l’abbaye voisine, chez les moniales de Sainte-Cécile, qu’il convient d’aller.
L’abbé s’arrêta, se parlant à lui-méme, reculant dans ses souvenirs et, lentement, il reprit :
— Partout, quand même, la voix de la religieuse conserve, en raison même de son sexe, une sorte de langueur, une tendance au roucoulement et, disons-le, souvent une certaine complaisance à s’entendre quand elle n’ignore pas qu’on l’écoute ; aussi, jamais le chant grégorien n’est-il parfaitement exécuté par des nonnes.
Mais chez les bénédictines de Sainte-Cécile, ces feintises d’un gnangnan mondain ont disparu. Ces moniales n’ont plus la voix féminine, mais une voix tout à fait séraphique et virile. Dans cette église, on est rejeté, je ne sais où, dans le fond des âges ou projeté dans l’avance des temps, quand elles chantent. Elles ont des élans d’âme et des haltes tragiques, des murmures attendris et des cris de passion et parfois elles paraissent monter à l’assaut et enlever à la baïonnette certains psaumes. A coup sûr, elles réalisent le bond le plus violent qui se puisse rêver de la terre dans l’infini !
— Alors, c’est autre chose que chez les bénédictines de la rue Monsieur, à Paris ?
— Il n’y a pas de comparaison à établir. Sans vouloir dénier la probité musicale de ces bonnes cloîtrières qui chantent convenablement, mais humainement, en femmes, l’on peut affirmer qu’elles n’ont ni cette science, ni ces inflexions d’âme, ni ces voix... Selon le mot d’un jeune moine, quand on a entendu les moniales de Solesmes, ce que celles de Paris semblent... province.
— Et vous avez vu l’abbesse de Sainte-Cécile ? tiens ! mais... et Durtal chercha dans sa mémoire — n’est-elle pas l’auteur d’un Traité de l’oraison que j’ai parcouru autrefois à la Trappe, mais qui n’a pas été vu d’un bon oeil, je crois, au Vatican ?
— C’est elle, en effet ; mais vous commettez la plus complète erreur, en vous imaginant que son livre ait pu déplaire à Rome. Il y a été, de même que tous les ouvrages de ce genre, examiné à la loupe, passé au tamis, ligne par ligne, tourné et retourné dans tous les sens ; mais les théologiens chargés du service de cette douane pieuse ont reconnu et certifié que cette oeuvre, conçue d’après les plus sûrs principes de la mystique, était savamment, résolument, éperdument orthodoxe.
J’ajoute que ce volume qui fut imprimé par madame l’abbesse, aidée de quelques nonnes, sur une petite presse à bras que possède le monastère, n’a jamais été mis dans le commerce. Il est, en somme, le résumé de sa doctrine, le suc essentiel de ses leçons, et il est surtout destiné à celles de ses filles qui ne peuvent profiter de ses enseignements et de ses conférences, parce qu’elles habitent loin de Solesmes, dans les autres abbayes qu’elle a fondées.
Tenez maintenant que les bénédictines étudient pendant dix années le latin, que beaucoup d’entre elles traduisent l’hébreu et le grec, sont expertes en exégèse ; que d’autres dessinent et peignent des pages de missel, rajeunissent l’art épuisé des enlumineurs d’antan ; que d’autres encore, telles que la mère Hildegarde, sont des organistes de première force... vous penserez sans doute que la femme qui les manie, qui les dirige, que la femme qui a créé, dans ses cloîtres, des écoles de mystique pratique et d’art religieux est une personne tout à fait extraordinaire et, avouons-le, par ce temps de frivole dévotion et d’ignare piété, unique !
— Mais c’est une grande Abbesse du moyen âge ! s’écria Durtal.
— Elle est le chef-d’oeuvre de dom Guéranger qui l’a prise presque enfant et lui a malaxé et lui a longuement broyé l’âme ; puis il l’a transplantée dans une serre spéciale, surveillant, chaque jour, sa croissance en Dieu, et le résultat de cette culture intensive, vous le voyez.
— Oui, et n’empêche cependant que les couvents sont, pour certaines gens, des réceptacles de fainéantise et des réservoirs de folie ; quand on songe aussi que d’obscurs imbéciles écrivent dans des feuilles que les moniales ne comprennent rien au latin qu’elles lisent ! Il serait à souhaiter qu'ils fussent d’aussi bons latinistes que ces femmes !
L’abbé sourit.
— Au reste, poursuivit-il, le secret du chant grégorien est là. Il faut non seulement connaître la langue des psaumes qu’on récite, mais encore saisir le sens souvent douteux, dans la version de la Vulgate, de ces psaumes pour les bien rendre. Sans ferveur et sans science, la voix n’est rien.
Elle peut être excellente dans les morceaux de la musique profane, mais elle est vide, nulle, quand elle s’attaque aux phrases vénérables du plain-chant.
— Et les pères, à quoi s’occupent-ils ?
— Eux, ils ont d’abord commencé pas restaurer la liturgie et le chant de l’Église, puis ils ont découvert et réuni dans un Spicilège et dans des Analectes, en les agrémentant d’attentives gloses, les textes perdus de subtils symbolistes et de studieux saints. A l’heure actuelle, ils rédigent et ils impriment la Paléographie musicale, l’une des plus érudites et des plus sagaces publications de ce temps.
Mais il ne siérait pas de vous persuader que la mission de l’ordre bénédictin consiste exclusivement à fouiller de vieux manuscrits et à reproduire d’anciens antiphonaires et d’antiques chartes. Sans doute, le moine qui a du talent, dans un art quelconque, s’adonne à cet art, si l’abbé le veut ; la règle est, sur ce point, formelle ; mais le but réel, le but véritable du fils de saint Benoît est de psalmodier ou de chanter la louange divine, de faire l’apprentissage ici-bas de ce qu’il fera là-haut, de célébrer la gloire du Seigneur en des termes inspirés par Lui-même, en une langue que Lui-même a parlée par la voix de David et des prophètes. Sept fois par jour, les bénédictins remplissent le devoir de ces vieillards de l’Apocalypse que saint Jean nous montre dans le firmament et que les imagiers ont sculptés, jouant des instruments, ici même, à Chartres.
En résumé, leur fonction particulière n’est donc point de s’inhumer dans la poudre des âges, ou bien encore d’exercer la substitution des péchés et la suppléance des maux d’autrui, ainsi que les ordres de pure mortification, tels que les carmélites et les clarisses ; leur vocation est de pratiquer l’office des anges ; c’est une oeuvre d’allégresse et de paix, une avance d’hoirie sur la succession jubilaire de l’au delà, l’oeuvre qui se rapproche le plus de celle des purs esprits, la plus élevée qui soit, sur la terre, en somme.
Pour s’acquitter convenablement de cet emploi, il faut, en sus d’une ardente piété, une science foncière des Écritures et un sens affiné de l’art. Les vrais bénédictins doivent donc être à la fois des saints, des savants et des artistes.
— Et le train-train journalier que l’on vit à Solesmes ? demanda Durtal.
— Très méthodique et très simple ; matines et laudes à 4 heures du matin ; à 9 heures, tierce, messe conventuelle et sexte ; à midi, dîner ; à 4 heures, none et vêpres ; à 7 heures, souper ; à 8 heures et demie, complies et grand silence. Vous le voyez, on a le temps de se recueillir et de travailler, dans les intervalles des heures canoniales et des repas.
— Et les oblats ?
— Quels oblats ? Je n’en ai pas vu à Solesmes.
— Ah !... mais s’il en existe, mènent-ils la même vie que les Pères ?
— Évidemment, sauf peut-être certains adoucissements qui dépendent du bon vouloir de l’abbé. Ce que je puis vous dire, c’est que dans d’autres abbayes bénédictines que je connais, la formule adoptée est celle-ci : l’oblat prend de la règle ce qu’il en peut prendre.
— Mais il est, je suppose, libre de ses mouvements, libre de ses actes ?
— Du moment qu’il a prêté serment d’obéissance entre le mains de son supérieur et qu’il a, après le temps de sa probation, revêtu l’habit monastique, il est moine comme les autres et, partant, il ne peut plus rien effectuer sans l’autorisation du père abbé.
— Fichtre ! murmura Durtal. En somme, si cette sotte comparaison qui a cours dans le monde était authentique, si le cloître devait être assimilé à une tombe, l’oblature en serait encore une ; seulement elle aurait des cloisons moins étanches et son couvercle entr’ouvert laisserait pénétrer un peu de jour.
— Si vous voulez, fit l’abbé, en riant.
Ils étaient arrivés, en devisant, près de l’évêché. Ils entrèrent dans la cour et aperçurent l’abbé Gévresin qui se dirigeait vers les jardins ; ils le rejoignirent et le vieux prêtre les invita à l’accompagner dans le potager où il désirait, pour être agréable à sa gouvernante, visiter les légumes qu’elle avaient semés.
— Le fait est qu’il y a assez longtemps que, moi aussi, je lui ai promis de les contempler, ses légumes ! s’écria Durtal.
Ils traversèrent les anciennes allées, atteignirent le verger en contre-bas, et, dès que Mme Bavoil les vit, elle se mit au port d’armes des jardiniers, le pied posé sur le fer de la bêche fichée en terre.
Elle montra fièrement ses plants alignés de carottes et de choux, d’oignons et de pois, annonça qu’elle méditait une excursion dans le domaine des cucumènes, s’emballa sur les concombres et les courges, finit, en déclarant qu’elle réserverait, au fond du potager, une place pour les fleurs.
Ils s’assirent sur un tertre qui formait une sorte de banc.
En veine de taquinerie, l’abbé Plomb remonta ses lunettes munies d’une arche sous laquelle descendait le nez, et se frottant les mains, très sérieusement, il dit :
— Madame Bavoil, les fleurs et les légumes sont de piètre importance, au point de vue décoratif et comestible ; ce qui doit seul vous guider dans le choix de vos cultures, c’est le sens symbolique de vertus ou de vices prêté aux plantes. Or, je crois le remarquer, vos élèves avèrent, pour la plupart, de fâcheux augures.
— Je ne comprends pas, monsieur le vicaire.
— Dame, songez que ces végétaux que vous choyez annoncent de funestes présages. Vous avez des lentilles ?
— Oui.
— Eh bien, la lentille possède des graines sournoises et ténébreuses. Dans son Interprétation des songes, Arthemidore nous assure que si l’on rêve d’elles, c’est un signe de deuil ; de même pour la laitue et l’oignon, ils pronostiquent des catastrophes. Les petits pois sont mieux famés, mais gardez-vous surtout, comme d’une peste, de cette coriandre dont les feuilles sentent la punaise, car elle fait naître tous les maux !
Par contre, selon Macer Floridus, le serpolet guérit les morsures du serpent, le fenouil stimule chez la femme les siestes du sang, et l’ail, mangé à jeun, préserve des maléfices que l’on pourrait contracter, en buvant d’une eau inconnue ou en changeant de place... plantez donc des prairies entières d’ail, madame Bavoil.
— Le père ne l’aime pas !
— Il convient aussi, poursuivit gravement l’abbé Plomb, de vous inspirer des livres du maître de saint Thomas d’Aquin, d’Albert le Grand qui, dans les traités qu’on lui attribue à tort sans doute sur les vertus des herbes, les merveilles du monde et les secrets des femmes, émet quelques aperçus qui ne sauraient, j’aime à le penser, demeurer vains.
N’est-ce pas lui qui atteste que la racine de plantain est excellente contre les maux de tête et les ulcères ; que le gui de chêne ouvre toutes les serrures ; que la chélidoine, appliquée sur la tète d’un malade, chante s’il doit mourir ; que grâce au jus de la joubarbe l’on peut saisir un fer chaud sans se brûler ; que la feuille du myrte tressée en anneau réduit les apostèmes ; que le lis pulvérisé et mangé par une jeune fille permet de s’assurer si elle est vierge car, au cas où elle ne le serait point, cette poudre acquiert, aussitôt qu’elle l’a absorbée, les irrésistibles vertus d’un diurétique...
— J’ignorais cette propriété du lis, dit Durtal en riant, mais je savais que ce même Albert le Grand assignait déjà cette qualité à la mauve ; seulement la patiente ne s’ingère pas le résidu de cette fleur, mais se tient simplement dessus ; et cela suffit, néanmoins, pour que l’épreuve soit décisive, il sied que la mauve reste quand même sèche.
— Quelle folie, s’exclama l’abbé Gévresin.
Complètement ahurie, la gouvernante regardait le sol.
— Ne l’écoutez pas, madame Bavoil, s’écria Durtal ; moi j’ai une autre idée moins pharmaceutique et plus religieuse, celle-ci : cultiver une flore liturgique et des légumineux à emblèmes, oeuvrer un jardin et un potager qui célébreraient la gloire de Dieu, lui porteraient nos prières dans leur idiome, rempliraient, en un mot, le but du Cantique des trois jeunes hommes dans la fournaise lorsqu’ils invitent la nature, depuis le souffle des tempêtes jusqu’au dernier des germes enfouis dans les champs, à bénir le Seigneur !
— Pas mal, s’exclama l’abbé Plomb, mais il faudrait alors disposer de vastes espaces, car l’on n’énumère pas moins de cent trente plantes dans les Écritures et immense est le nombre de celles auxquelles le moyen âge décerna des sens !
— Sans compter, dit l’abbé Gévresin, qu’il serait équitable que ce jardin, dépendant de notre basilique, reproduisit la botanique de ses murs.
— La connaît-on ?
— L’on n’a point dressé pour elle comme pour la végétation lapidaire de Reims un catalogue ; car l’herbier minéral de la Notre-Dame de cette ville a été soigneusement classé et étiqueté par M. Saubinet : mais remarquez-le bien, ces récoltes de chapiteaux sont à peu près partout les mêmes. Dans toutes les églises du treizième siècle, vous découvrez les feuilles de la vigne, du chêne, du rosier, du lierre, du saule, du laurier et de la fougère, des fraisiers et des renoncules. Presque toujours, en effet, les imagiers sculptaient les végétaux indigènes, les plantes de la région où ils travaillaient.
— Voulaient-ils exprimer une idée spéciale avec les couronnes et les corbeilles des chapiteaux ? A Amiens, par exemple, la guirlande de feuillages et de fleurs qui court au-dessus des arcades de la nef, s’enroule le long de l’édifice, côtoie les contours des piliers, a-t-elle, en dehors du but probable de partager la hauteur de l’église en deux parties pour le repos de l’oeil, une autre acception ; figure-t-elle une pensée particulière, traduit-elle une phrase relative à la Vierge sous le vocable de laquelle la cathédrale est placée ?
— J’en doute, répondit le vicaire. Je crois plus simplement que l’artiste qui cisela ces festons a cherché un effet décoratif et nullement prétendu nous raconter, en un langage hermétique, un abrégé des vertus de notre Mère. D’ailleurs, si nous admettons qu’au treizième siècle les sculpteurs usaient de l’acanthe à cause des douceurs émollientes qu’elle implique, du chêne parce qu’il spécifie la force, du nénuphar, parce qu’il simule, à cause de l’ampleur de ses feuilles, la charité, nous devons également supposer qu’à la fin du quinzième siècle, alors que l’art du symbolisme n’était pas encore entièrement perdu, les chicorées, les choux frisés, les chardons, les plantes aux touffes laciniées qui s’associent aux lacs d’amour dans l’église de Brou, avaient, eux aussi, un sens. Or, il est très certain que ces végétations ont été choisies pour l’élégance tourmentée de leur structure, pour la grâce grêle et maniérée de leurs formes. Autrement, nous avérons que ces ornements relatent une histoire différente de celles que nous narre la botanique de Reims et d’Amiens, de Rouen et de Chartres.
En somme, ce qui s’affirme le plus souvent dans les chapiteaux de notre cathédrale — qui n’est pas d’ailleurs l’une des mieux fleuries — c’est cette crosse d’évêque qu’imite la pousse naissante de la fougère.
— Bien, mais n’est-elle pas employée dans une intention symbolique, la fougère ?
— Elle est, en thèse générale, le synonyme de l’humilité — ce qui s’explique par ses habitudes de vivre, autant que possible, loin des routes, dans des fonds de bois ; mais si nous consultons le manuel de sainte Hildegarde, nous apprenons que ce végétal qu’elle dénomme « faru » est une plante magique.
De même que le soleil dissipe les ténèbres, de même, dit l’abbesse de Rupertsberg, le faru met en fuite les cauchemars. Le diable l’évite et l’abomine et rarement la foudre et la grêle tombent dans les endroits où elle s’abrite ; l’homme enfin, qui la porte sur lui, échappe aux cantermes et aux charmes...
— Sainte Hildegarde, elle, s’est donc occupée d’histoire naturelle, au point de vue médical et magique ?
— Oui, seulement son livre est inconnu parce qu’il n’a pas été traduit jusqu’à ce jour. Parfois, elle assigne de bien singulières qualités talismaniques à certaines flores. En voulez-vous des preuves ?
Tenez, suivant elle, le plantain guérit la personne qui a bu ou mangé un maléfice et la pimprenelle est dotée des mêmes vertus, lorsqu’on l’attache à son col. La myrrhe doit être chauffée sur la chair jusqu’à ce qu’elle s’amollisse et alors elle rompt l’art des sorciers, délivre des phantasmes, devient l’antidote des philtres. Elle disperse aussi les pensées de luxure si on la place sur la poitrine et sur le ventre ; seulement quand elle élimine les idées de libertinage, elle attriste et rend « aride » ; ce pourquoi, il ne faut surtout point en absorber sans grande nécessité, observe la sainte.
Il est vrai que, pour refouler le chagrin qu’insinuerait la myrrhe, l’on pourrait alors utiliser l’hymelsloszel qui est ou paraît être la primevère officinale, le vulgaire coucou dont les ombelles d’un jaune odorant s’épanouissent dans les forêts humides et dans les prés. Celle-là est chaude et puise ses forces dans la lumière. Aussi chasse-t-elle la mélancolie qui trouble, assure sainte Hildegarde, les moeurs de l’homme et lui fait proférer des paroles contre Dieu ; ce qu'entendant, les esprits de l’air accourent et achèvent d’affoler par leur présence celui qui les prononce.
Je pourrais vous citer encore la mandragore, plante chaude et aqueuse qui se peut assimiler à l’être humain dont elle singe la ressemblance ; ainsi subit-elle la suggestion du démon plus que les autres, mais je préfère vous révéler une de ses sages recettes.
Voici l’ordonnance qu’elle rédige, à propos de la fleur de lis : Prenez l’extrémité de sa racine, écrasez-la dans de la graisse rance, chauffez cet onguent et frottez-en le malade atteint de la lèpre rouge ou de la lèpre blanche et tôt il guérira.
Laissons maintenant ces récipés et ces amulettes d’antan et arrivons au symbolisme même des plantes.
En général, les fleurs sont des emblèmes du bien. Suivant Durand de Mende, elles représentent, ainsi que les arbres, les bonnes oeuvres qui ont les vertus pour racines ; selon Honoré le Solitaire, les herbes vertes sont les sages ; les fleuries, ceux qui progressent ; celles qui donnent des fruits, les âmes parfaites ; enfin, d’après les vieux traités de théologie symbolique, les végétaux énoncent les allégories de la Résurrection et la notion d’éternité est spécialement affectée à la vigne, au cèdre, au palmier...
— Ajoutez, interrompit l’abbé Gévresin, que les psaumes confondent ce dernier arbre avec le Juste et que, d’après une version de saint Grégoire le Grand, il indique avec son écorce rugueuse et les régimes dorés de ses dattes, le bois de la croix, dur au toucher, mais dont les fruits sont savoureux pour celui qui sait les goûter.
— Enfin, dit Durtal, je suppose que Mme Bavoil veuille tracer un jardin liturgique, quelles espèces doit-elle choisir ?
Peut-on d’abord former un lexique végétal des péchés capitaux et des vertus qui leur sont opposées, établir une base d’opérations, trier, d’après certaines règles, les matériaux dont l’horticulteur mystique pourrait user ?
— Je l’ignore, fit l’abbé Plomb ; néanmoins cela me paraît, à première vue, possible ; mais encore faudrait-il avoir présents à la mémoire les noms de plantes qui peuvent être les équivalents plus ou moins exacts de ces qualités et de ces fautes. Au fait, c’est une traduction, en langue florale, de notre catéchisme que vous me demandez ; essayons :
L’orgueil, nous avons la citrouille qui fut jadis adorée dans la ville de Sicyone, telle qu’une déesse. Elle revêt tour à tour l’apparence de la fécondité et de l’orgueil, — de la fécondité, à cause de ses nombreuses semences et de sa facilité à croître que le moine Walafrid Strabo célèbre en de glorieux hexamètres, pendant tout un chapitre de son poème ; — d’orgueil, à cause de l’importance de son énorme tête creuse et de son enflure ; nous avons encore le cèdre que, d’accord avec saint Méliton, Pierre de Capoue taxe de superbe.
L’avarice, j’avoue que je ne discerne point de végétal qui la reflète ; passons, nous verrons plus tard.
— Pardon, dit l’abbé Gévresin, saint Eucher et Raban Maur signalent comme images des richesses qui s’entassent, au détriment de l’âme, les épines. D’autre part, saint Méliton proclame que le sycomore est la cupidité.
— Ce pauvre sycomore, fit le vicaire en riant, ce qu’on l’a mis à toutes les sauces ! Raban Maur et l’anonyme de Clairvaux le qualifient aussi de juif incrédule ; Pierre de Capoue le compare à la croix, saint Eucher à la sagesse, et j’en omets. Mais, avec tout cela, je ne sais plus où j’en suis. Ah ! à la luxure. Ici, nous n’avons que l’embarras du choix. Outre la série des arbres phalliques, nous possédons le cyclamen dit pain de pourceau qui, d’après une ancienne assertion de Théophraste, est l’enseigne de la volupté parce qu’il servait à composer des philtres d’amour ; l’ortie qui, selon Pierre de Capoue, signifie les mouvements déréglés de la chair ; puis la tubéreuse, une plante plus moderne, mais connue néanmoins dès le seizième siècle et rapportée par un père minime en France. Son odeur capiteuse, qui détraque les nerfs, induit, paraît-il, aux émois des sens.
L’envie, nous avons la ronce et l’hellébore qui résume plus spécialement, il est vrai, la calomnie et le scandale, et encore l’ortie qui, d’après une autre interprétation d’Albert le Grand, frime la bravoure et chasse la peur.
La gourmandise ? — le vicaire chercha — les plantes carnivores telles que la dionée et le drosera des tourbières...
— Et pourquoi pas cette simple fleur des champs, la cuscute, la pieuvre du règne végétal, qui lance les antennes de ses tiges minces telles que des fils sur les autres plantes, y enfonce de petits suçoirs et se nourrit voracement de leur substance ? hasarda l’abbé Gévresin.
— La colère, continua l’abbé Plomb, est traduite par ce bâton à fleurs rosâtres, baptisé du sobriquet d’orange de savetier, par le peuple, par le basilic qui emprunte, depuis le moyen âge, à son homonyme de la race animale, sa déplorable réputation de cruauté et de rage.
— Oh ! s’écria Mme Bavoil, on en parfume les hachis et l’on assaisonne avec certains ragoûts !
— C’est une grave erreur de l’hygiène culinaire et un danger spirituel, fit en souriant le prêtre. Il poursuivit :
La colère peut être également alléguée par la balsamine, image surtout de l’impatience, à cause de l’irritabilité de ses capsules qui se détendent, au moindre contact, en éclatant bruyamment, en projetant, au loin, leurs graines.
Enfin, la paresse, par la famille des pavots qui endort.
Quant aux vertus opposées à ces vices, la version qu’elles exigent est enfantine.
Pour l’humilité, vous avez la fougère, l’hysope, le liseron, la violette qui, d’après Pierre de Capoue, est, en raison même de cette qualité, la figure du Christ.
— Et stipule, selon saint Méliton, les confesseurs et, suivant sainte Mechtilde, les veuves, ajouta l’abbé Gévresin.
— Pour le détachement des biens de la terre, nous relevons le lichen, qui est le simulacre de la solitude ; pour la chasteté : l’oranger et le lis ; pour la charité : le nénuphar, la rose et le safran, au dire de Raban Maur et de l’anonyme de Clairvaux ; pour la tempérance : la laitue qui est aussi le jeûne ; pour la douceur : le réséda ; pour la vigilance : le sureau qui signifie surtout le zèle ou le thym qui symbolise, avec ses sucs vifs et acides, l’activité.
Écartons les péchés dont nous n’avons que faire dans un pourpris voué à Notre-Dame et préparez vos parterres avec des gerbes de dévotes fleurs.
— Comment s’y prendre ? demanda l’abbé Gévresin.
— Mais de deux façons, répliqua Durtal : ou accepter le cadre d’une église réelle et inachevée et remplacer les statues par des fleurs, — ce qui serait avantageux au point de vue de l’art, — ou bien construire complètement un sanctuaire avec des arbres et des plantes.
Il alla chercher une baguette qui traînait dans le champ. Tenez voici le plan de notre basilique, fit-il, en dessinant sur le sol les lignes cruciales d’une église.
Je suppose maintenant que nous la bâtissions, en commençant par la fin, par l’abside ; nous y plaçons naturellement la chapelle de la Vierge, ainsi que dans la majeure partie des cathédrales.
Ici, les plantes abondent qui servent d’attributs à notre Mère.
— La Rose mystique des litanies ! s’exclama Mme Bavoil.
— Heuh ! fit Durtal, la rose fut bien galvaudée. Outre qu’elle fut une des plantes érotiques du paganisme, au moyen âge, l’on condamna dans nombre de villes les juifs et les prostituées à porter, comme signe distinctif de leur infamie, cette fleur !
— Oui, mais, s’écria l’abbé Plomb, Pierre de Capoue lui fait personnifier, en raison de son sens d’amour et de charité, la Vierge ; d’autre part, sainte Mechtilde déclare que les roses manifestent les martyrs et, dans un autre passage du livre de la Grâce spéciale, elle identifie aussi cette fleur avec la vertu de patience.
— Dans son Hortulus, Walafrid Strabo avère également que la rose est le sang des saints suppliciés, murmura l’abbé Gévresin.
— Rosae Martyres, rubore sanguinis, voir la clef de saint Méliton, confirma le vicaire.
— Va pour cet arbrisseau, s’écria Durtal, nous avons maintenant le lis.
— Ici je vous arrête, clama l’abbé Plomb, car il faut tout d’abord établir que le lis des Écritures n’est nullement, ainsi qu’on le croit, la fleur connue sous ce nom. Le lis ordinaire, celui qui fleurit en Europe et qui est devenu, même avant le moyen âge, l’emblème de la virginité dans l’Église, ne parait pas avoir jamais poussé en Palestine ; d’ailleurs quand le Cantique des Cantiques compare la bouche de la Bien-aimée à cette plante, il n’entend évidemment pas admirer des lèvres blanches, mais bien des lèvres rouges.
Le végétal désigné sous le nom de lis des vallées, de lis des champs, dans la Bible, est tout bonnement l’anémone. L’abbé Vigouroux le démontre.
Elle foisonne en Syrie, à Jérusalem, en Galilée, sur le mont des Olives, cette fleur qui jaillit de feuilles découpées et alternées d’un vert opulent et sourd et qui ressemble à un coquelicot délicat et subtil, suggère l’idée d’une plante patricienne, d’une petite infante, fraîche et pure, dans de coquets atours.
— Il est certain, fit Durtal, que la candeur du lis n’apparaît guère ; car son parfum, si l’on y réfléchit, est absolument le contraire d’une senteur chaste. C’est un mélange de miel et de poivre, quelque chose d’âcre et de doucereux, de pâle et de fort ; cela tient de la conserve aphrodisiaque du Levant et de la confiture érotique de l'Inde.
— Mais enfin, observa l’abbé Gévresin, en admettant qu’il n’y ait jamais eu de lis en Terre Sainte — et est-ce bien vrai ? — il n’en reste pas moins acquis que l’antiquité, que le moyen âge ont extrait de cette fleur toute une série de symboles.
Ainsi, ouvrez Origène ; pour lui, le lis est le Christ, car Notre-Seigneur a désigné sa propre personne lorsqu’il a dit : « Je suis la fleur des champs et le lis des vallées » ; et, dans cette phrase, les champs, qui sont terres cultivées, représentent le peuple hébreu instruit par Dieu lui-même et les vallées qui sont lieux en friche, les ignorants, en d’autres termes, les païens.
Lisez maintenant Petrus Cantor. Selon lui, le lis est la fille de Joachim à cause de sa blancheur, de son arome délectable entre tous, de ses vertus curatives, enfin parce qu’il sort d’un sol inculte comme la Vierge qui est issue de parents juifs.
— Au point de vue thérapeutique cité par Petrus Cantor, ajoutons, fit l’abbé Plomb, que le lis est, d’après l’anonyme anglais du treizième siècle, un remède souverain contre les brûlures ; ce pourquoi, il est l’image de la Madone, qui guérit, Elle aussi, les brûlures, autrement dit les vices des pécheurs.
— Consultez encore, reprit l’abbé Gévresin, saint Méthode, sainte Mechtilde, Pierre de Capoue, ce moine anglais dont vous venez de parler et vous trouverez que le lis est l’attribut non seulement de la Vierge Marie, mais encore de la virginité même et de toutes les vierges.
Voici enfin une bottelette de sens cueillis, l’un par saint Eucher qui rapproche la blancheur du lis de la pureté des anges ; l’autre par saint Grégoire le Grand qui confronte sa bonne odeur avec celle des saints ; cet autre par Raban Maur qui prétend que le lis est la béatitude céleste, l’éclat de la sainteté, l’Église, la perfection, la pureté de la chair...
— Sans compter que, suivant la traduction d’Origène, le lis, entre les épines, se réfère à l’Église entre ses ennemis, jeta l’abbé Plomb.
— Il est donc Jésus, sa Mère, les anges, les saints, l’Église, les vertus, les vierges, il est tout ! s’exclama Durtal. On se demande comment ces jardiniers mystiques parvenaient à démêler tant de desseins dans une seule et même plante !
— Mais vous le voyez ; outre les analogies et les similitudes qu’ils pouvaient relever entre la forme, la senteur, la teinte d’une fleur et l’être auquel ils la rattachaient, les symbolistes commentaient la Bible, étudiaient les passages qui mentionnent le nom de tel arbre ou de telle plante, et ils qualifiaient ensuite ces végétaux selon la signification que déterminait ou que laissait sous-entendre le texte ; et ils agissaient de même pour les animaux, pour les couleurs, pour les pierres, pour toutes les autres choses auxquelles ils distribuaient des sens ; en somme, c’est assez simple.
— Et assez compliqué ! où diable en étais-je ? s’enquit Durtal.
— A la chapelle de la Vierge, vous y mettez des anémones, des roses ; joignez-y un buisson, image de Marie, d’après l’anonyme de Clairvaux, de l’Incarnation, suivant l’anonyme de Troyes ; le noyer dont les fruits sont pris, par l’évêque de Sardes, dans la même acception.
— Et aussi du réséda, s’écria Durtal, car la soeur Emmerich en parle à diverses reprises et très mystérieusement. Elle dit que cette fleur a un rapport tout particulier avec Marie qui la cultiva et en fit grand usage...
Puis un autre arbuste me semble également indiqué, la fougère, non pour les qualités que lui prête sainte Hildegarde, mais parce qu’il est l’effigie de l’humilité la plus cachée, la plus secrète. Prenez, en effet, une de ses fortes tiges et coupez-la, en biseau, en bec de sifflet, et vous verrez très distinctement, gravée en noir, ainsi qu’au fer chaud, la figure héraldique d’un lis. Le parfum n’étant plus, nous pouvons le recevoir alors comme le symbole de l’humilité si parfaite qu’elle ne se découvre qu’après la mort.
— Tiens, tiens, mais notre ami n’est pas si ignorant des choses de la campagne que je croyais, dit Mme Bavoil.
— Oh ! j’ai un peu galopiné, pendant mon enfance, dans les bois !
— Pour le choeur de l’église, la discussion n’est pas possible, je pense, fit l’abbé Gévresin. Les substances eucharistiques, la vigne et le blé, s’imposent.
La vigne dont le Seigneur a dit : Ego sum vitis, et qui est aussi l’emblème de la communion de la huitième Béatitude ; le blé qui, en sa qualité de matière sacramentelle, fut l’objet de tant de soins, de tant de respect, au moyen âge.
Rappelez-vous les cérémonies solennelles de certains monastères, lorsqu’il s’agissait de préparer ces pains.
A Saint-Étienne de Caen, les religieux se lavaient le visage et les mains, récitaient, agenouillés devant l’autel de saint Benoît, l’office de laudes, les sept psaumes de la pénitence et les litanies des saints ; puis un frère lai présentait le moule dans lequel devaient cuire deux hosties à la fois ; et le jour où l’on apprêtait ces azymes, ceux qui avaient pris part à leur confection dînaient ensemble et leur table était servie pareillement à celle du père abbé.
De même à Cluny, où trois prêtres ou trois diacres à jeun, après avoir débité les prières que je viens d’énumérer, se revêtaient d’aubes et s’adjoignaient quelques convers. Ils délayaient dans de l’eau froide la fleur du froment provenant de grains triés, un à un, par les novices ; et un frère, les mains gantées, cuisait les oublies sur un grand feu de sarments, dans le moule historié de fer.
— Cela me fait songer, dit Durtal qui alluma une cigarette, au moulin à moudre le blé du sacrifice.
— Je connais bien le pressoir mystique qui fut très souvent reproduit par les verriers du quinzième et du seizième siècle et qui était, en somme, une paraphrase du texte prophétique d’Isaïe : « J’étais seul à fouler un pressoir et nul homme n’est venu travailler avec moi », mais j’avoue que le moulin mystique m’est inconnu, fit l’abbé Gévresin.
— J’en ai aperçu un à Berne, dans un vitrail du quinzième siècle, attesta l’abbé Plomb.
— Et moi, je l’ai vu dans la cathédrale d’Erfurt, peint non sur verre, mais sur bois ; ce tableau anonyme, et daté de 1534, m’est présent encore.
En haut, Dieu le Père, un bon vieux, à barbe de neige, solennel et pensif ; puis le moulin semblable à un moulin à café, placé au bord d’une table et ayant son tiroir du bas ouvert. Les bêtes évangéliques vident dans la bouche de l’instrument des outres blanches pleines de banderoles sur lesquelles sont inscrites les paroles effectives du sacrement ; et ces banderoles descendent dans le ventre de la machine, reparaissent dans le tiroir, en ressortent pour tomber dans un calice que tiennent un cardinal et un évêque agenouillés devant la table.
Et les mots se muent en un petit enfant qui bénit, tandis que les quatre évangélistes tournent une longue manivelle d’argent dans le coin du panneau, à droite.
— Ce qui est étrange, observa l’abbé Gévresin, c’est que ce soient les phrases de la transsubstantiation et non la substance même qu’elles doivent changer que les évangélistes deux fois représentés, sous l’aspect animal et humain, déroulent dans leur appareil et broient. De même pour la sainte oblate absente et remplacée par de la vraie chair.
Au fait c’est juste ; puisque les paroles de la consécration ont été prononcées, le pain n’est plus. Cette disposition, quand même bizarre, de sous-entendre, dans ce sujet matériel, dans cette scène de meunerie, le froment, en grain, en farine, en hostie ; ce dessein arrêté de supprimer les espèces, les apparences, pour y substituer une réalité que ne peuvent appréhender les sens, ont dû être adoptés par le peintre pour frapper les masses, pour affirmer la certitude du mystère, pour le rendre visible aux foules. Mais si nous revenions à la construction de notre église. Nous en étions ?
— Ici, fit Durtal, en désignant avec sa baguette les avenues longeant la nef dessinée sur le sable. Voyons, pour oeuvrer les chapelles latérales, nous avons le choix. Nous en dédions une, cela va de soi, à saint Jean Baptiste. Pour le distinguer des autres, nous avons le giroflier et le lierre auxquels il a cédé son nom ; l’armoise, surtout, qui, cueillie la veille de sa fête et pendue dans une chambre, détruit les malengins et les charmes, écarte la foudre et refoule l’apparition des spectres. Remarquons encore que cette plante, célèbre au moyen âge, était employée contre l’épilepsie et la danse de Saint-Guy, deux maux pour la cure desquels l’intercession du Précurseur est efficace.
Nous en dédicaçons une aussi à saint Pierre. Nous pouvons déposer alors sur son autel un bouquet des herbes placées par nos pères sous son vocable : la primevère, le chèvrefeuille des buissons, la gentiane et la saponaire, la pariétaire et le liseron, d’autres encore dont la nomenclature m’échappe.
Mais avant tout, il siérait, n’est-ce pas, d’édifier un refuge à Notre-Dame des Sept-Douleurs, comme il s’en élève dans tant d’églises.
La fleur nettement indiquée est la passiflore, cette fleur unique, d’un bleu qui violit et dont l’ovaire simule la croix ; les styles et les stigmates, les clous ; les étamines, les marteaux ; les organes filamenteux, la couronne d’épines ; elle renferme, en un mot, tous les instruments de la Passion. Associez-y, si vous voulez, un rameau d’hysope, plantez un cyprès, image du Sauveur, suivant saint Méliton, de la mort, selon M. Olier, un myrte qui, d’après un texte de saint Grégoire le Grand, certifie la compassion ; et n’oubliez pas surtout le nerprun ou le rhamnus, car ce fut l’arbrisseau dont les juifs enlacèrent les branches pour façonner la couronne du Christ ; — et la chapelle est bâtie.
— Le rhamnus, dit l’abbé Gévresin, oui, Rohaut de Fleury assure que ce fut avec ses tiges épineuses que l’on ceignit la tête du Fils, et cela laisse rêveur, si l’on songe que, dans l’Ancien Testament, au chapitre IX du livre des Juges, tous les grands arbres de la Judée s’inclinent devant la royauté que se décerne prophétiquement ce pauvre arbuste.
— Certes, répondit l’abbé Plomb, mais ce qui est bien curieux aussi, c’est le nombre de sens absolument différents que les très vieux symbolistes prêtent au nerprun. Saint Méthode l’adapte à la virginité ; Théodoret, au péché ; saint Jérôme, au diable ; saint Bernard, à l’humilité.
Tenez aussi que dans la Theologia symbolica de Maximilien Sandaeus, cet arbrisseau est noté comme le prélat mondain, alors que l’olivier, la vigne, le figuier auxquels l’auteur le compare, signifient les ordres contemplatifs. Il y a là, sans doute, une allusion aux épines que les évêques ne se faisaient pas toujours faute d’enfoncer dans le chef dolent des cloîtres.
Vous oubliez encore, dans le blason de votre chapelle, le roseau qui fut le sceptre dérisoire qu’on infligea au Fils. Mais le roseau est, ainsi que le rhamnus, une sorte de maître Jacques. Saint Méliton le définit : l’Incarnation et les Ècritures ; Raban Maur : le prédicateur, l’hypocrite et les gentils ; saint Eucher : le pécheur ; l’anonyme de Clairvaux : le Christ ; et j’en oublie.
— C’est bien des personnifications pour une seule espèce, fit Durtal ; — maintenant si nous désirons spécifier encore quelques chapelles vouées à des saints, rien n’est plus facile, au moins pour ceux dont le nom servit à baptiser des plantes.
Nous avons, par exemple, la valériane dite herbe de saint Georges, cette fleur blanche à tige fistuleuse qui croît dans les lieux humides et dont le surnom se comprend, puisqu’on l’utilisait dans la médication des maladies nerveuses contre lesquelles était invoqué ce saint.
L’herbe ou plutôt les herbes de Saint-Roch : la menthe pouliot, deux sortes d’inules dont une purgative, aux fleurs d’un jaune d’or, guérissant la gale ; autrefois, le jour de la fête de cet élu, l’on bénissait ces touffes que l’on accrochait dans les étables pour préserver, des épizooties, le bétail.
L’herbe de Sainte-Anne, une triste pariétaire, le perce-muraille, emblème de la pauvreté.
L’herbe de Sainte-Barbe, le vélar, plante crucifère et antiscorbutique, d’aspect misérable, se traînant, telle qu’une mendiante, le long des routes.
L’herbe de Saint-Fiacre, la molène dont les feuilles émollientes, cuites en cataplasmes, apaisent les coliques que ce saint a, d’ailleurs, la réputation de calmer.
L’herbe de Saint-Étienne, la circée, plante bénigne à grappes rougeâtres, portées sur un pédoncule velu ; et combien d’autres !
Quant à la crypte, en admettant que nous en creusions une, elle devrait évidemment être peuplée avec les essences de l’Ancien Testament qui est lui— même rappelé par cette partie de l’église. Il faudrait donc, en dépit des climats, cultiver la vigne, le palmier, enseignes de l’éternité ; le cèdre qui, à cause de son bois incorruptible, implique parfois l’idée des anges ; puis l’olivier, le figuier, figures de la Sainte-Trinité et du Verbe ; l’oliban, la casse, le balsamodendron-myrrha, symbole de la perfection de l’humanité de Notre-Seigneur, les térébinthes qui décèlent quoi, au juste ?
— D’après Pierre de Capoue, la croix et l’Église ; les saints, suivant saint Méliton ; la doctrine des juifs et des hérétiques, selon l’anonyme de Clairvaux ; quant aux gouttes de leurs résines, ce sont les larmes du Christ, si nous en croyons saint Ambroise, dit l’abbé Plomb.
— Avec tout cela, notre basilique reste incomplète ; nous marchons à tâtons, sans esprit de suite ; je veux bien qu’à l’entrée du sanctuaire se dresse, à la place du bénitier, la purifiante hysope, mais les murs, avec quoi les bâtir, si nous refusons l’aide d’une église réelle, en pierres, mais inachevée ?
— Prenez, fit l’abbé Plomb, le sens des murailles et traduisez : « Les grands murs translatent les quatre Évangélistes. » Pouvez-vous faire la version ?
Durtal hocha la tête et répondit :
— Les évangélistes sont bien représentés, dans la faune mystique, par les bêtes du Tétramorphe ; les douze apôtres ont leurs synonymes dans l’écrin des pierreries et, naturellement, deux des évangélistes s’y trouvent : saint Jean est associé à l’émeraude, signe de la pureté et de la foi ; saint Matthieu à la chrysolithe, marque de la sagesse et de la vigilance ; mais aucun n’a été, je pense, suppléé, soit par des arbres, soit par des fleurs... si, cependant ; saint Jean, par l’héliotrope qui allégorise l’inspiration divine ; car il est peint sur un vitrail de l’église Saint-Rémy, à Reims, le chef ceint d’un nimbe circulaire, surmonté de deux tiges de cette fleur.
Saint Marc aussi, par une plante à laquelle le moyen âge donna son nom, la tanoesie.
— La tanoesie ?
— Oui, un végétal amer, aromatique, aux fleurs couleur de cuivre, qui s’épanouit dans les terrains pierreux et est employé, en qualité d’antispasmodique, par la médecine. Ainsi que l’herbe de Saint Georges, elle entre dans le traitement des affections des nerfs contre lesquelles l’intervention de saint Marc est, paraît-il, souveraine.
Quant à saint Luc, on pourrait le commémorer par des touffes de réséda, car la soeur Emmerich raconte que ce fut, pendant sa vie médicale, son grand remède. Il mélangeait le réséda avec de l’huile de palmier, les bénissait, faisait ensuite des onctions en forme de croix sur le front et la bouche des malades ; d’autres fois, il usait de la plante sèche en infusion.
Reste saint Matthieu ; ici, je rends les armes, car je n’aperçois aucune végétation qui puisse raisonnablement le relayer.
— Ne jetez point votre langue aux chiens, ainsi qu’on dit vulgairement, s’écria l’abbé Plomb. Une légende du moyen âge nous apprend que sa tombe sécrétait des baumes ; aussi l’iconographiait-on, tenant une branche de cinnamome, symbole de l’odeur des vertus, chez saint Méliton.
— C’est égal, il serait plus sage d’occuper la carcasse d’une véritable église, d’utiliser le gros oeuvre et de se borner à le compléter par des détails empruntés à l’herméneutique des fleurs.
— Et la sacristie ? demanda l’abbé Gévresin.
— Eh bien ! mais, comme, d’après le Rational de Durand de Mende, la sacristie est le sein de la Vierge, nous la reproduirons avec des plantes virginales, telles que l’anémone, avec des arbres tels que le cèdre que saint Ildefonse rapproche de notre Mère ; maintenant, si nous voulons la nantir des objets du culte, nous découvrons, dans le rituel de la liturgie et dans les contours mêmes de certaines plantes, des indications presque précises. Ainsi le lin avec lequel doivent être tissés les amicts et les linges d’autel est nécessaire. L’olivier et le balsamum dont on extrait l’huile et le baume, l’oliban qui exsude les larmes de l’encens, sont décrétés. Pour les calices, nous pouvons choisir entre les fleurs qui servirent de modèles aux joailliers, le blanc liseron, la frêle campanule, la tulipe même, bien qu’à cause de ses accointances avec la magie, cette fleur soit décriée ; comme silhouette de la monstrance, nous avons l’hélianthe ou le tournesol...
— Oui, mais, interrompit l’abbé Plomb, en essuyant ses lunettes, ce sont là des fantaisies uniquement déduites d’apparences matérielles ; c’est du symbolisme moderne et qui n’en est point, ensomme. Et n’en est-il pas de même, un peu aussi, des diverses interprétations que vous acceptez de la soeur Emmerich ? Elle est morte en 1824 !
— Qu’importe, riposta Durtal. La soeur Emmerich fut une Primitive, une voyante dont le corps seul a vécu de nos jours, mais son âme était loin ; elle vivait beaucoup plus dans les années du moyen age que dans les nôtres. L’on peut même dire qu’elle remonte plus haut dans les temps, qu’elle est plus ancienne, car, de fait, elle fut la contemporaine du Christ dont elle suit la vie, pas à pas, dans ses livres.
Ses idées sur les symboles ne sauraient donc être écartées ; pour moi, elles ont une autorité égale à celles de sainte Mechtilde qui naquit pourtant dans la première moitié du treizième siècle !
Et en effet, la source où elles puisèrent, l’une et l’autre, est identique. Or, qu’est-ce que l’espace, le passé, le présent quand il s’agit de Dieu ? — elles étaient des tamis par lesquels se blutaient ses grâces ; dès lors, que ces instruments datent d’hier ou d’aujourd’hui, peu me chaut ! la parole de Notre-Seigneur est au-dessus des ères ; son inspiration souffle où et quand Il veut ; est-ce vrai ?
— J’en conviens.
— Avec tout cela, vous ne songez pas pour vos constructions à l’iris que ma bonne Jeanne de Matel considère comme un emblème de la paix.
— Nous la placerons, nous la placerons, madame Bavoil ; au reste, il est encore une plante qu’il convient de ne pas omettre, le trèfle, car les sculpteurs l’ont semé à foison, dans leurs champs de pierres, le trèfle qui est, ainsi que le fruit de l’amandier dont les auréoles divines prennent la forme, le symbole de la Trinité Sainte.
Si nous récapitulions ?
Au fond de la nef, dans la conque absidiale, devant un demi-cercle de hautes fougères rouillées par l’automne, nous voyons une flamboyante assomption de roses grimpantes, bordant un parterre d’anémones rouges et blanches, liséré lui-même par le vert discret des résédas. Ajoutons encore pour varier, en les entremêlant, ces simulacres de l’humilité, le liseron, la violette, l’hysope et nous pourrons façonner des corbeilles dont le sens s’accorde avec les parfaites vertus de notre Mère.
Maintenant, dit-il, en désignant avec sa baguette le dessin de la nef tracée sur la terre, voici l’autel, surmonté de pampres rouges, de raisins bleus ou nacrés, de gerbes d’épis d’or ; ah ! il faudrait pourtant ériger une croix sur l’autel...
— Ce n’est pas difficile, répondit l’abbé Gévresin ; depuis la graine de moutarde que tous les symbolistes envisagent ainsi que l’une des figures du Christ, jusqu’au sycomore et aux térébinthes, vous avez de la marge ; vous pouvez donc dresser, à votre choix, une croisette de rien ou un crucifix gigantesque.
— Là, reprit Durtal, tout le long des travées où surgissent les trèfles, des fleurs différentes jaillissent du sol, selon les saints auxquels elles correspondent ; ici, la chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs, reconnaissable à la fleur de la Passion épanouie sur sa tige sarmenteuse et munie de vrilles ; et le fond est une haie de roseaux et de rhamnus aux douloureuses acceptions mitigées par la pitié des myrtes.
Là encore, la sacristie où sourit, sur ses légers corymbes, la fleur du bleu doux des lins, les touffes floribondes des liserons et des campanules, les grands soleils, puis encore, s’il vous plaisait, un palmier, car il me revient que la soeur Emmerich fait de cet arbre le parangon de la chasteté, parce que, dit-elle, les fleurs mâles sont séparées des fleurs femelles, et qu’il les garde modestement, les unes et les autres, cachées. Une version de plus au compte du palmier !
— Mais, mais, à la fin, vous êtes fou, notre ami, s’écria Mme Bavoil. Tout cela ne tient pas debout ; vos plantes sont des plantes de climats différents, et, dans tous les cas, elles ne sauraient fleurir par les mêmes saisons, ensemble ; en conséquence, lorsque vous aurez planté l’une, l’autre mourra. Jamais vous n’arriverez à les cultiver côte à côte.
— Symbole des cathédrales si longtemps inachevées et dont les constructions chevauchent toujours sur plusieurs siècles, dit Durtal, en cassant sa baguette. Écoutez, fantaisie mise à part, il y a quelque chose à créer et qui n’existe pas pour la botanique ecclésiale et les selams pieux.
Un jardin liturgique, un vrai jardin de bénédictins élevant une série de fleurs à cause de leurs relations avec les Écritures et les hagiologes. Dès lors, ne serait-il pas charmant d’accompagner la liturgie des offices par celle des plantes, de les faire marcher de front dans le sanctuaire, de parer les autels de bouquets ayant chacun une signification, suivant les jours et suivant les fêtes, d’allier, en un mot, la nature dans ce qu’elle a de plus exquis, dans sa flore, aux cérémonies du culte ?
— Certes ! s’exclamèrent en même temps les deux prêtres.
— En attendant que ces belles choses se réalisent, je me contenterai de bêcher mon petit potager, en vue de bons pots au feu dont vous aurez votre part, fit Mme Bavoil. Là, je suis dans mon élément ; je ne perds pas pied ainsi que dans vos imitations d’églises...
— Et je vais de mon côté méditer sur la symbolique des comestibles, dit Durtal, qui tira sa montre ; l’heure du déjeuner est proche.
L’abbé Plomb le rappela, tandis qu’il s’éloignait, et riant :
— Dans votre future cathédrale, vous avez négligé de réserver une niche pour saint Columban, si tant est que nous puissions l’esquisser par une plante ascétique originaire ou tout au moins voisine de l’Irlande, pays où ce moine est né.
— Le chardon, signe de la mortification et de la pénitence, mémento de l’ascèse, qui domine dans les armes de l’Écosse, répondit Durtal ; mais pourquoi un autel à saint Columban ?
— Parce qu’il est le saint oublié par excellence, le saint le moins invoqué par ceux de nos contemporains qui devraient le harceler le plus. D’après les attributions auxiliatrices d’antan, il est le patron des imbéciles !
— Bah ! s’écria l’abbé Gévresin ; mais voyons, si jamais homme décela une magnifique intelligence des choses divines et humaines, c’est bien ce grand abbé, fondateur de monastères !
— Oh ! cela n’implique point que saint Columban ait eu l’esprit débile ; quant à savoir pourquoi cette mission de protéger la majeure partie des vivants lui fut, plutôt qu’à un autre, confiée, je l’ignore.
— Peut-être parce qu’il a guéri des aliénés et libéré des possédés ? hasarda l’abbé Gévresin.
— En tout cas, proclama Durtal, il serait bien inutile de lui édifier une chapelle, puisqu’elle serait à jamais vide. Personne ne viendrait le prier, le pauvre saint, car le propre de l’imbécile est de croire qu’il ne l’est pas !
— Alors, c’est un saint sans ouvrage, dit Mme Bavoil.
— Et qui n’est pas prêt d’en trouver, répliqua en partant Durtal.