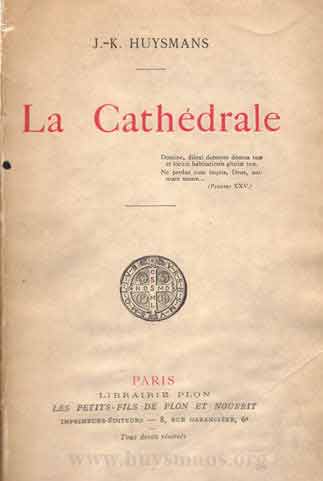������VII
COMBIEN elle peut contenir de fidèles, la cathédrale ? Près de 18.000, répondit l’abbé Plomb. Mais il est inutile de vous assurer, n’est-ce pas, qu’elle n’est jamais pleine ; que même pendant les temps de pèlerinages, les foules immenses du moyen âge ne l’emplissent plus. Ah ! Chartres n’est pas précisément ce qu’on appelle une ville pieuse !
— Elle est sinon hostile à la religion, au moins fort indifférente, fit l’abbé Gévresin.
— Le Chartrain est cupide, apathique et salace, répliqua l’abbé Plomb ; cupide surtout, car la passion du lucre est ici, sous des dehors inertes, féroce. Vraiment, par expérience, je plains le jeune prêtre que l’on envoie, pour ses débuts, évangéliser la Beauce.
Il arrive, plein d’illusions, rêvant aux conquêtes d’un apostolat, si désireux de se dévouer ! — et il s’affaisse dans le silence et le vide. Si encore on le persécutait, il se sentirait vivre ; mais on l’accueille par un sourire et non par une injure, ce qui est pis ; et promptement il se rend compte de l’inanité de ses démarches, du néant de ses efforts et il se décourage !
Ici le clergé est, on peut le dire, excellent, composé de saints prêtres, mais presque tous végètent, engourdis par l’inaction ; ils ne lisent, ni ne travaillent, s’ankylosent, se meurent d’ennui dans cette province.
— Pas vous ! s’exclama, en riant, Durtal ; car vous avez de l’ouvrage ; ne m’avez-vous pas raconté que vous cultiviez plus spécialement les âmes des belles dames qui daignent s’intéresser encore à Notre-Seigneur, dans cette ville ?
— Vous avez la plaisanterie féroce, riposta l’abbé. Croyez bien que si j’avais des servantes et des filles du peuple à gérer, je ne me plaindrais pas, car il y a des qualités et des vertus, il y a du ressort dans les âmes simples, mais dans la petite bourgeoisie et le monde riche ! — vous ne pouvez vous imaginer ce que sont ces femmes. Du moment qu’elles assistent à la messe le dimanche, et font leurs Pâques, elles pensent que tout leur est permis ; et, dès lors, leur sérieuse préoccupation est moins d’offenser le Christ que de le désarmer par de basses ruses. Elles médisent, lèsent grièvement le prochain, lui refusent toute pitié et toute aide et elles s’en excusent ainsi que de fautes sans conséquence ; mais manger gras, un vendredi ! c’est autre chose ; elles sont convaincues que le péché qui ne se remet point est celui-là. Pour elles, le Saint-Esprit, c’est le ventre ; en conséquence, il s’agit de biaiser, de louvoyer autour de ce péché, de ne jamais le commettre, tout en le frôlant et en ne se privant point. Aussi quelle éloquence elles déploient pour me rassurer sur le caractère pénitent de la poule d’eau !
Pendant le carême, elles sont toutes possédées par la rage de donner des dîners et elles s’ingénient à servir aux invités un maigre qui en soit, tout en ayant l’air de n’en être pas ; et ce sont d’interminables discussions sur la sarcelle, sur la macreuse, sur les volatiles à sang froid. C’est un zoologiste et non un prêtre qu’elles devraient aller consulter pour ces cas-là !
Quant à la Semaine Sainte, c’est encore une autre antienne ; à l’obsession de la volaille nautique succède le prurit de la charlotte russe. Peut-on, sans blesser Dieu, savourer une charlotte ? Il y a bien des oeufs dedans, mais si battus, si mortifiés que ce plat se révèle presque ascétique ; et les explications culinaires débordent, le confessionnal tourne à l’office, le prêtre devient un maître-queux.
Pour ce qui regarde le vice même de la gourmandise, elles s’en reconnaissent à peine coupables. Est-ce vrai, mon cher confrère ?
L’abbé Gévresin approuva d’un signe.
— Certes, dit-il, ce sont des âmes creuses, et qui plus est, imperméables.
Elles sont bouchées à toute idée généreuse, considèrent les relations qu’elles entretiennent avec le Rédempteur comme convenables pour leur rang, comme de bon ton ; mais elles ne cherchent nullement à entrer dans son intimité, se bornent, de propos délibéré, à des visites de politesse.
— Les visites que l’on rend, le jour de l’an, au parent âgé ! s’écria Durtal.
— Non, à Pâques, rectifia Mme Bavoil.
— Et, parmi ces pénitentes, reprit l’abbé Plomb, il y a l’affligeante variété de l’épouse du député qui vote mal et répond aux objurgations de sa femme : Moi ! mais je suis, au fond, plus chrétien que toi !
Invariablement, à chaque séance, elle recommence l’histoire des vertus privées du mari et déplore la conduite de l’homme publie ; et toujours cette narration, qui n’en finit point, aboutit à des éloges qu’elle se décerne, presque à une demande d’excuses qu’elle attend de nous, pour tout le tintouin que lui cause l’Église !
L’abbé Gévresin sourit et dit :
— Quand j’étais attaché à Paris à l’une des paroisses de la rive gauche dans laquelle est situé un grand magasin de nouveautés, j’ai fréquenté un singulier genre de femmes. Les jours surtout où ce magasin annonçait des expositions de blanc ou écoulait des soldes, c’était à la sacristie une affluence de dames en toilettes.
Ces femmes-là habitaient de l’autre côté de l’eau ; elles étaient venues, dans le quartier, pour effectuer des achats et, ayant sans doute trouvé les rayons qu’elles parcouraient trop pleins, elles voulaient attendre que la foule qui les emplissait fùt partie, pour y choisir plus à l’aise leurs emplettes ; alors, ne sachant plus à quoi s’occuper, elles se réfugiaient dans l’église et, là, le besoin de parler les tenaillant, elles requéraient, pour l’apaiser, le prêtre de garde, bavardaient au confessionnal comme dans un salon, tuaient ainsi le temps.
— Ne pouvant, de même que les hommes, aller au café, elles vont à l’église, dit Durtal.
— A moins, fit Mme Bavoil, qu’elles ne veuillent surtout confier à un ecclésiastique inconnu des fautes qu’il serait pénible d’avouer à leur confesseur.
— Enfin, s’exclama Durtal, voilà un point de vue neuf, l’influence des grands magasins sur le tribunal de la pénitence !
— Et celle des gares, ajouta l’abbé Gévresin.
— Comment, des gares ?
— Mais oui, les églises situées près des débarcadères ont une clientèle spéciale de voyageuses. — C’est là que l’observation que la chère Mme Bavoil vient de faire se vérifie. — Beaucoup de femmes de province, qui reçoivent à dîner chez elles le curé de leur pays, n’osent lui raconter leurs adultères parce qu’il lui serait trop facile de deviner le nom de l’amant, et que la situation de ce prêtre, vivant dans l’intimité de la maison, serait gênante ; alors elles profitent de leur passage à Paris ou y débarquent sous un prétexte quelconque pour s’ouvrir à un autre abbé qui ne les connaît point. En règle générale, lorsqu’une femme parle de son curé en de mauvais termes, lorsqu’elle débute, au confessionnal, par vous dire qu’il est inintelligent, sans éducation, inapte à comprendre et à guider les âmes, vous pouvez être sûr que l’aveu du péché contre le sixième commandement est proche.
— C’est égal, il en a de l’aplomb, le monde qui pivote autour du bon Dieu, s’écria Mme Bavoil !
— Ce sont de malheureux êtres qui opèrent une cote mal taillée de leurs devoirs et de leurs vices. Mais laissons cela et vaquons à des choses plus pressantes. Avez-vous apporté, ainsi que vous nous l’avez promis, votre article sur l’Angelico ? Lisez-le.
Durtal tira de sa poche son manuscrit qu’il avait achevé et qu’il devait expédier, le soir même, à Paris.
Il s’assit sur l’un des fauteuils de paille, au milieu de la chambre de l’abbé Gévresin où ils étaient réunis, et commença :
« LE COURONNEMENT DE LA VIERGE
de fra Angelico, au Louvre.
« L’ordonnance de ce tableau évoque l’attitude de ces arbres de Jessé dont les branches, soutenant sur chacun de leurs rameaux une figure humaine, s’évasent et se déploient, s’ouvrant, tels que des lames d’éventails, de chaque côté du trône en haut duquel s’épanouit, sur une tige isolée, la radieuse fleur d’une Vierge.
« Dans le Couronnement de la Vierge de fra Angelico, c’est, à droite et à gauche de la touffe séparée où le Christ, assis sous là pierre ciselée d’un dais, dépose la couronne qu’il tient de ses deux mains sur la tête inclinée de sa Mère, tout un espalier d’apôtres, de saints et de patriarches montant, en une ramure dense et serrée, du bas du panneau, finissant par éclater, de chaque côté du cadre, en une extrême floraison d’anges qui se détachent sur le bleu du ciel, avec leurs chefs ensoleillés de nimbes.
« La disposition de ces personnages est ainsi conçue :
« A gauche, au bas du trône, sous le dais de style gothique, prient agenouillés : l’évêque saint Nicolas de Myre, mitré et étreignant sa crosse à la hampe de laquelle pend, comme un drapeau replié, le manipule ; le roi saint Louis, à la couronne fleurdelisée ; les moines saint Antoine, saint Benoît, saint François, saint Thomas qui montre un livre ouvert sur lequel sont écrite les premiers versets du Te Deum; saint Dominique un lis à la main, saint Augustin une plume ; puis, en remontant, les apôtres saint Marc, saint Jean, portant leurs évangiles ; saint Barthélemy exhibant le coutelas qui servit à l’écorcher ; saint Pierre, saint André, saint Jean-Baptiste ; puis, en remontant encore, le patriarche Moîse ; — enfin, la théorie pressée des Anges, se découpant sur l’azur du firmament, les têtes ceintes d’une auréole d’or.
« A droite, — en bas, vue de dos, à côté d’un moine qui est peut-être saint Bernard, Marie-Madeleine à genoux près d’un vase d’aromates, dans une robe d’un rouge vermillon ; puis derrière elle, sainte Cécile, couronnée de roses ; sainte Claire ou sainte Catherine de Sienne, coiffée d’un béguin bleu semé d’étoiles ; sainte Catherine d’Alexandrie, appuyée sur la roue dé son supplice ; sainte Agnès caressant un agneau couché dans ses bras ; sainte Ursule dardant une flèche, d’autres dont les noms sont inconnus ; toutes ces saintes, faisant vis-à-vis à l’évêque, au roi, aux religieux, aux fondateurs d’ordres ; puis s’élevant le long des degrés du trône, saint Étienne avec la palme verte des martyrs ; saint Laurent avec son gril ; saint Georges couvert d’une cuirasse et coiffé d’un casque ; saint Pierre le Dominicain, reconnaissable à son crâne fendu ; puis, en s’exhaussant encore, saint Matthieu, saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Jude, saint Paul, saint Mathias, le roi David ; — enfin, en face des Anges de gauche, un groupe d’Anges dont les faces, cernées de ronds d’or, s’enlèvent sur l’horizon d’un outremer pur.
« Malgré les sévices des réparations qu’il endura, ce panneau, gravé et gaufré d’or, resplendit avec la claire fraîcheur de sa peinture au blanc d’oeuf.
« En son ensemble, il figure un escalier de la vue, si l’on peut dire, un escalier circulaire à double rampe, aux marches d’un bleu magnifique, tapissées d’or.
« La première, à gauche, en bas, est simulée par l’azur du manteau de saint Louis, puis d’autres grimpent, feintes par un coin entrevu d’étoffe, par la robe de saint Jean et, plus haut encore, avant que d’atteindre la nappe en lazulis du firmament, par la robe du premier des Anges.
« La première, à droite, en bas, par la mante de sainte Cécile, d’autres par le corsage de sainte Agnès, les draperies de saint Étienne, la tunique d’un prophète, plus haut encore, avant que d’arriver à la lisière en lapis du ciel, par la robe du premier des Anges.
« Le bleu qui domine dans le tableau est donc construit régulièrement, en échelons, espacé en vis-à-vis, presque de la même manière, de chaque côté du trône. Et cet azur épandu sur des costumes dont les plis sont à peine accusés par des blancs est d’une sérénité extraordinaire, d’une candeur inouïe. C’est lui qui, avec le secours des ors dont les lueurs cerclent les têtes, courent ou se tortillent sur les bures noires des moines, en Y sur la robe de saint Thomas ; en soleil ou plutôt en chrysanthèmes chevelus sur les frocs de saint Antoine et de saint Benoît ; en étoiles sur la coiffe de sainte Claire ; en broderies ajourées, en lettres formant des noms, en plaques de gorgerins sur les vêtements des autres saintes ; c’est lui qui donne l’âme colorée de l’oeuvre. Tout en bas de la scène, un coup de rouge magnifique, celui de la robe de Madeleine, qui se répercute dans la couleur de flamme de l’un des degrés du trône, reprend çà et là, atténué sur des bouts perdus d’étoffes ou se dissimule, étouffé sous des ramages d’or, comme dans la chape de saint Augustin, aide, ainsi qu’un tremplin, pour enlever le merveilleux accord.
« Les autres couleurs ne semblent plus jouer là que le rôle de nécessaires remplissages, d’indispensables étais. Elles sont, d’ailleurs, pour la plupart, d’une vulgarité, d’une laideur qui déconcertent. Voyez les verts : ils vont de la chicorée cuite à l’olive, pour aboutir à l’horreur absolue dans deux des marches du trône qui barrent la toile de deux traînées d’épinards tombés dans du macadam. Le seul vert qui soit supportable est celui du manteau de sainte Agnès, un vert parmesan très nourri de jaune que ravitaille encore, sur sa doublure aperçue, le voisinage complaisant d’un orange.
« Voyez, d’autre part, ce bleu que l’Angelico manie si somptueusement dans les teintes célestes ; s’il le fonce, il devient aussitôt moins ample et presque terne ; exemple : celui qui colore le béguin de sainte Claire.
« Mais ce qui est plus surprenant, c’est que ce peintre éloquent du bleu balbutie lorsqu’il touche à cette autre teinte angélique qu’est le rose. Le sien n’est ni léger, ni ingénu ; il est trouble, couleur de sang lavé d’eau, de taffetas d’Angleterre, à moins qu’il ne tourne au lie de vin ; tel celui qui s’étend sur les manches du Christ.
« Et il se révèle plus lourd encore sur les joues des saints. Il est, en quelque sorte, glacé, de même qu’une croûte de pâtisserie ; il a le ton d’un sirop de framboise noyé dans de la pâte à l’oeuf.
« Et ce sont là, en somme, les seules couleurs dont l’Angelico se sert : un bleu de ciel magnifique et un bleu vil, un blanc quelconque, un rouge éclatant, des roses mornes, un vert clair, des verts foncés et des ors. Ni jaune clair d’immortelles, ni paille lumineuse, tout au plus un jaune lourd et sans reflets pour les cheveux des saintes ; aucun orange vraiment franc, aucun violet faible ou valide, sinon dans une doublure clandestine de mante et dans la robe à peine visible d’un saint, coupé par le liséré du cadre ; aucun brun qui ne se cache. Sa palette est, on le voit, restreinte.
« Et elle est symbolique, si l’on y songe : il a fait certainement pour ses tons ce qu’il a fait pour toute l’ordonnance de son oeuvre. Son tableau est l’hymne de la chasteté et il a échelonné, autour du groupe formé par Notre-Seigneur et sa Mère, les saints qui avaient le mieux concentré cette vertu sur la terre : saint Jean-Baptiste qu'étêta la trémoussante impureté d’une Hérodiade ; saint Georges qui sauva une vierge de l’emblématique dragon ; des saintes telles que sainte Agnès, sainte Claire, sainte Ursule ; des chefs d’ordre, tels que saint Benoît et saint François ; un roi tel que saint Louis ; un évêque tel que saint Nicolas de Myre qui empêcha la prostitution de trois jeunes filles qu’un père affamé voulait vendre. Tout jusqu’aux plus petits détails, depuis les attributs des personnages jusqu’aux marches du trône dont le nombre correspond aux neuf choeurs des anges, est symbolique dans cette oeuvre.
« Il est, par conséquent, permis de croire qu’il a choisi les couleurs pour les allégories qu’elles expriment.
« Le blanc, symbole de l’Être supérieur, de la Vérité absolue, employé par l’Église dans ses ornements pour la fête de Notre-Seigneur et de la Vierge, parce qu’il annonce la bonté, la virginité, la charité, la splendeur, la sagesse divine lorsqu’il se magnifie dans l’éclat pur de l’argent.
« Le bleu, parce qu’il rend la chasteté, l’innocence, la candeur.
« Le rouge, couleur de la robe de saint Jean, comme le bleu est la couleur de la robe de Marie, dans les oeuvres des Primitifs, le rouge, parure des offices du Saint-Esprit et de la Passion, parce qu’il traduit la charité, la souffrance et l’amour.
« Le rose, l’amour de l’éternelle sapience, et aussi, d’après sainte Mechtilde, la douleur et les tourments du Christ.
« Le vert, dont la liturgie use dans les temps de pèlerinage et qui semble la couleur préférée de la sainte bénédictine lui décernant le sens de fraicheur d'âme et de sève perpétuelle ; le vert qui, dans l’herméneutique des tons, indique l’espoir de la créature régénérée, le souhait du dernier repos, qui est aussi la marque de l’humilité, selon l’anonyme anglais du treizième siècle, de la contemplation d’après Durand de Mende.
« Par contre, l’Angelico s’est volontairement abstenu d’utiliser les nuances qui désignent les qualités des vices, sauf, bien entendu, celles adoptées pour les costumes des ordres monastiques qui en dénaturent complètement le sens.
« Le noir, teinte de l’erreur et du néant, seing de la mort, dans l’Église, image, suivant la soeur Emmerich, des dons profanés et perdus.
« Le brun, qui, d’après la même soeur, est synonyme d’agitation, d’aridité, de sécheresse, de négligences ; le brun, qui, composé de noir et de rouge, de fumée obscurcissant le feu divin, est satanique.
« Le gris, la cendre de la pénitence, le symptôme des tribulations, selon l’évêque de Mende, le signe du demi-deuil, substitué naguère au violet dans le rit parisien, pendant le temps du Carême ; mariage du blanc et du noir, des vertus et des vices, des joies et des peines ; miroir de l’âme, ni bonne, ni mauvaise, de l’être médiocre, de l’être tiède que Dieu vomit ; le gris ne se relevant que par l’adjonction d’un peu de pureté, d’un peu de bleu, pouvant, alors qu’il se mue en un gris perle, devenir une nuance pieuse, un pas vers le ciel, un acheminement dans les premières voies de la mystique.
« Le jaune, considéré par la soeur Emmerich comme l’indice de la paresse, de l’horreur de la souffrance, et qui, souvent assigné, au moyen âge, à Judas, est le stigmate de la trahison et de l’envie.
« L’orangé, qui se signale ainsi que la révélation de l’amour divin, l’union de l’homme à Dieu, en mélangeant le sang de l’amour aux tons peccamineux du jaune, mais qui peut être pris dans une plus mauvaise acception, dans un sens de mensonge, d’angoisse, manifester, lorsqu’il tourne au roux, les défaites de l’âme surmenée par ses fautes, la haine de l’amour, le mépris de la grâce, la fin de tout.
« La feuille morte, qui témoigne de la dégradation morale, de la mort spirituelle, de l’espoir du vert à jamais perdu.
« Enfin, le violet, que l’Église revêt pour les dimanches d’Avent et de Carême et pour les offices de pénitence. Il fut la couleur du drap mortuaire des rois de France ; il nota, pendant le moyen âge, le deuil et il demeure à jamais la triste livrée des exorcistes.
« Ce qui est moins explicable, par exemple, c’est le choix limité des types de visages qu’il préféra ; car ici, le symbole est inutile. Voyez, en effet, ses hommes. Les patriarches, aux têtes barbues, n’ont point ces chairs d’hosties presque lucides ou ces os perçant le parchemin d’un épiderme sec et diaphane, comme cette fleur de lunelle, connue sous le nom de monnaie du Pape ; tous ont des physionomies régulières et aimables ; tous sont gens sanguins et bien portants, attentifs et pieux ; ses moines ont, eux aussi, la face pleine et les joues roses ; aucun de ses saints n’a l’allure d’un Père du Désert, accablé par les jeûnes, la maigreur épuisée d’un ascète ; tous ont des traits vaguement semblables, une corpulence similaire et des teints pareils. Ils figurent sur ce tableau une placide colonie de très braves gens.
« Ils apparaissent ainsi, du moins au premier coup d’oeil.
« Et les femmes sont toutes également de la même famille ; elles sont des soeurs aux ressemblances plus ou moins fidèles ; toutes sont blondes et fraîches, avec des yeux couleur de tabac clair, des paupières pesantes, des visages ronds ; toutes forment un cortège de types un peu gnangnan à cette Vierge au nez long, au crâne d’oiselle, agenouillée aux pieds du Christ.
« Il y a en somme, pour tous ces personnages, à peine quatre types qui diffèrent, si nous tenons compte de l’âge plus ou moins avancé de chacun d’eux, des modifications imposées par la coiffure, par le port de la barbe ou la rasure, des poses de profil ou de face qui les distinguent.
« Les seuls qui ne soient pas d’ensemble presque uniforme, ce sont les Anges aux adolescences asexuées, toutes charmantes. Ils sont d’une incomparable pureté, d’une candeur plus qu'humaine, avec leurs robes bleues, roses, vertes, fleuretées d’or, leurs cheveux blonds ou roux, tout à la fois aériens et lourds, leurs yeux chastes et baissés, leurs chairs blanches telles que des moelles d’arbres. Graves et ravis, ils jouent de l’angélique et du théorbe, de la viole d’amour et du rebec, chantent l’éternelle gloire de la Très Sainte Mère.
« En résumé, au point de vue des types, ainsi qu’au point de vue des couleurs, les choix de l'Angelico sont réduits.
« Mais alors, malgré la troupe exquise des Anges, ce tableau est monotone et banal, cette oeuvre si vantée est surfaite ?
« Non, car ce Couronnement de la Vierge est un chef-d’oeuvre et il est encore supérieur à tout ce que l’enthousiasme en voulut dire ; et, en effet, il dépasse toute peinture, parcourt des régions où jamais les mystiques du pinceau n’ont pénétré.
« Là, ce n’est plus un travail manuel, même souverain, ce n’est plus un ouvrage spirituel, vraiment religieux, ainsi que Roger van der Weyden et Quentin Metsys en firent ; c’est autre chose. Avec l’Angelico, un inconnu entre en scène, l’âme d’un mystique arrivé à la vie contemplative et l’effusant, ainsi qu’en un pur miroir, sur une toile.
« C’est l’âme d’un extraordinaire moine, d’un saint que nous voyons dans cette glace colorée où elle s’épand sur des créatures peintes. Et cette âme, on peut juger de son degré d’avancement dans les voies de la perfection, par l’oeuvre qui la répercute.
« Ses anges, ses saints, il les mène jusqu’à la vie unitive, jusqu’au suprême degré de la mystique. Là, les douleurs des lentes ascensions ne sont plus ; c’est la plénitude des joies tranquilles, la paix de l’homme divinisé ; l’Angelico est le peintre de l’âme immergée en Dieu, le peintre de ses propres aîtres.
« Et il fallait un moine pour tenter cette peinture. Certes, les Metsys, les Memling, les Thierry Bouts, les Gérard David, les Roger van der Weyden, étaient d’honnêtes et de pieuses gens. Ils imprégnèrent leurs panneaux d’un reflet céleste ; eux aussi, réverbérèrent leur âme dans les figures qu’ils peignirent, mais s’ils les marquèrent d’une étampe prodigieuse d’art, ils ne purent que leur donner l’apparence d’une âme débutant dans l’ascèse chrétienne ; ils ne purent représenter que des gens demeurés comme eux dans les premières pièces de ces châteaux de l’âme dont parle sainte Térèse et non dans la salle au centre de laquelle se tient, en rayonnant, le Christ.
« Ils étaient, suivant moi, plus observateurs et plus profonds, plus savants et plus habiles, plus peintres même que l’Angelico, mais ils étaient préoccupés de leur labeur, vivaient dans le monde, ne pouvaient bien souvent s’empêcher de laisser à leurs vierges des allures d’élégantes dames, étaient obsédés par des souvenirs de la terre, ne s’enlevaient pas hors de leur existence coutumière en travaillant, restaient, en un mot, des hommes. Ils ont été admirables, ils ont exprimé les instances d’une ardente foi, mais ils n’avaient pas reçu cette culture spéciale qui ne se pratique que dans le silence et la paix du cloitre. Aussi, n’ont-ils pu franchir le seuil du domaine séraphique où vaguait ce naïf qui n’ouvrait ses yeux fermés par la prière que pour peindre, ce moine qui n’avait jamais regardé au dehors, qui n’avait jamais vu qu’en lui.
« Ce que l’on sait de sa vie justifie d’ailleurs cette peinture. Il était un humble et tendre religieux qui faisait oraison avant de toucher à ses pinceaux et ne pouvait dessiner une crucifixion sans fondre en larmes.
« Au travers du voile de ses pleurs, sa vision s’angélisait, s’effusait dans les clartés de l’extase et il créait des êtres qui n’avaient plus que l'apparence humaine, l’écorce terrestre de nos formes, des êtres dont les âmes volaient déjà loin de leurs cages charnelles. Scrutez son tableau et voyez comme l’incompréhensible miracle de cet état d’âme qui surgit s’opère.
« Les types des apôtres, des saints sont, nous l’avons dit, quelconques. Eh bien ! fixez le visage de ces hommes et discernez combien, au fond, ils aperçoivent peu la scène à laquelle ils assistent ; quelle que soit l’attitude que leur attribue le peintre, tous sont recueillis en eux-mêmes et contemplent la scène, non avec les yeux de leurs corps, mais avec les yeux de leurs âmes. Tous examinent en eux-mêmes ; Jésus les habite, et ils le considèrent mieux dans leur for intérieur que sur ce trône.
« Et il en est de même des saintes. J’ai avancé qu’elles avaient l’air insignifiant, et c’est vrai ; mais ce que leurs traits, à elles aussi, se transforment et s’effacent sous l’épreinte divine ! elles vivent noyées d’adoration, s’élancent, immobiles, vers le céleste Époux. Une seule demeure mal dégagée de sa gaine matérielle, sainte Catherine d’Alexandrie qui, avec ses yeux pâmés, ses prunelles d’eau saumâtre, n’est ni simple, ni candide, ainsi que ses autres soeurs ; celle-là voit encore la forme hominale du Christ, celle-là est encore femme ; elle est, si l’on peut dire, le péché de cette oeuvre !
« Mais tous ces gradins spirituels, enrobés dans des figures d’êtres, ne sont, en somme, que l’accessoire de ce tableau. Ils sont placés là, dans l’auguste assomption des ors et la chaste ascension des bleus, pour mener par un escalier de pures joies au palier sublime où se dresse le groupe du Sauveur et de la Vierge.
« Alors, devant la Mère et le Fils, l’artiste exalté déborde. On croirait que le Seigneur qui s’infond en lui le transporte au delà des sens, tant l’amour et la chasteté sont personnifiés dans son panneau, au-dessus de tous les moyens d’expression dont dispose l’homme.
« Rien, en effet, ne saurait exprimer la prévenance respectueuse, la diligente affection, le filial et le paternel amour de ce Christ qui sourit, en couronnant sa Mère ; et, Elle, est plus incomparable encore. Ici, les vocables de l’adulation défaillent ; l’invisible apparaît sous les espèces des couleurs et des lignes. Un sentiment de déférence infinie, d’adoration intense et pourtant discrète, sourd et s’épand de cette Vierge qui croise les bras sur sa poitrine, tend une petite tête de colombe, aux yeux baissés, au nez un peu long, sous un voile. Elle ressemble à l’apôtre saint Jean placé derrière Elle, parait être sa fille et Elle confond, car de ce doux et fin visage qui, chez tout autre peintre, ne serait que charmant et futile, émane une candeur unique. Elle n’est même plus en chairs ; l’étoffe qui la vêt s’enfle doucement au souffle du fluide qu’elle modèle ; Marie vit dans un corps volatilisé glorieux.
« On conçoit certains détails de l’abbesse d’Agréda qui la déclare exempte des souillures infligées aux femmes ; l’on comprend saint Thomas avérant que sa beauté clarifiait, au lieu de les troubler, les sens.
« Elle est sans âge ; ce n’est pas une femme et ce n’est déjà plus une enfant. Et l’on ne sait même si Elle est une adolescente, à peine nubile, une fillette, tant elle est sublimée, au-dessus de l’humanité, hors le monde, exquise de pureté, à jamais chaste !
« Elle demeure sans rapprochement possible dans la peinture. Les autres Madones sont, en face d’Elle, vulgaires ; elles sont, en tout cas, femmes ; Elle seule est bien la blanche tige du blé divin, du froment eucharistique ; Elle seule est bien l’Immaculée, la Regina virginum des litanies, et Elle est si jeune, si ingénue, que le Fils semble couronner, avant même qu’Elle ne l’ait conçu, sa Mère !
« Et c’est là vraiment qu’éclate le génie surhumain du doux moine. Il a peint comme d’autres ont parlé, sous l’inspiration de la grâce ; il a peint ce qu’il voyait en lui, de même que sainte Angèle de Foligno a raconté ce qu’elle entendait en elle. Ils étaient, l’un et l’autre, des mystiques fondus en Dieu ; aussi la peinture de l’Angelico est-elle une peinture du Saint-Esprit, blutée au travers d’un tamis épuré d’art.
« Et si l’on y réfléchit, cette âme est plutôt celle d’une sainte que celle d’un saint ; que l’on se reporte, en effet, à ses autres tableaux, à ceux, par exemple, où il voulut rendre la passion du Christ ; l’on ne se trouve plus en face des tumultueuses pages d’un Metsys ou d’un Grünewald ; il n’a ni leur âpre virilité, ni leur sombre énergie, ni leurs tragiques émois ; lui, pleure, a la douleur désespérée d’une femme. Il est une moniale d’art plus qu’un moine, et c’est de cette sensibilité toute amoureuse, plus particulièrement réservée dans l’état mystique aux femmes, qu’il a su tirer les touchantes oraisons de ses oeuvres et leurs tendres plaintes.
« N’est-ce pas aussi de cette complexion spirituelle, si féminine, qu’il put également extraire, sous l’impulsion de l’Esprit, l’allégresse tout angélique, l’apothéose vraiment splendide dé Notre-Seigneur et de sa Mère, telle qu’il la peignit dans ce Couronnement de la Vierge qui, après avoir été révéré, pendant des siècles, dans l’église Saint-Dominique de Fiesole, s’abrite, admiré maintenant dans la petite salle de l’École italienne, au Louvre. »
— Elle est très bien votre étude, fit l’abbé Plomb, mais ces principes d’un rituel coloré que vous discernâtes chez l’Angelico, peuvent-ils se vérifier aussi exactement chez les autres peintres ?
— Non, si nous définissons les couleurs telles que l’Angelico les reçut de ses ancêtres monastiques, les enlumineurs de missels, et telles qu’il les appliqua dans leur acception la plus usitée et la plus stricte. Oui, si nous admettons la loi des oppositions, la règle des contrastes, si nous savons que la symbolique autorise le système des contraires, en permettant de noter, avec certains tons qui indiquent certaines qualités, les vices inverses.
— En un mot, une nuance innocente peut être prise dans un sens pervers et vice versa, fit l’abbé Gévresin.
— C’est cela même. Les artistes laïques et pieux parlèrent, en somme, un idiome différent de celui des moines. Au sortir des cloitres, la langue liturgique des tons s’altéra ; elle perdit sa raideur initiale et s’assouplit. L’Angelico suivait à la lettre les coutumes de son ordre et il respectait avec le même scrupule les observances de l’art religieux, en vigueur à son époque. Pour rien au monde, il ne les eût enfreintes, car il les considérait ainsi qu’un devoir canonique, ainsi qu’un texte arrêté d’office ; mais dès que les peintres profanes eurent émancipé le domaine de la peinture, ils nous soumirent des versions plus difficiles, des sens plus compliqués et la symbolique des couleurs, si simple chez l’Angelico, devint — en supposant qu’ils en aient toujours tenu compte dans leurs oeuvres — singulièrement abstruse, presque impossible à traduire.
Tenez, choisissons un exemple : le musée d’Anvers possède un tryptique de Roger van der Weyden intitulé : les Sacrements. Dans le panneau central consacré à l’Eucharistie, le sacrifice du Sauveur se consomme sous une double forme, sous la forme sanglante du crucifiement et sous la forme mystique de l’oblation pure de l’autel ; derrière la croix, au pied de laquelle gémissent Marie, saint Jean et les saintes femmes, un prêtre célèbre la messe et lève l’hostie, au milieu d’une cathédrale qui sert comme de toile de fond à l’oeuvre.
Sur le volet de gauche sont représentés, en de petites scènes distinctes, les sacrements du Baptême, de la Confirmation, de la Pénitence ; sur le volet de droite, celui de l’Ordination, du Mariage, de l’Extrême-Onction.
Ce tableau, d’une extraordinaire beauté, assure, avec la Descente de croix de Quentin Metsys, l’inestimable gloire du musée belge ; mais je ne m’attarderai pas à vous le décrire ; je supprime les réflexions que suggère l’art souverain du peintre et ne retiens actuellement, dans son ouvrage, que la partie relative au symbolisme des tons.
— Mais êtes-vous certain que Roger van der Weyden ait entendu assigner à ses couleurs des sens ?
— Le doute n’est pas possible, car il a blasonné, d’une teinte différente, chacun des Sacrements, en introduisant, au-dessus de chacune des scènes qui les figurent, un Ange dont la teinte de la robe varie suivant la nature même du magistère. Ses intentions ne peuvent donc prêter à aucune équivoque ; voici, maintenant, les couleurs qu’il adapte aux sources de grâce instituées par Notre-Seigneur :
A l’Eucharistie, le vert ; au Baptême, le blanc ; à la Confirmation, le jaune ; à la Pénitence, le rouge ; à il Ordination, le violet ; au Mariage, le bleu ; à l’Extrême-Onction, un violet si foncé qu’il est noir.
Eh bien ! vous avouerez que le commentaire de ce chromatisme divin n’est pas facile.
La version picturale du Baptême, de l’Extrême-Onction et de la Prêtrise est claire ; le Mariage même, traduit par du bleu, peut, pour les âmes naïves, se comprendre ; la Communion armoriée par le sinople se conçoit mieux encore, puisque le vert est la sève, l’humilité, l’emblème de la force qui nous régénère ; mais la Confession ne devrait-elle pas être translatée par du violet et non par du rouge ; et comment, en tout cas, expliquer que la Confirmation soit désignée par du jaune ?
— La couleur du Saint-Esprit est, en effet, le rouge, répondit l’abbé Plomb.
— Il y a donc déjà des divergences d’interprétation entre l’Angelico et Roger van der Weyden qui vécurent cependant à la même époque ; mais l’autorité du moine me semble plus sûre.
— Moi, fit l’abbé Gévresin, je repense à ce recto et à ce verso des tons dont vous parliez tout à l’heure ; mais savez-vous que cette règle des contraires n’est pas spéciale au rit des teintes ; elle existe dans presque toute la science des symboles. Voyez les analogies relevées dans le classement des bêtes : l’aigle qui incorpore tour à tour Jésus et Satan, le serpent qui, tout en étant un des avatars les plus connus du démon, peut néanmoins, ainsi que le serpent d’airain de Moïse, préfigurer le Christ.
— Le symbole anticipé du symbolisme chrétien fut le Janus à double visage du paganisme, fit, en riant, l’abbé Plomb.
— En somme, c’est une vraie volte-face de sens qu’exécutent ces allégories de la palette, reprit Durtal ; tenez, le rouge, nous avons vu que, dans son assimilation la plus commune, il est synonyme de charité, de souffrance, d’amour. Tel est son endroit ; son envers, selon la traduction de la soeur Emmerich, c’est la pesanteur, l’attachement au butin d’ici bas.
Le gris, emblème de la pénitence, de la tristesse, de l’âme tiède, ébauche, d’après une nouvelle exégèse, l’image de la Résurrection, — le blanc pénétrant le noir, — la lumière entrant dans la tombe, en sortant en une nouvelle teinte, le gris, nuance mixte, encore alourdie par les ténèbres de la mort qui ressuscite, en s’éclairant, peu à peu, dans le blanc des lueurs.
Le vert, si favorablement noté par les mystiques, acquiert un sens néfaste, en certains cas. Il sanctionne alors la dégradation morale, le désespoir, emprunte sa triste définition à la feuille morte, revêt le corps charnel des diables dans le Jugement dernier de Stephan Lochner, dans les scènes infernales narrées par les verrières des églises et les toiles des Primitifs.
Le noir, le brun, aux intentions hostiles de trépas et d’enfer, changent, dès que les fondateurs d’ordres s’en emparent pour en tisser la robe des cloîtres. Le noir nous rappelle alors le renoncement, la pénitence, la mortification de la chair, selon Durand de Mende ; le brun et même le gris ravivent la mémoire de la pauvreté et de l’humilité.
De son côté, le jaune, si maltraité dans le formulaire des comparaisons, devient le signe de la charité, si l’on en croit le moine anglais qui écrivit vers 1220, et il s’exhausse lorsqu’il se mue en or, jusqu’au symbole de l’amour divin, jusqu’à la radieuse allégorie de la Sagesse éternelle.
Enfin, quand il s’affirme ainsi que la marque distinctive des prélats, le violet relègue son habituelle expression de résipiscence et de deuil, pour feindre une certaine gravité, pour alléguer une certaine pompe.
En résumé, je ne vois que le blanc et le bleu qui soient invariables.
— Au Moyen Age, d’après Yves de Chartres, dit l’abbé Plomb, le violet fut remplacé par le bleu, dans le costume des évêques, pour leur apprendre qu’ils devaient plus s’occuper des biens du ciel que des biens de la terre.
— Mais enfin, demanda Mme Bavoil, comment se fait-il que cette couleur qui est toute innocence, toute pureté, qui est la couleur même de notre Mère, ait disparu du nombre des tons liturgiques ?
— Le bleu a été employé, au moyen âge, pour les offices de la Vierge et ce n’est qu’à partir du dix-huitième siècle qu’on le délaissa, fit l’abbé Plomb, dans l’Église latine, sauf en Espagne ; mais les Églises orthodoxes de l’Orient s’en accoutrent encore.
— Pourquoi, chez nous, cet abandon ?
— Je l’ignore, comme j’ignore pourquoi tant de tons, autrefois usités dans nos liturgies, s’effacèrent. Où sont les teintes de l’ancien Missel de Paris : le jaune safran réservé à la fête des Anges, l’aurore que l’on substituait, dans quelques cas, au rouge, le cendré qui compensait le violet, le bistre qui suppléait le noir, à certains jours ?
Puis, il y avait encore une couleur charmante qui continue d’ailleurs à figurer dans la gamme du rit romain, mais que presque partout les églises omettent, la teinte dite « de rose sèche », tenant le milieu entre le violet et le pourpre, entre la tristesse et la joie, une sorte de compromis, de nuance diminutive, dont l’Église se servait le troisième dimanche de l’Avent et le quatrième de Carême. Elle révélait ainsi, dans un temps de pénitence qui finissait, un commencement d’allégresse, car les fêtes de Noël et de Pâques étaient proches.
C’était là une idée d’aube spirituelle se levant dans la nuit de l’âme, une impression spéciale que le violet arboré maintenant, ces jours-là, ne saurait rendre.
— Oui, le bleu et le rose disparus des chapelles de l’Occident sont regrettables, dit l’abbé Gévresin ; mais, pour en revenir aux livrées monastiques qui libèrent de leur déplorable réputation les bruns, les gris et les noirs, ne pensez-vous pas qu’au point de vue des emblèmes parlants, la vêture de la congrégation des Annonciades fut ]a plus éloquente ? car ces moniales étaient habillées de gris, de blanc et de rouge, les couleurs de la Passion, et elles portaient de plus une simarre bleue et un voile noir, mémorial du deuil de notre Mère.
— L’image d’une permanente Semaine Sainte ! s’écria Durtal.
— Une autre question, reprit l’abbé Plomb. Dans les tableaux des Primitifs, les manteaux dont s’enveloppent la Vierge, les apôtres, les saints, montrent presque toujours, en des retroussis habilement ménagés, la couleur de leurs envers. Elle est naturellement différente de celle de l’endroit, ainsi que vous nous l’avez fait remarquer tout à l’heure à propos de la mante de sainte Agnès, dans l'oeuvre de l’Angelico. Croyez-vous qu’en dehors de l’opposition des tons, cherchée au point de vue technique, le moine ait voulu exprimer une idée particulière par le contraste de ces deux teintes ?
— D’après la palette des symboles, la couleur du dessus représenterait l’homme matériel et celle du dessous, l’homme moral.
— Bien ; mais que signifie alors le manteau vert doublé d’orange de sainte Agnès ?
— Dame, répondit Durtal, le vert dénotant la fraîcheur des sentiments, la sève du bien, l’espoir, et l’orangé, pris dans sa bonne acception, pouvant être la traduction de l’acte par lequel Dieu s’unit à l’homme, l’on pourrait sans doute déduire de ces données que sainte Agnès parvint à la vie unitive, à la possession du Seigneur, par la vertu de son innocence et l’ardeur de ses souhaits. Elle serait la figure de la vertu désirante et exaucée, de l’espoir récompensé, en somme.
Maintenant, je dois l’avouer encore, il y a bien des lacunes, bien des obscurités dans cette science allégorique des tons. Dans le tableau du Louvre, par exemple, les marches du trône, qui s’efforcent de jouer le rôle veiné des marbres, restent inintelligibles. Badigeonnées de rouge brut, de vert acide, de jaune de bile, elles disent quoi, ces marches qui, par leur nombre, peuvent indiquer, je le répète, les neuf choeurs des Anges ?
Il me semble en tout cas difficile d’admettre que le moine ait voulu évoquer les différentes hiérarchies célestes avec ces traînées de pinceaux sales et crues et ces stries.
— Mais le coloris d’un gradin a-t-il jamais formulé une idée dans le catalogue des symboles ? demanda l’abbé Gévresin.
— Sainte Mechtilde l’assure. Ainsi, parlant des trois degrés qui précèdent l’autel, elle prétend que le premier doit être peint en or pour attester que l’on ne peut aller à Dieu que par la charité ; le second en azur, pour témoigner de la méditation des choses divines ; le troisième en vert, pour certifier la vivacité de l’espoir et de la louange du ciel.
— Mon Dieu, fit Mme Bavoil que ces discussions commençaient à ahurir, je n’ai jamais vu cela ainsi. Je sais bien que le rouge désigne, pour tout le monde, le feu ; le bleu l’air ; le vert l’eau ; le noir la terre ; ce que je comprends, puisque chaque chose est imaginée par sa teinte naturelle, mais jamais je n’aurais pensé que c’était si compliqué, jamais je n’aurais cru qu’il y eût tant d’intentions dans les tableaux des peintres !
— De quelques peintres ! s’écria Durtal, car depuis le moyen age, la doctrine des emblèmes colorés est morte. A l’heure actuelle, les peintres qui abordent les sujets religieux ignorent les premiers éléments de la symbolique des couleurs, de même que les architectes ignorent maintenant les premiers principes de la théologie monumentale mystique.
— Dans nombre de tableaux de Primitifs, les pierres précieuses abondent, dit l’abbé Plomb. Elles s’enchâssent dans les orfrois des robes, dans les colliers et les bagues des saintes, s’amoncèlent en triangles de feu dans les diadèmes dont les peintres d’antan couronnèrent la Vierge. Nous devons logiquement, je crois, ainsi que pour la teinte des vêtures, chercher dans chacune de ces gemmes un dessein.
— Sans doute, fit Durtal, mais la symbolique des pierreries est très confuse. Les motifs qui ont décidé le choix de certaines pierres pour leur faire spécifier par la couleur de leur eau, par leur éclat, une vertu précise, sont amenés de si loin, sont si faiblement prouvés que l’on pourrait substituer une gemme à une autre, sans modifier pour cela la signification de l’allégorie qu’elles énoncent. Elles sont une série de synonymes pouvant se suppléer, à une nuance près en somme.
Dans l’écrin de l’Apocalypse, elles paraissent triées dans des acceptions sinon plus sûres, au moins plus imposantes et plus larges, car les exégètes les font coïncider avec une vertu, et aussi avec la personne même qui en fut douée. Ils ont trouvé mieux encore, ces joailliers de la Bible ; ils ont investi chaque brillant d’une double fonction ; ils les ont chargés de s’incarner en même temps dans un personnage de l’Ancien Testament et dans un du Neuf. Ils suivent donc le parallélisme des deux livres en symbolisant à la fois un patriarche et un apôtre, en les figurant par celle des qualités qui fut plus spécialement commune à chacun d’eux.
Ainsi l’améthyste, miroir de l’humilité, de la simplesse presque enfantine, s’adapte dans la Bible à Zabulon qui était un être docile et sans orgueil et dans l’Évangile à saint Mathias qui fut également un homme doux et naïf ; la chalcédoine, enseigne de la charité, on l’applique à Joseph qui fut si pitoyable, si clément pour ses frères, et à saint Jacques le Majeur, le premier des apôtres qui fut supplicié pour l’amour du Christ ; de même encore pour le jaspe qui augure la foi et l’éternité, on l’associe à Gad et à saint Pierre ; pour la sarde qui est foi et martyre à Ruben et à saint Barthélemy ; pour le saphir qui est espoir et contemplation, à Nephtali et à saint André et quelquefois, selon Arétas, à saint Paul ; pour le béryl qui est saine doctrine, science, longanimité, à Benjamin et à saint Thomas et ainsi de suite... Il existe, du reste, un tableau des concordances des pierreries, des patriarches, des apôtres et des vertus, dressé par Mme Félicie d’Ayzac qui a écrit une sagace étude sur la tropologie des gemmes.
— On opérerait tout aussi bien avec ces minéraux diserts l’avatar d’autres personnages des Saints Livres, observa l’abbé Gévresin.
— Évidemment, je vous ai prévenu, ces analogies sont tirées de loin. L’herméneutique des pierreries est vague ; elle ne se base que sur des ressemblances cherchées à plaisir, que sur des accords d’idées réunies à grand peine. Au moyen âge, elle fut surtout pratiquée par des poètes.
— Donc il faut se défier, dit l’abbé Plomb, car les interprétations de la plupart d’entre eux sont païennes. Exemple : Marbode qui, bien qu’il fût évêque, ne nous a que trop souvent laissé une glose impie des gemmes.
— En somme, les lapidaires mystiques se sont surtout ingéniés à traduire les pierres du Rational d’Aaron et celles qui fulgurent dans les fondements de la nouvelle Jérusalem, telle que l’a dépeinte saint Jean ; d’ailleurs, les murailles de Sion étaient serties des mêmes joyaux que le pectoral du frère de Moïse, sauf l’escarboucle, le ligure, l’agate et l’onyx qui, cités dans l’Exode, sont remplacés, dans le texte de l’Apocalypse, par la chalcédoine, la sardonyx, la chrysoprase et l’hyacinthe.
— Oui, et les orfèvres des symboles voulurent aussi forger des diadèmes et les parer de brillants pour en ceindre le front de Notre-Dame, mais leurs poèmes sont peu variés, car presque tous dérivent du De corona Virginis, un livre apocryphe de saint Ildefonse, célèbre autrefois dans les cloitres.
L’abbé Gévresin se leva et prit dans sa bibliothèque un vieux bouquin.
— Cela me remet en mémoire, dit-il, une séquence qu’un moine allemand du quatorzième siècle, Conrad de Haimbourg, rima en l’honneur de la Vierge.
Imaginez, poursuivit-il, en feuilletant le volume, une litanie de pierres précieuses dont chaque strophe lapidifie les vertus de notre Mère.
Cette prière minérale débute par une salutation humaine. Le bon moine s’agenouille et commence :
« Salut, noble Vierge, idoine à devenir la fiancée du souverain Roi ; acceptez cet anneau comme gage de cette alliance, Marie. »
Et il lui montre la bague qu’il tourne lentement entre ses doigts, expliquant à Notre-Dame le sens de chacune des pierres qui luit dans l’or de sa monture, en préludant par le jaspe vert, symbole de cette foi qui fit si pieusement accueillir, par la Vierge, le message de l’angélique paranymphe ; puis viennent : la chalcédoine, qui réfracte les feux de la charité dont son âme est pleine ; l’émeraude, dont l’éclat désigne sa pureté ; la sardonyx, aux flammes claires, qui se confond avec la placidité de sa vie virginale ; la sarde rouge, qui s’identifie avec son coeur saignant sur le Calvaire ; la chrysolithe, dont les scintillements d’un or qui s’éverdume rappellent ses miracles sans nombre et sa sagesse ; le béryl, qui décèle son humilité ; la topaze, qui avère la profondeur de ses méditations ; la chrysoprase, sa ferveur ; l’hyacinthe, sa charité ; l’améthyste, avec son mélange de rose et de bleu, l’amour que Dieu et les hommes lui vouent ; la perle dont le sens demeure, dans cette prose, sans désignation d’une vertu précise ; l'agate qui stipule sa modestie ; l’onyx, les dons multiples de ses grâces ; le diamant, sa force et sa patience dans les revers, tandis que l’escarboucle, cet oeil qui brille dans la nuit, proclame partout l’éternité de sa gloire.
Ensuite, le donateur fait remarquer à la Vierge l’acception de ces matières également incrustées dans les chatons de la bague et qui étaient considérées telles que des substances précieuses, au moyen âge : le cristal qui retrace la chasteté de l’âme et du corps ; le ligure, semblable à l’ambre, qui certifie plus particulièrement la qualité de tempérance ; la pierre d’aimant qui attire le fer, comme elle touche les cordes des coeurs pénitents avec l’archet de sa bonté.
Et le moine termine sa supplique en disant :
« Ce petit anneau, parsemé de gemmes, que nous vous offrons en ce jour, Épouse glorieuse, recevez-le avec bienveillance. Ainsi soit-il. »
— On pourrait sans doute reproduire presque exactement, une à une, les invocations des Litanies avec chacune de ces pierres ainsi comprises, fit l’abbé Plomb qui rouvrit le livre que son confrère venait de fermer.
Voyez, dit-il, combien les concordances entre les appellations des Litanies et les qualités assignées aux gemmes sont justes.
L’émeraude qui, dans cette séquence, est le signe de l’incorruptible pureté, ne reflète-t-elle pas, en la glace étincelante de ses eaux, le Mater purissima des litanies ?
La chrysolithe, qui est l’emblème de la sagesse, ne traduit-elle pas bien exactement le Sédes sapientiae ?
��������������������������������������������������������������������L’hyacinthe, attribut de la charité, du secours porté aux pêcheurs, l’Auxilium christianorum et le Refugium peccatorum du texte ?
Le diamant, qui est force et patience : le Virgo potens ?
L’escarboucle, qui est renommée : le Virgo praedicanda ?
La chrysoprase, qui est ferveur : le Vas insigne devotionis ?
Et il est probable, conclut l’abbé, en reposant le volume, que si nous nous en donnions la peine, nous retrouverions, un à un, dans ce rosaire de pierreries, le chapelet de louange que nous égrenons en l’honneur de notre Mère.
— Surtout, observa Durtal, si nous ne nous confinons pas dans le cadre rétréci de ce poème, car le manuel de Conrad est succinct et le dictionnaire de ses analogies est court ; en employant les acceptions des autres symbolistes, nous pourrions ciseler une bague semblable à la sienne et différente pourtant, car les devises des pierres ne seraient plus les mêmes. Ainsi, pour le vieil abbé du mont Cassin, Brunon d’Asti, le jaspe personnifie Notre-Seigneur, parce qu’il est immuablement vert, sans fane possible, immortel ; l’émeraude réfléchit, pour la même raison, la vie des justes ; la chrysoprase, les bonnes oeuvres ; le diamant, les âmes infrangibles ; la sardonyx, pareille au grain saignant d’une grenade, la charité ; l’hyacinthe d’un azur qui varie, la discrétion des saints ; le béryl, dont la nuance est celle d’une onde qui court au soleil, les Écritures qu’élucide le Christ ; la chrysolithe, l’attention et la sapience, parce qu’elle possède la couleur de l’or qui se confond avec elle, en lui prêtant son sens ; l’améthyste, le choeur des enfants et des vierges, car l’azur, qui se mêle à son rose, nous suggère la pensée de l’innocence et de la pudeur.
D’autre part, si nous empruntons au pape Innocent III ses idées sur la mystagogie des gemmes, nous découvrons que la chalcédoine, qui pâlit à la lumière et brasille dans la nuit, est le synonyme de l’humilité ; que la topaze coïncide avec la chasteté et le mérite des bonnes oeuvres ; que la chrysoprase, cette reine des minéraux, implique la sagesse et la vigilance.
En remontant moins loin dans les âges, en nous arrêtant à la fin du seizième siècle, à Corneille de la Pierre, nous relevons, dans son commentaire de l’Exode, de nouvelles interprétations, car il octroie à l’onyx et à l’escarboucle la candeur ; au béryl, l’héroïsme ; au ligure, d’un violet tendre et scintillant, le mépris des richesses de la terre et l’amour des biens du ciel.
— Alors que saint Ambroise fait de cette pierre l’emblème du Sacrement même de l’Eucharistie, jeta l’abbé Gévresin.
— Oui, mais qu’est-ce que le ligure ? demanda Durtal, Conrad de Haimbourg le présente semblable à l’ambre ; Corneille de la Pierre le croit violet, et saint Jérôme laisse entendre que le ligure n’a aucune personnalité, n’est en somme qu’un pseudonyme sous lequel s’abrite l’hyacinthe, image de la prudence avec son eau bleue comme le ciel et ses nuances qui changent. Comment s’y reconnaître ?
— A propos de pierre bleue, n’omettons pas que sainte Mechtilde voyait, dans le saphir, le coeur même de la Vierge, fit l’abbé Plomb.
— Ajoutons encore, reprit Durtal, que de nouvelles variations sur le thème des gemmes ont encore été exécutées au dix-septième siècle, par une abbesse célèbre de l’Espagne, par Marie d’Agréda, qui rapporte à notre Mère la vertu des pierreries, dont parle, dans le vingt et unième chapitre de l’Apocalypse, saint Jean. D’après elle, le saphir se réfère à la sérénité de Marie ; la chrysolithe déclare son amour pour l’Église militante et spécialement pour la loi de grâce ; l’améthyste, sa puissance contre les hordes de l’enfer ; le jaspe, sa constance invincible ; la perle, son inestimable dignité...
— La perle est envisagée par saint Eucher, ainsi que la perfection, la chasteté, la doctrine évangélique, interrompit l’abbé Plomb.
— Avec tout cela, vous oubliez la signification d’autres brillants connus, s’écria Mme Bavoil. Le rubis, le grenat, l’aigue-marine ; ils sont donc muets, ceux-là ?
— Non, répliqua Durtal. Le rubis annonce le calme et la patience ; le grenat réverbère, d’après Innocent III, la charité ; suivant saint Brunon et saint Rupert, l’aiguemarine concentre, dans la clarté verte de ses feux, la science théologique ; restent encore deux autres minéraux : la turquoise et l’opale. L’une, peu citée par les mystiques, doit promulguer la joie. Quant à la seconde, dont le nom n’apparaît point chez nos lapidaires, elle n’est autre que la chalcédoine qui nous est décrite telle qu’une sorte d’agate, d’une teinte trouble, voilée de nuages, lançant des étincelles dans l’ombre.
Afin d’en finir avec cette orfèvrerie symbolique, disons encore que la série des pierres servit à commémorer chacune des hiérarchies des anges ; mais là encore les acceptions sont issues de rapprochements plus ou moins contraints, de trames d’idées plus ou moins ténues, plus ou moins lâches. Toujours est-il que la sarde évoque les Séraphins, la topaze les Chérubins, le jaspe les Trônes, la chrysolithe les Dominations, le saphir les Vertus, l’onyx les Puissances, le béryl les Principautés, le rubis les Archanges et l’émeraude les Anges.
— Chose curieuse, fit l’abbé Plomb, tandis que les bêtes, que les teintes, que les fleurs sont prises par les symbolistes, tantôt dans un bon, tantôt dans un mauvais sens, seules les pierreries ne varient point ; elles n’expriment que des qualités et jamais des vices.
— Pourquoi ?
— Sainte Hildegarde donne peut-être le motif de cette insistance, lorsque parlant, dans le quatrième livre de sa Physique, des gemmes, elle dit que le Diable les hait, les abhorre et les dédaigne, parce qu’il se souvient que leur éclat brillait en lui avant sa chute et parce qu’aussi certaines d’entre elles sont produites par le feu qui est son tourment.
Et la sainte ajoute : Dieu qui l’en dépouilla ne permit pas que les vertus des pierres se perdissent ; Il voulut, au contraire, qu’elles fussent honorées et employées par la médecine afin de guérir des maladies et de conjurer des maux.
Et, en effet, le moyen âge les magnifia et s’en servit dans le but d’opérer des cures.
— Pour en revenir à ces tableaux de Primitifs où la Vierge jaillit telle qu’une fleur de la touffe colorée des gemmes, l’on peut affirmer, en somme, reprit l’abbé Gévresin, que le brasier des pierreries relate par de visibles signes les qualités de Celle qui les porte ; mais il serait difficile de spécifier le dessein du peintre lorsque, dans l’ornementation d’une couronne ou d’une robe, il enchâsse une pierre à telle place plutôt qu’à telle autre. Il y a là surtout affaire d’harmonie et de goût et peu ou pas de symbole.
— A coup sûr, fit Durtal, qui se leva et prit congé des deux prêtres auxquels, entendant sonner l’heure à la cathédrale, Mme Bavoil remettait leurs chapeaux et leurs bréviaires.
VIII
CET état de tranquillité un peu dolente, dans laquelle Durtal reposait depuis son installation à Chartres, cessa brusquement. Un jour, l’ennui s’implanta en lui, l’ennui noir qui ne permet ni de travailler, ni de lire, ni de prier, qui vous accable à ne plus savoir ni que devenir, ni que faire.
Après de lourdes et d’obscures journées traînées devant sa bibliothèque à feuilleter un volume, à le refermer, à en ouvrir un autre dont il ne parvenait pas à comprendre une page, il tenta d’échapper à la lassitude des heures par des sorties et il se résolut enfin à explorer Chartres.
Il y découvrit des ruelles sourdes et des sentes folles, telles que ce chemin du tertre Saint-Nicolas qui dévale du haut de la cité, en une fuite précipitée de marches ; puis le boulevard des Filles-Dieu, si désert sous ses allées plantées d’arbres, valait qu’on s’y arrêtât. En partant de la place Drouaise, on arrivait à un petit pont, là où se réunissaient les deux bras de l’Eure ; à droite, c’était, au-dessus de l’eau tournant avec les masures qui côtoyaient ses rives, l’escalade de la vieille ville, hissant au-dessus d’elle la cathédrale ; à gauche, c’était, le long du quai, en face d’une haie de grands peupliers éventant des moulins hydrauliques, des scieries et des chantiers de bois, des lavoirs de blanchisseuses agenouillées dans des boîtes sur de la paille et l’eau moussait devant elles, décrivait des cercles d’encre éclaboussés par le coup d’aile d’un oiseau, de gouttes blanches.
Ce bras de la rivière, coulant dans les fossés des anciens remparts, enveloppait le bas de Chartres, bordé, d’un côté, par les arbres des avenues, de l’autre, par des bicoques, par des jardins en lacets, descendant jusqu’au fil de l'Eure et reliés à l’autre rive par des passerelles de planches, par des ponceaux suspendus de fonte.
Et près de la porte Guillaume dressant les pâtés crénelés de ses tours, il y avait des maisons qui semblaient éventrées, qui montraient, ainsi que les cagnards disparus de l’Hôtel-Dieu, à Paris, une cave ouverte au ras de l’eau, un sous-sol dallé au fond duquel s’apercevaient, dans un jour de prison, les marches d’un escalier de pierre ; et si l’on franchissait sur un petit pont à dos d’âne la porte Guillaume dont la voûte conservait encore la rainure de la herse, que l’on abattait naguère pour clore, le soir, cette partie de ville, l’on retrouvait un nouveau bras de la rivière, baignant encore le pied des bâtisses, jouant à cache-cache dans les cours, musant entre des murs ; et aussitôt le rappel d’une rivière, semblable à celle-là, avec sa décoction de brou de noix bouillonnée de bulles, vous obsédait ; et, pour aider au souvenir, pour mieux évoquer la vision de la mélancolique Bièvre, l’odeur âpre et crue, chaude et comme vinaigrée du tan, fumait au-dessus de cette purée de jus de nèfles que roulait l’Eure.
Internée maintenant à Paris dans des égouts, la Bièvre paraissait s’être évadée de ses geôles et s’être réfugiée, afin de vivre au plein air, à Chartres, dans ces rues de la Foulerie, de la Tannerie, du Massacre, envahies par les mégissiers et les chamoiseurs, par les fabricants de mottes.
Seulement, le paysage parisien, aride et inquiet, touchant par son côté de souffrance muette, n’était plus dans cette ville ; ces rues suggéraient simplement l’impression d’une bourgade malade, d’un village pauvre. Il lui manquait, à cette autre Bièvre, la séduction de l’épuisement, la grâce de la Parisienne fanée, salie par la misère ; il lui manquait le charme fait de pitié et de regret, d’une déchéance.
Telles quelles cependant, ces rues qui dessinaient une sorte de mouvement tournant autour de cette colline sur laquelle s’exhaussait la cathédrale, étaient les seules vraiment curieuses à parcourir à Chartres.
Là, Durtal parvenait souvent à s’éloigner de lui-même, à rêver sur la détresse fatiguée de ces eaux, à ne plus songer à ses propres transes ; puis la lassitude vint de ces promenades assidues dans un même quartier et alors il battit la ville dans tous les sens, tenta de se plaire au spectacle des gîtes usés, aux élégances de la tourelle de la reine Berthe, de la maison de Claude Huvé, des autres bâtiments qui avaient survécu aux désastres du temps, mais l’entrain qu’il mit à scruter ces restes galvaudés par l’enthousiasme prévu des guides ne dura guère ; alors il se dispersa dans les églises. Encore que la cathédrale écrasât tout autour d’elle, Saint-Pierre, ancienne abbatiale d’un couvent bénédictin converti en une caserne, méritait qu’on s’y attardât à cause de la splendeur de ses vitraux habités par des abbés et des évêques qui vous dévisageaient, d’un oeil sévère, en tenant des crosses. Et ces fenêtres, avariées par l’âge, étaient bizarres. Leurs ogives de verre incolore étaient traversées, au milieu, par une lame d’épée ayant perdu sa pointe ; et, dans ces glaives carrés, méditaient saint Benoît et saint Maur, des apôtres et des papes, des prélats et des saints, se détachant, vêtus de flammes, dans la clarté blanche des vitres.
Vraiment les plus belles verrières du monde étaient à Chartres ; et chaque siècle avait estampé ces sanctuaires de sa plus altière empreinte ; le douzième, le treizième, voire même le quinzième, dans la basilique ; le quatorzième à Saint-Pierre, et il subsistait quelques spécimens malheureusement épars et placés sens dessus dessous, de carreaux peints par le seizième siècle ; à Saint-Aignan, une autre église dont la voûte avait été badigeonnée de couleur de pain d’épice granulé d’anis par les peintres de notre époque.
Durtal tua quelques après-midi dans ces temples, puis l’attrait de ces études prolongées cessa et le spleen s’imposa plus fort.
Pour le distraire, l’abbé Plomb l’entraîna hors de la cité, mais la Beauce était si monotone et si plate qu’aucun incident de site ne pouvait se produire. Alors le prêtre le ramena dans d’autres quartiers de la ville. Parfois certains monuments les requéraient, tels que la maison de force située rue Sainte-Thérèse, près du Palais de Justice. A coup sùr, ils étaient peu imposants ces édifices, mais, en raison de leur origine, ils pouvaient servir de tremplins à de vieux rêves. Les murs de la prison avaient je ne sais quoi, dans leur forme haute et rigide, dans leur aspect net et rangé qui décelait le mur de clôture élevé par un Carmel. Ils avaient, en effet, abrité des moniales de cet ordre ; puis, à quelques pas, dans une impasse, s’ouvrait l’ancien cloître des jacobins, devenu la maison-mère de la grande communauté de Chartres : les soeurs hospitalières de Saint-Paul.
L’abbé Plomb lui fit visiter ce monastère et il garda le souvenir enjoué d’une promenade, en l’air, sur les anciens remparts. Le chemin de ronde avait été conservé par les religieuses et il s’étendait en une longue et étroite allée qui tournait, en vous conduisant, à chacun de ses bouts, devant une statue de Madone — l’Immaculée Conception d’un côté, et la Vierge Mère de l’autre. — Et cette allée, sablée de cailloux de rivière et lisérée de fleurs, courait, bornée à droite par l’abbaye et le noviciat, surplombait à gauche le vide, en plongeant sur l’avenue de la butte des Charbonniers, longée elle-même par la rue de la Couronne ; et derrière elles fuyaient les pelouses d’herbe du clos Saint-Jean, la chaussée du chemin de fer, des taudis d’ouvriers et des couvents.
— Tenez, disait l’abbé, voici, derrière le remblai de la ligne de l’Ouest, la maison des soeurs de Notre-Dame et les carmélites ; ici, plus près de nous, en deçà de la voie des trains, les petites soeurs des pauvres...
Au reste, la ville foisonnait de cloîtres : soeurs de la Visitation, soeurs de la Providence, soeurs de Bon-Secours, dames du Sacré-Coeur, vivaient en des ruches rapprochées à Chartres. Des prières bourdonnaient de toutes parts, montaient en des fumées odorantes d’âmes au-dessus de la cité qui, en guise d’office divin, ne lisait que les mercuriales des blés et les cotes de ces marchés aux chevaux qui réunissent, à certains jours, dans les cafés de la place, tous les maquignons du Perche.
En sus de cette promenade sur les vieux remparts, ce monastère des soeurs de Saint-Paul convenait encore par son calme et sa propreté. Dans de silencieux couloirs, l’on apercevait des dos de religieuses, croisés par le triangle blanc d’un linge, et l’on entendait le cliquetis de gros chapelets noirs, à chaînons de cuivre se heurtant, sur la jupe, à la trousse pendue des clefs ; la chapelle sentait son Louis XIV, était tout à la fois enfantine et pompeuse, trop glacée d’or et trop parquetée de cire, mais un détail intéressait : à l’entrée, les murs avaient été remplacés par des glaces sans tain et, l’hiver, dans une salle chaude, les malades pouvaient s’asseoir devant la paroi de verre et suivre les cérémonies et écouter le plain-chant de Solesmes que les religieuses avaient eu le bon goût d’apprendre.
Cette visite raccorda Durtal, mais forcément il compara les heures quiètes égouttées dans ce couvent aux autres et son dégoût s’accrut de cette ville, de ses habitants, de ses avenues, de sa fameuse place des Épars qui joue au petit Versailles avec son cercle d’emphatiques hôtels et sa ridicule statue de Marceau, au centre.
Et la veulerie de cette bourgade qui s’éveillait à peine au lever du soleil et redormait à la brune !
Une seule fois, Durtal la vit alerte, ce fut le jour où Mgr Le Tilloy des Mofflaines prit possession de son siège. Alors, subitement, dans la ville galvanisée des plans surgirent ; les corps constitués délibérèrent et des gens qui restaient enfermés chez eux depuis des années sortirent.
On réquisitionna chez les maçons des perches d’échafaudages ; on jucha à leurs sommets des oriflammes jaunes et bleues et l’on relia ces mâts entre eux par des guirlandes de lierre aux feuilles cousues, les unes sur les autres, par du fil blanc.
Et Chartres épuisé souffla.
Surpris par cet apparat imprévu et par ce simulacre inusité de vie, Durtal s’était rendu au-devant de l’évêque jusqu’à la rue Saint-Michel. Là se dressait, planté sur une grande place, un portant de gymnastique débarrassé de ses trapèzes et de ses anneaux, entouré de branches de sapin, de fleurs en papier d’or et surmonté d’un faisceau de drapeaux tricolores s’écartant en lames d’éventail, sous un bouclier peint de carton. Cela mimait l’arc de triomphe sous lequel des frères des écoles chrétiennes devaient charrier le dais.
Et la procession qui était allée chercher l’évêque à l’hospice Saint-Brice où, selon un usage séculaire, il couche la nuit de son arrivée dans son diocèse, s’était déroulée sous la pluie fine des cantiques, coupée par l’averse des cuivres que déchaînait une fanfare pieuse.
Lentement, à pas comptés, le cortège défilait entre deux haies de foule massée sur les trottoirs ; partout, les croisées pavoisées de banderoles exposaient des grappes de visages et des corps penchaient séparés au milieu par la balustrade des fenêtres.
En tête, derrière les dos chamarrés de pesants suisses, serpentaient, en deux bandes tenant toute la chaussée, les filles des écoles congréganistes, habillées de bleu cru et voilées de blanc ; puis venaient les délégations des nonnes de tous les ordres installés dans le département : soeurs de la Visitation de Dreux, dames du Sacré-Coeur de Chàteaudun, soeurs de l’Immaculée-Conception de Nogent-le-Rotrou, les tourières des moniales en clôture à Chartres même, et des soeurs de Saint-Vincent de Paul et des clarisses qui tranchaient avec leurs robes d’un gris bleuté et d’un brun de motte à brûler sur les costumes noirs des autres soeurs.
Mais ce qui était bizarre, c’était la forme variée des coiffes.
Les unes avaient des oeillères molles et lisses, d’autres les portaient tuyautées et durcies par de savants empois ; l’on n’apercevait la face de celles-ci qu’au fond d’un tunnel blanc ; la physionomie de celle-là au contraire se voyait dégagée, dans un cadre ovale et godronné de linge, mais elles allongeaient derrière leurs nuques des cônes de toile amidonnée, lustrés par de puissants fers. En regardant ce champ de béguins, Durtal pensait à ces paysages de toits parisiens où les tuyaux de cheminée affectent ces aspects de cornette comme en arboraient ces religieuses, de chapeaux de gendarmes comme en exhibaient ces suisses.
Et derrière ce défilé de jupes sombres, sonnèrent telles que des fanfares les robes vermillon de la maîtrise. Les enfants marchaient, les yeux baissés, les bras croisés sous la pèlerine rouge, frangée d’hermine et, après eux, quelques pas en avant des autres groupes, deux coules blanches éclatèrent, celle d’un picpucien et celle d’un trappiste représentant les trappistines de la cour Peytral dont il était l’aumônier.
Enfin, en une multitude noire, piétinaient le grand séminaire de Chartres et le petit séminaire de Saint-Chéron, devançant le clergé à la suite duquel, sous un dais de velours amarante, brodé d’épis et de raisins d’or et paré aux quatre coins de plumes de catafalque couleur de neige, cheminait, mitre en tête et crosse au poing, Mgr le Tilloy des Mofflaines.
Au geste de l’évêque bénissant la rue, des Lazares inconnus surgirent, des morts oubliés ressuscitèrent.
Sa Grandeur multipliait le miracle du Christ ! des vieillards étaient tassés dans des fauteuils, sur le seuil des portes ou sur le bord des fenêtres, se ranimaient pour une seconde et retrouvaient la force de se signer. Des gens que l’on croyait enterrés depuis des années parvenaient presque à sourire. Des yeux ébahis de très anciens enfants contemplaient la croix violette que dessinait la main gantée du prélat, dans l’air. La nécropole qu’était Chartres se muait en une maison de maternité ; dans l’excès de sa joie, la ville revenait à l’enfance.
Mais quand le dais fut passé, ce fut bien autre chose. Durtal, effaré, hennit.
Le spectacle auquel il assistait devenait fou.
A la queue de l’évêque, une cour des Miracles se dandinait en flageolant ; une colonne de vieux birbes, costumés avec les friperies vendues des morgues, ballottait, se soutenant sous les bras, s’étayant les uns aux autres. Tous les décrochez-moi-ça d’il y a vingt ans ajustaient leurs mouvements, les accompagnaient, sur eux ; des culottes à ponts ou à pieds d’éléphants, des pantalons ballonnés ou collants, tissés d’étoffes lâches ou rétractiles, refusaient de se joindre aux bottines, laissaient voir des pieds où des élastiques grouillaient comme des vermines, des chevilles d’où coulaient des vermicelles cuits dans de l’encre ; puis, c’étaient d’invraisemblables vestons ras et déteints, taillés dans des draps de billard, dans des prélarts élimés, dans des rebuts de bâches ; des redingotes découpées dans de la tôle, dévernie dans la raie du dos et aux coudes ; des gilets glauques, parsemés de fleurettes et fermés par des boutons en fromage de cochon sec ; mais tout cela n’était rien, ce qui était prodigieux, hors de toute réalité, dûment insane, c’était la collection de chapeaux hissés sur ces défroques.
Les spécimens des couvre-chefs abolis, perdus dans la nuit des âges, s’étaient assemblés là ; les vétérans s’avançaient coiffés de boîtes à manchons et de tuyaux à gaz ; d’autres exposaient des hautes-formes blancs, pareils à des seaux renversés de toilette ou à des bondons percés dans le bas d’un trou ; d’autres encore se pavoisaient de feutres semblables à des éponges, de bolivars hérissés et velus, de melons à bords plats imitant des tourtes posées sur des assiettes ; d’autres enfin affichaient des chapeaux à claque qui gondolaient, jouaient de l’accordéon tout seuls, avec leurs côtes visibles sous la soie.
La démence des gibus dépassait le possible. Il y en avait de très élevés dont le fût menait à des platesformes évasées tels que les shakos des voltigeurs du premier Empire, de très bas, qui s’achevaient en gueule de tromblon, en table de schapska, en pots de chambre retournés d’enfants !
Et, au-dessous de ce sanhédrin de chapeaux saouls, grimaçaient des figures ridées de vieillards, avec des pattes de lapin le long des joues et des poils de brosses à dents sous le nez.
Durtal fut secoué par un rire inextinguible devant ce carnaval d’invalides, mais bientôt son hilarité cessa. Il distinguait deux petites soeurs des Pauvres qui conduisaient ce lycée de fossiles et il comprenait. Ces braves gens étaient vêtus avec des hardes quêtées, ils étaient habillés avec des fonds d’armoires dont personne ne voulait plus ; la cocasserie de leur accoutrement devenait touchante ; les petites soeurs avaient dû se donner bien du mal pour utiliser ces déchets de la charité et les vieux enfants, peu au courant des modes, se rengorgeaient très fiers d’être ainsi mis.
Durtal les suivit jusqu’à la cathédrale. Quand il arriva sur la petite place, le cortège, cahoté par un coup de vent, se débattait, pendu à des bannières qui se gonflaient ainsi que des voiles de navire et entraînaient les hommes cramponnés à leurs hampes. Enfin, tant bien que mal, tout ce monde s’était engouffré dans la basilique. Le Te Deum avait jailli dans le torrent des orgues. A ce moment, il semblait qu’exaltée par ce chant magnifique, l’église, lancée dans les airs en un jet éperdu, montât encore ; l’écho s’y répercutait à travers les siècles de cet hymne de triomphe qui avait tant de fois retenti sous ses voûtes ; pour une fois maintenant la musique était d’accord avec la nef, parlait la langue que la cathédrale avait depuis son enfance apprise.
Durtal exulta. Il lui parut que, dans ses vitres de feu, Notre-Dame souriait, émue par ces accents que des saints qu’Elle aima créèrent pour qu’ils pussent à jamais résumer en une décisive mélodie, en une unique prose, les louanges dispersées des fidèles, les joies informulées des foules. Mais subitement, sa griserie s’évapora ; le Te Deum était fini et un roulement de tambours et une sonnerie de clairons éclataient dans le transept. Et tandis que la fanfare de Chartres canonnait avec la balistique de ses sons les murs, il s’était enfui pour respirer loin de la multitude qui n’arrivait pas cependant à remplir le vaisseau, et, après la cérémonie, il avait encore assisté au défilé des corps constitués rendant visite au prélat, dans l’évêché.
Là, il s’était diverti sans honte. La cour qui précédait le palais regorgeait de prêtres ; tous les doyennés des archidiaconés de Chartres, de Châteaudun, de Nogent-le-Rotrou, de Dreux, avaient déposé, derrière la grille d’honneur, leurs troupes de vicaires et de curés qui s’ébrouaient autour du manège vert d’une pelouse.
Non moins comiques que les pensionnaires des petites soeurs des Pauvres, les seigneurs de la ville affluaient et refoulaient les ecclésiastiques dans les allées ; la tératologie vidait ses bocaux ; c’était un grouillement de larves humaines, de têtes en boulets de canons et en oeufs ; une série de visages vus au travers d’une bouteille, déformés par certains miroirs, échappés des albums fantastiques de Redon ; c’était un musée de monstres en marche. L’hébétude des métiers monotones, vécus de pères en fils, dans une cité morte, figeait toutes les faces et l’allégresse endimanchée de ce jour greffait sur ces laideurs transmises le ridicule.
Tous les habits noirs de Chartres humaient l’air. Les uns dataient du Directoire, absorbaient les cous, grimpaient à l’assaut des nuques, engloutissaient jusqu’aux oreilles, enflaient ; d’autres, au contraire, avaient diminué dans les tiroirs, et leurs manches raccourcies craquaient, sciant les aisselles de leurs maîtres qui n’osaient remuer.
Une odeur de benzine et de camphre flottait au-dessus des groupes. Ces habits tirés, le matin même, de leur saumure, et dessalés par des épouses, empestaient. Les tuyaux de poêle étaient à l’avenant. Ils avaient grandi, poussé tout seuls dans les armoires et ils se dressaient immenses, ramenaient sur leur colonne de carton des épis de poils rares.
Ce monde réuni s’admirait, se gratulait, pressait des mains enduites de gants blancs, nettoyés au pétrole, frottés à la gomme élastique et à la mie de pain. Et subitement, un remous s’était creusé dans la cohue des laïques et des prêtres qui se rangèrent, chapeaux bas, devant un vieux landau de corbillard traîné par une rosse étique et conduit par une sorte de moujik, un cocher dont la face bouffait sous des broussailles lui sortant des joues et de la bouche, des oreilles et du nez. La carriole s’était amarrée devant le perron et il en était descendu un gros homme, soufflé tel qu’une baudruche, et sanglé dans un uniforme brodé d’argent ; puis, derrière lui, un monsieur plus mince, vêtu d’un habit à parements bleu foncé et bleu clair ; et tous saluèrent le préfet qu’escortait l’un de ses trois conseillers de préfecture.
Ils avaient soulevé leurs bicornes empanachés de plumes, distribué quelques poignées de main et ils se perdaient dans le vestibule, quand l’armée parut, à son tour, représentée par un colonel de cuirassiers, par des officiers de l’artillerie et du train, par quelques fantassins gradés à culotte rouge, par un gendarme.
Et ce fut tout ; une heure après cette réception, la ville exténuée s’était rendormie, n’ayant même pas le courage de déplanter ses mâts ; les Lazares étaient retournés dans leurs sépulcres, les vieillards ressuscités étaient à nouveau retombés morts ; les rues étaient vides ; la réaction avait lieu ; Chartres gisait épuisé pour des mois par cet excès.
Quelle cambuse, quelle turne ! s’exclamait Durtal.
Certains soirs, las des après-midi internés au milieu des livres ou employés à suivre les heures canoniales dans l’église, à écouter des chanoines jouer languissamment, de chaque côté du choeur, à la raquette avec des psaumes dont ils se renvoyaient, en grommelant, des volants de versets, il descendait fumer, après son dîner, des cigarettes sur la petite place. Pour Chartres, huit heures du soir, c’était trois heures du matin pour une autre ville ; aussi tout était-il éteint et tout était clos.
Pressé de se coucher, le clergé avait, dès sept heures, bouclé la Vierge. Pas de prières, pas de bénédictions, rien dans cette cathédrale. Ces instants où lorsqu’on est agenouillé dans l’ombre, on croit que la Mère est plus présente, plus près de vous, plus à vous ; ces minutes d’intimité où on lui raconte moins timidement ses pauvres maux, n’existaient point à Notre-Dame. Ah ! l’on ne s’épuisait pas en tardives oraisons dans cette basilique !
Mais s’il ne pouvait pénétrer dans son intérieur, Durtal pouvait au moins rôder dans ses alentours. A peine éclairée par les indigentes lueurs de réverbères isolés dans les coins de la place, la cathédrale prenait alors une étrange forme. Ses porches s’ouvraient en des cavernes pleines de nuit et le parcours extérieur de sa nef, compris entre les tours et l’abside, avec ses contreforts et ses arcs-boutants devinés dans l’ombre, se dressait ainsi qu’une falaise rongée par d’invisibles mers. L’on avait l’illusion d’une montagne déchiquetée à sa cime par des tempêtes, creusée dans le bas par des océans disparus, de profondes grottes ; et si l’on s’approchait, l’on discernait dans l’obscurité de vagues sentiers abrupts courant le long de la falaise, serpentant en galeries au bord des rocs et parfois, dans ces noirs chemins, de blanches statues d’évêques surgissaient, en un rayon de lune, hantant comme des revenants ces ruines, bénissant, avec leurs doigts levés de pierre, les visiteurs.
Cette promenade dans le circuit de cette cathédrale qui, si légère, si fluette pendant le jour, grossissait avec les ténèbres et devenait farouche, n’était pas faite pour dissiper la mélancolie de Durtal.
Cet aspect de brèches frappées par la foudre et d’antres abandonnés par les flots le jetait dans de nouvelles rêveries et finissait par le ramener à lui-même, par aboutir, après bien des vagabondages d’idées, à ses propres décombres ; et une fois de plus, il se sondait l’âme et essayait de mettre un peu d’ordre dans ses pensées.
Je m’ennuie à crever, se disait-il, pourquoi ? Et, à vouloir analyser cet état, il arrivait à cette conclusion :
Il n’est pas simple, mais double, mon ennui ; ou tout au moins s’il est unique, il se divise en deux parties bien distinctes. J’ai l’ennui de moi-même, indépendant de toute localité, de tout intérieur, de toute lecture et j’ai aussi l’ennui de la province, l’ennui spécial, inhérent à Chartres.
De moi-même, ah oui, par exemple ! Ce que je suis las de me surveiller, de tâcher de surprendre le secret de mes mécomptes et de mes noises. Mon existence, quand j’y songe, je la jaugerais volontiers de la sorte : le passé me semble horrible ; le présent m’apparaît faible et désolé, et quant à l’avenir, c’est l’épouvante.
Il se tut, puis :
Les premiers jours, ici, je me suis plu dans le rêve suggéré par cette cathédrale. Je croyais qu’elle serait un réactif dans ma vie, qu’elle peuplerait ce désert que je sentais en moi, qu’elle serait, en un mot, dans l’atmosphère provinciale, une aide. Et, je me suis leurré. Certes, elle m’opprime toujours, elle m’enveloppe encore dans l’ombre tiède de sa crypte, mais je raisonne maintenant, je la scrute dans ses détails, j’essaie de causer d’art avec elle ; et je perds à ces recherches l’impression irraisonnée de son milieu, le charme silencieux de son ensemble.
Maintenant c’est moins son ame qui me hante que son corps. J’ai voulu étudier l’archéologie, cette misérable anatomie des édifices ; je suis devenu humainement amoureux de ses contours et le côté divin a fui pour ne plus laisser place qu’au côté terrestre. Hélas ! j’ai voulu voir et je me suis malédifié ; c’est l’éternel symbole de la Psyché qui recommence !
Et puis... et puis... n’y a-t-il pas aussi, dans cette lassitude qui m’accable, de la faute à l’abbé Gévresin ? Il a épuisé pour moi, en m’en imposant l’accoutumance, les vertus pacifiques et pourtant révulsives du Sacrement ; et le résultat le plus clair de ce régime, c’est que je suis tombé l’àme à plat, sans force pour résister.
Eh non, reprit-il après un silence ; me voici encore à rabâcher mes permanentes présomptions, mes infatigables soucis, me voilà une fois de plus injuste envers l’abbé. Ce n’est cependant pas de sa faute si la fréquence de mes communions les rend frigides ; j’y cherche des sensations et il faudrait pourtant se convaincre d’abord que ces désirs sont méprisables, se persuader ensuite que c’est précisément parce que ces communions sont glacées qu’elles deviennent méritoires et sont meilleures. Oui, c’est facile à raconter, mais quel est celui des catholiques qui les préfère celles-là aux autres ? des saints, sans doute ; mais eux aussi en souffrent ! c’est si naturel de demander à Dieu un peu de joie, d’attendre de cette union qu’Il appelle un mot affectueux, un signe, un rien, montrant qu’Il pense à vous !
L’on a beau faire, on ne peut pas ne point envisager comme douloureuses les mortes consomptions de ces vivants azymes ! et l’on a bien de la peine à confesser que Notre-Seigneur a raison de nous cacher le mal qu’elles nous évitent et les progrès qu’elles réalisent, car, sans cela, nous serions peut-être sans défense contre les attaques de l’amour-propre et les assauts de la vanité, sans abri contre nous-mème.
Enfin, quelle qu’en soit la cause, je ne suis pas mieux à Chartres qu’à Paris, concluait-il. Et quand ces réflexions l’assaillaient, le dimanche surtout, il regrettait d’avoir accompagné l’abbé Gévresin dans cette province.
A Paris, ce jour-là, il avait au moins son temps défrayé par les offices. Le matin, il pouvait messoyer chez les bénédictines ou à Saint-Séverin, écouter les vêpres et les complies, à Saint-Sulpice.
Ici rien ; et cependant, où réunir de meilleurs éléments pour exécuter le répertoire grégorien qu’à Chartres ?
A part quelques antiques basses qui aboyaient et qu’il eût été bien nécessaire d’abattre, il y avait une gerbe opulente de sons frais, une psallette de près de cent enfants qui eussent pu dérouler, dans de limpides voix, les amples mélodies du vieux plain-chant.
Mais en guise de cantilènes liturgiques, un maître de chapelle imbécile parquait, dans cette malheureuse cathédrale, une ménagerie d’airs forains qui, lâchés le dimanche, grimpaient, avec des gambades de ouistitis, le long des piliers, sous les voûtes. L’on pliait à ces singeries musicales les voix ingénues de la maîtrise. Décemment, à Chartres, il était impossible d’assister à la grand’messe.
Les autres offices ne valaient pas mieux ; aussi Durtal était-il réduit, pour entendre les vêpres, à descendre dans le bas de la ville, à Notre-Dame de la Brèche, une chapelle, où un prêtre, ami de l’abbé Plomb, avait instauré le chant de Solesmes et patiemment formé une petite manécanterie, composée d’ouvriers fidèles et de mômes pieux.
Ces voix, celles des gosses surtout, étaient médiocres, mais l’expert musicien qu’était ce prêtre les avait quand même ajustées et polies et il était parvenu, en somme, à imposer l’art bénédictin dans son église.
Seulement, elle était si laide, si tristement embellie d’images, Notre-Dame de la Brèche, qu’il fallait fermer les yeux pour y séjourner !
Et dans cette houle de réflexions sur son âme, sur Paris, sur l’Eucharistie, sur la musique, sur Chartres, Durtal finissait par s’abasourdir, par ne plus savoir où il était.
Parfois, cependant, il trouvait un peu de calme, et alors il s’étonnait, ne se comprenait plus.
Regretter Paris, se disait-il alors, pourquoi ? est-ce que l’existence que j’y connus diffère de celle que je mène ici ?
Est-ce que les églises, est-ce que Notre-Dame de Paris pour en citer une, n’étaient pas exécrées par de sacrilèges flonflons, comme Notre-Dame de Chartres ? D’autre part, je ne sortais guère pour flâner dans de fastidieuses rues et je ne fréquentais en fin de compte que l’abbé Gévresin et Mme Bavoil et je continue à les visiter même plus souvent, ici. J’ai en outre gagné, en me déplaçant, un compagnon savant et aimable, l’abbé Plomb ; alors ?
Puis, un beau matin, sans qu’il s’y attendît, tout s’éclaira. Très lucidement, il comprit qu’il errait sur de fausses pistes et découvrit, sans même la chercher, la vraie.
Pour rencontrer les causes ignorées de ses velléités d’il ne savait quoi et de ses inintelligibles malaises, il avait suffi qu’il remontât dans sa vie et qu’il s’arrêtât à la Trappe. En somme, tout dérivait de là. Arrivé à ce point culminant de son recul, il pouvait, ainsi que du haut d’un mont, embrasser d’un coup d’oeil le versant des années descendues depuis qu’il avait quitté ce monastère ; et il discernait maintenant, dans ce panorama penché de ses jours, ceci :
Dès sa rentrée à Paris, l’appétence des cloîtres s’était, sans discontinuer, infiltrée en lui ; ce rêve de se retirer loin du monde, de vivre placidement, dans la retraite, auprès de Dieu, il l’avait poursuivi sans relâche.
Sans doute, il ne se l’était formulé qu’à l’état de postulations impossibles et de regrets, car il savait bien qu’il n’avait, ni le corps assez solide, ni l’âme assez ferme pour s’enfouir dans une Trappe ; mais une fois lancée sur ce tremplin, l’imagination partait à la vanvole, sautait par-dessus les obstacles, divaguait en de flottantes songeries où il se voyait moine dans un couvent débonnaire, desservi par un ordre clément, amoureux de liturgies et épris d’art.
Il devait bien hausser les épaules quand il revenait à lui et sourire de ces avenirs fallacieux qu’il se suggérait dans ses heures d’ennui ; mais, à cette pitié de l’homme qui se prend en flagrant délit de déraison, succédait quand même l’espoir de ne pas perdre entièrement le bénéfice d’un bon mensonge et il se remettait à chevaucher une chimère qu’il jugeait plus sage, aboutissait à un moyen terme, à un compromis, pensant rendre l’idéal plus accessible, en le réduisant.
Il se disait qu’à défaut d’une vie monastique réelle, il s’en susciterait peut-être une suffisante illusion, en fuyant le tohu-bohu de Paris, en s’inhumant dans un trou.
Et il s’apercevait qu’il s’était absolument dupé lorsque, discutant la question de savoir s’il délaisserait Paris pour aller s’installer à Chartres, il lui avait semblé s’être décidé sur les arguments de l’abbé Gévresin et les instances de Mme Bavoil.
Certainement, sans se l’avouer, sans se l’expliquer, il avait surtout agi sous l’impulsion de ce rêve si constamment choyé. Chartres n’était-il pas une sorte de havre conventuel, de monastère complaisant, où il conserverait toute sa liberté et ne renoncerait pas à son bien-être ? En tout cas, n’était-ce point, à défaut d’un inaccessible ascétère, une pâture jetée à ses désirs et, en admettant qu’il parvint à se débarrasser de souhaits trop exigeants, ce repos définitif, cette paix auxquels il aspirait depuis son retour de la Trappe ?
Et rien de tout cela ne s’était réalisé ; cette impression, éprouvée à Paris, qu’il n’était pas assis, il la gardait à Chartres. Il se sentait en camp volant, perché sur une branche, se faisait l’effet d’un homme qui n’est pas chez lui, mais qui s’attarde dans un meublé dont il faudra déguerpir.
En somme, il s’était déçu quand il s’était figuré que l’on pouvait assimiler une chambre solitaire, dans un alentour muet, à une cellule ; le train-train pieux, dans l’atmosphère d’une province, n’avait aucun rapport avec le milieu d’une abbaye. L’illusion du cloître n’existait pas.
Cet échec enfin constaté exaspéra l’ardeur de ses regrets et le mal qui était demeuré, à l’état confus, à l’état latent, à Paris, éclata, net et clair, à Chartres.
Alors ce fut une lutte sans répit avec lui-même.
L’abbé Gévresin, qu’il consultait, se bornait, en souriant, à le traiter, ainsi qu’on traite dans un noviciat ou dans un séminaire le petit postulant qui vient avouer une grande mélancolie et une persistante fatigue. On feint de ne pas prendre son mal au sérieux, on lui atteste que tous ses camarades subissent les mêmes tentations, les mêmes épreintes ; on le renvoie consolé, tout en ayant l’air de s’en moquer.
Mais au bout de quelque temps, cette méthode échoua. Alors l’abbé tint tête à Durtal et un jour que son pénitent gémissait il lui répondit :
— C’est une crise à supporter ; puis négligemment, après un silence, il ajouta : Vous en verrez bien d’autres !
Et comme Durtal se cabrait sur ce mot, il l’accula au pied du mur, voulant lui faire avouer l’inanité de ses luttes.
— Le cloître, reprit-il, vous obsède ; eh bien, mais qui vous empêche d’en tâter ? pourquoi ne vous séquestrez-vous pas dans une Trappe ?
— Vous savez bien que je ne suis pas assez robuste pour endurer ce régime !
— Alors faites-vous oblat, rejoignez à Notre-Dame de l’Atre, M. Bruno.
— Quant à ça, non, par exemple ! L’oblature à la Trappe, c’est encore Chartres ! c’est une situation moyenne, mitigée. M. Bruno restera toujours hôte et ne sera jamais moine. Il n’a, en somme, que les inconvénients des communautés et pas les avantages.
— Il n’y a point que les Trappes, répliqua l’abbé. Devenez père ou oblat bénédictin, moine noir. Leur règle doit être douce ; vous vivrez dans un monde de savants et d’écrivains, que pouvez-vous désirer de plus ?
— Je ne dis pas, mais...
— Mais quoi ?
— Eh ! je ne les connais point...
— Rien n’est plus facile que de les connaître. L’abbé Plomb est un grand ami de Solesmes. Il vous procurera, pour ce couvent, toutes les recommandations que vous voudrez.
— Dame, c’est à voir... je consulterai l’abbé, fit Durtal qui se leva pour prendre congé du vieux prêtre.
— Notre ami, le Bourru vous travaille, lança Mme Bavoil qui avait entendu, de la pièce voisine dont la porte était ouverte, la conversation des deux hommes.
Elle entra, tenant son bréviaire.
— Ah çà, reprit-elle, en le regardant sous ses lunettes, pensez-vous donc qu’en déménageant son âme de place, on la change. Votre ennui, il n’est ni dans l’air, ni autour de vous, mais en vous ; ma parole, à vous entendre, on croirait qu’en se transférant d’un lieu dans un autre, on échappe à ses discordes et qu’on parvient à se fuir. Or, rien n’est plus faux... demandez au père...
Et lorsque Durtal qui souriait, gêné, fut parti, Mme Bavoil interrogea son maître :
— Ah çà, qu’a-t-il au juste ?
— L’épreuve des sécheresses le lamine, répondit le prêtre. Il subit une opération douloureuse, mais sans danger. Du moment qu’il conserve le goût de la prière et ne néglige aucun de ses exercices religieux, tout va bien. C’est là la pierre de touche qui nous sert à discerner si, dans ce genre d’affection, l’origine est divine...
— Mais, père, il serait quand même nécessaire de le soulager ?
— Je ne puis rien, sinon prier pour lui.
— Autre question, il est hanté par les monastères, notre ami ; peut-être bien que c’est là que vous devriez l’envoyer.
L’abbé eut un geste évasit.
— Les sécheresses et les phantasmes qu’elles engendrent ne sont point indices de vocation, fit-il. J’ajouterai même qu’elles ont plus de chances de s’accroître que de s’atténuer dans un cloître. Et, à ce point de vue, la vie conventuelle peut être pour lui mauvaise... cependant il n’y a point que cette question à envisager... il y a autre chose... puis, qui sait ? et après un silence, il reprit :
— Tout est possible, donnez-moi mon chapeau, madame Bavoil, je vais aller causer avec l’abbé Plomb de Durtal.