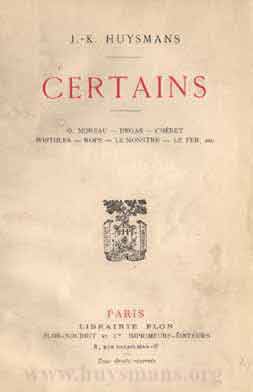Goya et Turner.
A une exposition des maîtres anciens qui eut lieu, en 1887, au profit des inondés du Midi, dans les galeries du quai Malaquais, deux toiles vraiment belles. L’une, une course de taureaux, de Goya ; l’autre, un paysage, de Turner.
Le Goya : un écrasis de rouge, de bleu et de jaune, des virgules de couleur blanche, des pàtés de tons vifs, plaqués, pêle-mêle, mastiqués au couteau, bouchonnés, torchés à coups de pouce, le tout s’étageant en taches plus ou moins rugueuses, du haut en bas de la toile. On cherche. Vaguement on distingue, dans le tohu-bohu de ces facules, un jouet en bois de la forme d’une vache, des ronds de pains à cacheter, barrés de noir, surmontés de trémas bruns ; puis, en montant, des guillemets et des points, toute une ponctuation de couleur aérant un page de couleur fauve. On se recule, et cela devient extraordinaire ; comme par magie, tout se dessine et se pose, tout s’anime. Les pâtés grouillent, les virgules hennissent, des torréadors apparaissent, brandissant des voiles rouges, s’efforçant, se bousculant, criant sous le soleil qui les mord. La petite vache se mue en un formidable taureau qui se précipite, furieux, les cornes en avant, sur un groupe en désarroi. Au fond du cirque, des chevaux se piétent, et ces écrasis de palette, ces frottis de torchon, ces traînées de pouces deviennent une pullulente foule qui s’enthousiasme, invective, menace, pousse d’assourdissants hourras. C’est tout simplement superbe ! — Et, dans ce margouillis, de nettes figures sortent : ces trémas, ce sont des yeux qui pétillent ; ces barres, des bouches qui béent ; ces guillemets, des mains qui se crispent. C’est le vacarme le plus effréné qui ait jamais été jeté sur une toile, la bousculade la plus intense qu’une palette ait jamais créée.
Les eaux-fortes de Goya sont d’une alerte incroyable, d’un sabrage fou, mais elles ne suscitent pas une idée complète de cette peinture turbulente et féroce, de ce mors aux dents du dessin, de ce délire d’impressionniste pétrissant à pleins poings la vie, de ce cri furieux, de ce cabrement exaspéré de l’art.
Quant au Turner, lui aussi vous stupéfie, au premier abord. On se trouve en face d’un brouillis absolu de rose et de terre de sienne brûlée, de bleu et de blanc, frottés avec un chiffon, tantôt en tournant en rond, tantôt en filant en droite ligne ou en bifurquant en de longs zig-zags. On dirait d’une estampe balayée avec de la mie de pain ou d’un amas de couleurs tendres étendues à l’eau dans une feuille de papier qu’on referme, puis qu’on rabote, à tour de bras, avec une brosse ; cela sème des jeux de nuances étonnantes, surtout si l’on éparpille, avant de refermer la feuille, quelques points de blanc de gouache.
C’est cela, vu de très près, et, à distance, de même que pour le Goya, tout s’équilibre. Devant les yeux dissuadés, surgit un merveilleux paysage, un site féerique, un fleuve irradié coulant sous un soleil dont les rayons s’irisent. Un pàle firmament fuit à perte de vue, se noie dans un horizon de nacre, se réverbère et marche dans une eau qui chatoie, comme savonneuse, avec la couleur du spectre coloré des bulles. Où, dans quel pays, dans quel Eldorado, dans quel Eden, flambent ces folies de clarté, ces torrents de jour réfractés par des nuages laiteux, tachés de rouge feu et sillés de violet, tels que des fonds précieux d’opale ? Et ces sites sont réels pourtant ; ce sont des paysages d’automne, des bois rouillés, des eaux courantes, des futaies qui se déchevèlent, mais ce sont aussi des paysages volatilisés, des aubes de plein ciel ; ce sont les fêtes célestes et fluviales d’une nature sublimée, décortiquée, rendue complètement fluide, par un grand Poète.
La salle des Etats au Louvre.
J’AI retrouvé, dans cette salle des Etats, inaugurée au Louvre, un grand nombre de tableaux que j’espérais bien ne jamais revoir. Je les croyais égarés dans les cryptes du Luxembourg ou enterrés dans les autres sépulcres de l’art, et, pas du tout, voici qu’on les exhume et qu’on les allonge en plein jour, du haut en bas des murs rafraîchis d’une opulente salle.
Gérard et Pagnest, Scheffer et de la Berge, Gleyre et Heim, Vernet et Gros, Léopold Robert et Deveria, Regnault et Daubigny reparaissent embaumés dans leurs cadres réveillés d’or. D’aucuns étaient restés, depuis des années sans sépulture, dans l’abandon d’une salle perdue prés du Sénat ; d’autres avaient été déposés dans des tombes ouvertes, relégués dans une salle du Louvre, veillés par un gardien qui gisait, hébété d’ennui, sur une banquette toujours neuve ; quelques-uns enfin avaient été ensevelis on ne savait où et l’on pouvait espérer qu’aucun obituaire n’avait conservé leurs noms.
De bureaucratiques ambitions les ont retrouvés, — et l’heure de l’injustice a sonné pour eux, car on va les respecter et le public visite déjà, d’un air recueilli, ce gibet de toiles pendues, plein de Romains en bois et de paysages de famille fabriqués avec des cheveux. Mais dans cette promiscuité de morgue une oeuvre resplendit dont le comique furieux vous crispe, un tableau de Guérin, une offrande à Esculape, ainsi assemblée : un trépied, surmonté du buste cher aux pharmacies, devant lequel un vieillard frisotté se gratte, alors que deux statues de jeunes gens avancent une jambe et tendent un bras. Il va sans dire que ces jeunes gens sont nus le plus qu’ils peuvent et qu’une jeune fille accroupie devant eux est habillée de tuyaux d’orgues qui lui remontent la taille sous les bras, et lui coussinent le menton par l’appui des seins. Cette peinture morne et sèche, emphatique et mesquine, nous déconcerte à l’heure présente et cependant n’est-elle pas supérieure au portrait du maréchal Prim dont le vagabondage du dessin et le cabotinisme édente des couleurs font vraiment peine ?
En somme, il n’existe de réellement intéressant, dans cette pendaison de châssis, que les Delacroix et que les Ingres.
Delacroix posséde là quelques-uns de ses grands tableaux : lu massacre de Scio, la barque de Dante, les femmes d’Alger. Ces oeuvres sont trop polluées par la vue pour que je les décrive, elles ont figuré depuis un temps immémorial dans les musées et récemment encore, à propos de l’exposition du quai Malaquais, elles ont été reproduites dans tous les journaux à images et pilonnées par toute la presse.
Je m’occuperai plus spécialement de l’Entrée des Croisés à Constantinople qui, après avoir été enfouie pendant des années dans la nécropolê oubliée d’une province, a fini par demeurer acquise au Musée du Louvre.
Ce tableau est la pièce maîtresse de la nouvelle salle et c’est, dans l’oeuvre de Delacroix, la toile la plus personnelle, peut-être la plus parfaite.
Pour la première fois, une entrée de vainqueurs dans une ville qu’on met à sac, n’est pas ordonnée dans une tempête de hourras, dans des triomphes de fanfares, dans des salves, d’apothéose. Ici, les Croisés arrivent, exténués, presque mourants ; les chevaliers s’affaissent sur leurs selles et leurs yeux rentrés, comme vernis par la fièvre, voient à peine les vaincus que leurs chevaux piétinent. Un écrasement de fatigues immenses ravine leurs faces et creuse leurs bouches qui divaguent, maintenant que le succès amène la détente du système nerveux exaspéré par tant d’efforts. Et cependant, sur ces physionomies dont la lassitude est telle qu’aucune autre expression ne semblerait plus devoir en altérer les traits, des fumées de sentiments passent, une férocité non éteinte encore chez quelques-uns, une vague pitié chez d’autres qui regardent un banal vieillard agenouillé, tenant dans ses bras sa femme et criant grâce. Ce triomphe si mélancolique et si vrai est en même temps qu’un délice spirituel, un régal des yeux. C’est une des pages les plus nettes du peintre, une concorde admirable de tons, un autodafé aux sels crépitants, sonore et clair, un hallali de flammes de couleurs, sur un fond d’océan et de ciel d’un splendide bleu !
Il faut bien le dire, surtout après la malencontreuse exhibition d’une trop copieuse fournée de Delacroix qu’on nous servit, pèle-mêle, dans la galerie des Beaux-Arts, ce peintre n’a pas toujours été aussi vibrant et aussi ferme. Artiste inégal et saccadé, Rubens dégraissé et affiné par les névroses, débarrassé du gros côté d’art peuple et de peinture bouchère que posséda, malgré son prodigieux talent, le diplomate sanguin d’Anvers, Delacroix a la grâce des maladies qui se terminent et des santés qui reviennent. Rien en lui du train-train coutumier, de la vie assise, du retiré du commerce de l’art sage, mais des sursauts, des exultations, des cabrements de nerfs mal dominés sautant quand même par dessus l’étisie et la mâtant ; par contre, c’est aussi un casse-cou perpétuel, un hasard de migraine, une chance de réveil, et si la déveine d’une passagère dysénergie de la vue s’en mêle, tout rate et il devient singulièrement inférieur ; sa fougue qu’il s’efforce de fouetter rebiffe et alors les tons s’épaississent, le dessin inachevé erre et chancelle. Homme étrange, incomplet presque toujours, rageur et languide, superbe quand sa fièvre flambe, cabotin et vieux mélo quand elle charbonne, il a été un tétanique puissant contre le coma de l’art, une strychnine électrisant le vieux julep prescrit par les recettes teinturières du grand art. En somme, il a infusé, à défaut de santé, dans la peinture de son temps, une bravoure acculée, un fluide nerveux, une force intermittente de colère, une pulsation d’amour ; en somme, il a commencé à ramoner, avant Manet, et à éclaircir le cul de four des toiles ; il a prononcé le rejet des anciennes ombres noires ou bistre et les a fait dériver de la couleur même de l’objet qui les donne ; il a ouvert la voie aux impressionnistes du temps présent. En dépit des lointains qui semblent séparer le peintre de la barque du Dante des peintres de la modernité contemporaine, il leur a laissé les traces héréditaires d’un puissant aïeul. L’un des promoteurs de la nouvelle formule, M. Cézanne, descend même directement de lui et c’est à son école que M. Degas doit cette science des couleurs qu’il manie en maitre.
A côté de Delacroix, un seul peintre, installé dans cette même salle du Louvre, parvient à ne pas trop fléchir, c’est le vieil Ingres. Je ne parle pas ici de son Apothéose d’Homère, cette glaciale transposition dans la peinture d’un bas-relief déjà médiocre. Je laisse également de côté sa mongoifière à forme humaine qu’il dénomme Angélique et son Bain si rigidement ennuyeux, avec sa femme, coiffée d’un madras, nue, nous tournant le dos, alors que derrière les tubulures d’un rideau de tôle apparaît, crachant dans une invisible piscine, une tète de lion dérobée au ceinturon d’un artilleur auquel elle servait certainement de boucle.
Sorti du portrait, Ingres n’est rien ; c’est un calligraphe patient, un Chouilloux des Radrets de la peinture, un pète-sec laborieux, un chef de division de la préfecture des arts, et encore dans le portrait se dédouble-t-il, étant, tour à tour odieusement pataud et curieusement subtil.
Pataud, dans le portrait de Madame Moitessier, une femme aux chairs conservées dans l’appareil frigorifique d’une Morgue, un mannequin congelé, assis dans une robe à fleurs blanches sur une ottomane rose et dont le dos se reflète dans une glace. Et quel reflet de porcelaine sur un fond d’acier ! et puis quelle pose de keapsake, une tête de sydonie appuyée sur un bras, avec un doigt posé sur une tempe et des yeux de raie morte ! C’est le papier peint dans toute sa gloire ! c’est cru, sec, rêche, enjolivé par des simagrées d’étoffes tricotées au petit point et lapidifiées de même que les chairs frottées ensuite comme un parquet au siccatif.
Subtil, dans le portrait de Madame de Vançay dont la vie mystérieuse vous prend aux moelles, un portrait peint à plat, n’avançant comme aucun des portraits habituels et ne reculant pas comme ceux de M. Whistler. C’est fixe, collé sur placard, fantômatique et muet. Madame de Vançay est ainsi posée sur fond vert : assise, en robe décolletée de velours noir, elle porte, négligemment jeté sur son bras, un manteau, une sorte de peplum cachou, barré de même que par des bàtons de cire à cacheter commune ; et les étoffes sont peintes ainsi que dans des aquarelles persanes, précieuses et peinées ; mais sous ses bandeaux chàtains et plats, la figure pàle jaillit et vous regarde d’un oeil si fascinant, si bizarre, qu’on s’arrête subjugué par l’énigme de cette physionomie qui ferait songer à celle d’une Ligeïa naturalisée, après une cure au bromure, en France.
Ce portrait est vraiment étrange, vraiment subtil ; à force de travail et de bonne foi, le vieil aphasique est parvenu à pousser un cri et à allumer la petite flamme qui sourd dans cette toile si différente de son oeuvre d’habitude grincheuse et morne.
Ce portrait a, lui aussi, aidé au mouvement de l’art actuel ; la conscience des détails, le labeur de boeuf, la franchise brutale, la volonté d’être réel et juste du peintre ont porté. L’école impressionniste s’est souvenue de ce plaquage japonais, de cette naïveté presque féroce des tons, de cette gaucherie imagière, voulue, de cette sincérité de primitif. L’un d’eux même s’est inspiré de ce portrait jadis : M. Forain, qui a peint Madame M***, allégée des étoffes oiseuses mais privée aussi de l’entière sincérité du vieux peintre.
Le portrait de Madame de Vançay n’appartient malheureusement pas au Louvre, mais un autre s’y trouve qui le rappelle un peu et soutient le panneau de la déplorable salle qu’il honore, le portrait de Madame Rivière, assise sur un divan d’azur et vous regardant, immobile, sous des coques de cheveux bruns. Là encore la fidélité de l’artiste nous requiert. Les chairs sont burgautées, sans granules, lisses ; le châle qui est placé près d’elle est pointillé comme une aquarelle indienne ; mais cette femme respire et ses yeux inquiètent ; elle vit, ainsi que Madamede Vançay, d’une vie glacée, si l’on peut dire ; c’est une ressuscitée encore un peu froide : c’est par la magie de l’oeil qu’Ingres anime ses effigies et leur insuffle ce mystère qu’un artiste moderne, M. Redon, obtient, lui aussi, souvent, par ses savantes déformations de la prunelle.
L’on peut signaler encore, dans la salle des Etats, le portrait de M. Rivière, peint lèches à lèches, un tantinet fantasque pourtant, mais rentrant un peu déjà dans la catégorie de ces travaux de maison de force dont Ingres a si souvent obtenu l’entreprise.
En résumé, cinq ou six toiles de Delacroix et une d’Ingres pourraient justifier les clabaudantes clameurs qui s’élevèrent dès l’ouverture de la nouvelle salle. Pour moi, je me réjouis surtout de la voir installée, parce que ses luisants et ses ors attirent la foule piétinante des visiteurs qui s’y entassent et laissent libres les couloirs où s’entassent les admirables Primitifs italiens et flamands qu’il m’est maintenant permis de contempler, sans être dérangé, tout à mon aise.
Bianchi.
JAMAIS on ne vit copiste dresser son chevalet devant cette toile. Personne, parmi les rares visiteurs fourvoyés dans la galerie des Primitifs Italiens, au Louvre, ne s’arrête devant cette oeuvre huchée sur un mur de refend, en un coin de porte. L’artiste même qui l’a créée, Francesco Bianchi est ignoré. D’après une chronique de Lancilotti, on le suppose né en 1447 et mort en 1510. Il peignait en 1481, dit Vasari qui l’inhume en quatre lignes. Sa désignation demeure aussi confuse. D’aucuns le nomment Bianchi Ferrari, d’autres Frarre, d’autres il Frate Francesco. Tous s’accordent pour attester qu’il fut le maître du Corrège, mais en admettant que la date de son décès soit authentique, il serait mort alors que son disciple avait seize ans ! Les biographies sont muettes sur ses oeuvres qui seraient perdues. Alôrs que tous les peinturlographes s’extasient devant les sourdes médiocrités de Raphaël, aucun ne paraît même soupçonner la singulière personnalité de Bianchi. D’où venait-il, quelle fut sa vie ? nul ne le sait. A quelle école appartenait-il ? Ecole de Modène, dit Vasari ; école Lombarde, affirme un catalogue ; école de Ferrare, prétend un autre. Et chacun passe, heureux de rentrer dans une voie battue et de retrouver les séculaires éloges dédiés au triomphant Allegri, son incertain élève.
Le Louvre possède un seul tableau de Blanchi et de cette toile s’exhalent pour moi des émanations délicieuses, des captations dolentes, d’insidieux sacrilèges, des prières troubles.
L’ordonnance de cette oeuvre est telle : La Vierge assise sur un trône tient entre ses bras l’enfant Jésus, paré de bracelets minces, la chair nue, serrée au-dessous du menton par le fil d’un collier d’or. Derrière elle, entre deux pilastres que gravissent en tournoyant de précieuses tiges, un lointain paysage, traversé par un fleuve, disperse les cimes arrondies de ses monts dans un ciel calme ; au pied du trône, un séraphin en robe verte joue du théorbe, un autre, en robe rose, joue de la viole. De chaque côté du cadre, debout, deux extraordinaires faces : un vieillard revêtu d’habits abbatiaux, tient à la main un livre à fermoir, relié en rouge ; un jeune homme bardé comme un chevalier de fer, regarde, la main appuyée sur une épée à la poignée en forme de croix.
D’après la tradition confirmée par l’avis des hagiographes, le vieillard est saint Benoît, et saint Quentin le jeune homme.
L’imposant aspect du vieillard livide et chauve, au visage rigide, à l’oeil nu, à l’allure sacerdotale et princière, s’adapte, en effet, au formidable saint, au patient semeur qui laboura les âmes en jachère et fit germer en elles les claustrales moissons de son grand Ordre. Le livre qu’il tient entre ses doigts fuselé, dans ses mains lentes, renferme les règles qu’il promulgua, ces règles qui, réformées ou intactes, courbent encore, dans tout l’Occident, sous la discipline des cloîtres, des milliers d’êtres !
Ce regard si triste, si profond, si clair, dans lequel passent les récurrences d’horribles luttes, peut être celui de l’homme qui, réfugié dans le désert de Subiaco, râlait d’angoisses et consumait les abois de sa chair, en la roulant sur les vertes braises des orties et des ronces.
L’on conçoit également son sourire hautain et navré. Le pli de sa bouche dure rappelle, en effet, l’écrasante tâche qu’assuma ce Directeur d’un contentieux divin, ce Gérant des dépendances terrestres du ciel, ce Régisseur du bienfonds des âmes. Le sourire mort de ses lèvres s’explique aussi lorsqu’on se souvient des haines qui l’assaillirent, des attentats surtout de ce prêtre qui voulut l’empoisonner et s’efforça de pervertir ses moines en prière, par la vue de filles dont les pâles nudités s’ouvraient en de séditieuses danses, dans le jardin même du monastère qu’il avait fondé.
La complexe expression de ce visage se comprend donc ; mais comment définir la troublante figure du saint Quentin, un éphèbe au sexe indécis, un hybride à la beauté mystérieuse, aux longs cheveux bruns séparés par une raie au milieu du front, et coulant à flots sur sa gorge corsetée de fer. N’étaient les pieds qui, au lieu d’être insérés dans les pédaliers d’armure, sont nus et chaussés de sandales rattachées par des bandelettes au bas de la jambe, l’on dirait du traditionnel costume d’une Bradamante ou d’un saint Georges.
Puis que penser de cette adorable tète dont une inétanchable douleur a voilé les traits ? que penser de ces yeux clairs mais dont le bleu évanoui cache comme un fond de bourbe ? — Ce ne sont plus les yeux navrés, les yeux purs, les yeux aux eaux de source, limpides et froides, du saint Benoît, ce sont des yeux brûlés par des tentations qui aboutirent, ce sont des prunelles d’eaux remuées et réfléchissant, quand elles se tranquillisent, des firmaments d’automne roux, ce sont de belliqueuses prunelles mal pacifiées par la pénitence, après la faute. Et l’aspect entier du saint fait rêver. Ces formes de garçonne, aux hanches un peu développées, ce col de fille, aux chairs blanches ainsi qu’une moelle de sureau, cette bouche aux lèvres spoliatrices, cette taille élancée, ces doigts fureteurs égarés sur une arme, ce renflement de la cuirasse qui bombe à la place des seins et protège la chute divulguée du buste, ce linge qui s’aperçoit sous l’aisselle demeurée libre entre l’épaulière et le gorgerin, même ce ruban bleu de petite fille, attaché sous le menton, obsèdent. Toutes les assimilations éperdues de Sodome paraissent avoir été consenties par cet androgyne dont l’insinuante beauté, maintenant endolorie, se révèle purifiée déjà, comme transfigurée par la lente approche d’un Dieu.
Car elle n’est pas encore venue pour lui, la combustion de l’âme qui fond et s’écoule en le Seigneur ; cet état parfait de l’extase, où l’esprit s’enivre de délices dans l’existence essentielle, n’a point été acquis par l’androgyne dont les abandons n’ont sans doute pas été assez pressurés par le remords. L’inconsolable détresse de sa physionomie l’atteste. Il semble bien que dans cette attitude la Renaissance éclose et qu’elle peigne un épisode intermédiaire d’âme que le Moyen Age, plus absolu, eût supprimé.
Mais toutes ces idées compréhensibles, alors qu’elles s’appliquent à des saints qui, après s’être internés dans les maladreries exquises de la chair, ont été subitement illuminés par la grâce, deviennent inexplicables alors qu’on les adapte à saint Quentin. Ni le martyrologe, ni la monographie de l’abbé Mathieu, ne concernent un hermaphrodite cuirassé de fer, un chevalier qui, après avoir été affamé de tracas luxurieux, agonise sous le poids de ses peines. La légende le représente simplement comme le fils d’un sénateur romain qui vint, dans le Vermandois, confesser son Dieu, et que le préfet de Dioclétien, Varus, fit torturer.
De Tillemont relate les successions de son supplice. Il fut d’abord pendu à des poulies et étiré de tulle sorte que ses genoux, déboîtés, flottèrent ; il fut ensuite flagellé par de courtes chaînes, puis on lui tisonna le dos avec des torches ranimées par de la poix et l’on emplit sa bouche d’une pâte mouillée de chaux vive.
Ces préludes terminés, le bourreau voulut qu’il reprît haleine et le déposa dans une cave. Pansé par le froid des ténèbres, il se recouvra, et alors le tortionnaire le transperça, du col aux cuisses, de deux barres aiguës, puis il lui fit jaillir des clous sous les ongles et, enfin, il le perfora de longues pointes dont l’une, mal dirigée, pénétra dans la cervelle et mit fin à son martyre.
Or, rien, dans la figure, dans les attributs du saint ne rappelle les incidents de ce supplice. Le sujet du tableau demeure donc mystérieux, et, ce qui ajoute encore à l’énigme de la scène, c’est le visage de la Vierge, douloureux et altier, sous ses yeux baissés, des yeux qu’on devine pareils à ceux du saint Quentin, limpides à la surface et troubles au fond. Aucun des personnages ne concourt, du reste, à l’explication du groupe. Indifférents à la Madone et à l’Enfant Jésus qui sourit et joue, les saints regardent fixement, tristement, devant eux et aucun lien ne semble rattacher entre elles ces hautes figures dont la vie vous poursuit et vous presse.
Et alors l’on s’aperçoit que toutes cependant se ressemblent. On dirait du saint Benoît, le père, de Marie et du saint Quentin, la soeur et le frère, et du petit ange vêtu de rose jouant de la viole d’amour, l’enfant issu du diabolique accouplement de ces Saints. Le vieillard est un père qui a résisté aux aguets d’épouvantables stupres, et dont le fils et la fille ont cédé aux tentations de l’inceste et jugent la vie trop brève pour expier les terrifiantes délices de leur crime ; l’enfant implore le pardon de son origine, et chante de dolentes litanies pour détourner la souveraine colère du Très-Haut.
Telle peut étre la signification de cette toile où la rousse et flexueuse perversité d’une Renaissance sourd déjà de la rigide blancheur du Moyen Age. Sans doute, Bianchi a tout bonnement peint, ainsi que la plupart des artistes de son temps, une famille de donateurs qui lui avaient, pour la parure d’une chapelle, commandé cette oeuvre ; il a travesti en de religieux costumes des podestats usés par les déboires du bonheur et les joies du vice ; en acceptant cette donnée d’une simple série de portraits, de quel sentiment surhumain, de quel subtil et impérieux talent n’a-t-il pas imprégné son oeuvre ! Sans rémission, les amateurs louent le chancelant sourire de la Joconde ; mais combien plus mystérieuses, plus dominatrices, sont ces lèvres closes, augustes et navrées, douces et mauvaises, vives et mortes ; combien les yeux attendus, sûrs, du Vinci, sont vides, si on les compare à ces prunelles en eau de roche ou en eau de rivière qui, frappée par la foudre, s’épure après l’orage !
Inexplicable malgré tout, cette toile d’une couleur lisse et meurtrie, d’un dessin solennel et svelte, d’une tristesse infinie, d’une allégresse, indicible d’art, vous arrache à la vie présente et vous suggère d’inquiétantes rêveries, alors que, chassé par l’heure de la solitaire salle, l’on redescend sur la place du Carrousel et qu’on rentre dans le fracassant tohu-bohu des voies publiques.