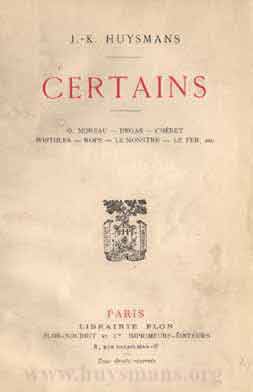Bartholomé. — Raffaëlli. — Stevens. — Tissot. — Wagner. — Cézanne. — Forain.
DANS la solennelle infamie des salons de Mai, deux toiles :
Une récréation de M. Bartholomé, ainsi conçue : des petites filles jouent dans un préau autour duquel court un hangar soutenu par des piliers de fonte et coiffé de tuiles rouges. Au fond, un arbre poussé de travers, un pan de mur qui se profile sur un champ pommelé de ciel. Un coup de soleil divise la cour en deux parts : l’une éclairée, l’autre perdue dans l’ombre.
Au premier plan, six fillettes se tiennent la main et s’apprétent à tourner en rond. La chaîne est interrompue par l’une d’elles, qui renoue le cordon de sa chaussure ; plus loin, d’autres se lancent et se renvoient des balles, tandis que, dessinant un A renversé sur sa pointe avec leurs pieds réunis et arcs-boutés sur le sol, leurs corps renversés en arrière, écartés à droite et à gauche comme les deux jambages de la lettre et reliés au milieu par la barre des bras, deux bambines, les mains enlacées, se préparent à pivoter éperdûment sur place.
D’autres, enfin, grimpent sur des bancs pour une partie de chat-perché, et, dans l’ombre du hangar, passe la silencieuse silhouette d’une méditante soeur.
Ce qu’il faut tout d’abord relever, c’est l’observation précise du peintre. Ces enfants sont saisies, piquées sur la toile, sans tricheries ni dols. A ce point de vue, les fillettes, qui tendent encore la main à leur camarade si naturellement courbée sur sa chaussure, sont décisives ; — puis, prenez chacune d’elles à part et voyez combien les tempéraments s’accusent. — Ici, une petite, maigriotte, pauvre de sang, intéressante par sa mine fûtée, anoblie presque par sa chétivité et sa pâleur ; là, une autre plus membrue, plus mastoque, plus tachée de sons ; la encore, une autre dont la figure est déjà faite : son visage de trente ans est prêt ; plusieurs sont dans ce cas fréquent, du reste, parmi les enfants du peuple. Et, dans cette joie d’une sortie de classe, dans ce délassement de cris et de rires, dans ces transports de courses et de danses, les traits endormis s'éveillent, les physionomies effacées s’accusent, les laides mème deviennent charmantes. De la toile à peine couverte s’évapore comme une puberté de gràces simples.
Ajoutez enfin que la peinture est lumineuse et gaie, que la couleur parfois un peu timide du peintre s’est enhardie et qu’avec les teintes neutres des tabliers et le bleu ou le lilas des robes, avec ces touffes de cheveux tombant en natte sur le col ou nouées en paquet d’échalotes sur la nuque, ces cheveux de blondines qui se fonceront plus tard, il est parvenu à moduler une mélodie d’une plaisance de tons exquise.
* *
Une autre de M. Raffaëlli : « La belle matinée. » Dans un lit capitonné, en bois blanc laqué, Louis XV, une femme dort ; le livre qu’elle parcourait est là, ouvert, sur la place vide du lit, près de l’oreiller désert qui l’avoisine ; le monsieur s’est levé et sans doute a fui ; la femme, lasse, s’est rendormie. Ce qui étonne dans cette oeuvre, c’est l’extrême véracité de cette femme qui, la tête un peu renversée, souffle doucement, les cheveux dénoués, le cou un peu tendu, les paupières talées, les membres las ; puis tout le ragoût du lit qui nous fait face, avec ses oreillers, ses draps, est épicé vraiment à point. C’est un hymne blanc, un hymne dans lequel le peintre a trahi le symbole de la couleur chaste, hystérisé la candeur, imprégné de volupté la fraîcheur des tons communiants, cantharidé les teintes évangéliques, les nuances d’épithalame ! Oeuvre d’une distinction mitoyenne, voulue, oeuvre précise, d’un réalisme absolu, d’une observation acérée, d’une vigueur intense, ce tableau détonne, dans la pièce où il chante à tue-tête son hosanna libertin des blancs, au milieu des antiennes multicolores moulues par les orgues de Barbarie de ses confrères.
* *
De M. Raffaëlli, mais exposées, cette fois, avec des paysages de Jersey, chez M. Georges Petit, d’extraordinaires aquarelles reproduites dans le numéro du Paris-Café-Concert, édité par M. Baschet.
L’une d’elles nous montre un quadrille aux Ambassadeurs : deux blanchisseuses qui ont lâché le fer à repasser, le « gendarme », deux lavasses roulées sur tous les canapés sans ressort des marchands de vins, secouent, les pieds au ciel, dans un furieux chahut, l’étal mouillé de leurs chairs ; et il faut voir le sourire carnassier de ces bouches, la danse de ces fanons, le cancan de ces yeux de filles à trois francs, qui allument le fond des corridors ou attirent, pour de courtes besognes, dans la nuit des terrains vagues !
Les deux hommes qui leur servent de vis-à-vis sont encore plus turpides ; l’un d’eux tord une gueule de garçon de cuvette et l’autre un mufle de camelot ou d’acteur ; eux aussi se dégingandent, battent avec les moulinets de leurs bras une rémolade de poussière dans les jets de gaz, font avec les manches de veste de leurs jambes les digue-digue-don d’une crampe atroce.
C’est de l’élixir de crapule, de l’extrait concentré d’urinoir transporté sur une scène, de la quintessence de berge, de dessous de pont, enrobée dans une musique poivrée de cymbales et salée de cuivres.
Peintre des paysages suburbains dont il a, seul, rendu les plaintives déshérences et les dolentes joies, M. Raffaëlli a voulu suivre la créature humaine échappée de la banlieue et jetée en pâture sur des tréteaux, aux ruts oculaires des quartiers riches ; et sous les paillons de ce carnaval, sous les teintures de ces faces, sous l’emphase de ces ventres en sortie et de ces tétons sautés, il a retrouvé la canaillerie alcoolique des gestes, l’indécence intéressée des yeux et il les a peintes, comme vues au travers d’un tempérament d’Anglais, d’un pinceau naïf et féroce, brutal et dur.
* *
STEVENS
Je m’explique décidément mal cette présomption des Belges de qualifier, depuis des années, M. Stevens de « grand peintre de la vie moderne. »
De ses doigts lourdauds il lapidifie les légers chiffons qu’il touche et sourdement il éclaire, de la lanterne glacée de son gros oeil, des petites femmes qui ne sont plus des Flamandes et qui ne seront jamais des Parisiennes.
Et puis, quelle vision superficielle des élégances de ce Paris qu’il peint ! Dans des intérieurs généralement déformés par de la porcelaine et de la quincaillerie japonaises, il campe en des poses sentimentales des modèles d’atelier qu’il affuble d’oripeaux durs. Cela représente la femme du monde, la Parisienne riche.
Dans cette série de minauderies belges, une exception eut lieu pourtant. M. Stevens exposa, un jour, chez M. Georges Petit, un portrait de fille : sur un fond sardiné s’enlevait une tête vannée, aux chairs retenues par des mastics, reconstituées par des cold-cream et des graisses. Sous une perruque rousse se liquéfiait un oeil bleu, las et rosse. Cela sentait non la luxure des noces partagées, mais l’épuisement de l’acte sans aide, de la caresse sans prière, du péché muet. Un peu d’âme était montée à la face de ce portrait : c’était authentique et curieux. M. Stevens avait eu tout à coup la grâce, cette grâce de l’art qui, plus fugitive que la grâce divine, délaisse les gens après une bonne oeuvre et les remet là où elle les a pris, dans la profitable boutique des succès bourgeois et des achats sûrs.
* *
J. TISSOT
En dépit des sourdes révoltes que soulevaient en moi leurs rigides manigances, j’ai longtemps, aimé les eaux-fortes de M. Tissot. D’aucunes me sollicitaient par leur ferme aplomb, par leur solide assise de planches méthodiques, d’architecture, si l’on peut dire, par leur ton sépiacé largement gravé dans du papier fort. Telles ses miss sur des ponts de paquebot penchés ou en compagnie d’un soldat à bonnet à poil dans une barque. Il y avait là un sentiment spécial du moderne anglais. C’étaient des eaux-fortes protestantes, un peu lourdes, mais rendant parfois un amusant entour de cordages et de vergues, des fonds de Tamise, sur lesquels se détachaient quelques grandes filles un peu godiches, quelques femmes bornées d’esprit mais de chairs saines.
Malheureusement, M. Tissot a jugé bon de passer la Manche et d’exposer à Paris de la peinture, et pas plus que M. Stevens, moins encore, il n’était de taille à s’attaquer à la femme élégante en France. Ses Parisiennes exhibées chez M. Sedelmeyer étaient issues de l’accouplement d’un Savoyard et d’une Jane Bull ; les poses étaient nigaudes et, malgré toutes ses simagrées, l’exécution était nulle. Ajoutons qu’elles n’étaient pas isolées dans son oeuvre, car il exhuma jadis, en 1883, je crois, dans le désert du Musée des Arts décoratifs, toute une série d’aquarelles et d’huiles et jamais je ne vis rien de plus pénible, de plus cinéraire et de plus morne que les châssis de cet homme qui avait été quelquefois libre et coloré dans ses grandes planches.
A propos de ses hauts pastels qui figuraient aussi dans ces salles — une nourrice et un enfant entre autres — je n’ai pu m’empêcher de songer aux agaçantes frivolités de cette infidèle soubrette de la couleur, à M. de Nittis, mais à une soubrette, assagie par l’épargne et par l’âge et devenue, en s’incarnant en M. Tissot, une matrone revêche, une Madame pète-sec, à menton carré et à gros os.
* *
WAGNER
Quelle singulière toile nous révéla la première Exposition des Indépendants qui s’ouvrit, en 1884, dans les baraques des Tuileries !
Dans un jour crépusculaire, ce jour qui éclaire les cauchemars des nuits mauvaises, aux sommeils concassés et sans repos, l’on entrevoyait une moitié de cirque, et des clowns pareils à des ombres jonglaient ou tenaient au bout du bras ces cerceaux de papier que les écuyères crèvent.
Ces clowns vivaient d’une vie fluide, étrange : on eût dit des spectres passant dans un cirque mort ; c’était devant ce tableau un malaise d’art qui s’accroissait alors que, contemplant ces figures, on les voyait s’animer et sourire avec des yeux mortellement tristes.
Aucun renseignement sur le catalogue ; le tableau ne portait aucun titre à la suite de ce nom : « Wagner ». Ni prénoms, ni lieu de naissance, ni adresse, rien.
Je me suis souvent demandé quel pouvait être cet homme qui n’avait jamais exposé jusqu’alors et qui n’a plus jamais exposé depuis. Mais personne, parmi les littérateurs et les peintres, ne le connaissait. Longtemps après, il me fut dit, au hasard d’une conversation, un soir : « A propos, j’ai entendu parler, par un monsieur dont j’ignore jusqu’au nom, de ce Wagner dont l’oeuvre vous préoccupe ; eh bien ! il paraît que ce peintre est un malheureux qui a été et qui est encore, je crois, lutteur dans les foires et clown. » Si c’était vrai, pourtant !
Mais alors, comment expliquer la maladive élégance de cette peinture noyée de rêve, le douloureux et délicat murmure de cet art réalisé par un paillasse qui fait les poids ?
* *
CÉZANNE
En pleine lumière, dans des compotiers de porcelaine ou sur de blanches nappes, des poires et des pommes brutales, frustes, maçonnées avec une truelle, rebroussées par des roulis de pouce. De près, un hourdage furieux de vermillon et de jaune, de vert et de bleu ; à l’écart, au point, des fruits destinés aux vitrines des Chevet, des fruits pléthoriques et savoureux, enviables.
Et des vérités jusqu’alors omises s’aperçoivent, des tons étranges et réels, des taches d’une authenticité singulière, des nuances de linge, vassales des ombres épandues du tournant des fruits et éparses en des bleutés possibles et charmants qui font de ces toiles des oeuvres initiatrices, alors que l’on se réfère aux habituelles natures-mortes enlevées en des repoussoirs de bitume, sur d’inintelligibles fonds.
Puis des esquisses de paysages en plein air, des tentatives demeurées dans les limbes, des essais aux fraîcheurs gâtées par des retouches, des ébauches enfantines et barbares, enfin, de désarçonnants déséquilibres : des maisons penchées d’un côté, comme pochardes ; des fruits de guingois dans des poteries saoûles ; des baigneuses nues, cernées par des lignes insanes mais emballées, pour la gloire des yeux, avec la fougue d’un Delacroix, sans raffinement de vision et sans doigts fins, fouettées par une fièvre de couleurs gâchées, hurlant, en relief, sur la toile appesantie qui courbe !
En somme, un coloriste révélateur, qui contribua plus que feu Manet au mouvement impressionniste, un artiste aux rétines malades, qui, dans l’aperception exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes d’un nouvel art, tel semble pouvoir être résumé, ce peintre trop oublié, M. Cézanne.
Il n’a plus exposé depuis l’année 1877, où il exhiba, rue Le Pelletier, seize toiles dont la parfaite probité d’art servit à longuement égayer la foule.
* *
J.-L. FORAIN
M. Forain est maintenant connu ; les journaux s’achalandent sur son nom ; ses aquarelles s’acquièrent à des prix fermes ; il n’est plus besoin de certifier, comme je le fis autrefois, l’apport ignoré de son talent neuf ; je n’ai donc que quelques notes à joindre à celles que j’ai réunies dans mon livre : « L’Art Moderne. »
Sorti de l’École des Beaux-Arts et ayant même passé, je crois, par l’atelier de feu Carpeaux, M. Forain n’eut en réalité que deux maîtres, Manet et M. Degas. Bien que la filiation de Manet surtout puisse être soupçonnée dans ses premières oeuvres qu’il signait d’un paraphe maintenant aboli, débutant par un L et un F emboîtés, en forme de 4, elle est devenue presque aussitôt problématique et quasi nulle. M. Forain eut, en somme, l’inespérable chance de ne ressembler à personne, dès ses débuts.
De ce temps datent des aquarelles étranges ; quelques-unes, usant de perspectives japonaises, prêtant, presque toutes, à la créature humaine une certaine roideur ironique, de bon ton, bizarre. Je me rappelle dans un jardin une jeune mère, effilée, droite, aux traits laconiques, au buste sortant d’un paletot mastic, conduisant par la main un enfant dont la très simple attitude du corps tourné sur le poignet était charmante ; de la même époque, quelques dessins parus dans La République de Lettres : l’un, un intérieur de salon, avec des messieurs chauves et diserts, aux allures différentes et pourtant pareilles ; l’autre, une salle de cabaret, avec des ouvriers tout en barbes et en pipes, et une fille passionnément vautrée sur un voyou froid ; un autre dessin inséré, en 1876, dans la Cravache, était merveilleux encore. Il était intitulé « L’Amant d’Amanda » et formait une parodie du groupe « Gloria Victis, » de M. Mercié, avec un gommeux rigide, mi-mort, la tête en arrière, soulevé par une exquise femme qui tenait tout à la fois de la poupée et de la maraudeuse !
Puis cette saveur spéciale, dure, presque naïve, verte, si l’on peut dire, s’effaça ; sous l’influence de M. Degas, toute une technique plus compliquée parut. Alors, il fit, en d’extraordinaires aquarelles rehaussées de gouaches, des scènes de coulisses et de cafés-concerts, de bordeaux et de bars ; il apprêta des ragoûts de couleurs studieusement épicés, mit à de friandes sauces des nudités, obtint, par des mariages et des heurts inattendus de tons des effets inouïs, atteignit la nuance vraiment exacte, par l’observation attentive des reflets et des ombres, par la science absolue des adjuvants et des fontes.
Ainsi armé, M. Forain a voulu faire ce que le Guys, révélé par Baudelaire, avait fait pour son époque : peindre la femme où qu’elle s’affirme, dans les lieux où elle travaille, et il a naturellement peint aussi l’éternel comparse de la vieille farce, le Hulot moderne ou le jeune jobard en quête d’un renom mondain. A coup sûr, personne n’a mieux que lui, dans d’inoubliables aquarelles, décrit la fille ; personne n’a mieux rendu les tépides amorces de ses yeux vides, l’embûche polie de son sourire, l’émoi parfumé de ses seins, le glorieux dodinage de son chignon trempé dans les eaux oxygénées et les potasses ; personne, enfin, n’a plus justement exprimé la délicieuse horreur de son masque rosse, ses élégances vengeresses des famines subies, ses dèches voilées sous la gaieté des falbalas et l’éclat des fards.
En sus de ses qualités d’observation aiguë, de son dessin délibéré, rapide, concisant l’ensemble, avivant le soupçon, forant d’un trait jusqu’aux dessous, il a apporté, en art, la sagace ironie d’un Parisien narquois.
C’est gràce, sans doute, à cette orientation d’un esprit net et blagueur, très élagué de toute chimère, qu’il dut d’avoir trouvé, pour les dessins des journaux où il logeait, d’audacieuses légendes, parfois cruelles, souvent même presque comminatoires pour les ridicules gredineries de ces temps fous.