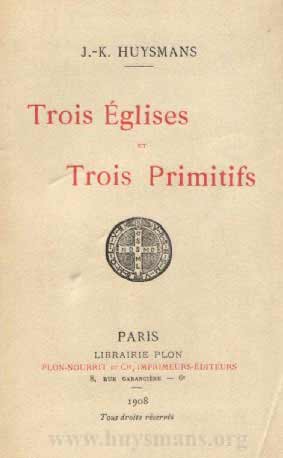LES GRÜNEWALD DU MUSÉE DE COLMAR (1)
MATHIAS Grünewald d’Aschaffenbourg, ce peintre de la Crucifixion du Musée de Cassel, que j’ai décrite dans Là-Bas et qui appartient maintenant au Musée de Carlsruhe, m’a, depuis bien des années, hanté. D’où vient-il, quelle fut son existence, où et comment mourut-il ? Personne exactement ne le sait ; son nom même ne lui est pas sans discussions acquis : les documents font défaut ; les tableaux qu’on lui attribue furent tour à tour assignés à Albert Dürer, à Martin Schôngauer, à Hans Baldung-Grien, et ceux qui ne lui appartiennent point lui sont concédés par combien de livrets de collections et de catalogues de musées !
A dire vrai, la seule preuve qui permette de lui imputer la paternité des panneaux dont nous allons parler et même de toutes les autres oeuvres qu’on lui prête, repose sur une simple indication du peintre biographe du XVIIe siècle, Joachim Sandrart, lequel raconte qu’il existait de son temps, à Isenheim, un tableau de Mathias Grünewald, représentant un saint Antoine et des démons derrière une fenêtre.
Or la description de ce tableau concorde avec le sujet du volet d’un polyptique venu de l’abbaye d’Isenheim, et maintenant exposé au Musée de Colmar.
La preuve de la filiation paraîtrait donc pouvoir être acceptée et alors, du moment que l’on sait que Grünewald a peint l’une des pièces de ce polyptique et qu’il est avéré, d’autre part, que toutes les pièces de la série sont l’oeuvre d’un seul maître, il devient facile de conclure et d’affirmer que Grünewald est l’auteur de l’ensemble.
Ce qui resterait à démontrer, d’une façon péremptoire, c’est que le volet de Colmar est bien le même que celui d’Isenheim — car s’il n’en était pas ainsi, tout serait remis en question — mais l’on peut attester qu’à défaut d’une certitude absolue, impossible à garantir, les présomptions sont vraiment assez fortes pour assurer qu’il y a identité entre les deux oeuvres.
Cette disposition très spéciale du sujet, avec un diable dans une croisée, ne se rencontre pas, en effet, dans les portraits de saint Antoine exécutés par les contemporains de Grünewald. L’on pourra comparer, à ce point de vue d’ailleurs, une autre effigie de ce saint qui se trouve dans la même salle du musée et qui a été traitée par Martin Schôngauer, d’après les données traditionnelles de l’époque où tous deux vécurent.
Cela dit, ce que l’on n’ignore pas de la vie de cet homme tient en quelques lignes plus ou moins sùres.
D’après M. Waagen, il serait né vers la fin du XVe siècle, à Francfort ; suivant M. Goutzwiller, répétant l’opinion de Malpe, il serait né vers 1450, en Bavière, dans la ville d’Aschaffenbourg, dont le nom s’est ajouté au sien. Selon Passavant, il vivait encore en 1529, et à en croire M. Waagen, il serait décédé l’année 1530. Enfin Sandrart, cité par Verhaeren dans une intéressante étude, le représente comme ayant surtout vécu à Mayence une vie solitaire et mélancolique, et ayant eu des tristesses dans son ménage. Un point, c’est tout.
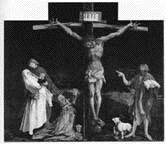
De ces renseignements sans doute revisables, un seul est suggestif, celui de Sandrart ; il permet au moins de s’imaginer ce peintre qui fut le plus tumultuaire des artistes, vivotant, casanier, à l’écart, tel plus tard Rembrandt, dans un coin de faubourg et s’absorbant dans la frénétique féerie de son oeuvre pour oublier ses peines.
Au tracas de ses chagrins domestiques s’accola peut-être la souffrance de son peu de renommée, le regret de son peu de gloire. Son nom ne figure pas, en effet, dans la liste des peintres célèbres de son temps. Tout le monde connaît Albert Dürer, les Cranach, Baldung-Grien, Schôngauer, Holbein, et personne ne soupçonnait, il y a quelques années, son existence. Fut-il plus famé de son vivant ? L’on peut en douter. Sa réputation, si tant est qu’il en eut, n’a pas franchi les domaines de la Franconie et de la Souabe ; alors que ses contemporains étaient, ainsi que Dürer, que les Cranach, qu’Holbein, choyés par les empereurs et les rois, lui, n’obtenait d’eux aucune commande. Nul vestige n’en subsiste du moins. Il n’était employé et connu que dans son pays même. Il fut peintre cantonal, un artiste de clocher qui n’oeuvra que pour les villes et les monastères de ses alentours. On le voit travailler à Francfort, à Eisenach, à Aschaffenbourg, où il aurait été, selon M. Waagen, appelé par l’archevêque de Mayence, Albert ; il est surtout évident pour moi qu’il a séjourné dans l’abbaye d’Isenheim ; certains détails de ses retables, que l’on sait avoir été exécutés de 1493 à 1516, sous le préceptorat de l’abbé Guersi qui les lui commanda, le prouvent.
Mais ce n’est plus ni à Francfort, ni à Mayence, ni à Aschaffenbourg, ni à Eisenach, ni à Isenheim, dont le cloître est mort, qu’il faut chercher les ouvrages de Grünewald, mais bien à Colmar, où ce maître s’avère par le magnifique ensemble d’un polyptique composé de neuf pièces.
Là, dans l’ancien couvent des Unterlinden, il surgit, dès qu’on entre, farouche, et il vous abasourdit aussitôt avec l’effroyable cauchemar d’un Calvaire. C’est comme le typhon d’un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l’impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée installé dans la vieille église désaffectée du cloître.
La scène s’ordonne de la sorte :
Au milieu du tableau, un Christ géant, disproportionné si on le compare à la stature des personnages qui l’entourent, est cloué sur un arbre mal décortiqué, laissant entrevoir par places la blondeur fraîche du bois, et la branche transversale, tirée par les mains, plie et dessine, ainsi que dans le Crucifiement de Carlsruhe, la courbe bandée de l’arc ; le corps est semblable dans les deux oeuvres ; il est livide et vernissé, ponctué de points de sang, hérissé, tel qu’une cosse de châtaigne, par les échardes des verges restées dans les trous des plaies ; au bout des bras, démesurément longs, les mains s’agitent convulsives et griffent l’air ; les boulets des genoux rapprochés cagnent, et les pieds, rivés l’un sur l’autre par un clou, ne sont plus qu’un amas confus de muscles sur lequel les chairs qui tournent et les ongles devenus bleus pourrissent ; quant à la tête, cerclée d’une couronne gigantesque d’épines, elle s’affaisse sur la poitrine qui fait sac et bombe, rayée par le gril des côtes. Ce Crucifié serait une fidèle réplique de celui de Carlsruhe si l’expression du visage n’était autre. Jésus n’a plus, en effet, ici, l’épouvantable rictus du tétanos ; la mâchoire ne se tord pas, elle pend, décollée, et les lèvres bavent.
Il est moins effrayant, mais plus humainement bas, plus mort. La terreur du trismus, du rire strident, sauvait, dans le panneau de Carlsruhe, la brutalité des traits que maintenant cette détente gâteuse de la bouche accuse. L’Homme-Dieu de Colmar n’est plus qu’un triste larron que l’on patibula.
Là ne s’arrête pas la différence qui se peut noter entre les deux oeuvres. Ici la disposition des personnages groupés n’est plus, en effet, la même. A Carlsruhe, la Vierge est, ainsi que partout, d’un côté de la croix et saint Jean, de l’autre ; à Colmar, les habitudes du sujet sont renversées et le surprenant visionnaire que fut Grünewald s’affirme, spécieux et sauvage, théologique et barbare à la fois, en tout cas, parmi les peintres religieux, seul.
A droite de la croix, trois personnes : la Vierge, saint Jean et Madeleine. Saint Jean, un vieil étudiant allemand, au visage glabre et minable, aux cheveux jaunes qui tombent en longs filaments secs sur sa robe rouge, soutient une Vierge extraordinaire, habillée et coiffée de blanc, qui s’évanouit, blanche comme un linge, les yeux clos, la bouche mi-ouverte et montrant les dents ; la physionomie est frêle et fine, toute moderne. Sans la robe d’un vert sourd qui s’entrevoit près des mains dont les doigts crispés se brisent, on la prendrait pour une moniale morte ; elle est pitoyable et charmante, jeune, vraiment belle ; devant elle, une femme toute petite, se renverse à genoux, les bras levés, les mains jointes vers le Christ. Cette fillette blonde, vieillotte, vêtue d’une robe rose doublée de vert myrte, la face coupée au-dessous des yeux et au ras du nez par un voile, c’est Madeleine. Elle est laide et disloquée, mais elle est si réellement désespérée qu’elle vous étreint l’âme et la désole.
De l’autre côté du tableau, à gauche, une haute et étrange figure, à la tignasse d’un blond roux, taillée droit sur le front, aux yeux clairs, à la barbe bourrue, aux jambes, aux pieds et aux bras nus, tient d’une main un livre ouvert et désigne de l’autre le Christ.
Ce visage de reître de la Franconie, dont la toison de poils de chameau s’aperçoit sous une ceinture dont le noeud bouffe et un manteau drapé en de larges plis, c’est saint Jean-Baptiste. Il est ressuscité, et pour que le geste dogmatique et pressant de son long index qui se retrousse en indiquant le Rédempteur s’explique, cette inscription en lettres rouges s’étend près du bras : « Illum oportet crescere, me autem minui. Il faut qu’il croisse et que je diminue. »
Lui, qui diminua, en s’eflàçant devant le Messie, qui trépassa pour assurer la prédominance dans le monde du Verbe, le voilà qui vit tandis que celui qui était vivant alors qu’il était décédé, est mort. On dirait qu’il préfigure, en se réincarnant, le triomphe de la Résurrection et qu’après avoir annoncé une première fois, avant que de naître sur la terre, la Nativité de Jésus, il annonce maintenant qu’il est né au ciel, sa Pâques. Il revient pour attester l’accomplissement des prophéties, pour manifester la vérité des Écritures ; il revient pour entériner, en quelque sorte, l’exactitude de ses paroles que consignera plus tard, dans son Évangile, l’autre saint Jean dont il a pris la place, à la gauche du Calvaire, de l’apôtre saint Jean qui ne l’écoute, qui ne le voit même pas, tant il est, près de la Mère, absorbé comme engourdi et paralysé par ce mancenillier de douleur qu’est la croix.
Et, seul, dans les sanglots, dans les spasmes affreux du sacrifice, ce témoin de l’avant et de l’après, cambré sur ses reins, debout, ne pleure ni ne souffre ; il certifie, impassible, et promulgue, décidé ; et l’Agneau du monde qu’il baptisa est à ses pieds, portant une croix, dardant de son poitrail blessé un jet de sang dans un calice.
Telle est l’attitude des personnages ; ils se détachent sur un fond commençant de nuit ; derrière le gibet, planté au bord d’une rive, coule un fleuve de tristesse dont les ondes rapides ont pourtant la couleur des eaux mortes et le côté un peu théâtral du drame se légitime, tant il est d’accord avec ce lieu de détresse, avec ce crépuscule qui n’en est déjà plus et cette nuit qui n’en est pas encore ; et, invinciblement, l’oeil, refoulé par les tons malgré tout sombres du fond, dérive des chairs vitreuses du Christ, dont l’énormité de la taille ne retient plus, pour se fixer sur l’éclatante blancheur du manteau de la Vierge, qui, soutenu par le vermillon des habits de l’apôtre, vous attire, au détriment des autres parties, et fait presque de Marie le personnage principal de l’oeuvre.
Ce serait là le défaut du tableau si l’équilibre prêt à se rompre et à verser sur le groupe de droite ne durait quand même, rétabli par le geste inattendu du Précurseur qui vous arrête à son tour, par la direction même qu’il indique au Fils.
L’on va, si l’on peut dire, en abordant ce Calvaire, de droite à gauche pour arriver au centre.
L’effet est certainement voulu, comme celui qui résulte de la disproportion des personnages, car Grünewald équilibre très bien et garde dans ses autres tableaux la mesure.
Lorsqu’il a exagéré la stature de son Christ il a tenté de frapper l’imagination en suggérant une idée de douleur profonde et de force : il l’a également rendu plus saisissant pour le maintenir quand même au premier plan et l’empêcher d’être complètement rejeté par la grande tache blanche de la Vierge dans la pénombre.
Pour elle, l’on conçoit qu’il l’ait mise en pleine lumière. Sa prédilection se comprend, car jamais il n’était encore parvenu à peindre une Mère aussi divinement jolie, aussi surhumainement souffrante. Et le fait est qu’elle stupéfie dans l’oeuvre rébarbative de cet homme.
C’est qu’elle forme aussi le plus impérieux des contrastes avec les types d’individus que l’artiste a choisis pour représenter Dieu et ses saints.
Jésus est un larron, saint Jean un déclassé, et l’Annonciateur est un reître ; acceptons même qu’ils ne soient que des paysans de la Germanie, mais, Elle, elle est d’une extraction toute différente, elle est une reine entrée dans un cloître, elle est une merveilleuse orchidée poussée dans une flore de terrain vague.
Pour qui a vu les deux tableaux, celui de Carlsruhe et celui de Colmar, l’impression se dégage assez nette. Le Calvaire de Carlsruhe est plus pondéré et plus d’aplomb, le sujet principal ne risque pas de se disperser au profit des alentours. Il est aussi moins trivial et plus terrible. Si l’on compare le rictus désordonné de son Christ et la physionomie plus peuple peut-être, mais moins déchue de son saint Jean au coma du Christ de Colmar, et à la grimace de vieux gamin du disciple, le panneau de Carlsruhe apparaît moins conjectural, plus pénétrant, plus actif et, dans son apparente simplicité, plus fort, mais il n’a pas l’exquise Vierge blanche et il est plus conventionnel, moins inattendu, moins neuf. La Crucifixion de Colmar introduit un élément nouveau dans une scène traitée d’une manière immuable par tous les peintres ; elle s’évade des moules et dédaigne les données ; elle est plus imposante à la réflexion et plus profonde, mais, il faut bien le confesser, l’intrusion du Précurseur dans la tragédie du Golgotha est plus une idée de théologien et de mystique qu’une idée de peintre ; il est très possible qu’il y ait eu là une sorte de collaboration de l’exécutant et de l’acquéreur, une commande précisée dans ses moindres détails par Guido Guersi, l’abbé d’Isenheïm, dans l’église duquel ce Calvaire fut placé.
Il en fut ainsi, du reste, pendant longtemps après le Moyen Age. Tous les renseignements d’archives constatent qu’en faisant marché avec des imagiers et des peintres — qui ne se considéraient d’ailleurs que comme des artisans, — les évêques ou les moines préparaient le plan de l’ouvrage, indiquaient même souvent le nombre des personnages, et spécifiaient leur sens ; l’initiative laissée aux artistes était donc limitée, ils oeuvraient suivant le désir de l’acheteur, dans un cadre tracé.
Pour en revenir au tableau, il occupe à lui seul deux volets de chêne qui coupent en se refermant un bras du Christ et juxtaposent, une fois clos, les deux groupes.
Son envers, car il a deux faces de chaque côté, contient sur chacun de ses panneaux une scène distincte : la Résurrection d’une part et l’Annonciation de l’autre.
Cette dernière, disons-le pour nous en débarrasser tout de suite, est franchement mauvaise.
A genoux dans un oratoire, devant un livre d’heures peint en trompe-l’oeil et détenant sur ses pages ouvertes la prophétie d’Isaïe dont la silhouette bistournée flotte, coiffée d’un turban, en un coin du tableau, sous la voûte, une femme blonde et bouffie, au teint cuit par le feu des fourneaux, minaude, d’un air plutôt mécontent, avec un grand escogriffe au teint également allumé et qui darde vers elle, dans une attitude de reproche vraiment comique, deux très longs doigts. Il sied d’avouer que le geste décisif de l’Annonciateur du Calvaire devient, dans cette imitation malheureuse, ridicule. Les deux doigts ainsi tendus font bêtement la nique et cet être à perruque bouclée, s’il n’avait pas un sceptre au bout d’un bras et des ailes vertes et rouges collées dans le bas du dos, ressemblerait beaucoup plus à un vivandier qu’à un ange, tant sa figure sanguine et replète est grossière, et l’on se demande comment l’artiste qui a créé la petite Vierge blanche a pu incarner la Mère du Sauveur en cette désagréable maritorne aux lèvres gonflées, qui marivaude, endimanchée dans sa toilette d’apparat, une robe d’un vert somptueux relevé par les traits d’une doublure en vermillon vif.
Mais si ce volet effare d’une manière plutôt pénible, l’autre vous transporte, car il est réellement magnifique, et, j’ose l’avancer, dans l’art de la peinture, unique. Grünewald s’y révèle, tel que le peintre le plus audacieux qui ait jamais existé, le premier qui ait tenté d’exprimer, avec la pauvreté des couleurs terrestres, la vision de la divinité mise en suspens sur la croix et revenant, visible à l’oeil nu, au sortir de la tombe. Nous sommes avec lui en plein hallali mystique, devant un art sommé dans ses retranchements, obligé de s’aventurer dans l’au-delà plus loin qu’aucun théologien n’aurait pu, cette fois, lui enjoindre d’aller.
La scène se situe ainsi :
Le sépulcre s’ouvre, des soudards casqués et cuirassés sont culbutés et gisent l’épée à la main, au premier plan ; l’un d’eux, plus loin, derrière le tombeau, pirouette sur lui-même et, la tête en avant, culbute, et le Christ surgit, écartant les deux bras, montrant les virgules ensanglantées des mains.
Un Christ blond, avenant et robuste, aux yeux bruns, n’ayant plus rien de commun avec le Goliath que nous regardions tout à l’heure se dissoudre, retenu par des clous sur le bois encore vert d’un gibet. Et de ce corps qui monte des rayons effluent qui l’entourent et commencent d’effacer ses contours ; déjà le modelé du visage ondoie, les traits s’effument et les cheveux se disséminent, volant dans un halo d’or en fusion ; la lumière se déploie en d’immenses courbes qui passent du jaune intense au pourpre, finissent dans de lentes dégradations par se muer en un bleu dont le ton clair se fond à son tour dans l’azur foncé du soir.
On assiste à la reprise de la divinité s’embrasant avec la vie, à la formation du corps glorieux s’évadant peu à peu de la coque charnelle qui disparaît en cette apothéose de flammes qu’elle expire, dont elle est ellemême le foyer.
Le Christ, transfiguré, s’élève majestueux et souriant, et l’on dirait de cette auréole démesurée qui le cerne et fulgure, éblouissante, dans une nuit pleine d’étoiles, de l’astre reparu des Mages dans l’orbe plus restreint duquel les contemporains de Grünewald posèrent l’enfant Jésus, lorsqu’ils peignirent les épisodes de Bethléem, l’astre du commencement revenant, comme le Précurseur sur le Golgotha, à la fin, l’astre de Noël grandi depuis sa naissance dans le firmament, de même que le corps du Messie, sur la terre, depuis sa nativité.
Et l’artiste qui osa ce tour de force a joué beau jeu. Il a vêtu le Sauveur et tâché de rendre le changement de couleurs des étoffes se volatilisant avec le Christ ; la robe écarlate tourne au jaune vif, à mesure qu’elle se rapproche de la source ardente des lueurs, de la tête et du cou, et la trame s’allège, devient presque diaphane dans ce flux d’or ; le suaire blanc qu’entraîne Jésus fait songer à certains de ces tissus japonais qui se transforment, après d’habiles transitions, d’une couleur en une autre ; il se nuance d’abord, en montant, de lilas, puis gagne le violet franc et se perd enfin, ainsi que le dernier cercle azuré du nimbe, dans le noir indigo de l’ombre.
L’accent de triomphe de cette ascension est admirable. Ces mots « la vie contemplative de la peinture », qui semblent n’avoir aucun sens, en ont cependant, pour une fois, un, car nous pénétrons avec Grünewald dans le domaine de la haute mystique et nous entrevoyons, traduite par les simulacres des couleurs et des lignes, l’effusion de la divinité, presque tangible, à la sortie du corps.
Plus que dans ses horrifiques Calvaires, l’indéniable originalité de cet artiste prodigieux est là.
Ce Crucifiement et cette Résurrection sont évidemment les chefs-d’oeuvre du Musée de Colmar, mais le coloriste inouï qu’est Grünewald n’a pas tout donné dans ces deux tableaux ; nous allons le retrouver, moins surélevé et plus bizarre, dans un autre dyptique à double face, qui se dresse, lui aussi, au milieu de la nef de l’ancienne église.
Il renferme, d’un côté, une Nativité et un concert d’anges ; de l’autre, une visite du Patriarche des cénobites à saint Paul l’Ermite et une tentation de saint Antoine.
A dire vrai, ce concert d’anges et cette Nativité, qui serait plutôt une exaltation de la Maternité divine, ne font qu’un et les ustensiles qui empiètent d’un volet sur l’autre et se coupent en deux lorsque les deux battants se rapprochent, l’attestent.
Le sujet est, avouons-le, obscur. Dans le volet de gauche, la Vierge se détache sur un lointain paysage aux sites bleuâtres, habité sur une hauteur par une abbaye, celle d’Isenheim sans doute ; à sa gauche, près d’une couchette, d’un baquet et d’un pot, pousse un figuier, et, à droite, un rosier. Elle, est une blonde au teint trop coloré, aux grosses lèvres arquées d’une raie, au grand front découvert et au nez droit. Elle est accoutrée, sur une robe carminée, d’un manteau bleu : elle est moins ancillaire, elle ne vient pas d’une bergerie, ainsi que sa soeur de l’Annonciation, mais elle n’est cependant encore qu’une bonne Allemande, nourrie de salaisons et soufflée de bière ; elle est, si l’on veut, une fermière qui commande à des servantes semblables à son effigie de la Visite angélique, mais elle n’en reste pas moins une ferrhière. Quant à l’Enfant, très vivant, très expertement observé, il est un petit paysan de la Souabe, aux reins vigoureux, au nez retroussé, aux yeux pointus, au visage rose et rieur ; enfin, au-dessus de ce groupe de Jésus et de Marie, dans le ciel, en une pluie de rayons safranés, tourbillonnent, tels que des pétales dispersés, au-dessous de Dieu le Père noyé dans les nuées d’un or qui s’orange, des essaims d’anges.
Ces êtres sont purement terrestres ; le peintre paraît s’en être rendu compte, car du chef de l’Enfant émane une lumière qui éclaire les doigts et le visage penché de la Mère. Il a évidemment tenté de suggérer l’idée de la divinité par ces lueurs qui filtrent de l’enveloppe des chairs, mais, cette fois, l’effort, devenu timide n’aboutit point, la projection lumineuse ne sauve ni la vulgarité de la physionomie, ni le rebut des traits.
En tout cas, jusqu’ici, le sujet est clair, mais la scène du volet de droite, qui complète celle-ci, l’est beaucoup moins.
Imaginez, dans une chapelle d’un gothique exaspéré, aux clochetons frottés d’or et hérissés de statues contournées de prophètes nichant dans des feuillages de chicorée, de houblon, de chardon bénit, de houx, sur de grêles colonnettes autour desquelles grimpent des floraisons singulièrement échancrées et des végétations aux tiges révulsées, des anges de toutes les couleurs, les uns ayant revêtu l’apparence humaine, les autres composés seulement de têtes emmanchées dans des auréoles de la forme d’une couronne funéraire ou d’une collerette, des anges à faces roses ou bleues, à ailes monochromes ou diaprées, jouant de l’angélique, du théorbe, de la viole d’amour, tous, comme celui du premier plan dont le visage malsain sourit, modelé dans du saindoux, tournés vers la grande Vierge de l’autre volet qu’ils adulent. L’ensemble est curieux, mais voilà que près de ces purs Esprits, entre deux des légers piliers de cette chapelle, apparaît une autre petite Vierge, couronnée, celle-là, d’un diadème en fer rouge et qui, la figure diluée dans un halo d’or, adore, à genoux, les prunelles baissées et les mains jointes, l’autre Vierge et l’Enfant.
Que signifie cette créature étrange qui évoque l’impression de fantastique suscitée dans la Ronde de nuit de Rembrandt par la fillette à l’escarcelle et au coq, nimbée de feux pàles ? Est-ce une sainte Anne naine ou une autre sainte, cette reine fantôme qui ressemble à s’y méprendre à une madone ? Elle en est certainement une. Évidemment, Grünewald a voulu recommencer le phénomène du bain de lumière qui évapore dans la Résurrection les traits du Christ, mais ici l’intention s’explique mal. A moins qu’il n’ait voulu exprimer l’idée de la Vierge, couronnée après l’Assomption et revenant sur la terre, suivie par la Cour de ses anges, pour rendre hommage à la Maternité qui fut sa gloire, ou que ce soit, au contraire, la Mère encore vivante ici-bas et qui voit d’avance célébrer son triomphe, après son douloureux séjour parmi nous ; mais cette dernière hypothèse est aussitôt détruite par le manque d’attention de Marie, qui ne paraît même pas soupçonner la présence des musiciens ailés auprès d’elle et ne s’occupe que d’égayer l’Enfant. Ce sont là, en somme, des suppositions que rien n’étançonne et il est plus simple de confesser que l’on n’y comprend rien. Si l’on ajoute que ces deux tableaux sont peints avec des couleurs agressives qui vont parfois jusqu’aux tons stridents et acides, l’on concevra qu’un vague malaise vous opprime devant cette féerie jouée dans le bruyant décor d’un gothique fol.
Comme contraste, pour se détendre les nerfs, l’on peut s’attarder devant le panneau représentant l’entretien de saint Antoine et de saint Paul ; celui-là est le seul qui soit pacifique dans cette série, mais l’on est déjà si bien habitué à la fougue des autres qu’on a presque envie de le juger trop inerte, de le trouver trop sage.
Dans une campagne couleur de lapis et de vert de mousse, les deux solitaires sont assis l’un en face de l’autre : saint Antoine étonnamment vêtu pour un homme qui vient de traverser le désert d’un manteau gris perle, d’une robe bleue, et coiffé d’une toque rose ; saint Paul, habillé de sa fameuse robe de palmier, qui n’est plus ici qu’une robe de roseaux ; près de lui est couchée une biche et, en l’air, dans les arbres, vole le corbeau, traditionnel apportant dans son bec le repas des ermites, un pain.
Ce tableau est d’une peinture claire et reposée, d’une tenue superbe. Dans ce sujet qui l’obligeait à se refréner, Grünewald n’a perdu aucune de ses qualités de magnifique peintre. Pour les gens qui préfèrent l’accueil cordial et sans surprise d’un prévenant tableau aux incertitudes d’une visite rendue à un art crispé, ce volet semblera certainement le plus débonnaire, le mieux pondéré, le plus raisonnablement peint ; il est une halte dans la chevauchée furieuse de cet homme, une halte brève, car il repart aussitôt, et dans le volet voisin nous le rencontrons, lâchant bride à sa fantaisie, caracolant dans les casse-cous, sonnant à plein cor ses fanfares de couleurs, excessif comme dans ses autres oeuvres.
La Tentation de saint Antoine, il dut s’y plaire, car les expressions les plus convulsives, les formes les plus extravagantes, les tons les plus véhéments s’accordaient avec ce sabbat de démons livrant bataille au moine.
Et il ne s’est pas fait faute de bondir dans l’au-delà cocasse ; mais si la Tentation est d’un mouvement et d’un coloris extraordinaires, elle est, en revanche, confuse. Elle est si singulièrement enchevêtrée que les membres de ses diables ne se distinguent plus les uns des autres et que l’on serait bien en peine d’assigner à tel animal telle patte, à tel volatile telle aile, qui écorchent ou égratignent le saint.
Le tohu-bohu impétueux de ces personnages n’en est pas moins prenant ; certes, Grünewald ne possède pas l’ingénieuse variété et le désordre très ordonné d’un Breughel ou d’un Jérôme Bosch ; nous sommes loin de cette diversité de larves si nettement délinéées et si prudemment folles de la Chute des anges, au musée de Bruxelles ; lui, est d’une fantaisie plus restreinte et d’une imagination plus courte. Quelques têtes de démons plantées d’andouillers de cerfs ou munies de cornes droites, une mâchoire de requin, un vague mufle de morse ou de veau, et tout le reste des comparses, qui appartient au genre des volatiles, semble avoir été généré par des empuses que couvrirent des coqs en courroux, dont les pattes des produits sont devenues des bras.
Et toute cette volière infernale lâchée s’agite autour de l’anachorète, jeté à la renverse, tiré en arrière par les cheveux, un saint Antoine à grande barbe qui me fait songer à une sorte de P. Hecker, né en Hollande ; et il crie, bouche béante, s’abrite d’un bras le visage, serrant de l’autre son bâton et son rosaire, que becquête une poule furieuse dont les plumes sont une carapace de crustacé, et toutes ces bêtes se précipitent ; une espèce de perroquet gigantesque, à chef vert, à bras cramoisis, à griffes jaunes, à plumage gris et fumé d’or, brandit une matraque pour assommer le moine, tandis qu’un autre démon arrache son manteau gris perle et le mâche et que d’autres viennent à la rescousse balançant des côtes de squelettes, s’acharnant à lacérer ses vêtements pour le mieux frapper.
Le saint Antoine est, en tant qu’homme, admirable de geste, de vocifération, de vie, et quand l’on a savouré l’amusant et le vertigineux ensemble, deux petits détails omis d’abord, situés au premier plan, comme cachés à chaque bout du cadre, vous arrêtent, car ils laissent à penser. L’un, à droite, est une feuille de papier sur laquelle sont tracées quelques lignes, l’autre est un être bizarre, assis, encapuchonné et presque nu, qui se tord de douleur près du saint.
Ce papier contient cette phrase : Ubi eras bone Jhesu, ubi eras, quare non affuisti ut sanares vulnera mea ? ce qui peut se traduire : « Lorque vous étiez là, mon bon Jésus, lorsque vous étiez là, pourquoi n’êtes-vous pas venu panser mes plaies ? »
Cette plainte, qui est sans doute criée par l’ermite dans sa détresse, est exaucée, car si l’on regarde tout en haut du tableau l’on aperçoit une légion d’anges qui descendent pour délivrer la victime et culbuter les démons.
Et l’on peut se demander si cet appel désespéré n’est pas aussi poussé par ce monstre qui gît à l’autre extrémité du cadre et lève sa tête dolente au ciel. Est-ce une larve, est-ce un homme ? En tout cas, jamais peintre n’a osé, dans le rendu de la putréfaction, aller aussi loin. Il n’existe pas dans les livres de médecine de planches sur les maladies de la peau plus infâmes. Imaginez un corps boursouflé, modelé dans du savon de Marseille blanc et gras marbré de bleu, et sur lequel mamelonnent des furoncles et percent des clous. C’est l’hosanna de la gangrène, le chant triomphal des caries !
Grünewald a-t-il voulu représenter dans ce qu’il a de plus abject le simulacre d’un démon ? Je ne le pense pas. A considérer avec soin le personnage, l’on s’aperçoit qu’il est un être humain qui se décompose et qui souffre.
Et si l’on se rappelle que ce tableau vient, ainsi que les autres, de l’abbaye des Antonites d’Isenheim, tout s’élucide. Quelques explications sur le but de cet Ordre suffiront, je crois, pour déchiffrer l’énigme.
L’Ordre des Antonites ou des Antonins fut fondé, en 1093 dans le Dauphiné par un seigneur nommé Gaston, dont le fils, atteint du mal des ardents, fut guéri par l’intercession de saint Antoine. Il eut pour raison d’être de soigner les malades férus de ce genre d’affection. Placé sous la règle de saint Augustin, il s’étendit rapidement dans la France et dans l’Allemagne et il devint si populaire dans ce dernier pays qu’à l’époque même où vivait Grünewald, en 1502, l’empereur Maximilien ler lui donna comme témoignage d’estime le droit de porter dans son blason les armes de l’Empire, en y adjoignant le Tau bleu que, sur leur costume noir, ses moines devaient, eux aussi, porter.
Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, un couvent d’Antonites gîtait en ce temps-là — il était déjà vieux d’un siècle — à Isenheim et le mal des ardents n’avait pas disparu. Ce couvent était donc un hospice, et nous savons, d’autre part, que ce fut son abbé ou, pour parler le langage technique usité dans cet institut, son précepteur, Guido Guersi, qui commanda ce polyptique à Grünewald.
L’on s’explique aisément dès lors la place que saint Antoine, le patron de l’Ordre, occupe dans cette série ; l’on comprend aussi le réalisme terrible de Grünewald et les chairs méticuleuses de ses Christs évidemment copiées sur les cadavres de la chambre des morts de l’hospice ; et la preuve est que le Dr Richet, examinant au point de vue médical ses Crucifiés, note que « le soin du détail est poussé jusqu’à l’indication de l’auréole inflammatoire qui se développe autour des petites plaies » ; l’on comprend surtout l’image peinte d’après nature dans la salle des malades, de cet être dolent et affreux de la Tentation, qui n’est ni une larve, ni un démon, mais bien un malheureux atteint du mal des ardents.
Les descriptions écrites qui nous restent de ce fléau sont d’ailleurs, de tous points, conformes à la description du peintre, et les médecins qui ignorent l’aspect de cette affection heureusement périmée pourront aller étudier le travail des tissus attaqués et des plaies dans le tableau de Colmar(2).
Le mal des ardents, appelé aussi feu sacré, feu d’enfer, feu de saint Antoine, apparut dans l’Europe qu’il ravagea, au xe siècle. Il tenait de l’ergotisme gangréneux et de la peste ; il se manifestait par des apostèmes et des abcès, attaquant peu à peu tous les membres, et, après les avoir consumés, il les détachait, petit à petit, du tronc. Tel il nous est détaillé, au XVe siècle, par les biographes de sainte Lydwine qui en fut atteinte. Dom Félibien, de son côté, dans son Histoire de Paris, en parle et dit, à propos de l’épidémie qui bouleversa la France au XIIe siècle :
La masse du sang était toute corrompue par une chaleur interne qui dévorait les corps entiers, poussait au dehors des tumeurs qui dégénéraient en ulcères incurables et faisaient périr des milliers d’hommes.
Ce qui est, en tout cas, certain, c’est qu’aucun remède ne parvenait à enrayer le fléau et qu’il ne fut souvent conjuré que par l’aide de la Vierge et des saints.
La Vierge possède encore en Picardie le sanctuaire de Notre-Dame des Ardents, et la dévotion à la sainte chandelle d’Arras est réputée.
Quant aux saints, outre saint Antoine, l’on invoqua saint Martin qui avait sauvé de la mort une troupe de ces malades, réunis dans une église érigée à Paris sous son vocable ; puis l’on eut recours à saint Israël, chanoine du Dorat ; à saint Gilbert, évêque de Meaux ; enfin à sainte Geneviève ; et, en effet, sous le règne de Louis le Gros, elle guérit, pendant que l’on promenait processionnellement sa châsse, une masse de ces pestiférés qui s’étaient réfugiés dans la cathédrale de Paris, et ce miracle fit un tel bruit que, pour en perpétuer le souvenir, l’on bâtit dans cette ville une église sous le nom de Sainte-Geneviève des Ardents ; elle n’existe plus, mais le bréviaire parisien célèbre encore sous ce titre la fête de la sainte.
Pour en revenir à Grünewald, qui, je le répète, a évidemment laissé un véridique portrait de ce genre de gangréneux, il reste encore à signaler, dans la galerie de Colmar, la prédelle d’une mise au tombeau, avec un Christ livide et tiqueté de tirets de sang, un saint Jean au profil dur, aux cheveux d’un jaune d’ocre délavé, une Vierge voilée jusqu’aux yeux et une Madeleine défigurée par les larmes, mais cette prédelle n’est qu’une réplique affaiblie de ses grandes Crucifixions. Elle stupéfierait, seule dans une collection de toiles d’autres peintres, mais ici elle n’étonne même plus.
Il sied de noter encore deux volets oblongs encadrant l’un, un saint Sébastien, petit et bancroche, lardé de flèches ; l’autre — celui cité par Sandrart, — un saint Antoine tenant à la main le Tau, la crosse de son Ordre, un saint Antoine majestueux et absorbé, ne se préoccupant même pas d’un démon qui, derrière lui, brise des vitres ; et la revue des ouvrages de ce maître est close.
D’autres très intéressants retables de Primitifs et de merveilleux bois, tels qu’une statue de Vierge debout et une de saint Antoine, en tilleul polychromé, assis, s’entassent dans la nef. Parmi les panneaux, d’aucuns sont propices aux pieuses rêveries, celui surtout de l’Annonciation, de Martin Schôngauer, dont les longues et avenantes figures s’enlèvent doucement, d’un tapis de fraisiers, sur un fond d’or. Cependant le chef-d’oeuvre de Schôngauer, la Madone aux roses, n’est pas dans ce musée, mais dans la sacristie de l’église de SaintMartin. Et, d’ailleurs, si elle était dans cette nef, elle subirait le sort des autres tableaux. Près de Grünewald, tous s’écroulent.
Avec ses buccins de couleurs et ses cris tragiques, avec ses violences d’apothéoses et ses frénésies de charniers, il vous accapare et il vous subjugue ; en comparaison de ces clameurs et de ces outrances, tout le reste paraît et aphone et fade.
On le quitte à jamais halluciné. Vainement l’on cherche ses origines, aucun des peintres qui le précédèrent ou qui furent ses contemporains ne lui ressemble. Il n’a aucun rapport avec Cranach, Striger, Burgmaier, Schöngauer et Zeitblom. Il ne s’apparente nullement à Albert Dürer et à ses élèves Huns de Culmbach, Schaüfelein, les Beham. et Altdorfer de Ratisbonne. Il est plus loin encore des premiers Primitifs de l’Allemagne, des enlumineurs, poussés en graine, de l’école de Cologne. Eux, furent des saccharifères, des fabricants de bonbons pieux. Il faut voir dans la cathédrale de Cologne le fameux Dombild, de Stéphan Lochner, et surtout, au musée, la petite soubrette, étiquetée sous le nom de Vierge de maître Wilhelm, pour se figurer jusqu’à quel point ces peinturiers s’éprirent de la rondouille et de la lèche.
Le seul qui soit, sinon moins maniéré, au moins plus ingénu, plus vraiment mystique, c’est le maître de Saint-Séverin, qui a peint une Vie de sainte Ursule, dont deux spécimens sont au Louvre ; ceux-là ne sont pas très attirants, mais, à Cologne, cet inconnu a des panneaux plus curieusement anémiques, plus étrangement pâles, celui, par exemple, où un ange annonce à la sainte son martyre.
Or, ce maître de Saint-Séverin est aux antipodes du peintre de Carlsruhe et de Colmar. Le seul des artistes contemporains qui se rapprocherait le plus de Grünewald, qu’il imite parfois, serait encore, si l’on s’en tient à la couleur bizarre de son tableau de Berlin, un Hercule rouge broyant un Antée de plâtre, Hans Baldung-Grien, mais combien celui-ci, malgré sa belle Crucifixion du maître-autel de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, lui est inférieur ! Il apparaît, du reste, en ce sujet similaire, tel qu’un classique. Il n’a ni les ardeurs délirantes de Grünewald, ni l’âpreté de son naturalisme mystique, ni sa grandeur.
L’on peut cependant relever une certaine influence étrangère dans l’oeuvre de Grünewald ; ainsi que l’a fait observer M. Goutzwiller, dans sa brochure sur le Musée de Colmar, une réminiscence ou une vague imitation de la façon de peindre les paysages des Italiens, de son temps, pourrait peut-être se remarquer dans la manière dont il architecture ses sites et poudre de bleu ses ciels. Aurait-il voyagé dans la péninsule ou aurait-il vu des tableaux de maîtres italiens, en Allemagne à Isenheim même, dont le précepteur Guido Guersi était, si l’on en juge par la désinence de son nom, originaire des. contrées d’outre-monts ? Nul ne le sait, mais cette influence même peut se discuter. Il n’est pas certain, en effet, que cet homme qui devance la peinture moderne et fait songer parfois, par ses tons acides, à l’impressionniste Renoir et par sa science des dégradations, aux Japonais, n’a pas inventé de toutes pièces, sans l’aide de souvenirs ou de copies, l’attitude de ces paysages, pris sur nature dans les campagnes de la Thuringe ou de la Souabe ; car il a fort bien pu voir dans ces régions l’allégresse des lointains bleuâtres de sa Nativité. Je ne crois pas non plus, comme l’affirme M. Goutzwiller, que la preuve « d’une touche italienne » résulte de ce fait qu’il a peint une touffe de palmiers dans le tableau des deux anachorètes. L’idée d’introduire ce genre d’arbres dans un paysage de l’Orient n’implique aucune suggestion, aucune assistance, tant elle est naturelle et amenée par les besoins mêmes du sujet. Il serait très étonnant, en tous cas, s’il connaissait des oeuvres étrangères, qu’il se fût borné à leur emprunter leur mode de disposer et d’exécuter des firmaments et des bois, alors qu’il négligeait de s’approprier leur système de composition et leur manière de peindre Jésus et la Vierge, les anges et les saints.
Il faut le répéter encore, ses sites sont bien allemands, certains détails même le prouvent. Ils peuvent sembler à beaucoup inventés pour frapper l’imagination, pour ajouter un élément de pathétique au drame du Calvaire, et ils ne sont que strictement exacts. Ainsi est-il de ce sol de sang dans lequel est plantée la croix de Carlsruhe, cette terre n’est nullement feinte. Grünewald ceuvrait dans les contrées de la Thuringe, dont la terre, saturée d’oxyde de fer, est rouge ; je l’ai vue, détrempée par la pluie, pareille à des boues d’abattoir, à des mares de sang.
Quant à ses personnages, ils ont tous le type germain et il ne dérive pas davantage de l’art italien pour sa façon de déployer les étoffes ; celles-là ont été vraiment tissées par lui et elles lui sont si personnelles qu’elles suffiraient à faire reconnaître ses tableaux parmi ceux de tous les autres peintres ; nous sommes loin, avec lui, des petits bouillons, des coudes durs et saccadés, des tuyaux rompus des Primitifs ; il drape magnifiquement en de larges mouvements et de grands plis ; il se sert d’étoffes aux trames serrées, imbibées de profondes teintures. Dans la Crucifixion de Carlsruhe, elles ont un je ne sais quoi qui fait penser à des écorces arrachées d’arbres ; elles aussi, sont farouches ; à Colmar, elles affectent moins cet aspect si particulier, mais elles ont encore gardé cette profusion d’emmitouflement, cette forme un peu résistante, ces nervures et ces creux qui sont l’étampe de son oeuvre ; on les discerne ainsi ordonnées dans le linge qui ceint les reins du Christ et dans le manteau de saint JeanBaptiste, sur le Calvaire.
Ici encore il n’est donc le disciple de personne, et force est bien de le classer dans l’histoire de la peinture ���������������������������������������������������������������tel qu’un être exceptionnel, tel qu’un barbare de génie qui vocifère des oraisons colorées dans un dialecte original, dans une langue à part.
Son âme tumultueuse va d’un excès à un autre ; on la sent agitée par les bourrasques, même dans ses volontaires répits et ses sommes ; mais autant elle est poignante lorsqu’elle médite sur les épisodes de la Passion, autant elle est inégale et presque baroque lorsqu’elle réfléchit sur les joies de la Nativité ; on peut l’avérer, elle se contourne et balbutie lorsqu’elle ne supplicie pas ; il n’est nullement le peintre des crèches mais bien le peintre des tombes ; il ne sait rendre la Vierge que lorsqu’îl la fait souffrir. Autrement, il ne la conçoit que rubiconde et vulgaire, et la différence entre ses Madones des mystères douloureux et ses Madones des mystères joyeux est telle qu’il sied de se demander s’il n’obéissait pas à un parti pris d’esthétique, à un système d’antithèses voulues.
Il est très possible, en effet, qu’il ait décidé que la vision de la Maternité divine ne se dégagerait clairement que sous l’épreinte des tortures, au pied de la croix ; cette théorie coïnciderait, en tout cas, avec celle qu’il a résolument adoptée pour exalter la déité du Fils.
Il l’a effectivement peint, de son vivant, ainsi que l’annoncèrent le Psalmiste et Isaïe, sous l’aspect du plus misérable des hommes, et il ne lui a restitué sa physionomie divine qu’après l’agonie et après la mort. Il a fait de la laideur du Messie crucifié le symbole de tous les péchés de l’univers qu’il assuma. Cette doctrine, qui fut prônée par Tertullien, par saint Cyprien, par saint Cyrille, par saint Justin, par combien d’autres, eut cours pendant bien des années au Moyen Age.
Il fut peut-être aussi la victime du procédé qu’il employait et dont Rembrandt devait se servir plus tard, susciter l’idée de la divinité par la lumière émanant de la figure même chargée de la représenter. Admirable dans sa Résurrection du Christ, cette sécrétion des lueurs devient moins persuasive lorsqu’il l’applique à la petite Vierge du Concert des anges et tout à fait inerte lorsqu’il l’emploie pour composer la vulgarité foncière de l’Enfant dans la Nativité.
Il a sans doute trop compté sur des effets, en leur attribuant une plénitude de puissance qu’ils ne pouvaient avoir. Il convient, en effet, de remarquer, que si le flux de lumière qui tournoie, comme un soleil d’artifice, autour du Christ ressuscité nous suggère la vision d’un monde divin, c’est parce que le visage de Jésus y prête par sa mansuétude et sa beauté. Il aide au lieu de contrarier, le sens et l’action de cette grande auréole qui adoucit et ennoblit les traits, en les vaporisant dans une buée d’or.
Tel est, dans son ensemble, le polyptique de Grünewald au Musée de Colmar. Je ne m’occuperai pas ici de ses autres ouvrages épars dans des sanctuaires et des galeries et qui ne lui appartiennent pas, pour la plupart. Les panneaux catalogués sous son nom dans l’église de Sainte-Marie de Lübeck ne sont pas de lui et les deux tableautins que je vis à Bâle sont ou des essais de jeunesse ou des copies ; je laisserai également de côté le Saint Maurice et le Saint Érasme de Munich, froids et bien peu dans la note du maître, si l’on veut absolument admettre qu’il en est l’auteur ; je négligerai même la Chute de Jésus, transférée, elle aussi, de Cassel à Carlsruhe et qui est bien authentique, celle-là. Elle se compose d’un Christ, affublé de bleu, à genoux et traînant sa croix. Il grince des dents, enfonce ses ongles dans le bois, au milieu de reîtres habillés de rouge et de bourreaux barrés de raies de vert pistache sur leurs vêtements blancs. Ce Christ éclate moins de douleur que de rage, il a l’air d’un damné. C’est un mauvais Grünewald et, ne retenant que la fleur éclatante et terrible de son art, le Crucifiement de Carlsruhe et les neuf pièces de Colmar, je me dis que l’on ne peut définir que par des accouplements de mots contradictoires l’oeuvre de cet homme.
Il est, en effet, tout en antinomies, tout en contrastes ; ce Roland furieux de la peinture bondit sans cesse d’une outrance dans une autre, mais l’énergumène est, quand il le faut, un peintre fort habile et connaissant à fond les ruses du métier. S’il raffole du fracas éblouissant des tons, il possède aussi, dans ses bons jours, le sens très affiné des nuances — sa Résurrection l’atteste — et il sait unir les couleurs les plus hostiles, en les sollicitant, en les rapprochant peu à peu par d’adroites diplomaties de teintes.
Il est à la fois naturaliste et mystique, sauvage et civilisé, franc et retors. Il personnifie assez bien l’âme ergoteuse et farouche de l’Allemagne, agitée à cette époque par les idées de la Réforme. Fut-il, de même que Cranach et que Dürer, mêlé à ce mouvement d’émotion religieuse qui devait aboutir à la plus implacable des sécheresses, après que les g laces du marais protestant furent prises ? Je l’ignore. Il a, en tout cas, cette âpre ferveur et cette familiarité de la foi qui caractérisèrent l’illusoire renouveau du début du XVIe siècle. Mais il personnifie encore plus pour moi la piété des malades et des pauvres. Ce Christ affreux qui se mourait sur l’autel de l’hospice d’Isenheim semble fait à l’image des affligés du mal des ardents qui le priaient ; ils se consolaient en songeant que ce Dieu qu’ils imploraient avait éprouvé leurs tortures et qu’il s’était incarné dans une forme aussi repoussante que la leur, et ils se sentaient moins déshérités et moins vils. L’on conçoit aisément que le nom de Grünewald ne se rencontre pas, comme ceux d’Holbein, de Cranach, de Dürer, sur les listes des commandes et les comptes des empereurs et des Princes. Son Christ des pestiférés eût choqué le goût des Cours ; il ne pouvait être compris que par les infirmes, les désespérés et les moines, par les membres souffrants du Christ.
Ces réflexions vous assaillent, alors que l’on s’échappe du musée pour aller faire un tour le long du petit cloître des Unterlinden. Sous les arcades gothiques, découpées dans le granit rouge, l’on a entassé des débris de statues, des pierres tombales, de vieilles ferronneries, d’antiques enseignes, et, par les fenêtres des salles ouvrant sur la galerie, l’on aperçoit les rangées de livres de la bibliothèque, des bouquins aux veaux fauves gravés d’ors éteints, ou bien le bric-à-brac d’un minuscule Cluny, avec d’anciennes bombardes et des boulets de pierre, des faïences, des dinanderies et des bois.
Au milieu du préau formé par le quadrilatère des bâtiments à un étage, coiffés de grands toits en tuile qui surplombent les corridors du petit cloître, s’érige une fontaine au-dessus de laquelle se perche assez tristement une statue rouge de Martin Schôngauer ; c’est de l’art officiel, de l’émétique pour la vue, du Bartholdi.
Et le jet d’eau crépite dans la vasque, on l’entend, tamisé par les parois des murs, dans la salle du musée ; l’on dirait d’un bruit de larmes accompagnant en sourdine les lamentations de la Vierge si pâle, soutenue par le saint Jean.
A vaguer dans ces allées solitaires, de suggestives pensées et de pieux rapprochements vous viennent. Ce couvent des Unterlinden fut au XIIIe et au XIVe siècle la demeure la plus extraordinaire qu’ait jamais habitée le Christ ; toutes les nonnes étaient des saintes, et jésus vivait dans ce monastère, descendait à sa guise dans chaque chambrée d’âme ; les phénomènes de la haute mystique, les visions, les ravissements, les extases, les maladies supernaturelles, les unions divines, les miracles y étaient à l’état continu, les réservoirs de prières et de pénitence ne tarissaient pas.
Ce monastère avait été fondé en 1232, hors Colmar, dans un lieu appelé « Uf Mühlen », « sur les moulins », par deux veuves, Agnès de Mittelheim et Agnès de Herkenheim, dont la statue se voit encore à l’un des bouts du musée. Ce couvent de Dominicaines, dont l’église, terminée en 1278, avait été consacrée en l’honneur de saint Jean-Baptiste, fut, à cause des perpétuelles batailles qui décimaient l’Alsace et amenaient des bandes de pillards jusque sous les murs de la ville, transféré dans la cité même là où il gîte actuellement. Il subsista jusqu’en 1793 et fut alors converti en une caserne de cavalerie, puis en un magasin de fourrages, en une resserre de vieux matériaux ; enfin, en 1849, il fut nettoyé et restauré et il devint un musée.
Quant aux moniales, elles étaient encore trente-six lorsque la Révolution les balaya. Les deux dernières, presque centenaires, sont mortes, l’une en 1855, à Ligdorff ; l’autre, je n’ai pu savoir à quelle date, à Colmar.
Plus heureuses que tant de basiliques désaffectées et contaminées par de malpropres industries, l’église des Unterlinden a conservé son caractère religieux ; elle garde, malgré d’inhabiles réparations, le charme de son abside et de son vaisseau gothique, aux clés d’arc sculptées de feuillages dorés et d’anges. Les Domini. caines pourraient y psalmodier encore les heures canoniales et prier devant l’effigie du patron de leur sanctuaire, saint Jean le Précurseur ; les Antonites s’y sentiraient également chez eux, en retrouvant leur magnifique maître-autel et cette série des panneaux de Grünewald qui furent transportés après la tourmente, de leur préceptorerie d’Isenheim, dans ce couvent de Colmar. Le cloître est, lui aussi, sauf ; seules les rangées de tilleuls qui le baptisèrent de leur nom « Unterlinden » « Sous les tilleuls » ne sont plus.
A défaut des oraisons liturgiques et des suppliques humaines, d’ardentes exorations de couleurs s’élèvent sous les voùtes silencieuses de la nef. Les fêtes de l’Annonciation, de la Nativité, de la Semaine-Sainte, de la Pâque, s’y célèbrent, sans dates de jours, ensemble, au dessus des siècles et au delà des temps. Le Laus perennis du Moyen Age revit en cet office incessant de la peinture que composa Grünewald. Le Vendredi-Saint y sanglote toute la semaine, et, pour consoler son Fils du départ de ses filles, la Vierge s’est revêtue d’une blanche livrée qui rappelle le costume et la coiffe des Dominicaines, et elle perpétue ainsi pour les âges à venir le souvenir de leurs amoureuses larmes. Jésus est encore chez lui dans ce musée, mais un sacrilège énorme souille la lisière de ce lieu demeuré pur.
Attenant à l’ancienne église, parade un théâtre bâti sur les ruines du vieux couvent, aux abords du cimetière des recluses. Et des pitres et des baladines s’agitent, en proférant le verbe impie des pièces près des ossements des saintes.
Notes
1. Une magnifique reproduction photographique, du format grand in-folio, de ces tableaux de Colmar existe dans un volume que publie M. W. Heinrich, éditeur, Broglieplatz, à Strasbourg. L’oeuvre entière du peintre est reproduite dans ce livre et commentée par une étude de M. Schmid, professeur à l’Université de Bâle.
2. Deux médecins se sont occupés de cette figure, M. Charcot et M. Richet. L’un, Les Syphilitiques dans l’art, voit surtout en elle l’image du mal dit « mal de Naples » ; l’autre, dans L’Art et la Médecine, hésite à se prononcer entre une affection de ce genre et la lèpre.