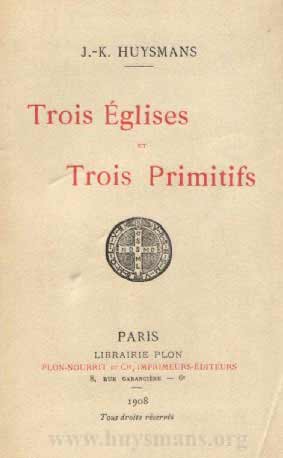LA SYMBOLIQUE DE NOTRE-DAME DE PARIS
C’EST à Victor Hugo, à Montalembert, à Viollet-le-Duc, à Didron, que nous devons le réveil de louanges dont se pare maintenant l’art gothique, si méprisé par le XVIIe et le XVIIIe siècles, en France. A leur suite, les chartistes s’en sont mêlés et ont parfois exhumé des layettes d’archives, des actes de naissance portant le nom des « maitres de la pierre vivel » qui bâtirent les cathédrales ; les recherches continuent dans les cimetières à paperasses des provinces ; quel est, à l’heure actuelle, le résultat de ce mouvement que détermina le Romantisme ?
Celui-ci : tous les architectes, tous les archéologues, depuis Viollet-le-Duc jusqu’à Quicherat, n’ont vu dans la basilique ogivale qu’un corps de pierre dont ils ont expliqué contradictoirement les origines et décrit plus ou moins ingénieusement les organes. Ils ont surtout noté le travail apparent des âges, les changements apportés d’un siècle à un autre ; ils ont été à la fois physiologistes et historiens, mais ils ont abouti à ce que l’on pourrait nommer le matérialisme des monuments. Ils n’ont vu que la coque et l’écorce ; ils se sont obnubilés devant le corps et ils ont oublié l’âme.
Et pourtant l’âme des cathédrales existe ; l’étude de la symbolique le prouve.
La symbolique, qui est la science d’employer une figure ou une image comme signe d’une autre chose, a été la grande idée du moyen âge, et, sans elle, rien de ces époques lointaines ne s’explique. Sachant très bien qu’ici-bas tout est figure, que les êtres et que les objets visibles sont, suivant l’expression de Saint Denys l’Aréopagite, les images lumineuses des invisibles, l’art du moyen âge s’assigna le but d’exprimer des sentiments et des pensées avec les formes matérielles, variées, de la vitre et de la pierre et il créa un alphabet à son usage. Une statue, une peinture, purent être un mot et des groupes, des alinéas et des phrases ; la difficulté est de les lire, mais le grimoire se déchiffre. Des livres tels que le « Miroir du Monde » de Vincent de Beauvais, le « Spéculum Ecclesiae » d’Honorius d’Autun, si bien mis en valeur par M. Male, le Spicilège de Solesmes, les apocryphes, la Légende dorée, nous donnent la clef des énigmes.
L’on comprendra cette importance attribuée à la symbolique, par le clergé, par les moines, par les imagiers, par le peuple même au XIIIe siècle, si l’on tient compte de ce fait que la symbolique provient d’une source divine, qu’elle est la langue parlée par Dieu même.
Elle a, en effet, jailli comme un arbre touffu du sol même de la Bible. Le tronc est la Symbolique des Écritures, les branches sont les allégories de l’architecture, des couleurs, des pierreries, de la flore et de la faune, les hiéroglyphes des Nombres.
Si ces diverses branches peuvent donner lieu à des interprétations plus ou moins sûres, il n’en est pas de même de la partie essentielle de la symbolique des Écritures, qui, elle, est claire et tenue pour exacte par tous les temps. Qui ne sait, en effet, nous déclare Saint Grégoire le Grand, que « l’Ancien Testament est la prophétie du Nouveau et le Nouveau la manifestation de l’Ancien », que, par conséquent, la religion Mosaïque contient en emblèmes ce que la religion catholique nous divulgue en réalité ? L’histoire sainte est une somme d’images ; tout arrivait aux Hébreux en figures, affirme saint Paul ; le Christ l’a rappelé maintes fois à ses disciples et lui-même s’est presque toujours servi, lorsqu’il haranguait les foules, de paraboles ou, si l’on aime mieux, de récits allégoriques qui lui permettaient, en montrant une chose, d’en dévoiler une autre.
Il n’est donc point surprenant que le moyen âge ait suivi la tradition que lui avaient, après les enseignements du Messie, transmise les Pères de l’Église et appliqué à la maison du Seigneur leurs procédés.
Cela dit, nous devons ajouter qu’en sus de cette précaution d’enclore, dans une cathédrale, les vérités du dogme, sous les apparences des contours et les espèces des signes, le moyen âge a voulu traduire, en des lignes sculptées ou peintes, les Légendaires et les évangiles apocryphes, être aussi en même temps qu’un cours d’hagiographie et de pieux fabliaux, un sermonaire narrant au peuple le combat des vertus et des vices, lui prêchant la sobriété, le travail, la nécessité évoquée par la parabole des vierges sages et des vierges folles, d’être toujours prêt à paraître devant Dieu, le menant, peu à peu, tout en l’exhortant le long de la route, jusqu’au jour de la mort qu’il lui découvrait brutalement, dès l’entrée même de la basilique, dans les tableaux du Jugement dernier et du pèsement des âmes.
La cathédrale était donc un ensemble, une synthèse ; elle embrassait tout ; elle était une bible, un catéchisme, une classe de morale, un cours d’histoire et elle remplaçait le texte par l’image pour les ignorants.
Nous voici loin, avec ces données, de l’archéologie de cette pauvre science de l’anatomie des édifices !
Voyons maintenant, en usant de la doctrine des symboles, ce qu’est Notre-Dame de Paris, quel est le sens de ses divers organes, quelles paroles elle profère, quelles idées elle décèle.
Ses conceptions et son langage ne diffèrent pas de ceux de ses grandes soeurs de Chartres, d’Amiens, de Strasbourg, de Bourges, de Reims. Tout au plus cachet-elle une arrière-pensée qui sent un tantinet le fagot et que j’expliquerai plus loin ; — nous pouvons donc, pour elle comme pour les autres, l’étudier, en lui appliquant les théories générales du symbolisme.
Occupons-nous d’abord de l’intérieur. Durand, évêque de Mende, qui vécut au XIIIe siècle, c’est-à-dire à l’époque même où fut construite Notre-Dame, nous enseigne que ses tours représentent les prédicateurs, et cette assertion se confirme par la signification assignée aux cloches qui rappellent aux chrétiens, avec leurs prédications aériennes, les vertus qu’il leur faut pratiquer, s’ils veulent parvenir aux sommets des tours, images de la perfection que cherchent à atteindre, en s’élevant, les âmes. Suivant une autre exégèse formulée, dans le Spicilège de Solesmes, par Pierre de Mora, Évêque de Capoue, les tours représenteraient surtout la Vierge Marie et l’Église, veillant sur le salut de la ville qui s’étend sous elles.
Le toit est l’emblème de la charité ; les tuiles destinées à abriter le temple des pluies, sont les soldats qui protègent l’Église contre les entreprises des païens ; les pierres des murailles, soudées entre elles, certifient, d’après Saint Nil, l’union des âmes, et suivant Hugues de Saint-Victor, le mélange des laïques et des clercs qui constituent la société chrétienne, qui sont, dit-il, les deux flancs d’un même corps.
Et ces pierres, liées par le ciment qu’Yves de Chartres assimile à la charité, forment les quatre grands murs de la basilique, les quatre Évangélistes, selon le « Tractatus super oedificium » de Prudence de Troyes, et selon la traduction d’autres écrivains, les quatre vertus principales : la Justice, la Force, la Prudence, la Tempérance.
Les fenêtres sont les emblèmes de nos sens qui doivent être fermés aux vanités de ce monde et ouverts aux dons du ciel ; elles sont garnies de vitres, laissant passer les rayons du soleil, du Soleil de Justice qui est Dieu ; elles sont encore, d’après la théorie d’Hugues de Saint-Victor, les Écritures qui éclairent, mais repoussent le vent, la neige, la pluie, similitudes des hérésies que le Père de la division et du mensonge forme.
Notre-Dame a trois portails, en l’honneur de la Trinité sainte ; et celui du milieu, dénommé portail royal, est divisé par un pilier sur lequel repose une statue du Christ qui a dit de lui-même dans l’Évangile de saint Jean : « Ego sum ostium ». Tranchée de cette façon, la porte signifie les deux voies que l’homme est libre de suivre.
Et cette allégorie est complétée par l’image du Jugement dernier qui se déroule sur le tympan du porche, avisant le pécheur du sort qui l’attend, suivant qu’il s’engagera dans l’une ou l’autre de ces deux routes.
Pour résumer en quelques lignes ces données, nous pouvons dire que l’âme chrétienne, partie du sol, du bas des tours, avec la foi dans les vérités primordiales de la religion, stipulées par les groupes des trois porches : la Trinité, que le nombre même de ces entrées avère, la croyance en la Divinité du Fils et la Maternité divine de la Vierge, racontée par les statues et les figures, s’élève peu à peu, en pratiquant les vertus désignées par les grands murs, jusqu’au toit, symbole de la Charité qui couvre une multitude de péchés, qui est la vertu par excellence, selon saint Paul.
Il ne lui reste plus dès lors, pour atteindre le Seigneur et se fondre en Lui, qu’à gravir les tours dont les sommets représentent les cimes de la vie parfaite.
Et cet abrégé de la théologie mystique que la façade de Notre-Dame nous enseigne, nous le retrouvons, condensé en d’autres termes, exprimé par d’autres mots, dans son intérieur, par l’ensemble de la nef, du transept et du choeur, ces trois degrés de l’ascèse, la vie purgative, énoncée par les ténèbres de l’entrée, loin de l’autel ; la vie contemplative qui s’éclaire en avançant vers le choeur ; la vie unitive qui ne se réalise que dans la partie attribuée à Dieu, là où convergent les feux allumés par le soleil de Justice, dans les vitraux des roses.
La forme intérieure de Notre-Dame est, de même que celle de la plupart des grandes basiliques, cruciale.
Et ainsi que nous l’apprend dans son « De Divinis officiis » le bénédictin Rupert, abbé, au XIIe siècle, du monastère de Deutz, si les dimensions de la croix sont en profondeur, en longueur, en largeur et en hauteur, il en est de même de l’église qui reproduit son image — et la profondeur notifie la foi — la longueur, la persévérance — la largeur, la charité — la hauteur, l’espoir de la récompense future.
Si nous passons maintenant aux détails de l’ensemble, nous trouvons que la voûte est, d’après l’exégèse de l’anonyme du « Psalterium glossatum » du XIe siècle, l’image de la vie céleste, que les piliers sont les apôtres, qu’au dire de Durand de Mende, les colonnes que, de son côté, Petrus Cantor assimile, à cause de leur force, au Christ, sont les Évêques et les Docteurs qui soutiennent l’église par leur doctrine ; que le pavé stipule l’humilité et qu’il figure aussi, parce qu’il est foulé aux pieds, les labeurs mis au service de la Foi, des fidèles ; que le jubé, supprimé presque partout et remplacé par le coquetier, plus ou moins élégant de la chaire à prêcher, est l’emblême de la montagne du haut de laquelle parlait le Fils.
Le choeur et le sanctuaire symbolisent le Ciel, tandis que la nef simule la terre et comme l’on ne peut s’élever de la terre jusqu’au ciel que par les souffrances rédemptrices de la croix, l’on érigeait jadis, au sommet de l’arcade grandiose qui réunit la nef au choeur, un crucifix colossal.
L’ignorance des architectes et des curés a depuis longtemps fait disparaître cette croix gigantesque de Notre-Dame.
Le signe marquant la division des deux mondes ne subsiste plus maintenant dans cette église que grâce à la grille qui entoure le choeur et limite les deux zones, celle de Dieu et celle des hommes, dit Saint Grégoire de Nazianze, dans un poème cité par l’abbé Thiers.
De son côté, l’abside, qui s’arrondit derrière le sanctuaire et affecte dans la plupart des cathédrales la forme d’un demi-cercle, rappelle la couronne d’épines sur laquelle s’appuya, lorsqu’elle fut sur le gibet, la tête ensanglantée du Christ. Dans la majeure partie des temples, la chapelle du fond est dédiée à la Vierge, afin d’attester, par cette position même qu’elle occupe, que Marie est le dernier refuge des pécheurs, mais, ici, où tout l’édifice lui est voué, elle n’a pas de chapelle spéciale à la fin du chevet et l’espace qui ne lui est pas consacré est tenu par un oratoire où l’on garde les réserves du Saint-Sacrement.
Si l’abside, située derrière le maître-autel, signifie le douloureux diadème qui ceignit le chef vivant du Christ, l’autel même est sa tête, comme les bras étendus du transept sont ses bras, comme les portes ouvertes au bout des deux allées de ce transept sont les plaies de ses mains, comme les portes du grand porche d’entrée sont les blessures de ses pieds percés de clous.
Enfin si l’on se place dans la nef de Notre-Dame l’on peut remarquer que l’axe du choeur incline légèrement sur la gauche.
Cette inflexion, nous la retrouvons presque partout, à Saint-Ouen et à la cathédrale de Rouen, à Saint-Jean de Poitiers, à Notre-Dame de Chartres et de Reims, à Saint-Galien de Tours, à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, à Saint-Nicolas-du-Port, près de Nancy, dans presque toutes les grandes basiliques du moyen âge.
La répétition constante de cet artifice est donc voulue et elle a sa raison d’être.
Or, jusqu’à présent, il était admis que cette déviation de l’axe du choeur était une allusion à l’attitude de Jésus expirant sur le bois du supplice ; c’était la traduction, en langue architecturale, du passage de l’Évangile selon Saint-Jean : « Et inclinato capite, tradidit spiritum. »
Mais l’École des Chartes, qui est devenue, depuis la mort de Léon Gautier et de Lecoy de La Marche, une sorte d’officine de Juivophiles et de protestants, dont le but semble être de déprécier le moyen âge que ses professeurs de jadis exaltèrent, a tout changé.
A l’heure actuelle la symbolique est reléguée par elle dans les rancarts et l’on y enseigne le matérialisme archéologique dans ce qu’il a de plus bas.
Une brochure intitulée « La déviation de l’axe des églises est-elle symbolique ? » et qui a pour auteur M. de Lasteyrie, membre de l’Institut et l’un des podestats de l’École, est, à ce point de vue, typique.
M. de Lasteyrie répond par la négative à sa question, déclare qu’il n’a découvert aucun texte du moyen âge relatif à ce sujet et il ajoute aussitôt : « Si jamais le hasard en faisait sortir quelqu’un des arcanes de nos bibliothèques, je ne crois pas qu’on dût y prêter grande attention, car il serait assez isolé pour qu’on pût hardiment en contester la valeur. »
Voilà qui est simple. Cette façon de prendre les devants pour nier l’importance de tout document qui réduirait sa thèse à néant est pour le moins ingénue ; elle est, dans tous les cas, prudente.
Mais en même temps qu’il nous atteste que l’inclinaison du chevet des cathédrales n’est pas intentionnelle et n’a été inspirée par aucun dessein mystique, il tente de nous fournir les raisons de cette constante anomalie des axes et de nous expliquer les causes pour lesquelles les architectes des basiliques du moyen âge la commirent.
Et c’est alors que ce vétéran de la paperasse nous exhibe des arguments dont l’extraordinaire indigence désarçonne.
Après avoir raconté ce que nous savons déjà — que les cathédrales ont été bâties par étapes successives et non d’un seul jet — très sérieusement, il nous dit :
« Il en résulte que les architectes qui présidaient à la suite des travaux avaient à raccorder les maçonneries nouvelles avec les parties antérieurement construites et c’était là un problème dont on comprendra toute la difficulté, si l’on songe que la célébration du culte dans une partie de l’église obligeait à élever, entre cette partie et le chantier où se poursuivaient les travaux, des cloisons ou des murs qui interceptaient complètement la vue.
« Or les gens du moyen âge, ne connaissant aucun des instruments qui permettent aux modernes de se repérer avec précision et de raccorder, malgré tous les obstacles, les lignes les plus compliquées, éprouvaient le plus grand embarras pour prendre leurs repères et une erreur minime avait pour conséquence une déviation très marquée dans les alignements. »
Et ce n’est pas plus malin que cela ! Les permanentes irrégularités des cathédrales tiennent simplement à ceci que les architectes du moyen âge ne savaient pas leur métier et n’étaient pas pourvus d’instruments modernes.
Un tablier de bois tendu entre la partie construite et celle à construire suffisait pour leur faire perdre la tête et tous se trompaient, aucun dans ses calculs ne tombait juste.
Évidemment les tire-lignes qui ont bâti, au XIXe siècle, Saint-François-Xavier, Notre-Dame-des-Champs et Saint-Pierre de Montrouge étaient fort supérieurs, comme science, aux pauvres architectes qui ont édifié les cathédrales de Chartres, de Reims, de Paris, car eux, n’ont pas commis d’inadvertances ; ils ont respecté les règles intangibles du cordeau, ils n’ont pas fait pencher le choeur de leurs églises !
Telles sont les leçons d’orthopédie monumentale qui se débitent maintenant à l’école des Chartes.
Mais laissons ces pédantesques balivernes et revenons à Notre-Dame de Paris.
Elle n’est, pour la récapituler, qu’une des pages du grand livre de pierre écrit au XIIIe siècle sur notre sol et elle ne fait qu’enseigner dans l’Ile de France le même cours de théologie mystique qu’enseignent en même temps, dans la Beauce, dans la Picardie, dans la Champagne, ses soeurs de Chartres, d’Amiens, de Reims, en nous bornant à en citer trois ; elle se sert du même idiome qu’elles et cette unanimité de doctrine et d’expression se comprend si l’on considère que les artistes n’ont jamais été, à cette époque, que les interprètes de la pensée de l’Église. Ainsi que le fait justement remarquer M. Male, dans son substantiel volume sur « L’Art religieux au XIIIe siècle », dès 787, les Pères du second concile de Nicée déclaraient que la composition des images n’était pas laissée à l’initiative des artistes ; elle relevait des principes posés par l’Église et la tradition religieuse et les Pères ajoutent encore : « l’art seul appartient aux artistes, l’ordonnance et la disposition nous appartiennent. »
Il y eut donc immuabilité de théorie et de langue et les maîtres maçons et les imagiers n’eurent qu’à se conformer aux règles de la symbolique que leur indiquaient les moines ou les prêtres.
Mais ce dialecte hermétique, clair pour ceux qui l’entendaient, était-il compris du peuple ?
Nous pouvons le croire, d’après les quelques renseignements que nous possédons. Yves de Chartres, dans son « De Sacramentis ecclesiasticis sermones », nous affirme, en effet, que le clergé apprenait la science des symboles au peuple et il résulte également des recherches de Dom Pitra, qu’au moyen âge, l’oeuvre du pseudo Méliton, évêque de Sardes, qui contient une clef des allégories employées par l’Église, était populaire et connue de tous.
Cette symbolique officielle, si l’on peut dire, était donc accessible à tous les croyants, mais il en est une autre qui figure, à Notre-Dame de Paris, une symbolique occulte, compréhensible seulement pour quelques initiés ; celle-là dérive de ce que l’on nomme les sciences maudites, très pratiquées au moyen âge. A-t-elle été insérée, à l’insu du clergé qui n’y vit goutte, sur certaines parties de la façade, ou les formules en furent-elles dictées aux imagiers par un prêtre adepte de l’astrologie et de l’alchimie ? On ne le saura jamais ; ce qui semble le plus probable, c’est que les dresseurs de thèmes généthliaques et les souffleurs de cornues ont cru découvrir, après coup, dans des sujets purement religieux, des intentions qui n’y étaient pas.
Toujours est-il que Notre-Dame de Paris est peut-être une des seules cathédrales en France où de semblables secrets auraient été cachés sous le voile apparent des Écritures.
Deux des portails de la façade, le portail royal, celui du milieu et celui de Sainte-Anne et de Saint-Marcel qui longe le quai, sont ceux devant lesquels se sont réunis, au moyen âge et depuis, les adeptes de l’astrologie et les philosophes de la chrysopée.
Au portail royal, quatre figures sont censées représenter les symboles de la pierre philosophale ; elles sont contenues dans quatre médaillons qui se font vis-à-vis, deux par deux et qui sont encastrés, non dans le portail même, mais dans les contreforts. Ils sont là, à taille d’homme, très en évidence, séparés de tout l’ensemble décoratif de la porte. Ils représentent : à gauche, le premier, en partant du haut, Job, sur son fumier rongé par des vers que l’on voit et entouré d’amis ; le second, un personnage étêté et manchot qui traverse, appuyé sur un bâton ou sur une lance, un torrent. Dans sa monographie de la cathédrale de Paris, M. de Guilhermy déclare qu’il est impossible d’identifier cette figure. Il est, en effet, difficile de savoir de quel nom ce bonhomme s’appelle. Il a l’attitude de Saint Christophe, franchissant, appuyé sur son bâton, une rivière, et l’arc et les flèches que l’on aperçoit à ses pieds seraient bien ses attributs, car il fut, avant que d’être décapité, tué à coups de flèches et devint même, à cause de ce genre de supplice, le patron des arbalétriers ; mais la place en haut du médaillon, pour y loger l’Enfant Jésus sur ses épaules, manque et d’ailleurs nul indice n’existe d’une statuette brisée, près du dos et de la tête cassée du Saint. Ce n’est donc point le Christophore, et ce passant garde jusqu’à nouvel ordre l’anonymat.
De l’autre côté, maintenant, à droite, en partant toujours du haut, nous trouvons Abraham prêt à sacrifier son fils et dont un ange arrête le bras, lequel bras a disparu, ainsi qu’Isaac tout entier et une bonne partie de l’ange ; enfin, près d’une tour, un guerrier casqué et vêtu d’une cotte d’armes, protégé par un bouclier, qui lance contre le soleil un javelot. Celui-là serait Nemrod qui, d’après une ancienne tradition, serait monté sur une tour pour livrer bataille au ciel et à ses habitants.
Si nous nous plaçons au point de vue de la symbolique chrétienne, ces bas-reliefs ne suscitent aucune difficulté d’interprétation ; les sujets, sauf celui du faux saint Christophe, sont clairs, et les enseignements lucides ; mais, il faut bien l’avouer, ils sont étrangement mis à part ; ils ne décèlent aucun sens dans l’ensemble sculpté du portail ; ils constituent, en somme, des phrases isolées, sans rapports entre elles.
Si nous acceptons le point de vue de la symbolique spagyrique, nous pouvons reconnaître, avec le vieil hermétiste Gobineau de Montluisant, que Job est une personnification de la pierre des philosophes qui passe par les épreuves avant que d’atteindre son degré de perfection ; qu’Abraham est l’alchimiste, le souffleur ; Isaac, la matière à jeter dans le creuset ; l’ange, le feu nécessaire pour opérer la transmutation de la matière en or. Restent le pseudo-Christophe et le Nemrod, mais les grimoires de l’alchimie ne nous renseignent guère sur le sens précis de ces figures.
D’autre part, les astrologues qui désignent, de temps immémorial, ce portail sous le nom de porche de l’astrologie, ont toujours vu, dans les tableaux qu’il représente, une effigie de la Vierge astronomique et dans le Christ, accompagné de ses apôtres, l’image du soleil qui monte à l’horizon, entouré des signes du zodiaque. Que cette opinion soit fondée ou non, il faut avouer qu’elle a eu raison de se produire, car c’est à elle que nous devons d’avoir conservé une partie du porche. Et, en effet, en août 1793, la commune avait décrété la destruction de tous ces simulacres de la vieille superstition religieuse ; et ce fut le citoyen Chaumette qui réclama en faveur de la science, déclarant que ce décor constituait un cours d’astronomie et avait servi à Dupuis pour établir son système planétaire — et le portail fut sauvé. Ce portail royal était et est donc encore revendiqué par les partisans de l’astrologie et les hermétistes. — La porte voisine, celle de Sainte-Anne et de Saint-Marcel, l’était et l’est encore par les alchimistes.
A les entendre, le récepte, le secret de la sublime pierre des sages est inscrit sous la statue qui se dresse sur le trumeau, tranchant en deux la baie. Cette statue, — qui n’est qu’une reproduction, car l’original est placé dans la salle des Thermes, au Musée de Cluny — portraiture un évêque, debout, mitré et crossé, bénissant d’une main ses visiteurs et foulant aux pieds un dragon sorti d’une sorte de chapelle funéraire où une femme morte est assise dans un linceul enveloppé de flammes.
La lecture de cette scène est très simple. Il suffit d’ouvrir les Bollandistes. La légende de saint Marcel, neuvième évêque de Paris, raconte, en effet, que ce saint délivra la ville d’un horrible dragon qui avait établi son gîte dans le cercueil d’une femme adultère, décédée, sans avoir eu le temps de se repentir et sans avoir reçu les sacrements ; le saint frappa de sa crosse le monstre, lui entoura le cou de son étole, l’emmena à quelques lieues de Paris, dans un désert, et là, lui intima l’ordre, auquel d’ailleurs il obéit, de ne jamais plus retourner dans la ville.
Ajoutons ce détail, qu’aux processions des Rogations, le clergé de Notre-Dame faisait autrefois porter, en souvenir de ce miracle, un grand dragon d’osier dans la gueule ouverte duquel le peuple jetait des gâteaux et des fruits. Cette coutume, qui remontait au moyen âge, a pris fin en 1730.
Telle est la version de l’Église ; autre est celle des alchimistes. Dans son cours de philosophie hermétique, Cambriel explique ainsi cette figure :
Sous les pieds de l’évêque, sur le socle même de sa statue, de chaque côté, deux ronds de pierre sont sculptés. Les ronds de droite seraient les simulacres de la nature métallique brute, telle qu’on l’extrait de la mine, les ronds de gauche, négligés comme les premiers par la symbolique chrétienne, seraient la même nature métallique mais purifiée ; et celle-là se rapporterait à la figure humaine, assise, dans la chapelle sépulcrale, et qui a pris naissance dans le feu dont son linceul s’entoure. De cette fournaise tombale qui serait l’oeuf philosophique, inséré dans l’athanor, le dragon, né à son tour de la figure humaine, serait, en s’élevant hors du fourneau, en plein air, sous les pieds du saint, le dragon babylonien dont parle Nicolas Flamel, autrement dit, le mercure philosophal, le lion vert, le lait de la vierge, la substance même qui change par une projection le plomb en or.
Dans cette interprétation, saint Marcel ne nous bénirait plus, mais il ferait un geste de circonspection, qui signifierait : taisez-vous, gardez le secret si vous l’avez compris.
Si bizarre qu’elle paraisse, cette glose se conçoit pourtant, car les préparateurs du grand oeuvre peuvent se placer sous le patronage de ce saint qui a, en effet, opéré plusieurs transmutations.
Une fois, alors qu’il n’était encore que sous-diacre et qu’il servait la messe de l’évêque Prudence, il transmua en un vin qui manquait, l’eau qu’il venait de puiser à la Seine ; une autre fois aussi, il changea cette même eau en une liqueur parfumée comme le saint chrême.
Le choix que les alchimistes firent de cet Élu pour lui attribuer la possession du fameux secret pourrait donc jusqu’à un certain point se justifier ; cependant, il convient d’observer que le patron officiel des spagyriques, au moyen âge, ne fut pas saint Marcel, mais bien saint Jean l’Évangéliste, soit parce qu’une très ancienne légende nous le montre savant dans l’art de traiter les minerais de fer ; soit parce que deux vers, pris en un sens éperdument littéral (1), de la séquence tissée en son honneur par Adam de Saint-Victor, nous le représentent fabriquant avec du bois de l’or et avec des cailloux des gemmes.
Que ces explications puissent sembler erronées, c’est bien possible, mais qu’importe ! Que plus fabuleuse encore nous apparaisse cette autre légende relatant qu’un scrupule de la pierre des sages a été caché par l’évêque Guillaume de Paris dans l’un des piliers du choeur que l’on reconnaitra si l’on suit la direction de l’oeil d’un corbeau qui le regarde, sculpté sur l’un des porches, il ne nous en chaut pas davantage ; ce qu’il sied simplement de retenir, c’est que, plus que ses congénères, Notre-Dame de Paris est mystérieuse, plus experte peut-étre mais moins pure, car elle est à la fois catholique et occulte et elle greffe sur la symbolique chrétienne les réceptes de la Kabbale.
En tous cas, ces discussions ne prouvent-elles pas que, sauf de nos jours, cette basilique fut toujours envisagée telle qu’un traité de symbolisme, s’exprimant à mots couverts, parlant, à l’exemple du Christ, en paraboles ? Les archéologues, les architectes l’ont disséquée, ainsi que l’on disséquerait un cadavre ; c’est très bien, l’anatomie de son corps est désormais connue ; les romanciers, comme Victor Hugo, ont créé d’après elle un décor plus ou moins véridique pour y loger des personnages imaginés de toutes pièces, et cependant le poète a été le seul, alors, qui ait eu une vague intuition de la symbolique du moyen âge, lorsqu’il a écrit sa comparaison fantaisiste de la façade royale, trouée d’une grande fenêtre flanquée de deux petites, ainsi que le prêtre est flanqué, pendant la messe, du diacre et du sous-diacre, à l’autel. Il reste désormais à décrire, autrement qu’en un rapide abrégé, ses aîtres spirituels, sa vie intérieure, son âme, en un mot. La vraie monographie de notre cathédrale serait celle-là ; mais le positivisme architectural ne fait que s’accroître, et, malheureusement, le clergé s’éloigne de plus en plus de questions qu’il aurait pourtant intérêt à ne pas dédaigner.
1. Qui de virgis fecit aurum, Gemmas de lapidibus.