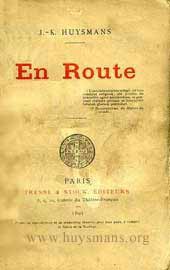Le Revue Illustrée
1 avril 1895.
LIVRES NEUFS ET D’OCCASION
En route, par M. J.-K. HUYSMANS.
En route n’est pas, à vrai dire, un roman. Je ne saurais trop, si l’on me forçait de definir ce livre, dans quelle categorie le ranger. Car il y a de tout, dans ce singulier ouvrage, et, quand on le ferme, on se sent dans le cerveau comme un tourbilionnement bizarre. On n’a pas goûté un plaisir franc et sincère; on a cependant été remué toujours et quelquefois charmé.
Il y a tout d’abord, dans cette etude, un côté que j’ecarterai de parti pris, parce que, à mon avis, c’est le moins important, bien qu’il occupe une place considérable. Vous avez tu sans doute Une Bouchée de pain, de Macé, et tant d’autres ouvrages écrits sur ce môdèle. Macé se propose d’apprendre aux enfants tout ce qui concerne, dans la physiologie, les fonctions digestives. Au lieu de formuler nettement et sèchement les donnees de la science, il emmielle les bords du vase, comme disaient nos pères. Il imagine une petite histoire, au cours de laquelle il passe en revue, sous forme de conversation, toutes les parties de cet enseignement. C’est ce qu’on appelle la science amusante.
Eh bien ! il y a quelque chose de cela dans l’En route de M. Huysmans. Il a prétendu nous initier à la vie des Trappistes et nous mettre au courant de leur histoire. Il a feint un Parisien las des plaisirs mondains, qui se réfugie à la Trappe et y va faire une cure de santé morale. Il en prend texte pour nous décrire par le menu un des couvents de l’ordre et l’existence qu’on y mène : et la façon dont ils furent crées jadis, dont ils sont administrés à cette heure.
Toute cette partie de l’oeuvre a du coûter à l’auteur de longues et patientes recherches. Mais j’avoue que, si elle emplissait le livre, je n’en parlerais pas : je dirai même, à ma confusion, que tous ces détails, si intéressants qu’ils puissent être, je ne les ai lus que sommairement et je crois que nombre d’honnêtes gens feront comme moi : l’histoire de la Trappe et le règlement de vie des Trappistes sont pour eux des choses assez indifferentes. Si la fantaisie leur vient de savoir au juste ce qui en est, ils prendront de preference un manuel quelconque qui traite de la question ex professo.
Mais M. Huysmans, qui est un psychologue très minutieux et très aigu, n’a pas borné sa tâche à l’étroite limite ou s’enferme un auteur qui fabrique des livres pour les distributions de prix. Il a, heureusement pour lui et pour nous, d’autres soucis plus importants.
Il a essayé de nous peindre les états d’âme par lesquels passe un artiste qui revient, par degoût, « du muflisme contemporain », à la religion et à l’Eglise.
« Ah ! s’écrie Durlal, le héros du roman, et ce Durtal me fait lout l’effet d’étre M. Huysmans lui-même, ah ! quand je songe à cette horreur, à ce degoùt de l’existence qui s’est, d’année en année, exaspéré en moi, comme je comprends que j’aie forcément cinglé vers le seul port où je pouvais trouser un asile, vers l’Eglise... Jadis, je la méprisais, parce que j’avais un pal (sic) qui me soutenait, lorsque soufflaient les grands vents d’ennui : je croyais à mes romans, je travaillais à mes livres d’histoire, j’avais l’art. J’ai fini par reconnaitre sa parfaite insuffisance, son inaptitude résolue à rendre heureux. Alors j’ai compris que le pessimisme était tout au plus bon à réconforter les gens qui n’avaient pas un réel besoin d’être consolés; j’ai compris que ses theories, alléchantes quand on est jeune et riche et bien portant, deviennent singulièrement débiles et lamentablement fausses, quand l’âge s’avance, quand les infirmités s’annoncent, quand tout s’écroule.
« Je suis allé à l’hôpital des âmes, à l’Eglise. On vous y reçoit, au moins, on vous y couche, on vous y soigne; on ne se borne pas à vous dire, en vous tournant le dos, ainsi que la clinique du pessimisme, le mal dont on souffre. Enfin, DurtaI avait été ramené à la religion par l’art... »
C’est une cure d’une espèce particulière. Aussi ne suffit-il point pour guérir ce Durtal du catholicisme des bonnes gens. Il lui faut ce que M. Huysmans appelle la mystique.
« Il n’y a pas à se leurrer, dit-il, le catholicisme n’est pas seulement cette religion tempérée qu’on nous propose; il ne se compose pas seulement de petites cases et de formules; il ne réside pas tout entier dans d’etroites pratiques, dans des amusettes de vieille folle, dans toute cette bondieuserie qui s’épand le long de la rue Saint-Sulpice; il est autrement surélevé, autrement pur. Mais alors il taut pénétrer dans sa zone brûlante, il faut le chercher dans la ’mystique’, qui est l’art, qui est l’espace, qui est l’âme de l’�glise elle-même... »
Je confesse que, malgré toutes les explications de l’auteur, je n’ai pas bien saisi en quoi consistait précisément cette ’mystique’ dont il est question tout le long du livre. Je ne la connais que par ses effets. Le premier m’a paru être un transcendant mépris du clergé séculier, de tous les prêtres qui, dans les paroisse, font la grosse besogne de l’�glise, depuis les évêques... Oh ! qu’il est dur pour les évêques ! Après avoir parlé de Bossuet, le cormoran de Meaux, et de Fénelon, le Job mitré, il ajoute : « Encore avaient-ils une certaine allure; ils avaient du talent, dans tous les cas; tandis que maintenant les évêques ne sont, pour la plupart, ni moins intrigants ni moins serviles; mais ils n’ont plus ni talent, ni tenu... »
S’il parle ainsi des évêques, que doit-il penser des desservants ? Il en montre un de profil : c’est un nigaud, faux bel esprit, qui est ravi des calembours qu’il perpètre, et ferait prendre la religion en horreur.
Tout ce clergé a le tort de ne rien comprendre à l’art ni au catholicisme; il a abandonné le plain-chant grégorien pour « les déculottages mystiques de feu Gounod » et ce qu’il en a gardé, il l’altère de la plus cruelle façon.
« Créé par l’Eglise, le plain-chant est la périphrase aérienne et mouvante de l’immobile structure des cathédrales; il est l’interprétation à l’oreille, il est la traduction ailée et fluide des toiles des primitifs, et il est aussi la stricte et la flexible étole de ces proses latines qu’édifièrent les moines. Il est maintenant altéré et décousu, vraiment dominé par le fracas des orgues, et il est chanté Dieu sait comme ! La plupart des maîtrises, lorsqu’elles t’entonnent, se plaisent à simuler les borborygmes qui gargouillent dans les conduites d’eau; d’autres se délectent à imiter le grincement des crécelles, le hiement des poulies, le cri des grues; malgré tout, son imperméable beauté subsiste... »
Cette impressionnable beauté ne se retrouve dans toute sa splendeur que dans le clergé régulier, chez les moines, et surtout à la Trappe.
M. Huysmans soutient la nécessité des couvents à l’aide d’une these qu’il a empruntée à la haute mystique, sur laquelle il revient sans cesse, et qu’il appelle la thèse de la substitution ou de la suppléance.
La voici résumée en quelques lignes :
« Vous n’ignorez pas que de tout temps des religieuses se sont offertes pour servir de victimes d’expiation au Ciel. Les vies des saints et des saintes qui affrontèrent ces sacrifices et réparèrent, par des souffrances ardemment réclamées et patiemment subies, les péchés des autres, abondent. Mais il est une tache encore plus ardue et plus douloureuse que ces âmes admirables envient. Elle consiste, non plus à purger les fautes d’autrui, mais à les prévenir, à les empêcher d’être commises, en supplantant les personnes trop faibles pour en supporter le choc.
« Lisez à cette occasion sainte Thérèse; vous verrez qu’elle obtint de prendre à sa charge les tentations d’un prêtre qui ne pouvait les endurer sans fléchir. Cette substitution d’une âme forte, débarrassant celle qui ne l’est point de ses périls et de ses craintes, est une des grandes règles de la mystique. Tantôt cette suppléance est purement spirituelle, et tantôt, au contraire, elle ne s’adresse qu’aux maladies du corps... »
Les couvents sont donc des lieux de substitution, où quelques hommes et quelques femmes se donnent pour mission de contre-balancer les péchés de leurs contemporains. L’auteur dit quelque part que Paris, de même qu’il s’entoure d’une ceinture de forteresses, devrait jeter autour de lui quelques-uns de ces asiles de purification morale.
Une autre théorie qui tient dans le livre une place énorme, c’est celle de la puissance de Satan. Satan, ce n’est pour nous, incroyants ou croyants fort tièdes, qu’une simple métaphore. Pour M. Huysmans, le diable, c’est un être toujours present, toujours agissant et toujours rôdant autour de ceux qui se sont engages dans le chemin de la conversion, qui sont « en route ». Nous avons quelque peine à prendre ses assauts au sérieux. Mais M. Huysmans, qui est depuis longtemps plongé dans les etudes de la magi noire et de l’occultisme, en parle avec une conviction troublante. Je ne serais pas étonné qu’il eût vu et baisé le pied fourchu de messer Satanas; qu’il n’eût été tourmenté des images lascives que cet ami de la luxure fait danser devant les yeux des aspirants à la sainteté.
Tout le roman, s’il y en a un, consiste dans le récit des huit jours passés par Durtal chez les Trappistes. Nous assistons aux inquiétudes, aux désespoirs, aux joies de ce Parisien qui est venu chercher un réconfort dans la pénitence et dans la communion. Je crois que toute cette peinture aurait gagné à être raccourcie en un petit nombre de pages. La répétition des mêmes phénomènes psychiques finit par fatiguer. II y a pourtant quelques pages sur le trouble d’une âme à l’heure de la confession que je vous recommande de lire avec soin; elles sont admirables.
Certaines scènes sont décrites avec un soin très curieux et dans une langue un peu précieuse, un peu tourmentée, mais très pittoresque. Je n’en donnerai qu’un spécimen. Les Trappistes viennent de communier; ils retournent à leurs bancs :
« Ils s’acheminaient très lentement et les mains jointes. Les figures avaient quelque chose de modifié; elles étaient éclairées autrement, en dedans; il semblait que, refoulée par la puissance du sacrement contre les parois du corps, l’âme filtrât au travers des pores, éclairât l’épiderme de cette lumière spéciale de la joie, de cette sorte de clarté qui s’épand des âmes blanches, file ainsi qu’une fumée presque rose le long des joues et rayonne, en se concentrant, au front, »
Francisque SARCEY.