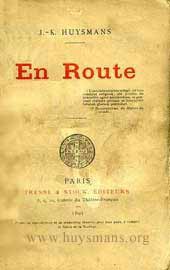Revue Bleue
6 avril 1895.
CAUSERIE LITTÉRAIRE
"En route", de M. Huysmans.
Puissante et hardie, très originale, simple en sa conception et cependant touffue, attachante malgré l’abus des digressions, inégale avec des parties de premier ordre, telle se présente l’oeuvre nouvelle de M. Huysmans (1), son oeuvre maîtresse à coup sûr, et l’une des plus fortes qu’on nous ait données depuis longtemps.
Qu’y manque-t-il donc? Certaines qualités modestes, de ces qualités qui s’acquièrent, mais que l’on a tort de mépriser, car sans elles il n’y a point d’ouvrage durable: un peu d’harmonie dans la composition, un peu de tenue dans le style. Quand on a pu écrire les belles pages de En route, on se doit à soi-même de faire la police de son talent, d’y mettre de l’ordre, et de redouter jusqu’à l’apparence de succès trop faciles, de s’interdire certaines brutalités d’expression qui furent le péché mignon du naturalisme, mais qui toujours rebuteront les gens de goût. Nous ne sommes plus au temps où, si l’on voulait passer pour un homme fort, il fallait commencer par crier fort. Et si l’on ne rencontrait dans En route des morceaux admirables, d’une simplicité pénétrante on insisterait moins pour que l’auteur se mît en garde contre les excès de l’originalité et du raffinement. Par exemple, contre l’abus du néologisme. Assurément, les mots nouveaux, s’ils sont expressifs et clairs, sont les bienvenus: à la condition pourtant qu’ils correspondent à une idée nouvelle et qu’ils soient nécessaires, c’est-à-dire qu’ils n’aient point déjà d’équivalents dans la langue. Mais est-il bien utile d’écrire "adjuver" pour "aider", "insane" ou "démentiel", pour "insensé"?
Après ces menues critiques, j’arrive au roman, dont la première originalité est de ne point ressembler à un roman. On nous fait grâce enfin de ces éternelles litanies amoureuses que psalmodient sans se lasser la plupart de nos romanciers, comme si notre société n’ouvrait pas à la littérature d’autres horizons. Ici, point d’amourette, ni de flirt, ni d’aventure vulgaire. Et pourtant le livre est plein de mouvement et de vie, même de passion. C’est que M. Huysmans, sans renier aucunement son passé, a tout à coup élargi sa manière. Dans le cadre de son roman réaliste, il a fait entrer, cette fois, non plus l’analyse aiguë d’une simple névrose, mais une véritable étude psychologique, qui touche à l’un des problèmes les plus graves du temps présent: une crise d’âme dans une peinture de moeurs.
I
Sans doute, vous vous rappelez Durtal, l’homme de lettres détraqué, le dilettante exaspéré de Là-bas qui longtemps égara dans les folies de l’occultism et du satanisme sa curiosité malsaine. Dans la magie noire, comme dans la société de ses contemporains, il n’a trouvé que l’ennui et le dégoût. N’ayant pu s’entendre avec le diable, il a essayé de se réconcilier avec Dieu. Il s’est mis à hanter les églises, d’abord en curieux, puis avec un désir sincère de croire. Il s’est bravement acheminé vers la foi, sous la direction de l’abbé Gévresin, un ecclésiastique très intelligent et très clairvoyant, qui l’a guidé d’une main légère, tout en causant avec lui. Après bien des hésitations, Durtal saute le pas et s’en va faire une rêtraite de huit jours dans une Trappe, à Notre-Dame de l’Atre. Cette conversion, ou plutôt cette tentative de conversion, voilà tout le sujet du roman.
Vous pensez bien que M. Huysmans n’a pas manqué l’occasion de nous peindre ce nouveau milieu. Il a exploré ce monde de la dévotion avec une véritable fureur d’attention, avec la patience acharnée d’un homme qui veut tout comprendre. Il a tout visité et tout lu. Il a porté dans cette étude une passion inquiête de néophyte, une sincérité souffrante et vibrante, qui souvent ne va point sans parti pris. Nous le retrouvons là tout entier, avec sa curiosité jamais lasse, avec son observation à la fois menue et profonde, sans scrupule d’aucun genre, prompte à saisir le détail pittoresque et l’envers des choses. Ne lui demandez ni impartialité ni modération: il s’est juré d’écarter violemment toutes les apparences, de jeter à bas ce qui sonne faux. Pour stigmatiser ce qu’il hait, il ne recule pas devant le scandale, il ne craint ni les gros mots, ni les grasses plaisanteries. Mais voici un nouvel aspect de son talent, qu’il nous avait soigneusement caché jusqu’ici. Ce railleur impitoyable n’a rien d’un sceptique. En face des choses belles et grandes qu’il découvre dans son pieux pèlerinage, soudain il devient grave, et, sans effort, sa pensée s’élève jusqu’à l’émotion mystique. Sous le satirique on entrevoit alors un dévot trop exigeant, écoeuré de la tiédeur et de la vulgarité des fidèles.
En effet, si Durtal se convertit, c’est en poursuit de ses sarcasmes le culte officiel. Il trouve que les habitués des églises gagnent le Paradis à trop bon compte. Il ne pardonne pas au catholicisme des villes de s’être fait si mesquin et si bourgeois, d’avoir perdu tout idéal, de sacrifier le sentiment aux pratiques, de se rapetisser au niveau des égoïstes ou des simples d’esprit. Le catholique, dit-il, "agit non par dilection, mais par peur: c’est lui qui, avec l’aide de son clergé et le secours de sa littérature imbécile et de sa presse inepte, a fait de la religion un fétichisme de Canaque attendri, un culte ridicule, composé de statuettes et de troncs, de chandelles et de chromos; c’est lui qui a matérialisé l’idéal de l’Amour, en inventant une dévotion toute physique au Sacré-Coeur."
Durtal, toujours errant dans les rues de Paris comme une âme en peine, ne peut passer devant une église sans y entrer: pour s’y recueillir, comme il dit. Singulier recueillement, qui le mène à rire de tout, sauf à s’en fâcher ensuite. Il s’irrite contre l’architecture ou la décoration de l’édifice, contre les intonations du prêtre en chaire, contre la routine des cérémonies où s’efface la beauté de la liturgie, contre l’attitude des officiants ou du publie, contre la laideur des chasubles, contre le mobilier des pompes funèbres. Au fond, il en veut au catholicisme d’avoir perdu son action souveraine sur les âmes généreuses, et il en accuse la vulgarité, l’ignorance du clergé séculier, toujours écrémé par les ordres religieux, si bien qu’il y reste seulement le "déchet", la "lavasse des séminaires".
Ce que Durtal reproche plus encore aux curés, c’est leur inintelligence de l’art, la prodigieuse décadence du goût dans l’église. Aux affreuses bâtisses des temps modernes il oppose les merveilles de l’âge gothique. Il a juré une haine mortelle aux statues peintes de la rue Saint-Sulpice, à tout ce qu’il appelle en son langage pittoresque "la bondieusarderie".
La musique surtout l’exaspère, telle qu’on l’entend d’ordinaire dans les églises de Paris. Il ne peut pardonner aux curés d’avoir laissé perdre ou de ne point faire revivre l’admirable tradition du plain-chant. Il s’acharne contre les maitrises, qu’il a toutes comparées entre elles, et qui presque toujours lui ont déchiré les oreilles. Pendant toute une fête de Noël, il a erré d’église en église sans pouvoir découvrir un office passable. Par chance, on sait encore à Saint-Sulpice exécuter un De Profundis et un Dies Irae, quoique les airs du Salut y tournent au rigodon. Évidemment l’on montre de la bonne volonté à Saint-Gervais; mais les vieilles mélodies y sont gâtées par une mise en scène de concert mondain. Quant aux autres églises, n’en parlons pas. Partout la liturgie musicale est mutilée ou faussée; et tout l’effort des modernes ne va qu’à enseigner aux maitrises des airs de danse ou des flonflons de théâtre. Le salut, c’est le retour pur et simple au vrai plain-chant, tel qu’il a été reconstitué récemment par les Bénédictins de Solesmes.
Ce plain-chant idéal, on peut l’entendre encore, avec sa beauté grave, dans les couvents qui suivent la règle de Saint-Benoît. Plus que tout le reste, c’est l’amour de la musique qui pousse Durtal vers les monastères. Et il faut reconnaître que les monastères ont merveilleusement inspiré M. Huysmans. Dès qu’il en franchit le seuil, c’est un homme nouveau, et l’on dirait que se réveille en lui, par un miracle d’hérédité, la foi naïve et profonde des ancètres. Cela vous surprend sans doute, car l’auteur ne nous avait guère, préparés a cette métamorphose. Mais le fait est là, et, en ce genre, je ne connais rien de plus émouvant que les épisodes monastiques de En route: la prise de voile aux Carmélites, la cérémonie de vêture chez les Bénédictines, et presque tout le séjour à la Trappe, la confession, les offices, les tentations diaboliques, l’extase nocturne des moines.
Pendant toute la seconde moitié du roman, l’auteur s’enferme avec son héros, loin de Paris, au couvent de Notre-Dame de l’Atre. Avec une émotion communicative, il a dégagé la poésie simple et vraie de ces pauvres abbayes perdues au fond des bois, si accueillantes dans leur mélancolie, si mystérieuses dans leur apparente bonhomie. Il nous promène le long de ces vieilles murailles banales qui parlent à l’âme; il nous conduit au réfectoire et à la bibliothèque, au bord de l’étang, dans la solitude des charmilles, au cimetière, à la ferme, aux étables. Il nous dit le secret de ces pieuses existences, tantôt monotones et douces, partagées entre la prière et le travail des mains, tantôt soulevées par l’extase ou torturées par le scrupule. Et l’on entreprendrait le voyage de la Trappe, rien que pour entrevoir ces braves gens qui firent si bon accueil à Durtal: le Père hôtelier, si complaisant et si discret dans son rôle de maître Jacques; l’énigmatique M. Bruno; le Père Maximin, si indulgent dans son austérité, et le Père Siméon, ce divin porcher qui met en fuite les diables.
Et pourtant, ce n’est pas sans une arrière-pensée maligne que M. Huysmans s’attendrit dans les monastères. C’est là seulement, parmi ces exilés volontaires des ordres contemplatifs, qu’il trouve sa religion idéale: une bonne musique, c’est-à-dire le vrai plain-chant; la paix de l’âme, à l’abri des vulgarités de la vie; enfin, la tradition de cette haute mystique dont il suit amoureusement l’histoire à travers les âges et dans les bibliothèques. S’il s’arrête volontiers au couvent, c’est encore pour faire pièce à l’église.
Tout cela est intéressant, souvent neuf, et les théories sont soutenues avec un grand luxe d’arguments et d’exemples, avec une verve amusante ou un accent de sincérité émue. Nous ne pouvons songer à discuter point par point Ies assertions de M. Huysmans. Je crois d’ailleurs qu’il a souvent raison, et pas seulement en matière d’art. Son tort est peut-être de chercher à avoir trop complètement raison. Bien des lecteurs jugeront sans doute qu’il a tracé un tableau un peu trop idyllique de la vie monacale, un peu trop sombre du culte officiel. On pourrait lui objecter aussi que les religions de tous les temps ont été amenées fatalement à distinguer entre la théorie et la pratique, entre l’idéal et la réalité. Ces deux courants contraires, on les observe à toutes les époques de l’histoire du christianisme, au moyen age et au siècle de saint Augustin comme aujourd’hui. Tandis qu’il s’efforce dans les couvents de réaliser l’idéal chrétien, le catholicisme hors des couvents s’accommode tant bien que mal aux nécessités sociales. S’il s’abaisse au niveau des fidèles, c’est peut-être leur faute plus que la siene. — Mais ces discussions nous entraîneraient trop loin. Tout ce que j’ai voulu montrer, c’est ce fond de philosophie mystique et satirique, sur lequel se détache, en pleine lumière, la conversion de Durtal.
II
Il est bien vivant et bien vrai, ce Durtal, avec sa dévotion fantasque, avec ses effusions de rapin contrit, et ses soliloques d’anachorète fumiste. Quelques-uns de nos contemporains pourraient se reconnaître en lui: gens de lettres blasés, las des raffinements pervers, vieux garçons aigris, dégoûtés des gargotes et des aventures, embarrassés de leur âme, ramenés vers la religion par le besoin d’une nouvelle expérience sentimentale. M. Huysmans a créé là un véritable type, en qui s’incarne l’un des travers ou l’une des souffrances de notre temps. Ce qui prouve bien la justesse de l’observation psychologique et la vigueur du rendu, c’est qu’on ne songe point à s’étonner de la simplicité hardie du roman. Ni action, ni incident; autour du personnage principal, à peine quelques silhouettes d’abbés ou de moines. D’un bout à l’autre, Durtal est en scène; le livre n’est, au fond, qu’un long monologue. Et pourtant l’intérêt ne languit pas.
Plusieurs mobiles, qui agissaient sourdement et dans la même direction, ont insensiblement poussé Durtal vers les églises. D’abord, un vague instinct d’hérédité, des souvenirs d’enfance: il a été élevé dans un milieu dévot, près des couvents, et dans son âme inconstante ont toujours traîné des vestiges de piété. Une existence égoïste, solitaire, dévoyée dans des expériences malsaines, l’a conduit peu à peu au mépris des hommes et de lui-même. Ennuyé de vivre, convaincu de la vanité des choses, tourmenté d’inconscients remords et désemparé, il se tourne vers la religion de son enfance, et s’y réfugie dans "l’hopital des âmes". D’ailleurs, la doctrine catholique n’a rien qui puisse révolter son esprit; au contraire, il lui sait gré d’avoir proclamé par avance le néant de tout, comme l’impuissance de la raison, et il savoure ce pessimisme chrétien, plus amer que celui de Schopenhauer. La curiosité, le dégoût, I’hérédité l’avaient poussé vers l’Église: son dilettantisme l’y retient. S’il juge sévèrement et raille le culte, c’est qu’il le voudrait parfaitement beau. Il admire en connaisseur les merveilles de l’art chrétien: les nefs gothiques, les cérémonies et les chants, la liturgie, les primitifs du Louvre, les chefs-d’oeuvre la littérature mystique. Et l’art chrétien l’achemine vers Dieu: "Ah! dit-il, la vraie preuve du catholicisme, c’était cet art qu’il avait fondé, cet art que nul n’a surpassé encore." C’est pour cela qu’il s’élance d’un bond au delà de la religion commune jusqu’aux couvents et à la mystique. Comme autrefois Chateaubriand, c’est son dilettantisme qui le convertit.
Mais cet art chrétien, il en jouirait bien plus s’il àvait la foi; et, par surcroît, il aurait la paix de l’âme. De là cette campagne qu’il s’impose à lui-même, pour atteindre cette foi, qui toujours se dérobe. Il se persuade peu à peu qu’un rayon de la grâce est tombé sur lui; puis il se désespère que cette grâce ait si peu d’efficace. C’est qu’en lui se défend le vieil homme. Il a des vices qui lui sont devenus chers avec le temps, et toujours il sera hanté par le souvenir d’une certaine Florence. Il a des habitudes et des manies qui le poursuivent jusqu’au moment du départ pour la Trappe: "Mon corps, dit-il, est fragile et douillet, habitué à se lever tard... Jamais je n’arriverai à tenir là-bas avec des légumes cuits dans de l’huile chaude ou dans du lait... Enfin, j’ai une telle habitude de la cigarette qu’il me serait absolument impossible d’y renoncer." Et, en effet, il ne s’en ira point sans une imposante provision de sucre, de chocolat, de serviettes, de livres, de drogues et de tabac. De plus, son orgueil résiste, l’empêche de se plieraux pratiques. Un jour qu’il s’est laissé enrôler dans une procession, il se dit à lui-même; "Ce que je dois avoir l’air couenne!" Même, l’homme de lettres n’est pas mort en lui: à un moment d’émotion réelle, où il veut élever son âme à Dieu, il ne se rappelle qu’une prière, et c’est précisément la prière que Paphnuce enseigna à la Thaïs de M. Anatole France.
De là, d’infinis retards dans la conversion, des hésitations de promptes décisions suivies de regrets, de brusques retours, et une inquiétude persistante de l’esprit. Depuis qu’il court les églises, Durtal s’ennuie beaucoup moins, mais il ne sait où il en est. Sans doute il hésiterait encore, si le bon abbé Gévresin ne le poussait doucement par l’épaule. Il part enfin, après d’affreuses angoisses, mais, il l’avoue, "comme un chien qu’on fouette". Arrivé à la Trappe, il est vite séduit par la poésie du décor; il semble s’y transformer; il y passe des journées terribles ou exquises, dans le ravissement oui les tentations; il s’y confesse; il y communie.
Est-il vraiment converti? M. Huysmans ne nous le dit pas, et il est permis d’en douter. Il semble que l’imagination ait joué le principal rôle dans cette aventure dévote. C’est par lassitude et par curiosité que Durtal s’est résigné à cette retraite. Il y a cherché la paix dans un séjour poétique, il y a étudié la mystique et la vie monacale, il y a entendu de bonne musique. Il a cédé à l’influence du milieu, et sincèrement il s’est cru converti. Au couvent même, il a gardé quelque chose de son dilettantisme d’autrefois. Entre les offices, il s’échappait dans le bois pour y fumer des cigarettes, il se fâchait d’y retrouver des statues peintes à la mode de Saint-Sulpice, il se renseignait sur la mystique, et il constatait avec soin que les ascètes n’ont pas nécessairement le crâne en pointe. Aussi voyez son découragement quand il quitte la Trappe. Il sait bien ce qui l’attend à Paris: l’ennui, le dégoût, le respect humain, l’inquiétude de l’âme: "Je suis encore trop homme de lettres pour faire un moine, et je suis cependant déjà trop moine pour rester parmi des gens de lettres." Ainsi, tout est a recommencer. Et c’est en vain qu’il recommencerait, car il n’a pas la foi; mais, par moments, il croit qu’il croit.
En réalité, Durtal a été, une fois de plus, le jouet de son imagination. Il n’a tenté qu’une expérience nouvelle, et avec le même résultat: il quittera Dieu, comme autrefois il a quitté le diable. Il n’a rien de ce qui fait vraiment le chrétien: ni l’humilité, ni la charité, ni la foi, ni même l’espoir sincère de la foi.
Et la peinture est d’autant plus vraie. Durtal est le vivant portrait de nos chrétiens à la nouvelle mode, qui prennent leurs fantaisies pour une religion, qui rôdent autour de l’Église sans se décider à y entrer, qui n’osent choisir entre la franchise du libre penseur et l’humble foi du fidèle. Caprice de dilettante qui s’ennuie, ou infirmité de célibataire sceptique qui vieillit. Invention plaisante, d’ailleurs, que plusieurs personnes ont le tort de prendre au sérieux. Croyez ou ne croyez pas, et agissez en conséquence; mais tâchez de voir clair en vous, et de vouloir ce que vous voulez. Ayez des devoirs précis, tâchez de faire oeuvre utile, et vous ne serez point tentés d’emboîter le pas derrière les juifs-errants du néo-christianisme.
PAUL MONCEAUX.
(1) J.-K. Huysmans, En route. — Paris, Tresse et Stock, 1895.