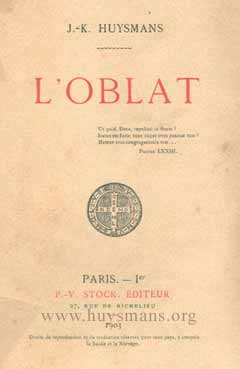Gil Blas.
9 mars 1903.
Vers 1830, dans le château de la Chênaie, en Bretagne, un prêtre connu sous le nom de M. Féli, et qui s’appelait Lamennais, réunit autour de lui quelques disciples aimant comme lui le peuple, la philosophie et les exercices religieux. Parmi ces jeunes gens se trouvait l’aimable Maurice de Guérin, et nous savons par lui comment passait la vie dans cette maison pleine d’ardeur, de science et de piété.
La liberté tempérait la règle; l’étude interrompait la prière; ce n’était point précisément la vie claustrale, mais un recueillement studieux, une solitude choisie. Ainsi vécut Maurice de Guérin dans sa jeunesse, et telle est aussi la vie que le héros de M. Huysmans, le romancier Durtal, rêva pour son âge mûr.
Durtal se sentait effrayé par la discipline obligée du cloître; il craignait que la multitude des offices, coupant incessamment la journée, ne rendît impossible tout travail: il désirait garder la liberté de son loisir et le choix de ses promenades. Pourtant, il aimait la prière, et ne voulait pas vivre loin de Dieu.
Plus jeune, Durtal eût été rejoindre à la Chênaie, Maurice de Guérin et M. Féli. Ou bien il eût tenté de réaliser, à Paris même, le plus difficile de ses rêves: une cité d’érudits, d’artistes, d’ouvriers d’art habitant chacun sa maisonnette, dans quelque allée fleurie des faubourgs une bibliothèque, un oratoire, un prêtre dirigeant la vie religieuse, le travail isolé, l’oraison commune. Mais M. Féli est mort, et les faubourgs de Paris n’ont pas vu s’ouvrir encore cette cité spirituelle. Durtal se fit donc oblat de Saint-Benoît.
D’après la règle de saint Benoît, l’oblat appartient à l’ordre; il est soumis à la juridiction de l’abbé. Mais il ne prononce pas de voeux; il vit hors de la clôture et garde l’habit séculier. Il est dans le monastère un ami toujours convié, et qui peut se dire de la maison. Durtal fut donc heureux, ayant trouvé ce qu’il cherchait. Il put vivre dans une maison solitaire, à l’ombre du cloître bénédictin. C’était au Val Notre-Dame, en Bourgogne, dans un pays de vignobles et de prés. Il travaillait au livre que M. Huysmans publie aujourd’hui et suivait assidûment les offices. Les paléographes bénédictins ont les premiers restitué dans sa pureté le plain-chant religieux. Or, Durtal aimait la musique religieuse et la liturgie; il goûtait la mystique et la symbolique. Il prit joyeusement sa part de la vie d’un ordre qui est voué au service des louanges du Seigneur.
Et c’est la vie de Durtal au Val Notre-Dame que M. Huysmans a voulu conter en ce gros roman; sa vie de chaque jour, dans sa maison, au monastère, et l’existence parallèle du couvent. Les pères sont doux, savants et bons. Durtal est heureux, et ce bonheur dure jusqu’au jour où de dures lois chassent du Val Notre-Dame, pour un exil lamentable, la sainte communauté. Durtal reste au Val Notre-Dame pour assurer, jusqu’au dernier jour, la continuité des offices, car la louange de Dieu ne doit pas être interrompue. Puis il repartira, désespéré, pour Paris, et voilà la fin du livre.
***
Ce livre est d’un désordre incroyable. Pour en concevoir une juste idée, imaginez les fragments mêlés d’un traité d’histoire ecclésiastique, d’un manuel d’horticulture, d’un catalogue de musée, le tout coupé çà et là d’articles de la Croix et de descriptions hétéroclites. Car M. Huysmans décrit tout: les cérémonies bénédictines, les sculptures de Dijon, le jardin bizarre où Durtal cultive la flore médicinale. De longues discussions, historiques sur l’art flamand de la Bourgogne se mêlent à des conjectures d’exégèse et à des recettes de cuisine. A aucun moment la composition ne révèle le moindre souci d’art; on ne discerne un dessein, une suite, ni dans le développement des caractères, ni dans les événements. M. Huysmans ne s’astreint même pas aux préparations les plus simples, aux ruses les plus communes du romancier.
« Ne nous pressons pas, dit Mlle de Garambois, car il nous faut attendre le P. Felletin et il n’est jamais en avance. Puisque nous avons du temps devant nous, ce serait peut-être le cas de tenir la promesse que vous avez toujours éludée jusqu’alors, de nous exhiber les documents que vous possédez sur l’oblature...
— Mais c’est une conférence que vous me demandez là!
— Du tout, prenez vos notes qui sont rangées avec soin, j’en suis sûre; lisez simplement; ça nous suffira... »
Durtal prend ses notes et lit. Et cela dure dix-huit pages. Et cela recommence.
La puissance a manqué à M. Huysmans, ou l’étude, ou tout simplement l’intention pour fondre dans l’unité d’une oeuvre cette masse énorme de documents, de renseignements, d’observations. Disons-le donc: L’Oblat n’est pas une oeuvre d’art, mais en revanche, c’est le livre d’un bon écrivain, et c’est pourquoi ces 450 pages se lisent malgré tout, et avec estime, et souvent avec plaisir. Style singulier, lui aussi, à la fois personnel et très composite. La conduite du récit, la disposition des paragraphes, les transitions, la coupe même des phrases, rappellent invinciblement Zola. Et la pâte de style coulée à la forme de ce moule; c’est somme toute « l’écriture artiste » des Goncourt.
M. Huysmans a retenu des Goncourt leurs qualités: l’attention, la minutie, la recherche de l’expression visuellement nuancée. Il n’a pas évité leurs défauts: l’affectation, la prédilection un peu puérile pour certains termes ou pour certaines formes de syntaxe, comme si la page d’un artiste devait à première vue, et par des signes tout extérieurs, se distinguer du style commun. On reconnaît aussi, à une certaine abondance outrée de néologismes que, de tous les écrivains naturalistes, M. Huysmans est le seul qui ait approché l’école dite décadente de 1885-1890. Mais cette truculence cocasse, et presque toujours bien située, donne précisément au style un goût savoureux d’humour rabelaisien. Et, dans l’ensemble, le récit est agréable et satisfaisant par sa carrure, sa grande solidité d’assiette, par la richesse et l’exactitude d’un vocabulaire bien appliqué aux objets. Et, parfois, la vigueur recherchée de sa trivialité devient éloquence.
***
Mais voilà des critiques de grammairien ou d’amateur de lettres, et je sais bien ce que pourrait m’objecter M. Huysmans. Il me répondrait qu’il n’a pas entendu faire oeuvre de romancier, ni d’artiste, mais seulement de chrétien, et que toute la valeur de son livre est dans le sens exprimé, ou dans sa force de propagande. Même à ce point de vue, et je le dis avec toute la réserve modeste qui convient, je doute que le livre de M. Huysmans soit agissant et solide. L’Oblat est l’oeuvre d’un chrétien, mais c’est l’oeuvre la moins populaire qu’on imagine, et elle suggère au lecteur trop de profanes distractions.
Nous sentons trop que, dans son exil claustral, Durtal est resté un romancier naturaliste, et qu’il prenait des notes pendant l’office. Quand il s’entretenait avec ses grands amis, il interrompait malgré lui ces conversations édifiantes pour noter la forme d’un front ou la nuance d’un regard. Il était toujours un amateur d’art et un dilettante, épris des cérémonies plus que de la prière, et de la liturgie plus que de la religion. Chaque fois qu’il parle du plain-chant, des psaumes variant avec chaque fête, de l’infinie diversité des pompes chrétiennes, il le fait sans naïf enthousiasme, mais en connaisseur critique et minutieux. Et je songe, malgré moi, à Sarcey, passant ses vacances d’été à la Comédie-Française, et notant, chaque dimanche, l’état du répertoire et les progrès inégaux des acteurs.
J’ai bien senti la pensée profonde de M. Huysmans. C’est dans l’alliance de l’art et de la vie monastique qu’il cherche l’avenir fécond de l’Eglise. Et l’oblature l’a tenté comme le symbole de cette sainte union. Il déplore « dans quel état d’abandon et d’anémie se trouve l’Eglise depuis qu’elle est désintéressée de l’Art et que l’Art s’est retiré d’elle ». Il voudrait réaliser le couvent d’Art, la maison du luxe pour Dieu, et il évoque dans ce dessein les souvenirs du moyen âge. Mais dans l’histoire du moyen âge nous ne rencontrons rien de pareil. C’est naturellement que l’art, comme toute chose, fut alors imbu de religion. Chacun donnait à Dieu ce qu’il pouvait, ce qu’il avait; la bonne volonté seule comptait, non la valeur de l’offrande. Le maître maçon, l’imagier, le tailleur de pierres ne voyaient, dans leur labeur et dans leur génie, qu’un don mieux approprié, mais qui n’avait pas plus grande dignité que la prière toute nue d’un pauvre. Ils donnaient une cathédrale gothique, un livre d’heures, un retable d’autel, comme le bourgeois son argent, le moine ses oraisons et le jongleur de la Légende Dorée, ses cabrioles. Nul orgueil, nul désir de gloire; toute oeuvre restait anonyme. Tandis que Durtal signe ses livres, et dans l’art il voit un présent de luxe, et à sa maison bénédictine il promet « un succès prodigieux ».
Grave contradiction, dont ce livre porte la marque, et qui gâtera son action comme son unité. Et après tout cela, il me semble que la meilleure chance que L’Oblat ait de durer, c’est que, dans quatre ou cinq cents ans, on en pourra peut-être user comme un document commode sur la vie des communautés. Armé de L’Oblat, un érudit expert pourra même reconstituer, dans son entier, la liturgie de quelques cérémonies bénédictines. Je n’entends point railler; c’est une grande chose. Le nom de Ruinart vit encore, et Mabillon a sa rue.
Léon BLUM.