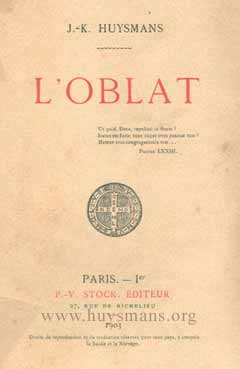CHAPITRE IX
Dans les campagnes, quand un enfant n’a pas de santé et est incapable de supporter les travaux des labours et des vignes la mère dit : il est chétif, ce petiot-là, nous en ferons un prêtre ; et c’est ainsi que l’abbé Barbenton était entré au séminaire, puis envoyé successivement en qualité de vicaire dans divers villages et enfin promu curé au Val des Saints.
Tous les ecclésiastiques auxquels Mgr Triaurault avait offert cette cure s’étaient récusés, sentant très bien la situation penaude qu’aurait un curé, en face d’un abbé de cloître.
Lui, avait accepté, sur la promesse qu’au bout d’un certain temps, il serait transféré dans une paroisse meilleure ; ce qui était absolument invraisemblable, car il était bien évident que s’il réussissait dans sa lutte contre l’abbaye, l’évêque s’empresserait de le laisser sur place et que, dans le cas contraire, il ne lui donnerait aucun avancement ou n’hésiterait pas, s’il le jugeait par trop compromis, à le briser.
Dans cet être malingre et vaniteux, il y avait une ambition démesurée de succès. Il se savait soutenu par les hobereaux qu’il avait visités, presque sympathique au maire qui, bien que socialiste et libre penseur, était, en haine des religieux, enclin à lui accorder son appui. Aussi, à peine fut-il installé au Val des Saints, qu’il engagea la lutte.
Et il débuta par un grand coup.
Dès le premier dimanche, il voulut faire table rase, détruire, en un jour, l’oeuvre patiemment poursuivie, depuis plusieurs années, par les moines ; il déclara aux jeunes paysannes qui connaissaient le plain-chant que l’on chanterait désormais des cantiques et il en distribua dont les airs de guinguette plurent d’ailleurs aux filles.
Poussé par les noblaillons du crû, il enleva de ce village cette senteur de hameau Moyen-Age qu’il exhalait, le dimanche, aux offices, et il transforma ce pays, unique peut-être en son genre, en un lieu comme un autre où l’on brailla dans l’église des rigaudons.
Puis lorsque ses « enfants de Marie » furent suffisamment exercées pour goualer sans trop d’accrocs, ses fariboles, il pria le cloître de lui prêter, pour les accompagner, son organiste, inoccupé, ce jour-là, puisque l’oratoire intérieur ne contenait aucun orgue.
Le P. Abbé était heureusement absent car, n’y cherchant pas malice, il eût sans doute cédé ; mais l’abbé Barbenton eut affaire à Dom de Fonneuve qui, plus méfiant, répondit :
— Cela dépend ; si vous vous confinez dans le plain-chant, oui ; autrement, non.
Vexé, le curé répondit qu’il était maître, dans son église, d’imposer, le dimanche, la musique qu’il aimait.
— Et moi de garder mon organiste, riposta le prieur.
Ce fut une première cause de brouille.
Il s’avisa ensuite de vouloir changer l’intérieur du sanctuaire, en y plaçant de nouveaux autels surmontés de saints façonnés par les plâtriers de la rue saint-Sulpice. La noblesse des alentours l’encourageait mais disparaissait dès qu’il s’agissait de délier sa bourse ; il n’en tira que des sommes insignifiantes ; il se rabattit alors sur M. Lampre, sur Mlle de Garambois, sur Durtal, mais ils lui déclarèrent, avec ensemble, qu’ils ne voyaient pas l’utilité d’enlaidir l’église.
Sa haine pour ces gens qui refusaient d’ailleurs de se confesser à lui et allaient au monastère ou à Dijon pour ne pas passer par ses mains, s’accrut.
La situation s’avérait nette : le couvent et ses trois amis d’un côté, les hobereaux et lui, de l’autre.
Restait le village ; mais, là, la situation se compliquait. Les paysans, d’abord bien disposés pour le curé et furieux contre l’abbaye qui ne fournissait plus les médicaments depuis que le père Miné divaguait, — car personne n’était pharmacien dans la maison, — s’exaspérèrent aussitôt que leur nouveau pasteur leur réclama les frais des mariages et des funérailles. Ils s’aperçurent tout à coup que les Bénédictins unissaient et enterraient sans jamais exiger d’argent et les bonnes femmes découvrirent que, depuis que l’abbé Barbenton gîtait dans le presbytère, on avait supprimé les beaux offices du dimanche qui attiraient quelquefois du monde de Dijon.
Et la défense la plus sérieuse du chant grégorien, ce furent les aubergistes qui, lésés dans leurs intérêts, la prirent.
En attendant, la lutte avec le moine sacristain s’engagea sur toute la ligne ; mais le curé se heurta contre une force d’inertie qu’il ne put vaincre ; le P. Beaudequin lui fuyait comme du vif-argent entre les doigts ; c’était des : « peut-être, des ce serait à examiner, des nous y réfléchirons » et ce n’était jamais ni un oui, ni un non ; la remise des calices et des chasubles qu’il convoitait, ne lui ayant pas été consentie, il voulut au moins tâcher de contrarier les religieux qui, pendant les jours de la semaine, étaient maîtres du choeur et y célébraient leurs offices et il leur demanda d’avancer ou de retarder leur horaire, sous le prétexte qu’il serait ainsi plus à l’aise pour assurer le service des catéchismes et des convois.
— Il y a une règle de saint Benoît que je ne puis enfreindre et des habitudes que je ne suis pas maître de changer, répliqua Dom de Fonneuve ; il m’est donc impossible de vous satisfaire.
Le curé témoigna son mécontentement de ce refus, en n’assistant plus jamais aux offices. Il avait, en effet, arraché au père abbé, l’autorisation d’occuper une place, auprès de lui, avant la stalle du sous-prieur, relégué de la sorte au second rang ; il la laissa désormais vide, pensant sans doute que cette abstention froisserait les moines ; mais personne ne parut même remarquer ce manège. Alors, il rompit avec le mode d’escarmouches qu’il avait adopté, dès son arrivée au Val des Saints et il résolut de prendre une revanche de ces petits combats qu’il avait jusqu’alors perdus, en engageant une vraie bataille dont il préparerait, au préalable, le terrain.
Et il crut en avoir saisi l’occasion. Se rappelant que Mgr Triaurault répondait au prénom de Cyrille, il vérifia l’ordo monastique et constata que cette fête tombait un dimanche.
Il rendit visite au prélat et le supplia de venir déjeuner, ce jour-là, au presbytère, avec la noblesse des environs désireuse de lui souhaiter sa fête, et de daigner ensuite présider les Vêpres.
Mgr Triaurault était souffrant et peu soucieux de perdre ainsi son temps ; mais l’abbé insista de telle sorte, garantissant le prestige qui rejaillirait sur lui dans le pays, s’il parvenait à y amener son évêque, que sa grandeur, ennuyée, céda.
Alors, le curé radieux s’en fut proposer au père de Fonneuve, pour donner plus d’éclat à la cérémonie et faire plus d’honneur à monseigneur, de célébrer avec ses religieux les vêpres, dans l’église qu’il mettait, ce dimanche-là, à leur disposition.
Dom Prieur accepta et le curé sourit.
— Je voudrais, reprit-il, que la cérémonie fût vraiment magnifique et frappât l’imagination de nos paysans. Ils ont tellement l’habitude du chant de Solesmes que ce genre de musique ne les intéresse plus ; aussi ai-je pensé à y adjoindre quelques morceaux choisis parmi les meilleurs auteurs de notre temps. M. le baron des Atours, avec M. son fils, renforcés de l’un de leurs domestiques qui possède une belle voix, s’est offert pour les chanter, en haut, dans la tribune de l’orgue...
— Non pas, interrompit brusquement Dom de Fonneuve, je refuse de participer, moi et les miens, à ce concert. Il existe une liturgie Bénédictine que je ne souffrirai pas de voir sophistiquer par je ne sais quelles turelures. Nous célébrerons l’office tel qu’il est ou nous ne le célébrerons pas à l’église : c’est à prendre ou à laisser.
— Mais, je ne vous interdirai pas de chanter vos vêpres comme vous l’entendrez, répliqua le curé. Mon observation ne vise que le salut du saint-sacrement qui doit les suivre ; et, un peu méprisant, il ajouta :
Vous conviendrez bien, mon révérend père, que les petits saluts Bénédictins avec leurs deux chants qui précèdent d’habitude le Tantum Ergo et l’hymne de « Te Decet Laus » ou le psaume « Laudate Dominum omnes gentes » que vous entonnez après, sont courts et ne s’imposent pas, en tout cas, aux masses.
— Nos Saluts sont, de même que nos offices, liturgiques. Ils ne comportent aucun répertoire de fantaisie ; la question reste donc la même et je la résume en ces trois mots : tout ou rien.
— Diable, reprit le curé qui semblait réfléchir, j’ai en quelque sorte promis à Mgr Triaurault l’hommage de votre présence. Que dira-t-il, s’il ne vous voit pas à l’église ?
— Je l’ignore. Ces conditions vous vont-elles ?
— Impossible ; je froisserais M. le Baron et sa famille ; mais songez, mon révérend père, que sa grandeur trouvera certainement étrange l’attitude des moines qui disparaissent lorsqu’elle arrive.
— Monseigneur est trop juste pour ne pas comprendre le bien-fondé de ces motifs et je compte sur votre loyauté pour les lui faire connaître.
Le curé s’inclina. Ça y est, se dit-il, en quittant le P. de Fonneuve.
— C’est très malin, fit M. Lampre au prieur qui causait avec lui de cette aventure ; le curé vous empêche, en effet, d’accueillir ses propositions et il vous fâche avec l’Evêque.
— Qu’y puis-je ? répondit le vieux père ; le devoir avant tout !
Le comique de l’histoire fut que si ce piège du curé happa les moines, il l’appréhenda, lui aussi. Mgr Triaurault ne lui pardonna pas, en effet, de l’avoir attiré dans ce qu’il appelait un guet-apens d’irrespect et il le secoua vigoureusement, lui reprochant sa maladresse, aussi furieux contre lui que contre les Bénédictins, lorsqu’il partit.
A dater de ce jour, les relations cessèrent presque complètement entre le presbytère et l’abbaye ; puis le curé se vexa d’être tenu à l’écart et il chercha un moyen de détendre la situation ; la fête de saint Benoît qui était proche lui parut, pour ce dessein, propice.
Il pensa d’abord à se servir de Durtal comme d’intermédiaire pour obtenir d’être invité à dîner, ce jour-là, au cloître. Il s’arrangea de façon à le rencontrer et doucement lui dit :
— Eh bien, cher monsieur, vous allez faire votre profession d’oblature. Je serai très heureux d’y assister. Si elle doit avoir lieu, en dehors des offices monastiques, je m’arrangerai, ce jour-là, afin de vous livrer mon église, — et il appuya sur le mon, — pour l’heure qui vous plaira.
— Je vous remercie, monsieur le curé, repartit tranquillement Durtal, mais la profession d’oblature se fera non dans l’église abbatiale, — et il appuya, à son tour, sur le mot abbatiale, — mais dans l’oratoire du monastère ; c’est vous dire que, sauf les moines, personne n’y assistera, puisque l’oratoire est sis dans la clôture.
— Ah ! et vous dînerez sans doute à l’abbaye, ce matin-là ?
— Sans doute.
— Le réfectoire étant, lui aussi, situé dans la clôture, dit avec une pointe d’ironie, le curé, je me demande si hormis vous et les gens de la maison, d’autres personnes seront conviées à ce repas.
— Je l’ignore. En l’absence du père abbé qu’il remplace, le prieur est maître d’inviter ou de ne point inviter qui bon lui semble ; il est donc le seul qui soit à même de répondre à votre question.
— Votre serviteur, monsieur.
— Le vôtre, monsieur le curé, répliqua Durtal, en s’éloignant.
L’abbé Barbenton se dit : il n’y a rien à tirer de celui-là ; allons-y bravement et il se fit introduire chez le prieur. Là, il joua la comédie, déclarant qu’il déplorait tous ces malentendus, se déchargeant de ses torts sur le dos de l’évêque dont il était obligé de suivre les instructions ; enfin, il s’écria que sa mise en quarantaine, le jour de la fête de saint Benoît, produirait un effet désastreux dans le bourg et Dom de Fonneuve, touché, l’embrassa et l’invita au dîner.
Alors il s’enquit de savoir si le Révérendissime ne serait pas présent pour la cérémonie, dans son cloître.
— Ce n’est guère vraisemblable, répondit Dom de Fonneuve. Le père abbé est en Italie, au Mont Cassin où, comme vous le savez, l’un de ses frères est profès ; et de là, il doit se rendre à Rome pour y voir le Primat ; il ne sera donc pas ici, avant une quinzaine.
Le curé qui craignait que les moines ne lui jetassent des bâtons dans les jambes, en mettant le révérendissime au courant de ses manigances, s’en fut, rassuré, décidé, du reste, à se réconcilier avec tout le monde, avant le retour de Dom Bernard.
Pendant ce temps, Durtal se préparait par quelques jours de retraite, à son oblature. Il passait alternativement entre les mains de Dom Felletin, le maître des novices et de Dom d’Auberoche, le cérémoniaire.
L’un l’interrogeait sur la règle de saint Benoît et l’autre qui entendait que la cérémonie d’oblature fût impeccable, le contraignait à saluer et à marcher dans tous les sens. Il aurait voulu que Durtal chantât, par trois fois, en haussant, chaque fois, la voix d’un ton, l’essentiel « Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam et non confundas me ab expectatione mea », accompagné du Gloria Patri, répété par tout le choeur. Ce verset du psaume 118 prescrit, pour la profession de ses moines, par saint Benoît, lui-même, dans le chapitre 58 de sa règle, était admirable lorsqu’il était revêtu de sa robe très simple de plain-chant. Il était timide et suppliant jusqu’à sa médiante, puis il s’élevait plus rassuré, toujours implorant mais plus ferme ; et, à chaque fois, il s’enhardissait, encouragé par l’accent résolu, sûr, des religieux le reprenant, affirmant à leur nouveau frère la certitude du désir exaucé, l’assurance qu’il ne serait pas confondu dans son attente.
Et cette formule, divinement magique, était si décisive que les plus anciens profès ne pouvaient s’empêcher de trembler jusqu’au fond de l’âme, lorsqu’ils l’entendaient chanter et la chantaient eux-mêmes, à chaque profession.
Durtal que l’intonation à décocher toujours plus haut, dans le silence de la chapelle et sans le soutien d’un orgue, épouvantait, avait fini par obtenir du P. d’Auberoche qu’il la psalmodierait tout bonnement et qu’il en serait de même pour les pères et les novices présents à la cérémonie et qui devaient doubler chaque fois, le verset, après lui.
Et c’étaient des répétitions ininterrompues, des salutations médiocres ou profondes, des agenouillements, sur la première ou sur la dernière marche de l’autel, des façons rectifiées de déployer contre sa poitrine la charte de profession, comme sur cette statue que l’on voit dans les montres religieuses et qui représente un chevalier tenant une banderole sur laquelle est inscrit le verbe « Credo » ; c’étaient des effacements de corps permettant d’évoluer dans la place restreinte de l’oratoire.
Enfin Durtal parvint à contenter Dom d’Auberoche ; le P. Felletin, lui, ne se souciait ni des gestes, ni des détails liturgiques, il expliquait l’oblature, planant au-dessus des âges, heureux d’avoir un novice qui connaissait aussi bien que lui la matière et il parlait de l’avenir, certain d’être compris.
— Il convient d’abord de se bien persuader, disait-il, que l’oblature de saint Benoît ne peut, ainsi qu’une oeuvre populaire, se diffuser ; elle ne s’adresse qu’à une élite et ne peut par conséquent rester qu’à l’état d’exception ; elle requiert, en effet, des postulants des conditions particulières, malaisées à remplir. Sa raison d’être, c’est la liturgie ; la vie du moine c’est la louange de Dieu, la vie de l’oblat sera aussi la louange de Dieu mais réduite à ce qu’il en pourra prendre ; pour atteindre ce résultat, il ne suffit point d’être fidèle à ses devoirs et de communier plus ou moins fréquemment, il faut aussi avoir le goût de la liturgie, le sens du cérémonial, l’amour de la symbolique, l’admiration de l’art religieux et des beaux offices.
Les oblats qui réuniront ces conditions — Dieu veuille, qu’ils soient nombreux, mais j’en doute — vivront donc autant que possible cette partie de l’existence monastique qui s’écoule à l’église, autrement dit, ils devront résider dans le cloître ou dans ses alentours.
Je ne me figure pas du tout, en effet, des oblats épars dans des villes telles que Paris, Lyon ou Marseille, n’ayant aucun rapport quotidien avec le monastère auquel ils appartiennent, n’assistant pas, par conséquent, à la messe conventuelle et aux vêpres chantées de chaque jour, ne s’assemblant qu’une ou deux fois par mois, comme à un son de corne, à l’abbaye. Ainsi comprise, l’oblature ne serait plus qu’une petite confrérie et il y en a assez, je pense, pour que nous n’en ajoutions pas une de plus à celles qui subsistent.
Ce serait, d’autre part, une grave erreur que d’assimiler l’oblature à un tiers ordre, puisqu’un tiers-ordre incorpore tous les gens, fussent-ils les plus incompréhensifs du monde, pourvu qu’ils soient des chrétiens zélés et des catholiques pratiquants.
Nous, au contraire, nous cherchons la qualité et non la quantité : il nous faut des savants, des lettrés et des artistes, des personnes qui ne soient pas exclusivement des dévots...
— Pas de marguilliers édifiants et de sacristes pieux ! s’écria Durtal.
— Oui, dit, en souriant, le père Felletin. Notre but n’est pas d’ailleurs d’improviser de doubles emplois avec les tiers-ordres des autres instituts, qui ont leur utilité car ils rendent service aux masses ; nous n’avons pas à marcher par exemple sur les brisées des Franciscains qui bénéficient d’une puissance séculairement acquise ; nous leur serions, du reste, au point de vue du prosélytisme et de l’organisation, très inférieurs.
Et puis, ayons le courage de l’avouer, en agissant de la sorte, nous duperions nos novices qui auraient plus d’intérêt à s’affilier au troisième ordre de saint François, car il est en pleine vigueur et assure à ses tertiaires des avantages que nous serions bien incapables de leur offrir ; Notre Seule force, à nous, ne peut résider que dans l’efficace des oraisons liturgiques et des offices ; et comment en faire réellement profiter des gens qui n’y prendraient aucune part et ne seraient imbus à aucun degré de cet esprit Bénédictin sans lequel aucune entrée dans notre ordre n’est ou ne devrait être possible ?
Non, plus j’y pense, et plus je suis convaincu que la seule oblature qui soit enviable est celle du Moyen-Age, celle du laïque habitant, comme je l’ai déjà dit, auprès ou dans l’intérieur d’un couvent vivant plus, en somme, dans la communauté que dans le monde, suivant régulièrement les exercices religieux des moines.
Ainsi comprise l’oblature est pratique surtout pour les artistes ; elle leur donne l’appui des grâces monastiques, l’aide même du patriarche et elle leur laisse toutefois une certaine liberté ; et, à ce propos, je dois le confesser, il y aurait, selon moi, tout avantage pour un artiste à ne pas résider dans la clôture de l’abbaye mais à sa porte. Fatalement, en effet, avec l’internement même mitigé, une sujétion s’impose et pour peu que l’abbé ou que le père, chargé de la direction des oblats, ait des idées arrêtées en esthétique et quelles idées souvent ! C’est le conflit et, au nom de l’obéissance, l’étouffement de la personnalité, la mort de l’art.
L’échec de l’abbaye de Beuron est, à ce point de vue, typique. On a voulu enfourner tous les peintres que détenait le couvent dans le même moule et l’on a tué le talent de chacun, pour ne produire que des peintures similaires, conçues d’après une formule unique, et destinées par cela même à devenir, au bout de peu d’essais, des rengaines.
La question se résume donc pour moi ainsi : direction spirituelle, énergique, de la part du religieux maître de l’oblature, et abstention pour tout le reste.
Maintenant, à titre de document, je vous signale une tentative bien oubliée — la plupart même des nôtres l’ignorent-qui eut lieu à Solesmes, sous le gouvernement de Dom Couturier.
Cet Abbé avait rêvé de rénover l’enluminure, cette gloire des abbayes Bénédictines d’antan ! Il possédait justement, avec M. Cartier, à demeure dans le cloître, un oblat, Anatole Foucher, le dernier artiste, qui, à l’heure présente, dispose de la science liturgique et ait le talent nécessaire pour continuer cet art exquis du Moyen-Age.
Il a façonné de remarquables élèves au monastère des Bénédictines de Sainte-cécile et il allait commencer de former certains moines qui étaient doués pour ce genre de travail, lorsqu’à la suite des décrets, en 1880, l’expulsion a dispersé la communauté dans le village. M. Foucher a alors quitté Solesmes et ce projet est naturellement tombé à l’eau.
A combien se montent actuellement les oblats, réfugiés dans l’intérieur des cloîtres de la congrégation de France ? Je ne le sais, d’une manière précise, car mes renseignements datent de plusieurs années déjà et d’aucuns ont pu, depuis ce temps, rentrer dans le monde.
En tout cas, il y en avait un, en robe, qui était prêtre, à Solesmes et qui se trouve aujourd’hui au prieuré de Farnborough, en Angleterre ; deux existaient à Ligugé, l’un, en robe, l’autre en laïque, mais tous les deux sont partis pour saint Wandrille où le premier s’est fait père. Il y en avait un aussi, en robe, à Paris, au prieuré de la rue de la Source et puis... ma foi, je crois bien que c’est tout.
Autour des abbayes, domiciliées dans les villages mêmes où elles sont situées, je n’en connais que cinq, dont une oblate, à Ligugé. Il y aurait, d’autre part, à saint Wandrille, un petit noyau d’affiliées ; ont-elles été régulièrement constituées ? Je l’ignore. A Solesmes, les quelques parents de religieux qui assistent assidûment aux offices sont-ils de réels oblats, ayant fait profession au monastère ? j’en doute. Quant à ceux qui résident où ils veulent et ne participent pas à la vie liturgique, ils sont assez nombreux à Paris, mais je le répète, cette sorte d’oblature n’a rien à démêler avec l’oblature du Moyen Age, avec l’oblature proprement dite.
Vous le voyez, le nombre des oblats est incertain et infime ; le fil n’a pas été rompu depuis le huitième siècle jusqu’à nos jours, mais ce qu’il est ténu !
Enfin, peut-être grossira-t-il ; en attendant que des compagnons s’adjoignent à vous, vous devenez demain le premier oblat moderne du Val Des Saints ; vous allez profiter plus effectivement de cet afflux de prières qui s’est accumulé dans cet ancien prieuré, pendant tant de siècles ; vous bénéficierez comme nous, au même titre que nous, de cette fruition des grâces dont la communauté de Solesmes a été investie, lorsque le pape Grégoire XVI l’institua l’héritière des privilèges accordés par ses prédécesseurs aux congrégations de Cluny, des saints Vanne et Hydulphe et de saint Maur. Le patrimoine, vous aiderez à le garder et vous y ajouterez vous-même, en vous associant à nos efforts liturgiques ; et lorsque le moment du repos sera proche, vous revêtirez l’habit du moine dans lequel vous serez inhumé et le patriarche, fidèle à sa promesse, interviendra en votre faveur auprès de l’exorable Juge.
Encore que vous ne prononciez aucun voeu, vous promettez devant l’autel, pendant le sacrifice de la messe, avant de recevoir le corps de Notre-seigneur, la conversion de vos moeurs, vous vous engagez à vivre, le plus saintement possible, en Dieu. Vous renoncez, en somme, à tout ce qui fait pour l’homme charnel la joie de la vie et c’est une existence d’être retiré déjà du monde, qu’il vous faudra désormais mener. Puisse-t-elle être douce et vous contenter ; puisse-t-elle surtout être agréée par les sacrifices qu’elle exige, du Tout-Puissant, là-Haut !
Alors, c’est bien convenu, n’est-ce pas, la cérémonie aura lieu pendant la messe de six heures et ce sera, au moment de l’offertoire, que vous vous lierez, par une cédule qui sera conservée dans les archives de l’abbaye, au grand ordre de saint Benoît.
— C’est entendu, père, priez pour moi.
— Vous pouvez y compter, mon cher enfant, et mes prières ne seront pas isolées, je vous l’affirme. Tous les petits novices qui se réjouissent d’avance d’être présents à cette messe ne vous oublieront pas.
Allons, le sort en est jeté, songea Durtal, en quittant la cellule du père ; à dire vrai, je ne me sens pas un bien éclatant mérite à repousser ce qu’on appelle les blandices terrestres ; j’ai répudié, de moi-même et depuis bien des années, tout ce qui flatte le goût des autres ; mais voilà, jusqu’ici, je n’y étais pas forcé, j’agissais de mon plein gré ; n’est-il pas à craindre maintenant, étant donnée la bêtise de la nature humaine, que par ce fait seul que j’ai souscrit à un engagement, je ne souffre d’être obligé de le tenir ?
Eh bien, tant mieux, ces mérites que je n’ai pas, je les acquerrai si je subis des jours de tentations et de regrets !
C’est égal, reprit-il, en allumant une cigarette, il convient d’avouer que, comme descendant des oblats des premiers siècles, je suis plutôt débile. L’ermite du Mont Cindre, le successeur des reclus de Lyon et, moi, le successeur des oblats du Val des Saints, nous formons la paire. Il me semble que nous sommes à de vrais moines ce que sont à de vrais soldats, ces hideux mioches que des familles égarées affublent de costumes militaires et promènent par les rues, une trompette dans la bouche et une chandelle sous le nez.
Il rentra chez lui et trouva Mme Bavoil exacerbée.
— Je ne comprends pas, grognait-elle, que des femmes ne puissent être admises à votre profession ; moi, je suis tertiaire de saint François et l’on n’use pas de pareilles cachotteries dans cet Ordre.
— Mais les Franciscains ne sont pas en clôture, ma bonne madame Bavoil.
— Je n’en sais rien, je ne sais qu’une chose, c’est que demain, moi, et, ce qui est plus violent encore, votre soeur l’oblate, Mlle de Garambois, nous sommes tenues à l’écart, dans l’impossibilité de prier près de vous.
— Vous prierez à distance, Madame Bavoil ; d’ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de la souveraine beauté que dégage une profession monastique, ce n’est pas celle de l’oblature qu’il faudrait voir ; elle n’est qu’un abrégé, qu’un raccourci, qu’une dilution homoeopathique de celle des moines — et ce n’est même pas encore à celle des Bénédictins, qui est superbe pourtant, mais à celle des moniales qu’il siérait d’assister.
L’altitude absolue de la liturgie et de l’art est là. La profession des moniales de saint Benoît ! Il y a des moments où, pendant l’extraordinaire cérémonie, le petit frisson de la splendeur divine vous fait trémuler l’âme et où l’on se sent exalté, projeté hors de soi-même, si loin de la banalité du monde qui vous entoure !
Oui, à certains instants, l’on a envie de bramer l’admiration qui vous étouffe ! Le chef-d’oeuvre de l’art ecclésial, c’est peut-être le Pontifical des Vierges. L’on est pris, dès le début, aux moelles ; alors qu’après le verset alleluiatique de la messe, l’évêque ou l’abbé qui officie, s’assied, en haut de l’autel, sur le falstidorium, le siège des prélats, en face du public, et que le maître des cérémonies ou l’assistant entonne cette phrase empruntée à la parabole des Vierges, de saint Matthieu :
« Vierges prudentes, apportez vos lampes, voici l’époux qui arrive ; allez au-devant de Lui. »
Et la vierge, tenant un flambeau allumé, fait un pas et s’agenouille.
Alors le prélat, qui représente le Christ, l’appelle debout, par trois fois, et elle répond en d’admirables antiphones : — « Me voici » — et elle s’avance, à mesure, plus près. L’on dirait d’un oiseau que fascine un bon serpent.
Et, d’un bout à l’autre, l’office se déroule, éloquent, presque massif, ainsi que pendant l’ample et la forte préface ; caressant et comme parfumé par toutes les essences de l’Orient, alors que le choeur des nonnes chante ces phrases du Livre De La Sagesse : « Viens, ma bien-aimée, l’hiver est passé, la tourterelle chante, les fleurs de la vigne embaument » ; délicieux vraiment en cet épisode des fiançailles où la novice acclame le Christ, s’affirme « fiancée à celui que les anges servent, à celui dont les astres du ciel admirent la beauté » ; puis, levant le bras droit en l’air, elle montre son doigt où brille la bague bénie par le prélat et, folle de joie, s’écrie : « Mon Seigneur Jésus-Christ m’a liée à lui par son anneau et il m’adorne telle qu’une épouse ! » — Et de très antiques oraisons sanctifient, macèrent ainsi que dans de célestes aromates la petite Esther qui, regardant le chemin parcouru depuis la probation et songeant que le mariage est maintenant consommé, chante, au comble de ses voeux : « Enfin, voici ce que j’ai tant désiré, je tiens ce que j’ai tant espéré, je suis unie dans les cieux à celui que j’ai tant aimé sur la terre... » et, après la récitation de la préface, la messe continue...
Que sont, en comparaison de ce drame vraiment divin qui se joue entre l’âme et Dieu, les pauvres machines inventées par les théâtriers anciens ou modernes ? Mon Dieu, les serins !
— Oui, mais malheureusement, il n’y a pas de couvent de Bénédictines ici, et je ne verrai jamais cela, fit Madame Bavoil.
— C’est pour vous dire simplement que la cérémonie de l’oblature est, si on la rapproche de celle-là, si minime qu’elle n’est même pas intéressante à contempler. Que cette certitude vous console de n’y pouvoir assister !
Le lendemain matin, après avoir répété telles qu’une leçon, ses réponses latines aux questions que devait lui poser le prieur, Durtal s’achemina vers le cloître.
Il se sentait perturbé, mal à l’aise et il aurait bien voulu que cette fête fût déjà terminée. Tout ce côté d’attitude, de décor, auquel tenait tant le père cérémoniaire l’inquiétait. Il craignait de se tromper ; et cette appréhension l’empêchait de penser à l’acte qu’il allait accomplir et à la communion qui devait le suivre. Ah ! Seigneur, je songe à tout, excepté à vous, murmurait-il ; ce que je serais mieux à vous prier, seul à seul, dans un coin !
Il rencontra sous les galeries les novices ; ils souriaient, en le saluant, mais aucun ne parlait ; l’heure du grand silence qui commençait après les complies, la veille, ne devant cesser qu’après prime, c’est-à-dire vers les sept heures.
Ils entrèrent avec lui dans l’oratoire ; et bientôt Dom Felletin et Dom d’Auberoche, en coule, arrivèrent à leur tour et se dirigèrent vers la sacristie où le père prieur s’habillait pour dire la messe.
Puis ce furent quelques moines, le père hôtelier, le zélateur, le père sacristain qui allèrent s’agenouiller dans les stalles.
Cet oratoire était une pièce minuscule, voûtée en cul-de-four et dallée de pierre ; elle était l’un des restes les plus curieux de l’ancien prieuré du Moyen-Age et elle avait dû alors être utilisée comme la desserte des vastes cuisines qui l’avoisinaient. On l’avait malheureusement parée de tièdes statues de la Vierge et du Sacré-coeur qui évoquaient les plus offensants souvenirs du Paris de la rue Bonaparte et de la rue Madame. Dom Felletin et Dom d’Auberoche n’étaient pas en cette chapelle, ainsi qu’au noviciat, maîtres de reléguer dans des combles ces pieuses horreurs et les autres religieux s’en accommodaient, tant bien que mal ; elles étaient là ; il ne serait venu à aucun d’eux l’idée de les changer.
La messe était servie par le frère Gèdre, un petit novice à mine fûtée, avec des yeux de souris, noirs. On le surnommait le frère « trotte-menu », tant, en effet, il se faufilait, souriant, regardant, toujours satisfait et toujours heureux. Il ne s’évadait de ses prières que pour se ruer sur le grec. Il en raffolait, mais les bons hellénistes manquaient au cloître et il était obligé de s’exercer tout seul ; c’était là le seul souci de cette existence qui s’écoulait dans la joie perpétuelle de vivre en Dieu, d’être moine.
Il avait été si peu gâté jusqu’alors, le pauvre enfant, qu’au point de vue matériel même, le monastère lui semblait être un rêve de confortable, un lieu de délices et de luxe.
Il avait été orphelin, seul, sans frère ni soeur, dès l’enfance, élevé par charité dans un établissement congréganiste ; il avait toujours mangé les ratatouilles et bu les débiles abondances des pensions ; il avait toujours couché en dortoir, n’avait jamais disposé d’une minute de liberté, d’un sou pour acheter même une image. A la fin de ses études, il était passé, sans aucune transition, de son collège au Val Des Saints.
Et là, il était chez lui, il avait une cellule à lui ; la vie en commun, si pénible pour les laïques qui renoncent au monde, ne le gênait point, attendu qu’il ne se figurait pas que l’on pût vivre autrement ; la nourriture du couvent lui paraissait si bonne qu’il se privait de certains plats de peur de devenir gourmand ; et la liberté du noviciat lui semblait extravagante en comparaison de celle du pensionnat.
Et pourtant il avait des heures d’affliction. Un jour, il avait dit à Durtal qui lui demandait la raison de sa mélancolie : ah ! Ce que l’on souffre au cloître !
Durtal se perdait en conjectures, tout en essayant de le réconforter. Au fond, sa souffrance venait simplement de ceci qu’au lieu de jouer le rôle de cérémoniaire qu’il devait prendre à la messe de ce matin-là, on l’avait chargé de faire « céroféraire » ; c’était pour lui comme un passe-droit et une déchéance.
C’était la tristesse d’un gosse auquel on enlève son bâton de sucre d’orge pour le donner à sucer à un autre ; ç’eût été évidemment risible si l’on ne savait que d’aucuns pâtissent autant pour un petit détail que d’autres pour des causes vraiment graves. N’était-ce pas la preuve, du reste, de la nécessité de cette douleur à laquelle nul n’échappe ? Que le motif fût sérieux ou futile, elle n’en atteignait pas moins les gens. Imperméable sur certains points qui suppliciaient sans doute ses frères du noviciat, le frère Gèdre était torturé par des riens et le terrible P. Emonot, qui l’avait remarqué, ne le ménageait pas, le frappant à l’endroit sensible, lui infligeant des humiliations de ce genre, le plus qu’il pouvait, pour briser en lui toute vanité, pour le détacher de lui-même, pour le façonner sur le modèle d’un véritable moine.
Mais ce matin-là, l’enfant était joyeux et il eut un petit sourire de tendresse, en regardant Durtal agenouillé, lorsqu’il sortit de la sacristie, précédant Dom De Fonneuve, à l’autel.
Durtal essaya de s’absorber dans sa messe, mais il déraillait à chaque prière ; la peur de s’embrouiller tout à l’heure, dans ses réponses, le dominait. Que je voudrais donc que cette cérémonie fût close ! se disait-il.
Au moment de l’offertoire, elle s’ouvrit.
Dom Felletin et Dom d’Auberoche montèrent à l’autel et se tinrent de chaque côté du prieur.
Durtal quitta sa place et vint s’agenouiller devant eux, au bas de l’autel.
Alors le prieur se signa, prononça le « Domine labia mea aperies », le « Deus in adjutorium », le Gloria, puis il commença de réciter le psaume 64 : « Deus misereatur nostri » dont les versets furent psalmodiés par les deux choeurs alternés des profès et des novices et s’adressant à Durtal :
— Quid petis ? Que demandez-vous ?
— La miséricorde de Dieu et votre confraternité, en qualité d’oblat de notre très saint père Benoît.
Lentement, le prieur répondit, toujours en latin.
— Mon fils, vous connaissez suffisamment, non seulement pour l’avoir lue, mais encore pour l’avoir pratiquée et essayée pendant tout le cours d’une année, la loi sous laquelle vous voulez militer. Vous n’ignorez pas les conditions de l’engagement à contracter pour entrer dans notre confraternité. Si donc vous êtes résolu à observer les salutaires préceptes de notre très saint père Benoît, approchez ; sinon vous êtes libre de vous retirer.
Puis, après un instant de silence, voyant que Durtal ne bougeait pas, il reprit :
— Voulez-vous renoncer aux vanités et aux pompes du siècle ?
— Volo.
— Voulez-vous entreprendre la conversion de vos moeurs, suivant l’esprit de la règle de Notre Saint père Benoît et observer les statuts des oblats ?
— Volo.
— Voulez-vous persévérer dans votre entreprise jusqu’à la mort ?
— Volo, gratia Dei adjuvante.
— Deo gratias. Que Dieu vous soit en aide. Puisque vous mettez votre confiance dans son secours, il vous est permis de faire votre profession d’oblat.
Durtal se releva et debout, devant l’autel, il lut à haute voix la charte de profession écrite sur parchemin et qui débutait par le « Pax » Bénédictin et la formule « In nomine Domini nostri Jesu Christi, Amen. »
Et il lisait, d’un ton mal assuré, le texte latin attestant l’offre qu’il consentait de lui-même au Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, au saint père Benoît pour le monastère du Val Des Saints, et promettant la conversion de ses moeurs suivant la règle du patriarche, s’y engageant en présence de Dieu et de tous les saints.
Quand ce fut terminé, le maître des cérémonies vint le chercher et ils montèrent en haut de l’autel et, là, à la place des evangiles, il posa sa charte et la signa d’une croix d’abord, puis de son nom et de ses prénoms laïques, enfin du nom monastique de frère Jean, qu’il devait porter.
Il redescendit, accompagné du cérémoniaire, les marches de l’autel, et tenant, de ses deux mains, le parchemin grand ouvert sur sa poitrine, il le présenta aux religieux debout dans les stalles ; et ils regardaient la signature et s’inclinaient.
Quand il eut fait ainsi le tour de l’oratoire, Dom d’Auberoche lui reprit la cédule qu’il enveloppa dans un corporal et remit sur l’autel.
Et Durtal s’agenouilla de nouveau, au-dessous de la dernière marche et les bras croisés en X, le front touchant presque cette marche, il prononça par trois fois, en haussant, chaque fois, le ton, le « Suscipe » que les moines psalmodiaient après lui.
Alors le prieur se retourna vers l’autel et après le Kyrie Eleison et le pater noster, il entama la série des longs versets de la rubrique auxquels répondirent les assistants, prononça l’oraison demandant au Seigneur, par l’intercession de saint Benoît, d’accorder à son serviteur d’être fidèle aux promesses qu’il venait de signer et après que Durtal eut murmuré : Amen, il dit :
« Nous, prieur de l’abbaye du Val-des-Saints, agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été octroyés par le révérendissime abbé de saint Pierre de Solesmes de la congrégation française de l’ordre de saint Benoît, par les mérites de ce même patriarche Benoît, de sa soeur la vierge sainte Scholastique, des saints Placide, martyr et Maur, abbé, de la séraphique vierge Gertrude, de saint Henri, confesseur et de sainte Françoise, veuve et des autres saints et saintes de notre ordre, nous vous recevons dans Notre Société et fraternité, vous donnant part à toutes les bonnes oeuvres qui se font avec le secours du Saint Esprit dans la congrégation de France de l’ordre de saint Benoît. « Que Dieu vous reçoive au nombre de ses élus, qu’il vous accorde la persévérance finale, qu’il vous protège contre les embûches de l’ennemi et qu’il vous conduise à son royaume éternel, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. »
— Amen, soupira Durtal.
Et il s’inclina plus bas, tandis que le prieur, l’enveloppant d’un grand signe de croix d’eau bénite, proférait :
« Pax et benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti descendant super te et maneant semper. »
Et la messe reprit.
Durtal retourna à sa place. Lorsque le moment de la communion fut venu, il fut vraiment touché, en voyant tous les novices qui n’étaient pas prêtres l’escorter à l’autel. Tous, au lieu de communier ainsi que d’habitude, dès l’aube, s’étaient réservés pour cette messe-là.
Le sacrifice s’acheva ; quand Durtal eut dit son action de grâce, il s’échappa de l’oratoire. Il étouffait dans cette atmosphère raréfiée et il était obsédé par le désir d’être, une minute, seul avec Dieu ; il traversa le cloître et s’en fut, pour se recueillir, dans l’église, en un coin.
Elle était noire et balayée par une âpre bise. Il s’affala sur une chaise, s’écouta et un immense silence descendit en lui ; c’était comme un vide d’impressions, comme une tombe de pensées ; il réagit, d’un effort violent ; alors toutes sortirent à la fois, en désordre, ronronnant, de même que des bourdons, dans un tambour ; il tâcha de les trier, de n’en garder par devers lui que quelques-unes, mais une idée surgit, renvoyant Dieu, l’oblature, toutes les autres réflexions dans les ténèbres de la mémoire, s’implantant, saillant, seule, en pleine lumière l’idée qu’il avait oublié d’avertir la mère Bavoil qu’il déjeunait, à midi, au monastère.
Et elle devint si tenace, si stupidement aiguë, qu’exaspéré contre lui-même, il retourna chez lui, grognant : quand j’aurai bu une goutte de café noir et grignoté une croûte de pain, peut-être arriverai-je à me ressaisir.
Une fois rentré, il fallut raconter, point par point, à Mme Bavoil la scène de l’oratoire.
Enfin, vous ne vous êtes pas trompé, c’est le principal, conclut-elle ; quant à vous voir d’ici à ce soir, bernique ! — Car je pense bien qu’après la grand’messe, qui se terminera tard, vous irez directement au réfectoire.
— Vous l’avez dit.
Et Durtal s’en fut effectivement à la grand’messe. Le tapis de Smyrne, les reliques, les veilleuses y étaient ; mais l’absence de l’abbé dont la stalle était cependant parée de velours rouge, réduisait le gala de la cérémonie qui n’était plus célébrée sur le mode Pontifical.
Avant la messe, il y eut procession sous les arcades de l’abbaye. Précédés du thuriféraire, de la croix, des deux portes-flambeaux, les convers drapés dans leurs coules brunes, marchaient en tête, suivis par les postulants et les novices, puis par les moines et les chantres habillés, et le prieur venait le dernier, accompagné, à quelques pas derrière, par M. Lampre et Durtal.
Et l’on s’avançait, deux à deux, doucement, dans un relent envolé d’encens ; l’on parcourut ainsi les quatre galeries qui formaient le carré du cloître et l’on rentra par où l’on était sorti, dans l’église où la messe commença.
Cette messe de saint Benoît, elle était, au point de vue du texte, exquise ; elle avait conservé le graduel et le trait, l’evangile et la communion de la délicieuse messe des abbés, mais elle débutait par le « Gaudeamus » des cocagnes liturgiques, était pourvue d’une epître spéciale très bien appropriée aux vertus que l’on adulait du patriarche, d’une séquence moins heureuse, en ce sens que si elle était habile à rappeler en ses courtes strophes les personnages de la Bible auxquels pouvait se comparer le saint, elle manquait trop de naïveté, et, avec son latin qui se croyait élégant, sonnait faux.
Quant au plain-chant, il était celui du répertoire de luxe, c’est-à-dire qu’il était prétentieux et médiocre. Le Kyrie à filandres et à tirebouchons, le Gloria de toit et de cellier, le Credo pour pochette de maître de danse, tout s’y trouvait.
Evidemment, soupirait Durtal, ma conviction s’affirme davantage, chaque jour, que les rénovateurs de la musique grégorienne sont partis d’un principe faux, alors qu’ils ont distribué les différentes parures des messes. Ils se sont imaginé que plus les pièces étaient chantournées et remorquaient à leur suite des caravelles exagérées de neumes et mieux elles convenaient au rite élevé des fêtes et étaient aptes à en rehausser l’éclat ; et pour moi, ce serait plutôt le contraire ; car plus le plain-chant est simple et naïf et plus il est éloquent et mieux il rend, en une langue d’art vraiment unique, l’allégresse ou la douleur qui sont, en somme, les deux sujets dont traitent les services de l’église, selon le Propre du Temps.
Quoi qu’il en soit, cette messe, après celle de saint Joseph qui l’antécédait sur le calendrier, était d’autant mieux la bienvenue qu’elle tranchait sur celles de carême, dont le défilé ne s’était pas interrompu, pendant toute la semaine d’avant. Partout l’ordo portait la mention : « de feria », c’est-à-dire office du propre, différent chaque jour, superbe du reste, mais bref ; plus de gloria, de credo, d’ite missa est, d’orgue ; le trait substitué à l’alleluia, le te deum interdit aux matines, deux cierges tout juste allumés ; les jours où il y avait diacre et sous-diacre, le diacre arborait son étole violette en buffleterie, le sous-diacre la sienne, relevée, en tablier ; et les messes étaient précédées des trois petites heures défilant à la suite.
Ces messes variées rompaient la monotonie des éternelles messes du commun et étaient dotées d’un Kyrie très ancien, court, sec, dansant, curieux par sa candeur d’enfant gâté, par sa naïveté de plainte presque joyeuse, sûre d’être accueillie.
Les Vêpres étaient transférées avant le déjeuner, car logiquement elles devaient être débitées à jeun et l’on n’aurait pu se sustenter avant cinq heures du soir, si l’horaire coutumier avait été suivi ; et ces vêpres de férie étaient une surprise. On les récitait si rarement ! L’on n’entendait plus le « Dixit Dominus Domino meo » et les psaumes rebattus du dimanche. Ils changeaient, sans doubler l’antienne, chaque jour ; et, le lundi, l’on pouvait enfin écouter le magnifique « In exitu Israel de Aegypto » que l’on ne chante presque jamais dans la liturgie Bénédictine.
Les Vêpres de saint Benoît ramenaient la monnaie courante des psaumes, mais leur inintérêt était sauvé par de splendides antiennes, celle de Sexte surtout, le « gloriosus Confessor Domini ». Elles eussent été parfaites sans une hymne aussi médiocre que celle de la messe, le « Laudibus cives resonent canoris », puant la langue païenne, le latin de la Renaissance, avec son Olympe mis tout le temps à la place du ciel, une hymne qui sentait la commande, le devoir de collège, le pion.
Mais, les hymnes de cette fête exceptées, ce temps de la sainte quarantaine était, au point de vue liturgique, admirable ; la tristesse y allait grandissant chaque jour, avant que d’éclater en les lamentables impropères, en les douloureux sanglots de la Semaine Sainte.
Cette période de tristesse et d’expiation avait été, elle-même, devancée par les mélancoliques semaines de la septuagésime, au début desquelles l’on pratiquait naguère l’abstinence, en ensevelissant l’allégre et le fol alleluia.
Et Durtal se rappelait, en souriant, que l’on procédait autrefois à son inhumation ainsi qu’à celle d’une grande personne, tant ce cri d’allégresse semblait vivant et intimement lié à Notre-seigneur, avec lequel il ressuscitait, le dimanche de Pâques.
Au douzième siècle, il avait même existé tout un office de ces funérailles fixées au samedi, veille de la septuagésime. Cet après-midi-là, après none, les enfants de choeur sortaient en procession de la sacristie, avec la croix, les torches, l’eau bénite, l’encens et ils portaient, en guise de corps, un peu de terre, traversaient le choeur de l’église et se rendaient au cloître où l’on aspergeait et encensait l’endroit choisi pour la sépulture.
C’était la mort d’une expression et le trépas momentané d’un chant ; c’était l’éclipse de gaies et de prodigues neumes, et l’on gémissait cérémoniellement de les avoir perdues ; et le fait est que les alleluias du répertoire grégorien étaient, pour la plupart, si délibérément exquis que l’on s’attristait de ne plus les chanter et que l’on se réjouissait, de bon coeur, alors qu’ils renaissaient avec le Christ.
Cette funèbre vie liturgique que nous avons commencée avec la Septuagésime, qui est la probation du Carême, comme lui-même est le noviciat de la passion et de la Semaine Sainte, va s’assombrir encore avec les préludes de Pâques, et ce sera enfin fini, murmurait Durtal ; et je n’en serai vraiment pas fâché, car ces jeûnes et ces maigres répétés m’excèdent ; vrai, le brave saint Benoît aurait bien dû, à l’occasion de sa fête, nous permettre d’user d’aliments gras ! Va te faire fiche, l’austère morue va, une fois de plus, sévir, continua-t-il, en emboîtant le pas derrière les moines qui rejoignaient le cloître par la petite porte ouverte dans le fond de l’église. De nombreux prêtres des environs, quelques Dominicains, invités par le père prieur, se promenaient sous les galeries. Il y eut échange de présentations. Durtal cherchait un joint pour aller fumer une cigarette dans le jardin, quand il fut accaparé par le curé. Il l’emmena dans une allée et là, en attendant l’heure du repas, le prêtre lui raconta les cancans du village. Vous connaissez la fille Minot, disait l’abbé, et Durtal secouait la tête ; mais vous connaissez au moins sa soeur qui a épousé Nimoret ? et Durtal secouait encore la tête.
— Ah çà, mais vous ne connaissez donc personne ici ! s’exclama le curé, ahuri et un peu défiant.
— Non, à part la mère Vergognat mon ancienne bonne et le vieux Champeaux que j’emploie pour ratisser les allées du jardin, je ne fréquente personne ; je me borne à faire la navette de ma maison au cloître. Je me ballade parfois dans le jardin et vais à Dijon ou chez M. Lampre et Mlle de Garambois, mais je n’ai aucun rapport avec la population du pays que je sais libidineuse et cupide, ainsi que celle de toutes les campagnes, du reste.
L’Angelus sonna et mit fin à l’entretien ; ils regagnèrent les arcades du cloître. Dom Prieur lava les mains de tous les invités qui se pressaient à la queue leu-leu devant la porte du réfectoire et, au son d’une lecture tombant en ondée monotone sur les tables, le dîner commença.
Il n’y avait point la morue prédite, mais une anguille chapelurée, nageant dans une eau échalotée qui sentait le cuivre, des oeufs mollets crevés sur des épinards au sucre, des pommes de terre frites, une crème liquide au caramel, du gruyère et des noix ; et, ce qui fut le comble du luxe, l’on but un doigt de vin excellent récolté dans les monastères de l’Espagne.
Après le retour des grâces achevées à l’église et le café, Durtal, que la discussion des curés sur la politique, la récolte des vins et la démission toujours retardée de Mgr Triaurault n’intéressaient guère, s’échappa avec le père Felletin et s’en fut rejoindre les novices.
Il y avait grand débat lorsqu’ils arrivèrent. Les petits qui n’étaient pas prêtres déploraient que l’abbaye ne contînt pas assez de moines pour pouvoir célébrer sans interruption, du matin au soir et du soir au matin, l’office ; mais comme il eût fallu de fortes équipes pour établir le roulement du « Laus Perennis », il n’était pas possible d’y songer.
Enfin, ça viendra bien, un jour, affirmaient les frères Gèdre et Blanche ; ce jour-là nous pourrons proclamer que l’Ordre Bénédictin est le plus grand Ordre de l’Eglise.
Durtal ne pouvait s’empêcher de sourire de leur emballement et il regardait en dessous les novices prêtres qui ne soufflaient mot.
Eux, formaient ce qu’on appelle dans les noviciats le parti curé, c’est-à-dire celui des gens peu férus de liturgies et d’offices. Ils en étaient saturés depuis le séminaire et, malgré la différence que présentaient les offices misérables des paroisses et ceux des cloîtres, ils n’y mordaient généralement pas.
Aussi les Bénédictins préféraient-ils avoir comme novices des laïques, des gens venant du monde et justement attirés par la splendeur de l’art monastique, que des prêtres qui tirent un certain orgueil de leur sacerdoce, ont des habitudes difficiles à déraciner et manquent d’enthousiasme pour l’opus dei, pour ce qui fait précisément l’essence de l’institut Bénédictin.
Eux, voyaient surtout dans le monastère le débarras de l’existence, la paix, le moyen de se sanctifier à petit feu et ils acceptaient en échange l’ennui des longues cérémonies, la fatigue des Matines.
— N’est-il pas vrai, monsieur Durtal, disait le frère Blanche, que le but de la vie monastique devrait être la louange ininterrompue de Dieu ?
— Certainement, petit frère, mais pour vous consoler de ne pouvoir réaliser ce projet, persuadez-vous que la louange pérennelle subsiste, non dans un Ordre particulier mais dans tous les Ordres réunis ensemble ; la prière des congrégations n’arrête jamais ; les couvents des diverses observances se relaient entre eux et ils effectuent, à eux tous, ce que vous voudriez pratiquer seul.
— Comment cela ?
— Mais voyons, prenez à vue de nez les horaires des différentes communautés et vous constaterez qu’il en est ainsi. Dans le jour, forcément, à moins que vous ne dévidiez les prières de l’Adoration Perpétuelle, en ayant toujours plusieurs moines devant le saint sacrement, vous aurez des trous dans la trame déroulée des offices ; car vous ne pouvez réitérer indéfiniment les heures canoniales et il faut travailler, manger, vivre, en un mot. La question ne se pose donc que pour la nuit ; il s’agit de prier le Seigneur quand personne ne le prie plus ; eh bien mais, elle est résolue et, dans ce concert permanent, votre place est réservée.
— C’est juste, fit le P. Felletin.
— Expliquez-nous cela, dirent les moinetons.
— Dame, grosso modo et sauf erreur, car je n’ai pas sous les yeux les règles d’Ordres. Je ne m’occupe, bien entendu, que des cloîtres contemplatifs et laisse les autres qui, dès le matin, vous apportent, eux aussi, le renfort de leurs suppliques.
En partant du moment où la dernière heure liturgique cesse, c’est-à-dire après les complies qui se terminent généralement de 8 h. à 8 h. et demie du soir, le service divin recommence, avec les Matines et les Laudes.
De 8 heures et demie à 10 heures chez les Bénédictines de la congrégation de France.
De 9 heures à 11 heures chez les Carmélites.
De 11 heures à 1 heure et demie chez les Clarisses-Colettines.
De 11 heures et demie à 2 heures chez les Chartreux.
De 2 heures à 4 ou 4 heures et demie chez les Trappistes, les Trappistines, les Bénédictins et les Bénédictines de la primitive observance, les Bénédictines du Saint-Sacrement.
De 4 heures et demie à 5 heures et demie chez les Bénédictins de la congrégation de France.
De 4 heures et demie à 6 heures chez les clarisses et autres instituts car à partir de 6 heures, le service est alors assuré par toutes les cénobies ; il est bien entendu que j’omets en cette liste les ordres dont j’ai oublié les règlements ou dont je n’ai pas lu les statuts et que cet horaire que je viens de tracer ne saurait être qu’approximatif, puisque les offices durent plus ou moins longtemps, selon le rite des fêtes.
— Ajoutons, dit Dom Felletin, que le monastère des norbertines qui s’est implanté en France fait l’office, de minuit à une heure et le reprend à cinq heures du matin, après un sommeil coupé, tel que celui des clarisses et des Bénédictines du saint-sacrement ; il n’est pas, en effet, une heure de la nuit qui chôme ; quand le monde dort ou pèche, l’église veille ; ses moniales et ses religieux sont toujours postés en grand’garde, pour abriter le camp des fidèles constamment assiégé par l’Ennemi.
— Et vous négligez, dans votre nomenclature, les Bénédictines Calvairiennes ! s’écria le frère de Chambéon ; elles sont à joindre au groupe des trappistes, des trappistines, des Bénédictines sacramentines, car, elles aussi, se lèvent à deux heures pour chanter matines ; c’est un ordre de réparation qui suit les préceptes de saint Benoît dans leur rigueur la plus stricte ; elles ont le maigre perpétuel et sont déchaussées comme les clarisses, du premier mai jusqu’à la fête de l’exaltation de la sainte Croix.
Le frère de Chambéon jubilait en parlant de la dureté de ces ascétères. Ce vieux grognard du Bon Dieu qui se macérait de terrible façon était cependant doux et aimable ainsi qu’un homme qui ne souffre pas. Il était à son âge le plus jeune caractère du noviciat. Il prêchait d’exemple et mieux que les exhortations du maître des novices et du zélateur, sa bonhomie apaisait les petites querelles qui se produisaient forcément entre le parti « moine » et le parti « curé ». Il irradiait la paix autour de lui et tous étaient d’accord pour l’écouter, tel qu’un saint.
— Il serait curieux de savoir, reprit Durtal, si ces horaires liturgiques ont été combinés entre les divers ordres ou s’ils ont été organisés, je ne dis pas au hasard, car le hasard n’existe pas, mais par une décision de la providence qui se serait arrangée, lorsqu’elle a inspiré les ordonnances de chaque institut, pour que chacun choisisse une heure différente, afin de remplir le cadre.
— Ah ça ! s’écria Dom Felletin, nous l’ignorons. Il est difficile de croire à une entente préalable, car la naissance des congrégations n’a pas eu lieu, aux mêmes époques. Il faudrait admettre alors qu’après avoir pris connaissance des observances des ordres déjà nés, ceux qui se fondaient auraient repris la prière au moment où les autres la laissaient. C’est, après tout, possible ; mais la preuve de ce dessein, où est-elle ?
Le père Emonot qui avait tenu compagnie à l’un des curés invités, arriva sur ces entrefaites conduisant doucement par le bras le père Philigone Miné. Il se débattait, en pleine enfance.
Depuis qu’il était en cet état, il errait lentement dans les corridors et ne se trouvait content que parmi les moinillons. Il s’asseyait au milieu d’eux, ne causait pas, les regardait avec de bons yeux, rire.
Bien qu’il fût interdit aux pères de communiquer avec les novices, l’on tolérait cette infraction et, par charité, les petits le promenaient, quand il en manifestait l’envie, dans leur allée.
Il était d’ailleurs vénéré par tous. Son cas était extraordinaire. Ce doyen qui était un moine de la vieille roche, n’avait jamais, sa vie durant, manqué à un office ; depuis qu’il extravaguait, il continuait de s’y rendre, ne se dispensant même pas de celui de matines dont tous les malades sont cependant exempts. Quand le P. Abbé lui avait dit : père, vous êtes âgé et souffrant, vous pouvez ne vous lever qu’à cinq heures, il avait doucement hoché la tête, comprenant très bien le sens des paroles et il avait persisté à occuper sa stalle, avant que le psaume des paresseux ne fût récité.
Et ce n’était pas affaire d’habitude, de routine, comme on pouvait le croire : car, marchant à peine, il se levait maintenant plus tôt, afin de n’être pas en retard. Il calculait très exactement son temps et priait très bien à l’église. La raison, sombrée pour les choses humaines, demeurait intacte, alors qu’il s’agissait de louer Dieu.
Et il était touchant, ce vieillard, s’appuyant aux murs pour gagner l’église. On lui avait adjoint un convers, un brave frère, pour le soutenir et le servir ; mais il refusait ses soins, ne voulait être à charge à personne. Il tomba un beau matin, et se fendit le front. Alors le P. Abbé lui défendit, au nom de l’obéissance, de sortir de sa cellule, sans être accompagné ; il comprit, pleura et, tant qu’il fut seul, ne bougea plus.
Sa pharmacie qu’il l’avait tant intéressé lorsqu’il n’était pas dément, il ne la reconnaissait plus ; on l’y amena, un jour, pensant lui être agréable ; il la regarda, hébété, ne paraissant pas se rappeler qu’il avait, en cette cellule, encombrée de fioles, passé toute sa vie. La mémoire était morte ; dans les décombres de cette âme Dieu seul restait ; et de temps à autre, lorsqu’il était assis près des novices, il balbutiait quelques paroles que l’on ne comprenait pas. Croyant qu’il désirait quelque chose, on lui faisait patiemment répéter les mots, et l’on finissait par saisir qu’il parlait de Notre-seigneur et de la Sainte Vierge.
— Asseyez-vous, père, dit le frère Blanche qui l’installa sur un banc ; mettez-vous là, près de notre frère Durtal. Et, tout à coup, réveillé, le vieillard le scrutait d’un oeil qui s’éclaircissait — et il secouait douloureusement la tête, le considérant avec une indicible pitié-puis il le fixait gaiement, avec un doux sourire.
Et comme tous, interdits, Durtal le premier, de ces jeux de physionomie lui demandaient : qu’y a-t-il, père ? Il retombait dans le mutisme de ses traits, incapable de s’exprimer plus.
CHAPITRE X
Jamais semaine Sainte ne s’était annoncée, au cloître, plus triste. Cette loi des associations, à la réalité de laquelle aucun moine ne croyait, venait d’être votée par les députés ; et à l’optimisme le plus résolu avait succédé le pessimisme le plus noir.
A part quelques éberlués qui se raccrochaient à l’espoir que le président du conseil les sauverait, au dernier moment, en faisant échouer la loi au sénat et que M. Loubet, homme pieux, donnerait sa démission plutôt que de perdre son âme, les autres convenaient que les séniles matassins du Luxembourg ne valaient pas mieux que les pernicieuses malebêtes de la chambre. Tous étaient les leudes perdiablés des loges ; il n’y avait rien de propre à attendre d’eux.
Le P. Abbé, revenu de voyage, avait recueilli dans ses courses les bruits les plus alarmants sur le sort des congrégations, en France ; il ne soufflait mot, mais la tristesse de son regard et l’ardeur de ses prières en disaient long.
Enfin, il est impossible que les oraisons dont les communautés assaillent sans relâche le ciel soient repoussées par Notre-seigneur, pensaient les novices ; il faut redoubler de zèle et tous se privaient de quelque chose, se levaient plus tôt, se mortifiaient pour détourner le coup.
Depuis quelques semaines déjà, sur l’ordre du p. Abbé, après tierce et avant la grand’messe de neuf heures, tous les religieux chantaient, à genoux, le psaume « Levavi oculos meos in montes », le « Sub Tuum » et la prière à saint Michel ; et le découragement prenait de voir tant de suppliques préservatrices, demeurer vaines.
Durtal qui avait toujours été frappé du caractère démoniaque si marqué de l’affaire Dreyfus et qui ne la considérait que comme un tremplin installé par les juifs et les protestants, pour mieux bondir à la gorge de l’Eglise et l’étrangler, Durtal avait perdu depuis longtemps tout espoir ; et cependant, lorsque la loi fut adoptée par le parlement, il eut le petit tressaut d’un homme qui se trouve subitement en face d’un danger qu’il croyait moins proche.
— Quand on songe, disait-il à Mme Bavoil, que quelques gueux, élus Dieu sait comment, à l’aide de quelles manigances, dans quels bas-fonds, vont crucifier l’épouse ainsi que les juifs ont naguères crucifié l’époux. C’est la passion de l’église qui commence ; rien n’y manque ; tout y est, depuis les clameurs et les blasphèmes des galope-chopines de l’extrême-gauche, jusqu’à cet ancien élève des jésuites, ce Judas qui a nom Trouillot, jusqu’à ce nouveau Pilate qu’est Loubet.
Ah ! celui-là ! — Il allait régulièrement à la messe, en cachette, tous les dimanches, à la Sorbonne, alors qu’il gîtait dans le clapier soupçonneux du sénat ; et il a signé la loi et il s’en lave les mains ; je serais vraiment curieux de savoir quel est le sacerdoce qui ose l’absoudre quand il se confesse pour faire ses pâques !
— Que peut-il bien raconter au Seigneur, ce M. Loubet, lorsqu’il le prie, demanda Mme Bavoil ?
— Eh bien mais, il lui demande de lui conserver sa place, d’aider à la parturition de ses bonnes valeurs ; il le supplie de protéger ses enfants afin qu’ils deviennent d’intrépides chrétiens, tels que lui.
Comme il n’entretient pas de danseuses, il se juge un honnête homme, car il est probablement pareil à la majorité des catholiques pour laquelle, seul, le péché de la chair compte ; d’autre part, il s’estime peut-être charitable, car il a sauvé de la prison les tranquilles fripouilles du Panama ; sa conscience est donc sans scrupules, sans reproches et il vit, honoré par les siens, en paix.
Il se dédouble, du reste, car s’il reconnaît à Dieu le droit de s’occuper de l’homme privé, il estime que l’autre, l’homme politique, est à part et ne le regarde pas ; n’est-il point, d’ailleurs, une simple machine à écrire ? On appuie sur les touches et le mot Loubet se forme. Si le Christ n’est pas content, ce n’est pas à lui, mais à Trouillot, à Monis, à Millerand, à Waldeck-Rousseau, qu’il devra s’en prendre, car ce sont eux qui manipulent le clavier, et tracent, en bas des décrets, son nom.
Puis, une fois cette besogne terminée, ce père de famille qui interdit aux pauvres de donner à leurs enfants une éducation religieuse, appelle le curé de Saint-Philippe du Roule, — lequel dit, tous les dimanches, la messe à l’Elysée, — pour lui recommander de bien enseigner à sa progéniture le catéchisme et il palpe avec une certaine fierté le chapelet de luxe que sa sainteté le Pape a offert, en récompense sans doute de ses vertus, à cette autre excellente catholique qu’est Madame sa femme.
— Mais, notre ami, c’est le portrait tout craché du pharisien que Notre-seigneur a tant honni, que vous nous dessinez là.
— Avec ressemblance garantie, j’en ai peur, Madame Bavoil.
— Enfin, tout n’est pas désespéré, Rome peut encore intervenir.
— Pourquoi faire ? Aucun pape n’a plus que Léon XIII aimé la France ; harcelé, il faut bien le dire, par les catholiques qui, dénués de toute initiative, lui réclamaient, à propos de n’importe quoi, des instructions, il a cru nous rendre service en s’immisçant dans nos affaires et, mal renseigné et certainement trompé sur l’état de notre pays, il s’est imaginé qu’il apprivoiserait ce volatile, mâtiné de vautour et d’oie qu’est la république des juifs et des athées ; hélas ! Elle a percé à coups de bec les mains qu’il tendait pour la caresser ; il ne s’est néanmoins pas découragé ; il a disputé, pied à pied, les quelques libertés religieuses demeurées intactes et il a subi, en échange, des nominations d’évêques indignes, des injures et des menaces. Naturellement, plus il se montrait paternel, et plus l’ennemi devenait arrogant ; cela nous a mené à la loi des congrégations ; il a tenté alors un dernier effort, en laissant entendre que si l’on touchait aux ordres, il retirerait le protectorat des oeuvres de l’Orient à la France ; cette fois, on lui a épargné les coups de bec ; c’étaient des blessures encore trop nobles — et les satrapes de barrière qui nous régissent se sont contentés de le narguer en lui piquant ce qu’on appelle, dans l’argot du peuple « une méduse » ; et, attristé, appréhendant d’envenimer les choses, il a gardé le silence. Que voulez-vous qu’il essaie dorénavant ? Il ne peut plus réagir ; il est trop tard.
— Certes, si quelqu’un est à plaindre, dit Mme Bavoil, c’est bien ce vieillard dont les affectueuses intentions n’ont été récompensées que par des moqueries et des outrages !
— Je me figure cependant, reprit Durtal, que de plus amples douleurs ont encore supplicié la vie de notre père ; il en est, en tout cas, une, qui a dû être pour lui la dernière goutte du calice à boire ; l’on n’en connaît vraiment pas de plus amère.
La Papauté pouvait, devait jouer un rôle magnifique à notre époque, et Léon XIII était certainement prêt à assumer la responsabilité d’un tel geste dans l’histoire ; et des événements qu’il dut subir et que nous ignorons, brisèrent sa volonté, le rejetèrent, épuisé, dans l’ombre.
Alors, en effet, que cette Europe en pourriture, coalisée contre la miséricorde et l’équité, à plat ventre devant la force, regardait, en souriant, les massacres des Arméniens et les brigandages des Anglais au Transvaal, un seul homme pouvait se dresser, imposant par sa majesté et son âge, le pape, et leur dire à tous : je parle au nom du Seigneur que vous crucifiez par votre lâcheté ; vous êtes les adorateurs de la vache à Colas et du veau d’or ; vous êtes les Caïns des peuples. Cela n’eût servi de rien, au point de vue politique, c’est possible ; mais, au point de vue moral, c’était immense. Cela prouvait qu’il subsistait encore une justice ici-bas ; Rome fulgurait comme un phare allumé dans cette nuit qui envahit le monde et les peuples en désarroi eussent pu au moins se tourner de ce côté et croire que le représentant du Christ sur la terre était avec eux, pour eux, contre les gredins couronnés et les démagogues.
Pour des motifs évidemment péremptoires, sa sainteté qui a dû pleurer des larmes de sang de ce mutisme obligé, s’est tue. Ah ! le pauvre Pape !
— Le fait est, dit Mme Bavoil, que l’existence de Léon XIII, interné dans le vatican, spolié d’un pouvoir temporel auquel il a droit, n’est depuis de longues années qu’un Calvaire !
— Hélas ! — Pour en revenir maintenant aux épreuves que lui inflige celle de ses filles qu’il aime le plus, la France, que va-t-il décider ? Aujourd’hui, que la partie qu’il a jouée contre les francs-maçons est perdue et que le pillage de son patrimoine spirituel s’annonce, va-t-il se redresser et, en un réveil foudroyant, frapper d’excommunication, retrancher de l’église, vouer à la malédiction jusqu’en leurs derniers descendants, Loubet, Waldeck-Rousseau, Trouillot, Monis, tous les députés qui ont voté la loi et tous les sénateurs qui la voteront. Ce serait tout de même un soulagement pour ces malheureux catholiques qui se voient lâchés par leurs chefs dans les grandes largeurs et je vous assure que les interdits riraient moins qu’on ne pense de ce châtiment, car ce sont sur les familles, nominativement désignées dans les bulles, des amas de maux que ces anathèmes fulminés attirent !
Le Souverain Pontife les déchaînera-t-il ? j’en doute ; il pardonnera et il aura évangéliquement raison ; seulement où toutes ces défaites résignées nous mènent-elles ?
— Ah ! s’écria Mme Bavoil, en secouant la tête, laissons ces désolantes histoires ; ne songeons qu’à Jésus que l’on va crucifier ; l’heure des ténèbres est proche ; allons le consoler.
— En supposant que nous en soyons dignes ! dit Durtal qui mit son chapeau et enfila son caban.
Une fois installé dans l’église, il oublia les tristesses de l’heure présente. La divine liturgie l’enlevait, planant si haut, loin de nos boues ! Et il embrassait d’un coup d’oeil le panorama de la terrible semaine, de la semaine « peineuse » telle que la qualifiait le moyen-age.
Avant de gravir ces jours qui conduisaient en de brèves étapes au sommet du Golgotha, au pied même du gibet, l’église montrait, dans l’evangile de la passion, le fils de Dieu réduit à s’enfuir et à se cacher, afin de n’être pas lapidé par les Pharisiens ; — et pour exprimer cette humiliation, elle couvrait de voiles de couleur violette ses statues et ses croix. Une semaine s’écoulait encore et soudain, pendant quelques instants, sa détresse s’interrompait, à la fête des Palmes.
La veille même, l’Epître de la messe énonçait les épouvantables malédictions que proférait Jérémie, cette préfigure du Christ, contre les juifs ; et, le lendemain, en de magnifiques offices, au cri de « l’hosanna », au chant triomphal du « Gloria Laus », Jésus s’avançait, monté sur le petit de l’ânesse prédit par Zacharie, et il entrait, assourdi par les vivats du peuple, dans cette Jérusalem qui devait, quelques jours après, dans des clameurs de rage, le trucider.
Et dès que la marche glorieuse était avec la procession des rameaux finie, l’angoisse du Christ et de son église reprenait aussitôt avec la messe pour ne plus cesser qu’avec les pâques ; déjà la lecture de la passion commençait avec saint Matthieu pour continuer, le mardi avec saint Marc, le mercredi avec saint Luc, le vendredi avec saint Jean.
Et, en les entendant, Durtal jaillissait, transporté hors de lui-même par ce chant étrange et pénétrant ; c’était une sorte de mélopée courant dans le récit, revenant avec des retours flottants de ritournelles ; ce chant était monotone et angoissant et presque câlin, aussi ; et cette impression de bercement et de peine, on l’éprouvait également pendant les lamentations de ténèbres, chantées sur quelques tons à peine, variant avec les points, les points d’interrogations, les arrêts du texte.
Ces cantilènes avaient dû être recueillies, en partie, dans les plus anciens antiphones du peuple juif. Le courant gréco-romain auquel la paléographie de Solesmes rattache l’origine du plain-chant se faisait moins sentir que le courant hébraïque en ces mélopées qui rappelaient, dans le chant des lettres, avec leur côté languide et cadencé, les mélodies à la fois ingénues et subtiles de l’Orient.
Elles remontaient certainement, en tout cas, à la plus haute antiquité ; et les réparations que leur trame avait subies au dix-septième siècle et depuis, n’en avaient altéré ni la couleur, ni les contours ; elles étaient merveilleusement assorties aux offices qui, eux aussi, dataient des premiers âges de l’église, peut-être même de l’église de Jérusalem, au quatrième siècle.
Et ces jours luctueux étaient admirables au Val-des-Saints.
Chaussé de sourdes pantoufles, les moines que n’annonçait plus le son des cloches, entraient, tels que des ombres, et ils soulevaient, en passant, avec leurs grandes coules noires, au vent froid qui soufflait l’odeur de cave des murs salpêtrés et des dalles ; et les petites heures défilaient à la queue-leu-leu, avant la messe, tombant, gouttes à gouttes, sans le « Deus in adjutorium » qui, d’habitude, les précède, sans le gloria qui les sépare et les suit et, à la fin de chaque office, l’on récitait le « Miserere » sur un ton lugubre, jusqu’au dernier mot « vitulos » jeté alors en l’air, ainsi qu’une pelletée de terre, sur une tombe.
Dans l’église à peine éclairée, avec les croix enfermées dans des losanges, le triangle fumant des cires, le bêlement d’agneau des lettres hébraïques chantées au commencement de chacune des lamentations de Jérémie, c’était navrant. L’Abbé, mitré, crossé, en ornements violets, procédait, le jeudi, au mandatum, lavait les pieds de ses convers ; et, le vendredi, après l’adoration de la croix et les funèbres impropères, coupées comme de refrains, par les apostrophes implorantes du Trisagion, il allait, vêtu d’une chasuble noire et mitré de blanc, sans bougeoir, sans crosse, prendre le pain consacré au reposoir, et tous les moines à genoux, sur deux rangs, tenaient des cierges sombres allumés et les éteignaient aussitôt après que l’abbé avait consommé les Espèces saintes.
L’office monastique de la semaine ne différait pas de l’office romain ; seulement, il n’existait pas d’église même cathédrale où on le célébrât avec une pareille ampleur ; malheureusement, s’il avait été, au Val des Saints, magnifique jusqu’au matin du samedi, ce jour-là, tout se gâta.
Par suite d’un compromis, entre l’abbaye et le presbytère, il avait été convenu que les religieux occuperaient l’église le dimanche de pâques, mais que l’honneur de bénir l’eau baptismale, le samedi, reviendrait au curé. Il opérait donc, entouré de toute la communauté qui le servait, et il savait à peine son métier et mêlait la prononciation française de son latin à la prononciation italienne des pères.
Pour des gens habitués de longue date à entendre les « um » prononcés « oum », les « us » prononcés « ous », les « ur » prononcés « our », les j devenus des y, pour les gens accoutumés au chuintement du C qui mue, par exemple, le mot « coelum » en celui de « tchoeloum », le latin à la française était déjà un peu embarrassant ; il eût été néanmoins supportable, seul ; mais, mélangé à l’autre manière de le proférer, il tournait à la cacophonie ; il semblait que le curé et les Bénédictins ne parlassent pas la même langue ; et ce tohu-bohu se répercutait dans le chant grégorien que le curé chantait, non d’après les textes de Solesmes, mais ainsi qu’au séminaire, et Dieu sait comme !
Tout le monde avait hâte que cette cérémonie devenue ridicule cessât. Heureusement que la splendeur de la messe avait compensé la misère de cet office, si merveilleux lorsqu’il est bien exécuté, par des moines, en plain-chant.
Après l’epître courte de saint Paul, le sous-diacre se présenta devant l’abbé debout au trône et lui annonça la résurrection de l’alleluia. Et l’abbé le chantait, joyeux de la bonne nouvelle, par trois fois et, trois fois, le choeur répondait un alleluia encore un peu timide, hésitant à prendre son vol ; puis, après le credo, à l’offertoire, on amenait jusqu’à la barre de communion l’agneau paschal, paré de rubans et de fleurs.
La pauvre bête que tirait le père hôtelier et que poussait par derrière le père cuisinier, regimbait ; elle regardait, défiante, cherchant à fuir, cet homme, vêtu d’or qui s’avançait du fond du choeur, escorté d’une nombreuse suite, pour prier au-dessus d’elle et la bénir ; elle semblait avoir le pressentiment que tant de déférence pour sa pauvre personne, finirait mal.
Ce samedi saint était, le matin, interminable. Commencé à huit heures, l’office s’achevait à peine vers les midi ; mais Durtal était heureux ; il quittait les rangs liturgiques, quand la cérémonie s’alentissait et il s’évaguait, seul, errant sur les traces de Jésus et de sa Mère.
Oui certes, se disait-il, songeant à la Vierge sur laquelle, dans cette période de larmes, les ecritures sont si brèves, oui certes, le moment où elle se tint au pied du Calvaire fut atroce : la transfixion prédite par le vieillard Siméon se réalisait, mais le glaive des douleurs ne s’enfonça pas dans sa poitrine, d’un coup. Il tâtonna d’abord et il y eut dans les souffrances de Marie un instant qui dut être particulièrement affreux, celui de l’attente, du temps qui s’écoula entre l’arrestation et la condamnation de son fils ; ce fut alors l’entrée de la pointe perçant la chair, s’y remuant, évasant la plaie, sans plus y pénétrer.
Cette attente a duré 11 heures. Jésus a été, en effet, arrêté et ramené à Jérusalem, le jeudi soir, vers 11 heures. Le vendredi, il a été traîné d’Anne à Caïphe, de minuit à 2 heures du matin, conduit chez Pilate vers 6 heures, transféré chez Hérode à 7 heures, bafoué, flagellé, couronné d’épines, condamné à mort de 8 à 10.
La sainte vierge savait que Jésus devait périr. Elle même avait consenti à sa mort et elle l’eût même sacrifié de ses propres mains, dit saint Antonin, si le salut du monde l’eût exigé ; mais elle n’en était pas moins femme. Elle eut toutes les vertus à un degré héroïque, elle posséda les dons les plus parfaits de l’esprit, elle fut la plus sainte des vierges. Elle fut unique, mais elle n’était pas déesse, elle n’était pas Dieu ; elle ne pouvait pas échapper à sa condition de créature humaine et, par conséquent, ne pouvait s’empêcher d’être torturée par les anxiétés de l’attente.
L’eût-elle pu d’ailleurs, qu’elle eût imité son fils qui mit en quelque sorte en suspens sa divinité sur la croix pour mieux pâtir et qu’elle eût demandé et obtenu de s’infliger l’âpre tourment des expectatives déçues.
Ce que furent ces heures d’attente, on se l’imagine mal.
Génitrice d’un Dieu, fille et épouse du seigneur et soeur des hommes dont elle devait devenir aussi la mère, une mère enfantée, au pied d’un gibet, dans des flots de sang, elle greffait, les unes sur les autres, toutes les douleurs des parentèles ; mais elle pleurait surtout la perversité de cette race abominable dont elle était issue et qui allait réclamer, en un baptême de malédiction, que le sang du sauveur retombât sur elle.
Voulant souffrir tout ce qu’elle pouvait souffrir, elle dut espérer contre tout espoir, se demander, dans l’excès de son angoisse, si, au dernier moment, ces scélérats n’épargneraient pas son Fils, si Dieu, par un miracle inattendu, n’opérerait pas la rédemption du monde, sans infliger à son Verbe les tortures horribles de la croix. Elle se rappela sans doute qu’après son consentement, Abraham fut délivré de l’effroyable tâche d’égorger son fils et peut-être espéra-t-elle que, de même qu’Isaac, sa préfigure, Jésus serait délié, lui aussi, au dernier moment, et sauvé du sacrifice.
Et ces pensées sont naturelles si l’on songe que Marie savait ce qu’il était opportun qu’elle sût, mais qu’elle ne savait pas tout ; elle connut, par exemple, le mystère de l’incarnation, mais elle en ignora le temps, le lieu et l’heure ; elle ignora, avant la visite de l’ange Gabriel, qu’elle était la femme, choisie de toute éternité, celle dont le Messie naîtrait.
Et, humble, telle qu’elle était, ne cherchant point à pénétrer les secrets du Très-Haut, elle put aisément se leurrer.
Que se passa-t-il pendant ces heures sur lesquelles les evangiles se taisent ? Lorsqu’elle apprit que le sauveur était arrêté, raconte Ludolphe le Chartreux, elle s’élança, avec Magdeleine à sa poursuite et dès qu’elle l’eut retrouvé, elle s’attacha à ses pas et ne le quitta plus.
La soeur Emmerich confirme, de son côté, ces courses de la Vierge et elle entre dans de nombreux détails, un peu confus, sur les allées et venues de Marie, qui, selon elle, était non seulement accompagnée de Magdeleine, mais encore de la petite troupe des saintes femmes.
Elle la montre, suivant à distance les soldats qui entourent Jésus et s’évanouissant lorsqu’elle s’assure que l’arrestation est maintenue.
Elle nous narre qu’on la transporta dans la maison de Marie, mère de Marc, et que ce fut l’apôtre Jean qui la renseigna sur les brutalités commises par les goujats de corps de garde, pendant la route ; elle relate que ce fut également lui qui s’échappa de chez Caïphe, pour la prévenir, tandis que le pauvre Pierre, affolé, mentait.
Elle ne tenait pas en place, dit la visionnaire. Elle sortit de nouveau et rencontra, près de la demeure de Caïphe, Pierre auquel elle dit : Simon, où est mon fils ? Il se détourna, sans répondre ; elle insista et alors il s’écria : mère, ne me parlez pas, ce que souffre votre fils est indicible ; ils l’ont condamné à mort et, moi, je l’ai renié !
Et, l’âme déchirée, elle parcourut sans repos ni trêve la voie des supplices jusqu’au moment où saint Jean l’expose alors, au pied du Calvaire, le coeur définitivement percé par les sept glaives des péchés capitaux, les glaives enfoncés, cette fois, jusqu’à la garde.
En se remémorant ce lamentable récit, Durtal revenait toujours à sa première idée : avant de pénétrer franchement dans la chair et d’y rester fixées, quelles tortures ces implacables épées n’infligèrent-elles pas à notre dame des sept douleurs, en tournant dans les blessures, en attisant en quelque sorte le feu des plaies, avec ces sautes de désespérances et d’espoirs, et quel sujet de méditation que l’acuité de ces transes dans la vie si parfaitement inconnue de notre Mère !
Et Durtal gémissait avec elle, lorsqu’à la deuxième leçon du nocturne du vendredi saint, la voix douce et claire du petit frère Blanche, debout au milieu du choeur, devant le pupitre, chantait, ainsi qu’en un bêlement prolongé et plaintif, la lettre hébraïque « Mem » et poursuivait sur un rythme dodelineur et dolent la leçon du prophète : « A qui te comparerai-je, à qui dirai-je que tu ressembles, fille de Jérusalem ? Où trouverai-je quelque chose d’égal à tes maux ? Et comment pourrai-je te consoler, ô vierge, fille de Sion ? Ta blessure est large comme la mer ; qui pourra y appliquer le remède ? »
Le remède, soupira Durtal, à la place de l’huile et du vin avec lesquels le bon samaritain pansait naguère les plaies, c’est avec de l’eau régale et du vitriol que les modernes pharisiens panseraient ses plaies, à elle, s’ils la détenaient. Depuis des siècles, la vierge a plus spécialement élu domicile en France, car nulle part, en aucun autre pays, elle n’a distribué autant de grâces ; nulle part, elle ne s’est attestée, ainsi qu’à l’heure présente, par de continuels miracles comme à Lourdes et, de même que dans la Palestine, les injures pleuvent sur elle, et la persécution sévit contre les siens.
La France a inventé le moyen de faire, pour la madone, du calendrier liturgique, une éternelle Semaine Sainte !
Ces pensées l’obsédaient. Au fond, pour dire toute la vérité, la semaine peineuse était celle qui convenait le mieux à ses aspirations et à ses goûts ; il ne voyait bien notre-seigneur qu’en croix et la vierge en larmes. La « pieta » surgissait devant lui avant la crèche.
Ainsi, sortait-il de ces longs offices de la grande semaine, accablé, mais heureux. Il se sentait si bien en communion avec l’église et il avait si bien prié !
Et il lui fallait un effort pour se substituer un état d’âme différent avec la pâques, pour s’associer aux transports des alleluias fusant joyeux sous les voûtes, aux gais carillons des cloches balançant les grappes des novices pendus à leurs cordes ; et pourtant quelle magnifique fête que celle de la résurrection ! Quelle atmosphère de jubilation emplissait l’église ! Elle était tendue de velours rouge, couverte de fleurs et les reliquaires réverbéraient, ainsi que des miroirs de verre et d’or, les lancettes en feu des cierges ; la messe pontificale était aussi pompeuse que celle de noël, avec les cérémoniaires aux noirs capuchons retombant sur les blancs surplis, avec le porte-crosse, le porte-mitre, le porte-bougeoir, le porte-queue ; elle s’épanouissait, après la procession, dès l’introït où le Christ célèbre sa résurrection, par la voix prophétique du psalmiste et les touffes de prières qui s’élevaient du choeur, même les suppliques implorantes, telles que le kyrie, se paraient, en signe de fête, d’astragales, se gaudissaient avec la séquence, si enthousiaste, si candide, du Victimae Paschali Laudes, s’affirmaient vraiment triomphales avec cet alleluia, si délibéré, si fier, qui suit l’ite missa est et reprend après le deo gratias de la fin.
Et pour que la suprématie de cet office fût complète, les antiennes des Vêpres étaient exquises et l’on avait, au salut, adjoint en l’honneur de la Vierge, en sus des prières marquées, après la complainte campagnarde et boute-en-train qu’est « l’O filii et filiae » une ancienne prose « le Salve Mater misericordiae » extraite du recueil des « Variae Preces » qui l’avait empruntée à l’ancien bréviaire des Carmélites, une prose, à refrain, dont les strophes se déroulaient sur une mélodie populaire.
Ce fut une journée d’ivresse musicale, une orgie d’allégresses liturgiques ; Durtal n’avait pas quitté l’église et le monastère depuis le matin ; et il avait mangé avec les religieux, M. Lampre et le curé, l’agneau paschal.
Ledit agneau avait été servi en entier sur une table et il se convulsait les pattes en l’air, la gueule béante, exhibant ses rangées de dents et tirant une langue noire. Enveloppés de grands tabliers, le père cellerier et le père Ramondoux, armés d’énormes couteaux, le dépecèrent.
Et Durtal eut vraiment un moment d’hilarité.
Les petits novices qui ne mangeaient plus à leur faim, depuis le commencement du Carême, se délectaient, encore que cet agneau eût la chair en cordes à violon d’un vieux bélier ; les angelots bâfraient comme des ogres ; et les vieux moines engloutissaient furieusement les quartiers récalcitrants de la bête.
Le fait est, songea Durtal qui regardait le petit Gèdre et le frère Blanche, le fait est que les pauvres gosses n’ont pas goûté à une miette de viande depuis quarante jours et qu’on leur a mesuré le pain, juste ce qu’il fallait pour ne pas défaillir ; et ce n’est pas avec des épinards et des betteraves à la sauce blanche que l’on soutient des enfants levés dès l’aube et debout jusqu’au soir.
Et moi-même, dont l’abstinence fut presque aussi rigoureuse, car, faute de poisson au Val des Saints, j’ai dû me contenter, les jours où les oeufs étaient interdits, de légumes, je me sens débilité, l’estomac en charpie, et je ne suis pas fâché d’attaquer, à mon tour, le gigot de ce mouton rebelle et je suis plus satisfait encore de reprendre mes habitudes, de retrouver mes vêpres remises à quatre heures, c’est-à-dire à une heure facile, au lieu de ces onze heures et demie qui me laissaient une heure inoccupée que je ne savais à quoi employer, après la messe terminée à dix heures.
Il me fallait, en attendant, remonter chez moi ou traîner dans le village ; nous rentrons enfin dans la norme à partir d’aujourd’hui, alleluia !
Et, après le dîner, quand, au retour de la chapelle, il fut réuni dans la salle des hôtes pour boire le café avec le P. Abbé, Dom de Fonneuve, Dom Felletin, Dom Badole, le curé et son ami, M. Lampre, Durtal se sentit débordé par un bien-être dont il eût été incapable d’analyser les causes ; elles étaient, à vrai dire, multiples ; il y avait l’entrain agissant d’un cloître possédé par cette joie liturgique qui se déversait depuis le matin dans les offices ; il y avait la satisfaction d’un homme libéré d’exercices incommodes et de repas pénibles ; il y avait enfin l’enjouement de la température qui devenait, au sortir des frimas, clémente, car la nature ressuscitait avec le Christ.
Il faisait presque doux. Durtal s’était promené, avant la messe, dans son jardin ; la petite allée du bois était tapissée de violettes ; les bourgeons des marronniers jaillissaient, en pointes d’un brun gommé, des branches encore noires ; les arbres fruitiers étaient en fleurs et les cerisiers et les pêchers étaient saupoudrés, les uns d’une neige blanche et les autres d’une neige rose ; après les nudités sinistres de l’hiver et la fatigue des prières absorbées à doses massives pendant la semaine, c’était, en effet, un immense allègement que celui de ce printemps et de cette Pâques !
Et cette impression, tous l’éprouvaient, jusqu’au curé qui se trémoussait, les jambes en l’air, devant la cheminée où un reste de fagot brûlait.
Et, subitement, sur un mot du P. Abbé, devenu soucieux, toute gaieté tomba.
Après l’entretien obligatoire des convives sur la beauté de la cérémonie et l’ampleur des chants, l’abbé s’adressant à M. Lampre et à Durtal, avait cité les paroles de l’évangile de saint Luc : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette pâques avec vous, avant de souffrir. » — et, tout le monde écoutant, — il avait ajouté : l’an prochain, à pareille heure, où serons-nous, avec qui mangerons-nous l’agneau paschal ?
— O père, dit Durtal, êtes-vous donc décidé à nous quitter ?
— Décidé ? Je ne puis rien décider encore ; il faut d’abord attendre que la loi soit votée par le sénat ; c’est une affaire de quelques mois ; puis il sied aussi de connaître, avant d’adopter une résolution, le sens des instructions que le Pape nous adressera.
— Et s’il ne vous en envoie pas, fit M. Lampre, ou plutôt s’il ne vous en envoie que d’imprécises et de vagues, laissant à chacun le soin de se débrouiller à sa guise, — et, entre nous, il ne peut vous en formuler de claires et de fermes, car les intérêts des instituts diffèrent et la solution qui convient à l’un serait nuisible à l’autre, — comment agirez-vous ?
— Dans ce cas, nous nous réunirons, tous les abbés de l’ordre, à notre maison mère de Solesmes et nous arrêterons la ligne de conduite à suivre.
— Et elle est tracée d’avance, dit le P. De Fonneuve, car nous ne pouvons nous soumettre à une loi qui viole manifestement le droit supérieur de l’église et le principe même de la vie religieuse.
Accepter les prescriptions de ce texte sacrilège serait, de notre part, une forfaiture.
Et, en effet, les Ordres à voeux solennels, tels que le nôtre, jouissent du privilège de l’exemption à l’égard de l’ordinaire et la loi édicte absolument le contraire puisqu’elle veut nous placer sous la juridiction des Evêques.
Or, ce droit d’exemption a été déterminé par le concile oecuménique de trente et par les constitutions apostoliques qui n’ont fait que confirmer les décrets du concile et il n’appartient ni au gouvernement, ni à l’évêque d’y rien changer. Ils n’ont ni à approuver, ni à désapprouver les statuts des Ordres religieux, du moment que le saint père les a revêtus de son approbation souveraine. C’est donc là un empiètement intolérable du pouvoir civil sur les prérogatives du saint siège et c’est en même temps aussi la négation de la vie monastique, puisque le firman de ces impies se refuse à reconnaître les voeux solennels qui en sont la base.
— Voyez-vous, s’écria Dom Felletin, Mgr Triaurault se substituant à saint Benoît et, si nous consentions à lui remettre notre règle, supprimant les articles qui lui déplaisent ou y introduisant des ordonnances de son cru !
— Sans compter, dit M. Lampre, qu’un autre Evêque, dans un autre diocèse où se trouverait une autre abbaye Bénédictine pratiquerait tout le contraire. Celui-là bifferait les clauses conservées par son confrère et en inventerait de nouvelles à son tour. Quel gâchis ce serait !
— Ajoutons, reprit Dom de Fonneuve, qu’il faudrait être singulièrement naïf pour se plier aux exigences de cette loi et déposer, avec la demande d’autorisation, un état des recettes et dépenses et un état inventorié des biens, meubles et immeubles que l’on possède, car ce serait livrer, soi-même, sa bourse à des aigrefins qui n’hésitent, actuellement que sur le procédé à employer pour la voler.
Enfin, quelle garantie nous offre cette autorisation, en admettant qu’on l’accorde ? — puisqu’il suffira d’un simple décret, pris en conseil des ministres, pour l’annuler.
Nous devons fournir aussi la liste des membres de la communauté mentionnant leur nom patronymique ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés en religion, leur nationalité, leur lieu de naissance, leur âge, la date de leur entrée ; c’est la surveillance de la haute police abrogée pour les malfaiteurs et rétablie pour les moines. Il n’y manque que la fiche anthropométrique imaginée par M. Bertillon !
— Il y a eu là un oubli de la part de cet argousin des loges qu’est Trouillot, observa Durtal ; espérons que le rapporteur de la loi au sénat le réparera.
— D’ailleurs, fit le père hôtelier, le règlement d’administration publique, annoncé par l’article 20, pourra encore aggraver par des interprétations judaïques l’infamie de cette loi.
— Vous pouvez vous y attendre, dit M. Lampre.
— Il n’y a pas à se leurrer, reprit le P. Abbé, la congrégation de Solesmes ne consentira pas à subir le supplice de ce carcan. Donc, en supposant que le sénat vote la loi dès la rentrée des vacances — et il le fera certainement — cela nous met au mois de juin et dès lors, il nous reste six mois pour nous retourner. Par conséquent, en décembre, au plus tard, nous ne serons plus ici.
— Et où irez-vous, mon révérendissime ? demanda Durtal.
— Je l’ignore ; la Belgique est le pays le plus proche ; et la vie n’y est pas onéreuse ; c’est la dernière nation catholique où la meute des francs-maçons soit encore muselée ; si, comme cela est certain, l’assemblée des abbés de l’ordre ordonne le départ pour l’exil, je commencerai, aussitôt revenu de Solesmes, des recherches.
— Oh ! il faudrait d’abord savoir si les ministres appliqueront la loi ? dit le curé.
— Comment s’ils l’appliqueront ! s’exclama Durtal ; vous croyez que ces mécréants sont arrivés à ce résultat si longuement, si habilement préparé depuis tant d’années pour le lâcher ! Vous les prenez vraiment pour plus bêtes qu’ils ne sont ; soyez tranquille, ils iront jusqu’au bout de leurs méfaits et ce bout ne s’arrêtera pas aux religieux mais bien au clergé séculier dont la persécution est, je vous l’assure, proche.
L’abbé haussait doucement les épaules ; s’il jugeait en son for intérieur les cloîtres encombrants et inutiles, il estimait par contre que le prêtre était indispensable et que jamais la république n’oserait y toucher.
— Et après le clergé, ce sera le tour du bourgeois ; après la curée des biens de mainmorte, nous assisterons au dol des valeurs vivantes. La bourgeoisie secouera-t-elle au moins son apathie, lorsque l’on forcera sa caisse ? dit M. Lampre.
— Elle ! elle s’inclinera, en soupirant et ce sera tout, repartit Durtal ; quant aux catholiques, vous savez aussi bien que moi l’amas de sottise et de lâcheté qu’ils recèlent ; si par hasard, il se trouvait parmi eux des gens intrépides résolus à résister, les députés et les sénateurs du parti s’interposeraient aussitôt et feraient le jeu de l’ennemi, en les désarmant.
— Mais alors, il n’y a rien à tenter ! s’écria Dom de Fonneuve.
— Non, mon père, rien. Je ne suis pas prophète, mais tenez que, pendant les événements plus ou moins périlleux qui s’apprêtent, les orateurs catholiques se remueront dans le vide ; il feront signer de ces pétitions que tout gouvernement, lorsqu’il les reçoit, jette au panier et il prononceront de pathétiques discours dans des réunions triées avec soin, pour qu’on n’y avarie pas leurs précieuses personnes ; puis, quand le moment de descendre dans la rue et de se montrer sera venu, ces pieux matamores rédigeront encore de belliqueuses protestations, tandis que nos seigneurs les évêques gémiront respectueusement en des phrases cherchées, ce après quoi, tous se soumettront, ventre à terre, tranquilles, convaincus d’ailleurs qu’ils ont rempli leur devoir et qu’ils se sont vaillamment conduits.
— S’il en était ainsi, ce serait à désespérer de la France.
— Je ne vois pas de raison pour n’en point désespérer, répliqua Durtal.
— Ah non ! s’écrièrent en choeur les assistants ; vous êtes trop pessimiste ; c’est un temps à passer ; les Ordres partiront en exil, c’est entendu ; nous subirons un quatre-vingt-treize après, c’est encore possible ; mais il y aura ensuite une réaction et la France se relèvera et les monastères refleuriront...
— J’espère, ainsi que vous, en une réaction, répondit Durtal, mais quitte à feindre l’oiseau de mauvais augure, je vous avoue que je ne vois pas, même après une victoire conservatrice, les moines réintégrés dans leurs maisons. Il en sera pour moi de la loi des congrégations comme du concordat que les rois très chrétiens se sont empressés de garder. C’est une arme dont aucun gouvernement, quel qu’il soit, ne voudra se dessaisir...
La meilleure chance qui pourrait vous échoir serait que la loi fût si implacablement, si odieusement exécutée, qu’elle devînt par cela même difficile à défendre ; peut-être alors modifierait-on les plus imprudents de ses articles ; je le souhaite ; si, au contraire, on l’applique placidement, doucereusement, si elle étrangle avec un lacet savonné les Ordres, elle s’inscrira, sans réforme, telle qu’une concession à perpétuité, dans le cimetière de nos codes. C’est triste à dire, mais il faudrait du sang pour la malédifier et le sang, dame, c’est ainsi que l’argent les catholiques en sont plutôt un peu chiches !
— Hélas ! s’exclama le père de Fonneuve, j’ai grand’peur que vous n’ayez, cette fois, raison.
La cloche sonna. La récréation était finie. Tous se séparèrent.
— C’est très bien, tout cela, notre ami, dit Mme Bavoil à Durtal qui lui racontait la conversation de l’après-dîner, mais si les Bénédictins s’en vont, qu’est-ce que nous allons devenir ?
Et Durtal ne répondant pas : — Le moment est peut-être venu, reprit-elle, de prier une des saintes que vous aimez, sainte Christine l’admirable que l’on invoque pour résoudre les cas difficiles.
— Et aussi, saint Benoît, je pense, car enfin j’inaugure, pour lui et de par lui, au Val des Saints une profession un tantinet bizarre, celle de l’oblat in extremis, celle de l’oblat de la dernière heure. Je vais me porter moi-même, en terre et mener mon propre deuil.
Il me semble tout de même que le bon patriarche pourrait bien me ressusciter quelque part, à l’abri du monde, je ne sais où ; je l’espère, mais, en attendant ce nouvel aiguillage, voilà bien des inquiétudes sur la planche.
CHAPITRE XI
Quelques mois s’étaient écoulés ; ainsi que l’on devait le prévoir, la chambre avait trouvé dans le sénat son sosie d’opprobres. Un sous-Trouillot, du nom de Vallé, avait rempli avec quelques terrines de son eau de vaisselle l’auge de la rue de tournon et les vieux glandivores s’étaient ventrouillés dans le purin de cette éloquence et avaient voté, haut la patte, la loi ; les congrégations étaient bel et bien étranglées ; le but si patiemment poursuivi depuis tant d’années était atteint.
Le Pape avait parlé, réprouvant les dispositions de la nouvelle loi, mais laissant, chacun, libre, sous certaines réserves, d’être traîné, s’il le jugeait opportun, sur la claie des cultes. Tout accord étant impossible entre des communautés rivales et d’esprit différent, il n’y avait même pas à songer à une résistance en masse qui eût évidemment été la seule attitude digne, la seule attitude propre ; la détermination, prise par Rome, était donc, en de telles circonstances, sage.
Les quelques moines, agités d’idées belliqueuses, étaient bien obligés d’en convenir. En ce cloître du Val des Saints jadis si paisible, les soucis, jusqu’alors écartés de l’avenir, naissaient ; tous les pères envahissaient le scriptorium où étaient les revues et les journaux catholiques que recevait le monastère ; ils les lisaient silencieusement et, pendant la récréation, les commentaient, en les agrémentant parfois des plus cocasses gloses.
Tout ce petit monde qui n’était au courant de rien et qui s’était moqué, Dieu sait combien, jusqu’alors de la politique, se demandait quel mal il avait bien pu commettre pour qu’on le pourchassât de la sorte.
Et ce trouble se répercutait dans le noviciat.
Ce que vous avez fait, mais, aux yeux de vos proscripteurs, vous avez commis le plus impardonnable des crimes, celui de n’en pas commettre contre Dieu, dit Durtal, au petit frère Gèdre, qui le consultait, ahuri par ce bourdonnement de ruche qu’on enfume.
Tous erraient dans les corridors, aux écoutes. Le révérendissime était à Solesmes et l’on attendait avec impatience qu’il écrivît au père prieur pour savoir quand et comment s’effectuerait le départ.
Il n’y a pas de nouvelles, dit M. Lampre à Durtal qui sortait avec lui de la grand’messe, mais la résolution du chapitre des abbés est si parfaitement connue d’avance qu’une lettre de Dom Bernard ne nous apprendrait rien que nous ne sachions ; c’est l’exil à bref délai ; le lieu choisi du bannissement demeure seul ignoré et pour longtemps encore, je pense.
Et Durtal s’apprêtant à le quitter sur le seuil de l’église : — Voyons, reprit-il, puisque vous déjeunez aujourd’hui à la maison, au lieu de vous rendre chez moi à l’heure imperturbable du repas, arrivez dès maintenant ; nous feuilletterons, en guise d’apéritif, mes enluminures.
— Ah ça, je veux bien, dit Durtal.
L’habitation de M. Lampre, située à deux pas de l’église et du couvent, était une de ces grandes bâtisses indifférentes, telles qu’il en prospère dans tous les bourgs. Elle sentait la province, l’odeur mélangée de la colle à poisson et de la pomme, mais elle était, à l’intérieur, assez bien distribuée et munie de vieux meubles confortables. M. Lampre la tenait de famille, ainsi que ces ruines du cloître qu’il avait données avec de vastes arpents de terre aux moines.
Il s’était simplement réservé un spacieux jardin qu’il avait séparé par un mur de celui de l’abbaye, pour que chacun fût chez soi ; et ce jardin, planté d’arbres séculaires, était traversé par des allées bordées de fleurs ; l’une arborait des massifs de roses de toutes formes, de toutes teintes, parmi lesquelles figurait la variété, assez laide du reste, de la rose verte. Sa collection de roses, entretenue à grands frais, était, en Bourgogne, cotée.
Pourtant, disait-il, un jour, à Durtal, je n’ai nullement la marotte de l’horticulture ; je me force par devoir à m’en enticher et ne dépense de l’argent que pour m’y intéresser.
Et comme Durtal qui admirait le feu d’artifice de certaines touffes jaillies du sol, le regardait sans comprendre.
— C’est bien simple, reprenait-il, je suis si paresseux, si peu marcheur, que je ne bougerais pas de chez moi, que je ne descendrais pas me promener dans le jardin, si je n’étais mu par le sentiment, très médiocre d’ailleurs, de m’assurer que je ne perds pas, en voyant des arbustes qui poussent, l’argent que leur achat et que leur entretien me coûtent. Je considère une plate-bande, je scrute une corbeille et, sans y prêter attention, je trottine ; l’horticulture me dégourdit plus les jambes qu’elle ne m’égaie les yeux ; c’est un point de vue un peu spécial mais il a, puisqu’il m’est utile, sa raison d’être.
Que diable a-t-il bien pu faire dans la vie ? Se demandait parfois Durtal. Ce que l’on savait de précis sur son compte se réduisait à presque rien. M. Lampre avait été, dans sa jeunesse, élève à l’école des chartes et avait longtemps habité Paris. Il était resté célibataire et ne possédait plus pour toute famille que la fille de sa soeur mariée à un M. De Garambois, préfet sous l’empire. Sa soeur et son mari étaient morts et sa nièce, il ne l’avait guère fréquentée, car elle avait toujours vécu chez des religieuses ou près des cloîtres de Solesmes. Leurs relations jadis si espacées ne s’étaient réellement resserrées que depuis qu’elle s’était fixée au Val des Saints ; et ils s’aimaient, en se disputant, sans trop se voir.
A en croire les potins du monastère, M. Lampre, dont la fortune avait été considérable avant qu’il ne l’eût écornée par de nombreuses frasques, avait mené pendant sa jeunesse, à Paris, une existence de petit coq en émoi ; puis, il s’était converti et il avait désormais vécu, dans sa maison du Val des Saints, bienfaisant et rageur, très retiré.
Lui et Durtal s’entendaient bien ; des goûts communs les rapprochaient ; M. Lampre était peu au courant de la littérature contemporaine et tout à fait arriéré pour ce qui concernait l’art de notre temps. Il était, en sa qualité de collectionneur, confiné en un nombre de matières fort restreint. Il s’arrêtait, en peinture, avant même les tableaux des primitifs, aux enluminures et, en histoire monastique, il n’appréciait que les monographies et les cartulaires.
Il en détenait des collections très complètes ; il possédait surtout d’admirables livres d’heures du quatorzième et du quinzième siècles que lui enviait l’abbaye à laquelle il avait promis d’ailleurs de les léguer. Il avait naguère dépensé d’imposantes sommes à ces achats ; mais des époques moins débonnaires étaient venues ; il avait dû aider à l’installation, pourvoir même, pendant les premières années, à la subsistance de ces moines qu’il avait demandés à Solesmes et il était à la fois furieux contre eux qui l’empêchaient de continuer des dépenses somptuaires et satisfait de les secourir.
Les jours de mauvaise humeur, il grommelait son habituelle plainte : qu’est-ce que je leur réclame, en échange des belles occasions que j’ai, à cause d’eux, ratées ? De devenir des saints et j’y suis de ma poche, car ces mâtins-là me leurrent ; et, soulagé par quelques grains de débinage, il était de nouveau prêt à leur rendre service.
En sus de sa passion pour les cartulaires et les miniatures, il était encore, en sa qualité de Bourguignon, féru d’un autre amour, celui d’une bonne cave et, mélancoliquement, à table, il se remémorait les années où il n’avait pu acquérir une petite provision de beaune-hospice, parce que ces sacrés Bénédictins l’avaient mis à sec.
Ces regrets enchantaient sa nièce à laquelle il reprochait sa gourmandise.
— Voilà, disait-elle, il faut être indulgent les uns pour les autres, car chacun a sa petite manie et son gros péché ; moi, ce sont les friandises ; mon oncle, ce sont les vieux crus de la Bourgogne.
Mais il n’admettait pas cette assimilation ; l’amour des grands vins, disait-il, est un amour presque noble, car il y a une certaine beauté, un certain art dans la saveur, dans la couleur, dans le bouquet d’un Corton ou d’un Chambertin, tandis que la convoitise des chatteries et des gâteaux relève d’un sentiment bourgeois et décèle des instincts grossiers, des appétences viles ; et il la rabrouait, tandis qu’amusée de l’entendre grogner, elle se tordait.
En attendant qu’elle arrivât, — car ce matin-là elle devait déjeuner aussi, chez lui, — M. Lampre introduisit Durtal dans la pièce où s’alignaient sur des rayons de chêne les histoires monastiques et les cartulaires.
La pièce était vaste, tapissée d’un papier fleuri de coquelicots sur champ gris, meublée de bergères en velours d’utrecht citron, de tables d’acajou, d’un secrétaire empire avec serrure à trèfle.
Durtal explorait les bibliothèques, mais quelques-uns seulement de ces gros bouquins l’intéressaient car, de même que dans toutes les collections, il y avait, pour faire nombre et compléter les recueils, un tas de volumes illisibles que, pas plus que lui, M. Lampre n’ouvrait.
Ce qui captivait davantage Durtal, c’étaient les livres d’heures : ceux-là étaient rangés dans le secrétaire et enfermés dans des écrins. M. Lampre ne désirait généralement pas les montrer ; il les gardait jalousement pour lui. Il les avait pourtant exhibés déjà, plusieurs fois, à Durtal, mais il fallait que ce fût, lui-même, qui proposât de les regarder, sinon il demeurait sourd à toute invite.
Il avait offert, ce matin-là, de les examiner ; cela allait donc tout seul et il en sortit de leurs gaines quelques-uns.
C’était toujours un régal que l’apparition de ces fraîches merveilles ; je n’en ai pas beaucoup disait-il, mais je crois n’avoir râflé dans les ventes que des pièces de choix et il soupirait, avouant le prix de trente mille francs payé pour l’un de ces livres, magnifique du reste « Horae beatae Mariae Virginis », un petit in-quarto avec reliure du seizième siècle, à larges dentelles, un manuscrit de l’école flamande francisée de la fin du quatorzième siècle, en lettres gothiques, sur vélin, paré de cadres de branchages et de rinceaux, à chaque page ; et ce volume de près de 300 feuilles contenait une cinquantaine de miniatures à fonds d’or plat ou diapré, étonnantes, des vierges de nativité, à peine pubères, mélancoliques et mutines, des saint Jean, jeunes et imberbes, écrivant près d’un aigle, dans des intérieurs charmants, éclairés de croisées à résilles de plomb ouvertes sur de verts paysages à allées très pâles, menant à de petits donjons ; et de grandes scènes, telles que l’annonciation aux bergers, la visitation, le Calvaire étaient traitées avec une bonhomie de réalisme et un sentiment de piété naïve, vraiment touchants.
— Voici, dit M. Lampre, un diurnal de moindre prix, mais bien curieux ; remarquez la façon dont l’artiste a peint la sainte trinité ; elle diffère absolument du modèle connu, adopté par la plupart des enlumineurs du Moyen-Age : le saint esprit, planant sous la forme d’une colombe au-dessus du père et du fils. Ici, le père, couronné ainsi qu’un pape du trirègne, et assis sur le rebord d’une gloire, pareille à une amande d’or, les pieds appuyés sur l’escabeau du monde, tient en son giron Jésus qui tient, lui-même, de la même manière le Paraclet, figuré par la souriante personne d’un gamin blond. Est-ce étrange !
— Et ce qui est non moins étrange aussi, c’est la conservation de ce manuscrit ; les teintes sont en fleur, comme lorsqu’elles naquirent, s’écria Durtal, stupéfié, en effet, par ce coloris clair et jeune, par ces rouges restés intacts, par ces ors inaltérés, par ces ciels bleuâtres demeurés limpides.
— Ah ! ils n’acquéraient point leurs produits chez des marchands et l’aniline n’était pas encore inventée, répondit M. Lampre. Ces gens broyaient, eux-mêmes, leurs couleurs qu’ils extrayaient de certains minéraux, de certaines terres, de certaines plantes.
Nous n’ignorons pas leurs recettes ; ce blanc un peu pâteux que vous voyez là, est du blanc d’os, celui-ci plus léger est de la céruse : ce noir provient du charbon pulvérisé d’un sarment de vigne ; ce bleu est du lapis ; ces jaunes sont de l’herbe à foulon et du safran ; ce rouge vif du minium et ce brun rouge qui correspond à notre ocre est de la terre maigre, de la macra de Naples ; ce vert est tiré de la fleur de l’iris ou de la baie du nerprun ; ce bleu, tournant au violet, n’est pas, ainsi que vous le pourriez croire, obtenu par un mélange de bleu et de rose, il est issu du tournesol et il entrait dans sa composition des éléments assez hétéroclites, tels que de l’urine d’homme ayant bu du vin.
Ils se repassaient des ordonnances singulières mais efficaces, puisque aucune de leurs nuances n’a bougé. Le blanc d’oeuf qui était l’ingrédient le plus usité pour la détrempe, ils en détruisaient la viscosité avec de l’eau de lessive vieille de quinze jours et l’écume avec un peu de cerumen, de cire d’oreille. Pour fixer leur or, découpé dans des feuilles, ils commençaient par frictionner le parchemin avec de la colle à bouche, en ayant soin de ne l’employer que lorsqu’ils avaient terminé leur digestion ou étaient à jeun ; puis, ils usaient d’enduits adhérents dans la confection desquels figuraient de la gomme adragante, du bol d’Arménie et du miel ; d’après un récipé découvert dans les comptes de Dijon, à propos du peintre Malouel, ils se servaient aussi d’une gélatine extraite des nageoires de la morue.
Mais Durtal ne l’écoutait plus ; il considérait les éclatantes floraisons de ces vélins. Ah ! fit-il en refermant le livre, la délicieuse et la frêle et la fine petite fille, aux yeux d’azur et aux cheveux d’or, que cette enluminure qui enfanta, en une longue gésine, une fille si énorme, la peinture, qu’elle mourut, en lui donnant le jour !
— Oui, mais elle ne trépassa point sans avoir atteint l’apogée suprême de son art, avec Fouquet, Jacquemart de Hesdin, André Beauneveu, Simon Marmion, les frères de Limbourg et, dans ses dernières années, avec cet étonnant Bourdichon, qui peignit les Heures d’Anne de Bretagne.
Ceux-là qui travaillèrent pour les princes et les rois, nous les connaissons, car l’on a retrouvé leurs noms et l’état civil de leurs ouvrages dans les layettes des archives et les registres des trésoreries, mais combien restent inconnus ! Et, dans les clôtures où la miniature naquit et où les moines ne mentionnèrent pas toujours par écrit les noms de leurs praticiens, combien de chefs-d’oeuvre anonymes ou perdus, combien attribués à des laïques qui furent leurs imitateurs ou leurs disciples !
Certainement, reprit M. Lampre, après un silence, en ouvrant les heures de la vierge, ce manuscrit est une merveille, mais, à vous parler franc, mon rêve, à moi, eut été de posséder des peintures moins parfaites peut-être, mais antérieures à celles-ci et d’origine monastique plus sûre, cette bible, par exemple, dont il est question dans la chronique de Cluny et qui avait été copiée et enluminée par Albert de Trèves et parée par les ornemanistes du cloître d’une reliure sertie d’or et oeillée de béryls et de rubis ou bien encore un volume de ce religieux nommé Durand qui illustrait si magnifiquement les livres liturgiques de l’abbaye que l’abbé voulut, en signe de reconnaissance et d’admiration, que la communauté doublât pour lui, après sa mort, l’office que l’on chantait pour chacun des frères défunts.
J’aurais vendu maison, champs, tout le bazar, pour les acquérir. Qu’étaient ces moines dont les travaux ravirent leurs contemporains ? Je l’ignore : les histoires de Cluny et les biographies de quelques-uns des abbés sont parfois disertes, mais elles nous renseignent mal sur la vie de ces miniateurs qu’elles signalent, pêle-mêle, avec les architectes, les joailliers, les relieurs, les tailleurs d’images, les verriers, avec tous les ouvriers d’art, issus de toutes les régions, qui remplissaient le monastère, car ce fut une véritable école d’art mystique, sous toutes ses formes, que Cluny !
— Sans compter, fit Durtal, les écrivains, tels que saint Mayeul, saint Odilon, saint Hugues, Pierre le Vénérable, d’autres qui ne furent point canonisés et qui nous laissèrent d’instructives monographies, Syrus, celle de saint Mayeul, Jotsand, celle de saint Odilon, enfin le célèbre Raoul Glaubert, dont l’histoire universelle est, tant de fois, depuis le Moyen-Age, citée.
Mais la gloire de l’abbaye, ce furent surtout ses architectes qui l’assurèrent. Je me rappelle avoir visité ces restes devenus une école professionnelle et un haras ; les ruines de la basilique suggèrent l’idée contradictoire de la sveltesse et de l’énormité ; cette église gigantesque avec sa forêt de clochers, son vestibule grand à lui seul comme Notre-Dame de Dijon et précédant la réelle église, immense, avec ses cinq nefs, ses futaies de piliers aux chapiteaux sculptés de feuillages, d’oiseaux, de bêtes chimériques, ses trois cents fenêtres dont les personnages brûlaient en des torches de couleur, ses deux cent vingt-cinq stalles de religieux, dans le choeur, suscitait l’impression d’un monument colossal, décelait le type d’un style roman qui ne subsiste que là et dont les proportions formidables n’ont pas été dépassées par le gothique.
Il n’y a pas à barguigner, c’étaient de fiers lapins, les deux moines qui érigèrent cette basilique géante, Gauzon qui en traça les plans et Hazelon qui les exécuta !
— Et il n’y eut point que ces deux-là, dit M. Lampre, des architectes dont les noms sont oubliés et qui étaient, eux aussi, des clunistes, ont rayonné de toutes parts et créé ces sanctuaires superbes de Paray-le-monial, de Saint-étienne de Nevers, de Vézelay, de la Charité-sur-loire, de Montierneuf, de Poitiers, de Souvigny, de combien d’autres encore !
Les Abbés n’avaient imposé aucune formule, aucun gabarit d’esthétique à leurs ateliers ; ils respectèrent le tempérament de chacun et cette déférence explique l’extrême variété de ces constructions et convainc d’erreur Viollet-le-duc qui voulait qu’il y eut un style Clunisien — et il n’en a pas existé de proprement dit ; — il y a eu un style roman et des architectes clunisiens l’utilisant, mais, tous, d’une façon différente, travaillant pour la gloire de Dieu, selon leurs conceptions personnelles, selon leurs forces !
— Ah ! ce Cluny ! s’exclama Durtal, ce fut vraiment l’idéal du labeur divin, l’idéal rêvé ! ce fut lui qui réalisa le couvent d’art, la maison de luxe pour Dieu ; je ne cesserai de le répéter, c’est à cette source-là que la congrégation moderne de France doit remonter, si elle veut conserver sa raison d’être.
— Vous en causez à votre aise ; il faudrait découvrir des gens de talent et pieux, dans tous les génies, ou en créer et ce n’est pas commode, fit M. Lampre.
— Evidemment ; mais, imaginez, à Paris, un cloître et une église édifiés par Dom Mellet, l’architecte monastique de Solesmes et une colonie venue de cette abbaye, chantant, sous la direction de Dom Mocquereau, le plain-chant ; imaginez des cérémonies magnifiques, des ornements, des statues, tout à l’avenant. Le succès des Bénédictins eut été prodigieux ; le snobisme s’en serait même mêlé, ainsi que pour la troupe des cabots de Saint-Gervais, mais il aurait aidé à attirer les foules.
Et ils auraient certainement gerbé des vocations d’artistes fascinés par la splendeur de ce milieu et récolté tout l’argent qu’ils auraient voulu. Ajoutons qu’ils auraient singulièrement avancé l’heure du triomphe du chant grégorien, en l’implantant, en plein coeur de Paris et qu’ils auraient pu occuper dans l’art une telle place qu’aucun gouvernement n’aurait osé les toucher.
Afin d’obtenir un semblable résultat, il eût été nécessaire, pour parler la langue industrielle, de faire grand, d’exposer une maîtrise impeccable, de dérouler sous d’imposantes voûtes un habile cortège de fastueux liturges. Seul, Solesmes était de taille à réaliser un pareil concept ; mais par suite de circonstances désastreuses, indépendantes de sa volonté, l’abbé n’a pu établir un monastère à Paris. La malechance s’en est mêlée comme autrefois à Solesmes même, lorsque Dom Couturier voulut rénover l’enluminure.
— Tiens, vous savez cela ?
— Dame, Dom Felletin m’a raconté ce projet et nommé un oblat fort expert en cet art désuet...
— Anatole Foucher, oui, je l’ai jadis fréquenté...
— Et qui a façonné des élèves à sainte Cécile de Solesmes.
— Et aussi chez les Bénédictines de la rue monsieur, à Paris, car les miniatures se sont maintenant réfugiées dans les cloîtres féminins de l’ordre. J’ai vu, d’ailleurs, des vélins dessinés et coloriés par ces moniales de Paris et aussi par celles de Dourgne et qui révélaient, en sus d’une savoureuse adresse de métier, des surgies d’âmes vivant en Dieu, vraiment charmantes.
Il y a bien aussi les dames du monde qui historient le parchemin, mais je n’ai pas besoin de vous décrire leurs contre-sens liturgiques et la fadeur de leurs imageries dignes de figurer sur des boîtes de baptême ou dans les pieuses et bébêtes chromos d’un Bouasse.
— Celles-là, je les connais ; je les ai autrefois visitées à Paris, où la société de ces nobles gribouilleuses les exhibait en de précieux salons ; mais il y a encore pis, une nouvelle école, appliquant les procédés du moyen-age, à des sujets contemporains et profanes ; celle-là, composée de pénibles virtuoses, plaque sur des fonds, en relief, une boue d’or qui sert de monture à des turquoises d’occasion et à des bouts de perles. C’est le rastaquouérisme de l’enluminure ; je doute qu’elle puisse jamais être traitée avec un goût plus vil et un dessin plus bas.
— Je vous l’ai dit, avant de disparaître complètement, elle se survit en Foucher et en ses quelques disciples, perdus derrière les grilles des cloîtres. à noter encore — j’ai lu cette annonce quelque part — que les Bénédictines de Maredret, en Belgique, ont illustré un superbe manuscrit de la règle de saint Benoît offert à l’empereur d’Allemagne, par l’abbé de Maria Laach ; c’est tout ce que je sais.
— J’arrive en retard, s’écria Mlle de Garambois qui entra en coup de vent dans la pièce ; mais c’est la faute du père Felletin que j’avais fait demander à l’auditoire...
— Le déjeuner est prêt, fit M. Lampre, en voyant la bonne ouvrir la porte de la salle à manger ; allons, à table ; vous vous excuserez après.
— Je suis furieuse, dit-elle, lorsqu’ils furent assis ; je n’ai pu communier, ce matin, parce que, malgré sa promesse, Dom Felletin ne m’a pas confessée, hier au carmel de Dijon. Il vient de m’expliquer qu’il avait été requis au dernier moment et mis dans l’impossibilité de prendre le train... vous avouerez que, depuis la nomination de ce curé, Notre Situation devient absurde au Val des Saints !
— Je vous crois, repartit Durtal, quand je pense que le jour de la pentecôte, le jour de la fête du saint esprit, les pères n’ont pas officié à l’église parce que c’était un dimanche et que ledit curé n’avait pas jugé à propos de leur prêter son immeuble, c’est inouï ! Il a fallu se contenter d’une messe chantée dans ce malheureux petit oratoire où l’on étouffe et où aucune cérémonie n’est possible.
Lorsque je me rappelle pareille fête, l’année d’avant, avec l’office pontifical, la théorie des moines dont les coules noires et les aubes blanches tranchaient sur la pourpre et l’or des ornements, lorsque je me rappelle le « veni creator » enlevé par tous les moines et projeté jusqu’aux voûtes par la trombe des orgues et que je songe à la misère de ce que j’ai entendu et vu dans le brouhaha et l’asphyxie de ce pauvre refuge, j’enrage et voue à tous les cinq cents diables et l’épiscope et son curaton !
— Vous avez la messe et les vêpres de la paroisse, dit, en riant, M. Lampre.
— Ah ! s’écria Durtal, figurez-vous que, dimanche dernier, je me suis glissé, à l’heure du salut, dans l’église et que j’y ai assisté à l’un des spectacles les plus bouffes qui soit. Le baron des atours était debout devant un harmonium dont son grand cadet-lagingeole de fils lubréfiait de ses doigts humides les touches.
Et le baron, après s’être nonchalamment passé sur le stérile boulet de son occiput une main qu’allumaient des bagues, a retroussé la brosse à dents de sa moustache militaire et, les yeux au ciel, d’une voix acétique, a débité un étonnant couplet dont je n’ai retenu que la fin.
Jésus sera mon ambroisie
Et mon doux miel,
Je serai sa maison chérie,
Son petit ciel.
Voyez-vous le baron devenu le petit ciel du Christ ! Les paysannes ahuries ouvraient des bouches en valves d’huîtres et notre curé dodelinait du chef et souriait, déférent et heureux.
— Oui, certainement, répliqua M. Lampre, avec sa morgue et ses prétentions vocales, le baron des atours est bien ridicule, mais sorti de là, il faut dire, pour être juste, qu’il est un brave homme qui rend d’appréciables services aux sociétés philanthropiques de Dijon. Son fils est également beaucoup moins godiche qu’il n’en a l’air. C’est un honnête garçon, très travailleur, mais dame ! Il n’a jamais quitté sa province ! — Tenez, bien qu’il soit provincial aussi, celui-là, je vous le recommande, poursuivit-il, en débouchant avec des soins infinis une bouteille. Ce vin est du clos de la commaraine ; il est produit par des vignobles dépendant du finage de Pommard ; nos pères le qualifiaient de « loyal, de vermeil et de marchand ». Il est, dans tous les cas, bouqueté par l’âge et de bonne garde ; regardez, c’est de l’escarboucle liquide qui coule dans le verre.
— Et il me reprochera ma gourmandise ! s’exclama Mlle de Garambois.
— Ma nièce, les grands crus sont des oeuvres monastiques comme l’architecture, comme l’enluminure, comme tout ce qui est bel et excellent, ici-bas. Le clos Vougeot et le Chambertin, l’honneur de notre Bourgogne, ont été cultivés, l’un par les moines de Cîteaux, l’autre par les moines de Cluny ; Cîteaux a possédé des vignobles dans les climats de Corton et de la Romanée ; les chartes de Volnay mentionnent, sur le territoire de cette commune, le clos saint Andoche, qui appartenait à l’abbaye Bénédictine de ce nom. Le monastère cistercien de Maizières et, plus tard, les Carmélites exploitèrent de nombreuses chevances à Savigny-les-beaune et vous savez que l’on appliquait alors au vin de Beaune les laudatives épithètes de vin « nourrissant, théologique et morbifuge » ; l’on ne peut le nier, les climats les plus renommés de notre province sont issus de l’art viticole des cénobites.
N’est-ce pas naturel, d’ailleurs ? Le vin est une substance sacramentelle. Il est exalté dans maintes pages de la bible et notre-seigneur n’a pas trouvé de plus auguste matière pour la transformer en son sang. Il est donc digne et juste, équitable et salutaire de l’aimer !
— Les médecins le prohibent maintenant, dit Mlle de Garambois.
— Les médecins sont des imbéciles, reprit M. Lampre ; outre que le vin réjouit le coeur de l’homme, ainsi que l’énoncent les saintes ecritures, il est d’un réconfort autrement puissant, autrement sûr, que les fers qui ne s’assimilent point et les autres drogues ; on l’interdit aujourd’hui aux gens qui se plaignent de maux d’estomac et nos pères l’employaient au contraire pour la cure de ces maux, témoin Erasme qui relate que l’on guérissait, de son temps, ce genre d’affections avec des doses réfractées de vieux Beaune ; la vérité est que notre-seigneur a justement choisi, pour nous les signaler et pour les anoblir, les deux substances qu’il jugeait les plus précieuses et qu’il destinait à assurer la santé du corps et de l’esprit : le pain et le vin ; aussi est-ce faire fi de ses enseignements, que de n’en pas user !
— Bien, mon oncle, mais il existe encore un autre point de vue que vous me paraissez négliger, le point de vue liturgique ; vous reconnaissez avec moi, n’est-ce pas, que l’idéal de Cluny, de célébrer les louanges de Dieu avec pompe, de lui dédier ce que nous avons de plus beau et de meilleur, est un idéal légitime et magnifique et, comme dirait notre frère Durtal, surélevé...
Elle se tut, attendant de son oncle un signe d’approbation.
Mais, sentant qu’elle préparait de loin une attaque, il resta impassible.
Elle reprit, considérant ce silence tel qu’une adhésion.
— Ne vous semble-t-il pas dès lors que le vin présenté au sauveur pour transsubstantier son précieux sang devrait être, lui aussi, à l’avenant des cérémonies liturgiques, du luxe et du confort dont on l’entoure, en notre ordre ; par conséquent les plus admirables crus des vins blancs devraient être distribués aux moines pour le service des messes et vous qui détenez d’exacts Montrachet et d’authentiques Pouilly vous feriez certainement une oeuvre pie, en vous dépouillant en faveur de l’autel.
Vous me prêcheriez, par la même occasion, un exemple du mépris de la table et de la fine chère qui me serait sans doute profitable...
— Ah ! C’est à cela que vous en vouliez venir, à la gourmandise pour le bon Dieu, je vous reconnais, là ! — eh bien, je ne veux pas, sous le prétexte d’honorer le très-haut, inculquer à ses prêtres des distractions de gourmets pendant la messe ; péché pour péché, il vaut mieux, tout bien considéré, que ce soit moi qui le commette, car il est moins grave, moins offensant pour Dieu, devant un verre, à table, que devant un calice, à l’église. Je conserverai donc, ne vous en déplaise, dans l’intérêt même de la religion, mes Montrachet et mes Pouilly, et avec la piété et le bon sens qui vous caractérisent, ma nièce, vous me donnerez, en y réfléchissant, raison.
— Je n’ai pas de succès, fit en riant Mlle de Garambois ; à vrai dire, je m’y attendais un peu ; mais voyons, mon cher Durtal, pour en revenir à notre malheureuse situation au Val des Saints, comment s’arrange la brave Mme Bavoil pour accomplir ses devoirs religieux, car elle est logée à la même enseigne que moi !
— Dame, ne pouvant se rendre souvent à Dijon pour y joindre le P. Felletin, car il n’y aurait plus de ménage et de cuisine possibles, elle se contente du curé ; mais elle n’y va qu’à son corps défendant et gémit d’être confessée, dit-elle, par un petiot qui ne sait rien ; j’essaie de la consoler en lui démontrant la parfaite sapience de Dieu qui l’a privée de toute grâce sensible, pour qu’elle n’ait pas de discussions mystiques avec cet homme — ça ne prend pas !
— C’est peut-être un bien, car ces ennuis l’aideront à supporter plus aisément le départ d’ici, si vous filez à la suite des moines.
Durtal eut un geste vague.
— L’idée de déménager mes livres et de charroyer l’amas de mes bibelots et de mes meubles m’abêtit à un tel point, soupira-t-il, que j’aime mieux n’y pas songer.
— Mais, fit M. Lampre, tous les pères ne déserteront pas la commune.
— Pourquoi ?
— Ecoutez, il y a d’abord la vigne qui est la principale ressource de l’abbaye et il faudra toujours bien laisser le P. Paton et les convers qu’il emploie pour la soigner. Il faudra, peut-être aussi, un ou deux religieux pour garder les immeubles ; il en restera donc forcément, quelques-uns, ici.
— Et si le gouvernement s’empare des bâtiments et de la vigne ?
— Turlututu ! j’ai offert à l’abbaye l’ancien prieuré et les terres qui en dépendent, mais je n’ai point été assez bête pour ne pas adopter des dispositions qui garantissent contre toute spoliation légale, et les pères et moi ; autrement dit, je loue aux Bénédictins leur maison que j’ai fait rebâtir — les devis, les factures sont à mon nom et c’est moi qui ai réglé, en personne, les mémoires des entrepreneurs et de l’architecte. — Les Bénédictins, suivant des baux consentis et enregistrés en bonne et due forme, me paient, chaque trimestre, contre quittance, les arrérages d’un loyer de dix mille francs par an. Je leur rends l’argent après ou ne le reçois pas, poursuivit, en souriant, M. Lampre, mais les pièces sont là ; je suis seul propriétaire de l’immeuble et des terres ; et comme ces biens me viennent de famille et que l’on ne peut arguer que je les ai acquis spécialement pour y loger des moines, aucune chicane de personne interposée n’est possible.
De même pour la vigne ; elle a été achetée à mon nom, soldée par moi, chez notaire — les actes en témoignent — et je suis également censé de leur avoir louée pour la faire valoir ; mes droits sont, au point de vue juridique, incontestables.
— Oui, mais ils peuvent empêcher les Bénédictins d’être vos locataires.
— Tout est possible, avec des happe-lopins de cette espèce ; mais personne ne peut interdire au père Paton, une fois relevé de ses voeux, d’entrer dans le clergé séculier du diocèse de Dijon dont il est originaire, et de me louer, en qualité, non plus de moine, mais de simple particulier, ma vigne ; de même encore pour les convers qui quitteront, eux aussi, l’habit monastique, et seront engagés au titre de domestiques.
J’en ai déjà causé avec le révérendissime et c’est ainsi que, d’un commun accord, nous agirons.
Par conséquent, quoi qu’il arrive, quitte à soutenir des procès que je me charge de prolonger pendant des ans, le cloître ne sera pas complètement vide et il y aura peut-être moyen de monter des offices, d’organiser quelque chose.
— Le père Paton, qui est-ce ? Jamais on ne le rencontre. Il paraît aux heures canoniales puis s’en va par la porte de la sacristie ; personne n’a de rapport avec lui.
— Le père Paton est un ancien curé, très fort en viticulture, un cénobite macéré, dur, comme il serait désirable qu’il y en eût beaucoup au Val des Saints ; il est, au demeurant, un excellent homme qui trime, du matin au soir, ainsi qu’un paysan, et qui, à cause même de son genre de travail, vit très à l’écart. J’ajoute qu’il a des vertus laïques, c’est-à-dire qu’il ne dénonce pas ses confrères et ne considère point la délation, telle qu’une vertu... nous aurons en lui un directeur rugueux mais dévoué, aimant vraiment les âmes...
— Ah ! vous me versez du baume dans le coeur ; peut-être que l’on pourrait alors ne pas partir. Si vous saviez combien cette perspective d’aller à Paris ou je ne sais où, devient maintenant, pour moi, un cauchemar !
— Attendez, cela tournera mieux que vous ne croyez ; vous verrez que nous nous en tirerons.
— Au fond, mon oncle, c’est vous qui tenez la clef de la situation, dit Mlle de Garambois.
— Oui, en partie, du moins ; je suis le paravent, un paravent blindé de procédure ; et je vous jure qu’il faudra déchaîner une sacrée brise pour l’abattre.
— J’ai visité, une fois, pendant une promenade, la vigne des pères, reprit Durtal. Elle est spacieuse et bien située ; ils fabriquent avec des vins de messe ?
— Oui, pas mauvais, d’ailleurs. Le coteau sur lequel le vignoble est placé est un sol argilo-calcaire, coloré de rouge par des oxydes de fer ; il ressemble à la terre de certains des climats de Pommard ; le père Paton y a planté des cépages de pinots et, dans quelques années, si les saisons sont propices, ce ne seront plus de simples vins de messe mais des vins de table plus qu’ordinaires qu’il y récoltera ; ce jour-là, l’abbaye sera riche.
En attendant, la vente des vins blancs suffit presque à compenser la dépense de la communauté ; aussi faut-il sauver à tout prix ce clos, car si les moines se fixent à l’étranger, ce sera grâce à lui qu’ils vivront, sinon, ce sera la disette et, à bref délai, la débâcle.
— Bien, admettons que le gouvernement ne puisse confisquer le vignoble ; il n’en restera pas moins impossible à Dom Paton et à ses domestiques de résider chez eux, dans la clôture, car ils seraient poursuivis sous inculpation de former ou de reconstituer une congrégation non autorisée.
— Il n’est pas utile que le P. Paton et les frères lais habitent le monastère même. Ils demeureront au dehors ; nous en recueillerons chacun un et l’office aura lieu, même si le commissaire de police appose les scellés sur les portes de la chapelle du noviciat et de l’oratoire, dans une pièce quelconque que l’on arrangera à cet effet, chez l’un de nous.
— Que Dieu vous entende ! s’écria Durtal qui se leva pour prendre congé.
— Eh bien, quoi, vous vous retirez, mais il n’est pas quatre heures !
— Si, à force de bavarder, nous avons atteint l’heure des Vêpres. Ecoutez tinter les premiers coups.
— L’heure des Vêpres ! dit M. Lampre, qui regarda sévèrement sa nièce ; c’est, ma foi, vrai ; et vous osez arborer des rubans blancs à votre chapeau et une cravate de la même teinte ! Et la sainte liturgie, qu’en faites-vous ?
— Mais, répondit Mlle de Garambois ahurie, c’est aujourd’hui une fête simple de la vierge et la couleur du jour est le blanc.
— Pardon, les Vêpres sont dimidiées ; elles sont panachées ainsi que des glaces mi-vanille blanches et mi-pistache, vertes ; elles sont marquées sur l’ordo, comme étant, à partir du capitule, du suivant, c’est-à-dire de demain dimanche, (de Ea), neuvième dimanche après la pentecôte, vert. Or, une liturgiste de votre envergure ne peut ignorer que le conopée du tabernacle change en ce cas-là, et arbore le ton de la deuxième partie, alias du lendemain. Vous devriez donc porter à cette heure des rubans et une cravate verts ; les avez-vous au moins sur vous, pour changer ?
— C’est la vengeance du Montrachet et du Pouilly demandés pour le service de l’autel, s’exclama Durtal, en riant.
— Je lui revaudrai cela, fit Mlle de Garambois, en riant, à son tour.
— Que M. Lampre nous conserve ici, des moines et vous ne lui revaudrez rien du tout ; et nous le bénirons, en choeur, au contraire.
— Ah certes, répliqua-t-elle, en se coiffant, car vivre sans mon office, c’est impossible et je filerai plutôt, si je le puis, à la remorque du monastère, en Belgique.
— Elle en serait bien capable, grogna son oncle, qui enfila son paletot pour se rendre avec elle, aux vêpres, dont le deuxième coup venait de sonner.
CHAPITRE XII
Evidemment la gloire de la sculpture des Pays-bas est, ici, à Dijon, pensait Durtal, en tournant autour du puits de Moïse qu’il était revenu voir dans l’asile d’aliénés, bâti sur l’emplacement de l’ancienne chartreuse de Champmol, situé à dix minutes de la gare.
Cet établissement, où l’on pouvait, à certains endroits, s’abstraire loin des fous, eût été un refuge de rêveries et d’art si l’on avait pu s’asseoir, tranquille, devant ce puits, sans être toujours accompagné d’une concierge attendant que l’on eût fini d’examiner les sculptures pour refermer le grillage qui les enclôt et vous reconduire, par les voies les plus courtes, dehors.
L’hospitalière ville de Dijon était, en ce lieu, insupportable.
Aussi, quand il s’était bien rempli les yeux de l’oeuvre de Sluter et de ses élèves, Durtal s’en allait-il la digérer plus loin, dans le délicieux jardin botanique qui borde la route de Plombières, en face du remblai des trains. Par le soleil de ce matin-là, les feuillages des grands arbres de l’asile se tachetaient de gouttes d’or qu’ils reversaient en gouttes bleuâtres sur les cailloux du sol ; l’on cheminait dans les allées sous un crible de lumière et d’ombre et la haie serrée des cyprès que l’on devait longer pour atteindre le préau où se trouvait le puits, parfumait d’un fleur léger de résine, le vent.
C’était dans ce préau solitaire, que s’élevait le monument commandé par Philippe le Hardi à Claus Sluter, assisté des imagiers les plus habiles de son temps.
Ce monument émergeait de l’intérieur même du puits, supporté par un piédestal hexagone, sur les pans duquel se tenaient les statues des six prophètes qui avaient annoncé la passion du Christ et il était surmonté d’une plate-forme appuyée sur six anges pleurant au-dessus des prophètes. Sur cette plate-forme, cette terrasse, comme l’appellent les anciens textes, se dressait jadis un Calvaire disparu, dont quelques débris avaient été recueillis par le musée archéologique de la ville. Le tout était abrité dans une énorme volière en fil de fer plafonnée d’un toit et garnie, au dedans, par-dessus la margelle même du puits qu’il dépassait, d’un plancher courant de bois et d’une balustrade au-dessous de laquelle l’on voyait l’eau quasi morte dans laquelle trempait le piédestal, verdi par les mousses, au fond du trou.
Et l’on se promenait sur ce balcon autour des effigies des prophètes, taillés grandeur nature, dans des blocs de pierre qui avaient été autrefois peints par Malouel mais étaient redevenus, avec l’âge, d’un ton uniforme où il entrait un peu de blond et beaucoup de gris.
La plus surprenante de ces statues, celle qui vous accaparait aussitôt par la véhémence imprévue de son aspect, était celle de Moïse.
Enveloppé d’un manteau dont l’étoffe aussi flexible qu’un véritable tissu, ondoyait en de souples plis, descendait en de mourantes vagues de la ceinture aux pieds, il étreignait, d’une main, les tables de la loi et de l’autre un rouleau déployé sur lequel se lisait la phrase de l’exode, devancière des temps : « La multitude des enfants d’Israël immolera un agneau, vers le soir. »
La tête était chevelue, énorme, avec le front renflé, en guise de cornes, de deux bosses, ridé d’accents circonflexes au-dessus de l’oeil qui clignait, dur et presque insolent, la barbe bifide roulant sur les joues, tombant en deux énormes coulées sur la poitrine, laissant à sec un nez en bec d’aigle et une bouche impérieuse, sans indulgence et sans pitié. Sous cette crinière de fauve, la face soulevée, s’avançait implacable ; c’était le visage d’un justicier et d’un despote, un visage de proie ; Moïse semblait écouter les excuses embarrassées des tribus coupables, prêt moins à pardonner qu’à châtier cette tourbe d’hébreux qu’il savait apte à toutes les défections, à toutes les idolâtries, à toutes les hontes.
Cette figure d’orage qu’on sentait sur le point d’éclater était d’une allure presque surhumaine ; elle était, en tout cas, autrement éloquente, autrement altière, soit dit en passant, que celle du Moïse que refit, moins d’un siècle après, Michel-ange, un Moïse également pourvu de cornes et d’une barbe de fleuve ; seulement, lui, n’érigea qu’une attitude, ne sculpta qu’un colosse indifférent, aux formes robustes, majestueuses même, si l’on veut, mais un colosse redondant et creux.
Malheureusement, il faut bien l’avouer, le Moïse de Sluter était le seul qui témoignait d’un art plus que réaliste, et d’un certain essor parmi les statues réunies du groupe ; les autres n’étaient plus, en effet, que des oeuvres terre à terre, admirables, mais sans surgie d’âme, sans envolée dans l’au-delà. La plus typique, en ce genre précis et plat, était celle du roi David qui se dépréciait, par contraste, du reste, en l’avoisinant.
Le chef ceint d’un diadème, les cheveux longs et bouclés, la barbe divisée sous le menton en deux touffes timorées, il s’annonçait, la main posée sur une lyre et déroulant, de l’autre, un phylactère sur lequel étaient gravés ces mots : « Ils percèrent mes pieds et mes mains et dénombrèrent mes os. »
Ce David avait la placide figure d’un Hollandais blond et tirant sur le roux, d’un bon bourgeois un peu soufflé, nourri de fumures et de salaisons, engraissé par de pesantes bières. Il était, le futur « roi boit » de Jordaens, avant l’épiphanie et avant le repas. Il s’attestait, en somme, plus alourdi que désolé, plus somnolent que songeur ; cette statue était parfaite en tant que portrait d’homme du nord, riche et un peu dédaigneux, plus apte à jouer du vidrecome que de la lyre, mais elle était absolument insuffisante pour représenter la préfigure du Christ et le Psalmiste.
Plus recueilli, plus sérieux, était le prophète Jérémie, placé à ses côtés ; coiffé d’un chaperon, les joues et le menton ras, le nez busqué et les yeux clos, il tenait de sa main droite un livre grand ouvert et de la gauche une banderole avec cette inscription : « O vous qui passez, voyez s’il est une douleur comparable à la mienne. »
La physionomie était moins douloureuse que réfléchie ; c’était celle d’un des religieux de la chartreuse de Champmol qui avait sans doute servi de modèle, en tout cas, celle d’un prêtre en train de faire sa méditation ; elle était prise sur le vif et avait dû être d’une ressemblance à crier ; mais quel rapport ce prêtre tranquille avait-il avec Jérémie dont l’existence d’épreuves et de larmes fut considérée autant qu’une vivante prophétie des souffrances du Christ ?
Et l’on pouvait en demander autant pour Zacharie, couvert d’un étrange chaperon où il y avait du chapiteau d’église et de la tourte ; lui, baissait vaguement affligé, une tête paysanne de vigneron, aux moustaches, seules rasées, dans un flot de barbe. Sûrement, l’on avait aperçu ce vieillard derrière un comptoir ou dans un chais préparant les envois de ses queues et de ses tonnes aux débitants des villes ; cette face terrienne et marchande était un peu exhaussée par les tribulations et anoblie par les peines ; mais elle exhalait quand même l’odeur de sa caque. étaient-ce bien ces paroles qu’il affichait sur sa feuille dépliée de parchemin : « Ils ont apprécié ma rançon à trente deniers », qui le navraient de la sorte ? Il avait plutôt l’air de déplorer la perte d’une vendange que la mort du Verbe.
Autre était son voisin, Daniel, désignant violemment du doigt le phylactère sur lequel était écrit : « Après soixante générations, le Christ sera occis. » Celui-là discutait, rageur, contre les incrédules. Dans cette réunion taciturne, lui seul, parlait ; et il n’était nullement marri mais rebiffé. Il était un Bourguignon qui avait la tête près du bonnet et qu’il ne fallait point contredire. Coiffé d’un turban lâche d’étoffe, revêtu d’une ample robe retenue par une ceinture, drapé dans un manteau magnifique, aux parements studieusement brodés, il se détachait, de profil, le nez en lame de serpe, les cheveux ondulés, la barbe fleurie de petites bulles. Il tenait à la fois du négociant et du juriste, du négociant riche surtout. Il devait acheter les vins de Zacharie, intimider par son ton agressif les objections des clients, hâter, par la fougue de ses boniments, les ventes.
Enfin Isaïe affirmait autant, sinon plus que les autres, le désaccord trop certain qui existait entre ces statues et les personnages qu’elles étaient censées représenter. Lui, apparaissait sous les traits d’un vieux juif, d’un rabbin des judengasses, d’un patriarche des ghettos. Le crâne rond, chauve, creusé de ravines sur le front, chaque joue sabrée de profondes rides au-dessous du sécateur qui lui servait de nez, la barbe en fourche, les moustaches retombant, à la chinoise, aussi longues que la barbe, et les yeux aux lourdes paupières, presque fermés, il penchait tristement la tête, un livre sous un bras et, pendant au bout de l’autre, un rouleau sur lequel était tracée cette phrase : « Comme une brebis à la boucherie, on le conduira et comme un agneau, en présence du tondeur, il sera muet et n’ouvrira pas la bouche. »
En aucun temps l’on n’avait extrait de la pierre une image plus incisive et plus vivante, une effigie plus véridique, un portrait plus beau, mais ici encore la même question se posait : quelle analogie pouvait-on relever entre cet octogénaire las et triste et l’évangéliste de l’Ancien Testament, le nabi en tumulte, l’impétueux, le vitupérant Isaïe ?
Le Moïse mis à part dont la face léonine et l’allure grandiose spécifiaient bien l’être extraordinaire que fut cet homme, les autres prophètes de Sluter n’incarnaient qu’un gambrinus à jeun, un Chartreux ou un prêtre, un vigneron, un négociant, un juif.
Et Durtal, rôdant encore autour d’eux, se disait : oui, mais si l’entente entre ces personnages et les prédictions qu’ils annoncent, ne surgit point, si la lamentation des événements qu’ils promulguent n’émeut pas suffisamment ces hérauts des symboles divins, c’est parce que Claus Sluter en a décidé, volontairement, ainsi. Ses visages sont plus ou moins absorbés, plus ou moins dolents, mais l’expression de leurs peines s’en tient là. Les prophètes s’attristent, mais les anges qui les surmontent, en les séparant, pleurent.
Le rôle de « plorants » est, en effet, spécialement dévolu, en cette oeuvre, aux anges, et vaguement, en cherchant bien, l’on discerne les motifs de ce choix.
Les prophètes ont vu la Passion du Messie dans la mesure où Dieu voulut bien la leur montrer et chacun d’eux répète le détail qui lui fut le plus particulièrement livré ; ils se complètent, les uns les autres, le seigneur ayant divisé les visions et ne les ayant pas départies, toutes, d’emblée, à un seul ; ils devaient être consternés par la certitude acquise que ce peuple incorrigible qu’ils étaient chargés d’avertir et de réprimander, commettrait le plus abominable des forfaits, en crucifiant le Christ : mais, une fois les révélations messianiques reçues et propagées parmi les familles d’Israël, ils vivaient dans le présent, dans leur époque, et il est compréhensible que cet avenir qu’ils n’étaient pas appelés à voir de leurs propres yeux et qu’ils n’apercevaient d’ailleurs que fragmenté, dans la lumière divine, ne les ait pas jetés dans un état permanent de larmes. Sluter a donc eu peut-être raison de limiter les indices de leurs sentiments et de confier les signes plus manifestes de la douleur aux purs esprits qui, tout en ne pouvant découvrir par eux-mêmes l’avenir, ont un mode de connaissance plus subtil que le nôtre, et sont, en tout cas, indépendants, en leurs êtres, des conditions de temps et de lieux.
Une autre question à tirer au clair, serait celle de déterminer la part assignée à ses collaborateurs, dans cet édifice. En sus de Claus de Werve, qui a, nous le savons, sculpté les anges, plusieurs sculpteurs travaillaient sous ses ordres, Hennequin de Prindale, Rogier de Westerhen, Pierre Aplemain, Vuillequin Semont, pour en citer quatre dont les noms me reviennent. Un autre appelé Jean Hulst, semble indiqué plus particulièrement, tel qu’un ornemaniste, ciseleur de feuillages et de chapiteaux. Dans quelle mesure contribuèrent-ils à parfaire les figures du puits ?
D’après les comptes de la chartreuse, conservés dans les archives de la côte-d’or, il paraît que Claus de Werve, et Hennequin de Prindale auraient sculpté certains morceaux des statues des Prophètes.
Lesquels ? Serait-ce la partie des parures et des ornements ? s’il en était ainsi, ils seraient, il faut bien l’avouer, en leur genre, les plus étonnants des spécialistes, car les harpes brodées sur le manteau de David, les festons, les rinceaux, les croix grecques qui passementent ceux de Daniel et d’Isaïe, les boucles ciselées de leurs ceintures de métal et d’étoffe, les livres de Jérémie et d’Isaïe avec leurs feuilles de pierre aussi flexibles que des feuilles de vélin, leurs reliures à plaques, à cabochons, à courroies, à coins, sont exécutés avec une adresse et presque une sorte de trompe-l’oeil, qui déconcerte. Jamais, en l’art de la sculpture, accessoires n’ont été plus pertinemment oeuvrés, plus patiemment rendus.
Mais rien ne prouve qu’ils se soient confinés dans des reproductions de nature morte et qu’ils n’aient pas travaillé, aussi, aux parties vives des modèles. Le nom de Sluter couvre tout ; et, faute de renseignements plus précis, il absorbe à lui seul la gloire des humbles imagiers qui l’aidèrent.
Et ils étaient, non de simples ouvriers mais bien de personnels artistes, car, après la mort de Sluter, ce fut l’un des deux, Claus De Werve, qui devint le sculpteur en titre du duc et c’est à lui que l’on doit l’achèvement de l’ouvrage commencé par De Marville et Sluter, le tombeau de Philippe le Hardi, actuellement au musée de la ville.
Il y besogna, assisté, lui aussi, par d’autres « entailleurs de pierre » dont il accapara, à son tour, la part de gloire ; et ce labeur dura cinq ans.
C’est singulier, murmurait Durtal, en regardant encore avant de partir le groupe des prophètes, en son ensemble, comme ce Sluter, qui vivait à la fin du quatorzième siècle, annonçait déjà, bien avant la mort du Moyen-Age, la renaissance. Son art est étrangement en avance sur les données de son siècle. s’il n’avait plus ce concept vraiment mystique des imagiers des époques précédentes, s’il répudiait leurs visages émaciés et brûlants, leurs poses hiératiques, leurs corps effilés, presque fluides, contenus dans des gaines d’étoffes rigides, tuyautées de longs plis, il apportait, en échange, des attitudes moins contraintes, des physionomies plus naturelles de gens redevenus, sur la terre, pesants ; il apportait un jeu de draperies plus malléables et de dessous plus souples ; il apportait surtout un don d’observation et une puissance à insuffler la vie qui font de lui l’un des plus grands artistes de tous les temps.
Il était certainement pieux puisqu’il a terminé ses jours dans un cloître et cependant son art ne décèle qu’une piété de superficie, qu’une piété de commande ; ses portraits sont ceux de gens qui se préoccupent plus de leurs propres affaires que de celles de Dieu ; ses prophètes sont des prophètes de marchés et de coin de feu ; son oeuvre n’a pas été préparée par la prière et elle ne suggère pas l’idée de prier devant ; et c’est là, la tare de cette sculpture, si on l’envisage au point de vue où d’ailleurs, elle-même, se place ; car le tout est de s’entendre. Si Sluter ne nous avait pas présenté ses personnages comme étant des personnages de la bible, s’il les avait simplement étiquetés, sur un monument civil, sous le nom de négociants, de prêtres et d’échevins, il n’y aurait qu’à admirer et sans aucune restriction le talent immense de cet homme.
Le Calvaire qui était autrefois érigé sur le socle et dont il subsiste des débris était-il d’un sentiment plus religieux ? J’en doute, poursuivit Durtal ; j’ai vu au musée la tête retrouvée du Christ ; elle est correcte, d’un art déférent, d’une expression pathétique, d’une dévotion sonore, mais elle n’est pas supraterrestre, elle n’est pas divine et quant à la Vierge, dressée sur le portail de la chapelle, à quelques pas d’ici, elle suggère l’idée d’une femme méchante, prête à fouetter un enfant qui pleure.
Je refuse de croire que cette Vierge soit de lui ; l’homme qui, à défaut de l’influx mystique, a tout de même su rendre la grandeur épique d’un Moïse, n’a pu concevoir un type aussi vulgaire et aussi mensonger de Vierge !
Non, ce que je préfère la petite Madone de la fresque qui s’efface sur le mur de Notre-Dame de Dijon ; et au fond, c’est la réflexion qui me vient : le vrai sens divin, il n’est ni ici, ni au musée, mais dans les oraisons peintes de cette église !
Oui, je sais bien, je t’embête, reprit-il, considérant la concierge qui commençait à agiter furieusement son trousseau de clefs ; tu te fiches de Sluter et de Claus De Werve dont tu as cependant appris les noms pour les réciter aux touristes et ces imagiers vont te valoir, une fois de plus, pourtant, dix sous ; tu devrais songer à eux, à ces braves Hollandais qui m’incitent, d’outre-tombe, à te donner la pièce — et, ce n’est que juste, car tout, ici-bas, même les rêveries se paient, fit-il, en quittant l’asile.
Il se rendit, à petits pas, au jardin botanique ; il était formé de l’ancienne promenade de l’arquebuse, réunie au jardin des plantes et il était charmant avec ses chemins intimes, ses hautes frondaisons, ses massifs de fleurs, ses pelouses aux gazons semés de pâquerettes et de boutons d’or.
Certaines charmilles lui rappelaient la Trappe de Notre-Dame de l’âtre et certains bancs de pierre, adossés à la maison du dix-huitième siècle qui s’étendait devant le jardin, l’ancienne pépinière du Luxembourg.
Le matin, quelques bonnes tricotaient près d’un gigantesque peuplier dont le tronc creux s’ouvrait en une grotte de bois, au ras du sol. Cet arbre, qui figurait sur d’anciennes vues cavalières de Dijon, bombait une carapace d’éléphant rogneux, cerclée de bandages, corsetée de fonte, étayée par des béquilles, retenue par des fils de fer, dans tous les sens.
Et, çà et là, des prêtres lisaient leurs bréviaires et des jardiniers brouettaient des charretées de fleurs ; l’on humait près des marges des plates-bandes, l’odeur de miel et d’herbe fraîche des iris ; mais par instants, l’ingénu et le sucré parfum était balayé par un coup de vent qui soufflait une bouffée de cette odeur aigre et mûre que répand le chalef, l’olivier de Bohême, dont on apercevait des spécimens, au fond du jardin, trois ou quatre arbres aux troncs d’encre, aux feuilles d’argent et aux fleurettes d’or.
Et cela sentait le melon avancé, la fraise qui tourne, l’emplâtre qu’on enlève.
Durtal, avant de s’asseoir, faisait un tour dans les allées qui séparaient les massifs. Il y avait là des collections de conifères, des cèdres bleus, des mélèzes variés, des pins aux fûts presque blonds et aux aiguilles presque noires et, dans les parterres, des corbeilles de roses saumonées, thé clair et soufre, des croix de malte d’un rouge de bichromate de potasse vif, des buissons magnifiques d’aconits, aux feuilles sombres, aux découpures linéaires aiguës, aux fleurs d’un bleu céleste de turquoises, mais de turquoises dont on aurait, de leur azur trop lourd, décanté le blanc.
C’est vrai cela, ruminait Durtal, ces aconits sont des turquoises végétales aux nuances plus légères et plus pures ; mais si maintenant elle est bénite par les baladins dont elle raccommode les cordes vocales, usées par l’abus des scènes, de quelle haine cette plante ne fut-elle pas poursuivie par nos ancêtres qui la croyaient née de l’écume de cerbère et la qualifiaient du plus soudain des poisons ! — par contre, en voici une, mieux famée, monastique au moins, reprit-il, en regardant de blanches aigrettes qui fusaient, en forme de jets d’eau, de touffes énormes portant, au bout de tiges teintes en cramoisi, de larges feuilles d’un vert sourd et lustré ; c’est l’âcre et la stimulante rhubarbe, l’herbe des moines, ainsi nommée parce qu’elle abondait jadis dans les officines des cloîtres dont elle était le remède préféré ; et le fait est que le père Philigone Miné en distribuait, à profusion, en cachet et en poudre, aux paysans du Val des Saints, qui se plaignaient de fatigues et de malaises.
Quant à ces gueuses-là, elles ne sont anoblies par aucune ascendance conventuelle et elles sont d’une laideur qui autorise à les classer dans la catégorie de ces plantes néfastes, bordant les clairières des forêts dans lesquelles se démenait, au Moyen-Age, le Sabbat, continua-t-il, examinant, en un coin, parquées à l’écart, des plantes grasses, alignées dans des pots.
D’aucunes ressemblaient à des raquettes velues, à des lobes d’oreilles géantes hérissées de poils ; d’autres affectaient des contours de serpents aux peaux pelées et piquées de crins ; d’autres encore pendaient, telles que des bajoues de vieillards aux barbes pas faites ; d’autres enfin s’arrondissaient en palettes pour battre les bouchons, des palettes munies de cils blancs et coupés ras ; et elles arboraient, au soleil, des couleurs horribles, des verts de moisissure, des jaunes d’ictère, des violets de tartre de vin, des roses de brûlures, des bruns de morilles pourries, de cacao mouillé.
Cette exhibition de monstres l’amusait et il s’intéressait aux avatars de leurs tons, mais, ce matin-là, il était obsédé par les sculptures du puits et surtout par ce Claus Sluter dont la personnalité le hantait. Il s’éloigna des plantes grasses et, seul, sur un banc, il se remémora les quelques renseignements qu’il avait lus sur cet artiste.
On le savait né dans la Néerlande, originaire peut-être, ainsi que son neveu Claus De Werve, de Hatheim, au comté de Hollande. Il vint en Bourgogne, on ne connaît pas comment, et il entra, pendant l’année 1384, en qualité de sculpteur, dans l’atelier de Jean De Marville, maître imagier et varlet de chambre du duc. Après la mort de ce Marville qui trépassa, en 1389, il fut investi de ses titres et il travailla au tombeau de Philippe le Hardi, sculpta le portail de la Chartreuse, le puits de Moïse, diverses statues pour les châteaux de Germolles et de Rouvres.
Quel homme était-ce ? Faut-il croire, avec M. Cyprien Monget qui hasarde cette opinion, dans son livre très sagace et très documenté sur la chartreuse de Dijon, que Sluter était de caractère difficile et toujours mécontent, parce qu’il faisait constamment réparer ou modifier le logis qu’il occupait, après Jean De Marville, dans une maison appartenant au duc et surtout parce qu’il changeait d’ouvriers comme de chemises ? C’est bien possible, mais il faut dire, à sa décharge, que d’après les devis mêmes des architectes, l’immeuble usé ou mal bâti menaçait ruine et que, d’autre part, ces ouvriers qu’il transplantait de la Flandre et des Pays-bas dans un pays de vignobles où le vin se vendait bon marché, étaient peut-être, à certains moments, ingouvernables.
Nous sommes, au demeurant, fort mal renseignés sur sa façon de vivre et sur le plus ou moins de souplesse de son caractère ; sans crainte de se leurrer pourtant, il est permis d’admettre qu’il avait parfois des idées singulières ; une quittance du bailliage de Dijon nous apprend, en effet, qu’il commanda à un orfèvre une paire de besicles pour en orner le nez de sa statue de Jérémie ; et l’on est en droit de se demander ce que pouvait bien signifier pour lui, alors qu’il s’agissait d’un prophète de la bible, cet attribut ?
Mieux vaut, en tout cas, croire à un état d’esprit bizarre qu’à un désir de rendre plus ressemblant encore le portrait du Chartreux ou du curé qui lui a évidemment servi de modèle, car ce serait la preuve trop certaine alors d’une incompréhension ou d’une indifférence par trop naturalistes du sujet religieux qu’il s’était engagé à traiter.
Si sa jeunesse ne nous est pas révélée, et si son âge mûr nous est à peu près ignoré, sa vieillesse nous est, en revanche, mieux connue.
Avant même qu’il n’eût achevé les travaux prescrits par le duc, il se retira à l’abbaye de Saint-étienne, de l’ordre de Saint-augustin, à Dijon et, en 1405, après un séjour de deux ans, il y mourut.
Le contrat passé entre lui et frère Robert de Beaubigney, docteur en décret et abbé de ce monastère, est classé dans les archives départementales de la Côte-d’or, et l’on peut s’informer, en le lisant, du mode d’existence que Sluter mena pendant ses derniers jours.
Moyennant une somme de quarante francs d’or, dont moitié fut payée comptant, il disposait, sa vie durant, pour lui et un domestique, d’une chambre et d’un cellier, dans le cloître ; on lui donnait, tous les dimanches, vingt-huit petits pains dits michottes ou quatre, tous les jours, à son choix, plus une pinte et demie de vin, mesure de Dijon ; et, chaque fois qu’il y avait distribution extraordinaire de vivres, à l’occasion d’une fête, le couvent était tenu de lui allouer une portion de chanoine. Il lui était loisible de prendre ses repas, chez lui, ou en ville, ou dans le réfectoire de l’abbaye, avec les moines ; mais, dans ce cas, il apportait son pain et son vin et devait se contenter de l’ordinaire de la communauté « sans autre pitance et provende avoir ».
Enfin, il devenait, aux termes de cet acte, « féal à l’Abbé et à son monastère » et il devait participer aux messes, prières et oraisons dudit monastère qui devait, à son tour, profiter de ses prières et oraisons.
Il fut, en un mot, l’oblat d’une abbaye Augustine. Il y résidait, il y mangeait quand il lui plaisait et il était maître de travailler à sa guise, de surveiller, au dehors, ses ateliers qui étaient situés dans d’anciennes écuries appartenant aux Ducs.
Et cela fait naturellement songer à ces « frères de la vie commune » qui prospéraient, à la même époque, en Hollande, et qui avaient été placés, eux aussi, par leurs fondateurs Gérard le grand et Radewyns, sous la règle de saint Augustin.
Leur petit cloître laïque à Deventer était composé de savants et d’artistes, qui copiaient des manuscrits, les enluminaient, s’occupaient d’art religieux, tout en priant, à certaines heures, ensemble.
La véritable raison d’être de l’oblature moderne est celle-là, se disait Durtal.
Ainsi que le remarque fort bien Dom Felletin, il n’y a pas à vouloir l’étendre ainsi qu’un tiers-ordre qu’elle n’est pas, au sens strict du mot. Les tiers-ordres contemporains — qui sont d’ailleurs des oeuvres excellentes et constituent sans doute, avec les événements dont nous sommes menacés, les réserves d’une nouvelle sorte de monachisme pour l’avenir, — suffisent. Du moment qu’elle relève du finage Bénédictin, l’oblature, en dehors de la sanctification personnelle de ses membres, obtenue par les moyens liturgiques, ne peut poursuivre qu’un but : rénover l’art catholique tombé si bas. Il semblerait, au premier abord, que cette tâche serait plutôt celle des religieux, mais il est bien évident que les cloîtres ne recruteront pas souvent des artistes, car, avec les heures divisées par les offices, aucun travail de longue haleine n’est possible ; l’oeuvre n’est donc exécutable que si elle est confiée à des laïques, assujettis à certaines formalités rituelles, mais vivant, autour du monastère, libres.
Oui, celle-là, c’est la véritable, l’authentique oblature, celle que nous découvrons dans les âges les plus reculés, celle que je mène, moi-même, auprès de l’abbaye du Val des Saints ; elle va disparaître de France, avec les moines ; les projets du père Felletin, qui étaient également les miens, sont par terre ; il s’agit par conséquent ou de renoncer à ce mode de monachisme séculier ou de le transformer de telle manière que, tout en lui conservant son caractère du Moyen-Age, il puisse s’adapter aux exigences de notre temps.
Est-ce réalisable ? Je le crois, si l’on admet que l’oblature peut s’organiser d’elle-même et vivre d’une vie qui lui serait propre, sous la direction d’un ou de plusieurs pères, laissés pour cette oeuvre en France, par un Abbé.
Evidemment, cette institution ne sera pas commode à établir ; il faudrait pour qu’elle fonctionnât régulièrement bien des choses... d’abord, des artistes pieux et ayant du talent. Où sont-ils ? Je l’ignore ; mais c’est au seigneur qu’il appartient, au cas où il n’y en aurait point, d’en faire surgir et, s’il y en avait, d’inconnus, d’épars, çà et là, en des coins de villes, de les grouper ; il faudrait ensuite une façon de petit monastère ; les oblats n’étant plus, en effet, à même de s’installer près d’un reclusage et de participer aux offices, devraient en constituer un et pratiquer, dans une certaine mesure, l’exercice des heures canoniales ; mais cela n’aurait de chance de réussir qu’en adoptant quelques précautions que justifie, pour qui le connaît, le train-train du cloître.
Ainsi, pour éviter les inconvénients de l’existence en commun et les inutiles bavardages qui sont de constants motifs de bisbilles et de troubles, il serait nécessaire que chacun habitât séparément une maisonnette, pareille à celle des Chartreux, les seuls captifs qui n’eurent jamais besoin, depuis leur fondation, de réformes, tant leur régime de solitude est habile et savamment dosé.
Il prescrit, en effet, le silence et l’isolement, mais, au moment où ils deviendraient trop pénibles, il les rompt par des offices et, à des jours fixés, par des repas servis non plus à part, mais dans le réfectoire et aussi par des promenades qui s’appellent, en style cartusien, des spaciements.
Il ne s’agit évidemment pas de s’affilier, de près ou de loin, à la règle de saint Bruno, beaucoup trop sévère et beaucoup trop absorbante pour des laïques qui n’ont pas à observer le maigre perpétuel, les levers dans la nuit, et dont le but n’est point de demeurer en clôture. Son esprit même n’a rien à voir avec le nôtre. Il sied simplement de lui emprunter son système, mitigé et encore détendu de solitude, et de suivre pour tout le reste la règle de saint Benoît, prise dans son acception la plus large. Autrement dit, couvent non plus d’une seule pièce, mais coupé par des maisonnettes, en tranches ; vie moins cénobitique et plus personnelle ; liberté d’aller et de venir avec horaires d’offices réduits, permettant de besogner, des heures d’affilée, en paix.
Ce ne serait nullement, ainsi que des gens se l’imagineront, une nouveauté, mais bien au contraire une régression, presque un retour aux premiers temps du monachisme où chaque moine résidait dans une hutte distincte et se réunissait avec les autres, dans un lieu spécial, pour y prier. Cela nous remettrait à la paroisse conventuelle que régissait, au quatrième siècle, saint Séverin d’Agaune, dans le Valais ; ce serait un système mixte, un petit peu Chartreux et très Bénédictin ; ce serait encore, pour les personnes désireuses d’analogies, le type des béguinages, tel qu’il subsiste chez les femmes en Belgique, une série de minuscules maisons dans lesquelles chacun séjourne chez soi et où tout le monde s’assemble dans une chapelle, quand l’heure des offices sonne.
Comment ne pas rêver, soupira Durtal, d’une existence, abîmée en Dieu, et aboutissant, par l’aide des prières liturgiques, à des oraisons colorées d’art, lorsque l’on se trouve à Gand ou à Bruges, lorsqu’on pénètre dans ces petites villes situées dans les grandes, et si placides et si recueillies, dans ces pieux et avenants béguinages, aux façades si gaies, avec leurs murs de briques roses, ou blanchis à la chaux, leurs toits en escalier, leurs fenêtres aux châssis peints en vert Véronèse et tendues, derrière leurs vitres, de stores clairs ou de légers rideaux, leurs portes discrètes, ouvrant sur de larges pelouses plantées de vieux ormes très droits, traversées par des allées menant à l’antique église où des béguines prient, les bras en croix ?
Il ne semble pas qu’il y ait d’endroits plus reposants et, en même temps, plus incitants pour un peintre ou un écrivain qui voudrait oeuvrer à la gloire de Dieu, un tableau ou un livre.
Et Durtal, parti en plein rêve, se remémorait, en les résumant, en quelques mots, les statuts de ces asiles. La béguine promettait, à sa réception, obéissance à la supérieure, à la grande dame, comme on la nomme, et s’engageait à observer, de la façon la plus stricte, les règlements ; elle subissait deux années de noviciat, avant que d’être définitivement reçue, ne se liait par aucun voeu, pouvait se retirer de l’enclos, à sa guise ; elle devait aussi justifier d’une rente de cent dix francs et subvenir, à l’aide de ce pécune et de son travail, à ses besoins.
Elle portait un costume religieux, semblable à celui d’une nonne, était astreinte à participer à quelques offices, à rentrer avant la nuit et c’était à peu près tout.
Oui, mais... ruminait Durtal, ces petites bergeries n’ont jamais pu s’acclimater que dans le nord de l’Europe. Elles ne fructifient plus maintenant que dans la Belgique et la Hollande ; il n’y en a plus en France, actuellement.
Pourquoi ? nul ne le sait. Le tempérament froid et sensé, la piété forte et tranquille des races du nord, leurs goûts d’intimité, sans vie évaguée au dehors, expliqueraient peut-être cette anomalie. Il paraît, du reste, que même au Moyen-Age où la foi était ardente dans les régions du midi, aucun béguinage ne put, en ces pays, prendre racine. Ces sortes de couvents dont l’origine remonte à la fin du douzième siècle, ne se sont, en effet, épanouis que dans les districts du nord, de l’ouest, de l’est et aussi du centre. On les découvre nombreux, à Cologne, à Lubeck, à Hambourg ; ils foisonnent sur les territoires des Flandres ; ils abondent en France, mais leur habitat semble s’arrêter aussitôt après la Loire.
Dans un article sur les Béguines de Paris, M. Léon Le Grand cite des maisons de ce genre, un peu partout-sauf dans le sud ; — il en signale en Picardie, à Laon, à Amiens, à Noyon, à Beauvais, à Abbeville, à Condé, à Saint-quentin — dans l’est, à Reims, à Saint-nicolas-du-port, à Châlons ; — dans l’ouest, à Rouen, à Caen, à Mantes, à Chartres, à Orléans, à Tours ; — autour de Paris, à Crépy, à Melun, à Sens ; — enfin à Paris même où le roi saint Louis en créa une sur la paroisse de saint Paul.
Ce Béguinage qui était peu différent des béguinages contemporains de Bruges et de Gand, dépérit, au bout de deux siècles, faute de sujettes. L’on n’en compterait plus que deux, en 1471 ; et depuis, je ne connais qu’un essai qui ait été tenté pour rénover en France ces gynécées abolis, un essai récent ; en 1855, un abbé du Soubeiran voulut fonder une maison à Castelnaudary, sur le modèle des refuges belges, et il échoua.
Il ne s’était évidemment pas rendu compte que le terrain de culture du Languedoc n’était pas du tout celui qui convenait à cette variété de plante conventuelle, car elle a besoin pour croître et de silence et d’ombre.
Il me semble pourtant, ruminait Durtal, qu’en transférant ce système semi-monastique des femmes chez les hommes, il y aurait quelque chose à entreprendre.
Le cadre, aisément, on l’imagine dans une grande cité, telle que Paris, une villa comme il en existe pour les sculpteurs et pour les peintres, au boulevard arago ou dans la rue de bagneux, par exemple, des allées fleuries, bordées de maisonnettes et d’ateliers ; il serait facile d’installer, au fond, des salles communes et un oratoire et cela suggérerait assez bien l’idée d’une miniature de couvent, d’un petit institut de béguins ou de laïques Bénédictins.
Des Bénédictins surtout, car l’Ordre de saint Benoît, à l’encontre de beaucoup d’autres, admet les artistes ; sa règle est formelle sur ce point ; et d’ailleurs, cette oeuvre serait le prolongement logique de ses offices, l’aboutissement de sa théorie du luxe pour Dieu, la fleur, si l’on peut dire, de ses tiges de prières, de ses touffes d’oraisons.
Elle est d’essence purement Bénédictine, clunisienne, pour employer le mot propre.
Les Bénédictins modernes voudront-ils ou pourront-ils la réaliser ? C’est une autre question. Certes, je n’adhère nullement aux théories de M. Lampre prétendant que la glorieuse paternité serait étonnamment vexée si elle voyait des laïques, des moines séculiers, parfaire une oeuvre qu’elle serait elle-même, incapable d’accomplir ; c’est prêter aux fils de saint Benoît des sentiments qu’ils n’ont pas et c’est très inéquitablement les juger. D’ailleurs, n’ont-ils pas jadis encouragé des écrivains comme Bultau, l’oblat de Saint-germain-des-prés, qui nous a laissé une histoire de son ordre et une histoire du monachisme en Orient ? Il n’y a pas de raison pour croire, qu’à défaut d’une ardeur égale au travail, la congrégation de Solesmes serait plus étroite d’idées, plus bouchée que n’était son aïeule de saint-Maur ; mais enfin, si, à cause même des difficultés que va lui susciter l’exil, elle hésitait à revendiquer son héritage d’art, si elle ne pouvait détacher de son personnel un religieux apte à organiser et à diriger l’oblature, il n’y aurait évidemment qu’à passer outre et à marcher sans elle.
Après tout, en y réfléchissant, l’oblature, telle que je me la figure, pourrait se créer et se développer sans le secours de ses cloîtres, si elle avait à sa tête un prêtre, aimant la mystique et la liturgie, assez éloquent pour les bien expliquer à ses auditeurs et les mettre ainsi en mesure de les utiliser pour leurs travaux, assez saint surtout pour que sa direction ne pût être discutée et fût acceptée, sans murmures, par tous.
Il pourrait d’ailleurs s’affilier, lui-même, en qualité d’oblat à l’un des monastères Bénédictins de France ou de l’étranger et il suffirait dès lors de l’aide temporaire d’un moine, afin d’enseigner la psalmodie, le maintien, le chant, afin d’imprimer, dès les premiers jours, la marque particulière, l’étampe monastique de l’Ordre, aux oblats.
La difficulté ne gît point là, mais bien dans le choix du prêtre chargé, à défaut d’un père, de gouverner la barque. Bah ! la providence saura bien le dénicher si elle veut que la place, restée vide, depuis des siècles, dans son église, soit remplie !
Car enfin, toutes les oeuvres affluent, excepté celle de l’art pour Dieu ; les congrégations se sont partagé toutes les autres, sauf celle-là.
Les unes, en effet, ainsi que les jésuites, les franciscains, les rédemptoristes, les Dominicains, les missionnaires prêchent, ménagent des retraites, évangélisent les mécréants ; d’autres tiennent des pensionnats et des écoles ; d’autres, tels que les sulpiciens et les lazaristes des séminaires, la plupart cumulent même ces différents emplois ; d’autres encore soignent les malades, ou de même que les Chartreux et les cisterciens réparent les péchés du monde, sont des réservoirs d’expiation et de pénitence ; d’autres enfin, semblables aux Bénédictins de la congrégation de France, se vouent plus spécialement au service liturgique, à l’office divin des louanges.
Mais aucune, pas même celle des Bénédictins auxquels elle revient le droit, n’a réclamé la succession de l’art religieux, tombée en déshérence depuis la disparition de Cluny.
Oui, je sais bien, reprit Durtal, après un silence, en roulant une cigarette, des gens diront : l’art, est-ce bien utile ? N’est-ce pas un superflu, quelque chose comme un dessert, après un repas ? Eh, pourquoi n’en offrirait-on pas au Christ ?
On l’en a privé depuis la réforme et même avant ; il serait peut-être convenable de lui en redonner.
Il faut être bien ignorant, du reste, pour nier, en ne se plaçant même qu’au point de vue pratique, la puissance de l’art. Il a été l’auxiliaire le plus sûr de la mystique et de la liturgie, pendant le Moyen-Age ; il a été le fils aimé de l’église, son truchement, celui qu’elle chargeait d’exprimer ses pensées, de les exposer dans des livres, sur des porches de cathédrales, dans des retables, aux masses.
C’est lui qui commentait les evangiles et embrasait les foules ; qui les jetait, riant en de joyeuses prières au pied des crèches, ou qui les secouait de sanglots devant les groupes en larmes des Calvaires ; lui, qui les agenouillait, frémissantes, alors qu’en de merveilleuses pâques, Jésus, ressuscité, souriait, appuyé sur sa bêche, à la Magdeleine ou, qui les relevait, haletantes, criant d’allégresse, quand, en d’extraordinaires ascensions, le Christ, montant dans un ciel d’or, levait sa main trouée, d’où coulaient des rubis, pour les bénir !
Tout cela est loin — hélas ! dans quel état d’abandon et d’anémie se trouve l’église, depuis qu’elle s’est désintéressée de l’art et que l’art s’est retiré d’elle ! Elle a perdu son meilleur mode de propagande, son plus sûr moyen de défense. Il semblerait donc que, maintenant qu’elle est assaillie et qu’elle fait eau, de toutes parts, elle doive supplier le seigneur de lui envoyer des artistes dont les oeuvres opéreraient certainement plus de conversions, lui amèneraient plus de partisans que ces vaines rengaines que ses prêtres, huchés dans des coquetiers, versent sur la tête résignée des fidèles, du haut des chaires !
L’art religieux, si éteint, si mort qu’il soit, peut renaître, et si l’oblature Bénédictine a une raison d’être, c’est précisément de le créer à nouveau et de l’élever.
Evidemment, certaines conditions pour réussir sont nécessaires. Il faut, avant tout, bien entendu, que telle soit la volonté du Très-Haut — mais admettons qu’il en soit ainsi ; — eh bien, en l’envisageant alors par son côté humain, une semblable institution ne serait guère possible qu’à Paris ou dans ses alentours, car les gens de lettres, les chartistes, les érudits, les gens, spécialisés dans l’étude des diverses sciences, aussi bien que les peintres, les sculpteurs, les architectes, que les artisans de tous les métiers d’art que pourraient abriter des maisons d’oblats, auraient besoin d’entretenir des relations avec les éditeurs et les marchands et de fréquenter les bibliothèques et les musées. Il conviendrait aussi de distribuer la vie de telle sorte que chacun pût vaquer à ses affaires et travailler sans être continuellement dérangé par des offices. L’horaire serait facile à établir : — prière, et messe, le matin, de bonne heure : liberté complète pendant la journée — Vêpres vers les cinq ou six heures pour ceux qui seraient en mesure d’y assister — et Complies pour tout le monde, le soir.
Je ne me dissimule pas cependant que, par cela même qu’elle serait rédemptrice et vraiment propre, cette oeuvre aurait des chances d’encourir toutes les haines, mais il me paraît impossible qu’en dépit de toutes les railleries, de toutes les mauvaises volontés, elle ne prenne pas corps, un jour, car elle est, comme on dit, dans l’air ; il y a trop de gens qui l’attendent, qui la convoitent, trop de gens qui ne peuvent, à cause de leurs occupations, de leur état de santé, de leur genre de vie, s’interner dans les cloîtres, pour que Dieu n’instaure pas un havre de grâce, un port, où s’amarreraient ces âmes qu’obsèdent des appétences monastiques, des désirs de vivre hors du monde et de travailler près de Lui et pour Lui, en paix.
Je rêve tout éveillé, se dit Durtal qui consulta sa montre et se dirigea vers la gare. Avouons que le moment est mal choisi pour songer à fonder ou plutôt à imaginer un couvent, alors que justement les chambres s’acharnent à exterminer toutes les compagnies et tous les Ordres.
Eh mais, reprit-il, en cheminant, il n’est peut-être pas si mal choisi que cela ! — dame, raisonnons. Je suis de plus en plus convaincu que la loi sur les congrégations ne sera pas abrogée d’ici à bien des années-que deviendra alors l’institut des Bénédictins qui se sera, lui-même, banni de France ? Aura-t-il les reins d’âme suffisants pour supporter l’exil ? Je veux le croire. Pourra-t-il se recruter à l’étranger où déjà d’autres abbayes de la même famille existent ? J’en doute. En supposant même qu’elles ne meurent pas faute de ressources, les maisons de la congrégation de Solesmes sont donc condamnées à végéter sur place et à se désagréger, peut-être à la longue, dans un insurmontable ennui ; en tout cas, l’esprit Bénédictin est appelé à disparaître de notre pays si l’on ne découvre pas un subterfuge pour l’y conserver ; et c’est ici, que l’oblature se décèle pour moi, ainsi que ce subterfuge et que cet expédient ; les Bénédictins useront-ils, pour l’honneur même de saint Benoît, de ce pis aller, de cette dernière ressource ?
Je l’espère — et ne vois pas du reste que le gouvernement ait le pouvoir de s’opposer à ce dessein : aucune loi ne peut, en effet, empêcher des artistes de louer, chacun, une maison dans une villa aménagée en conséquence, d’y vivre ainsi qu’il leur plaît, de s’assembler, à certains moments, pour y causer d’art ou y prier, pour y faire, en un mot, ce qu’ils voudront. Ils ne sont pas prêtres, ils ont une profession civile, reconnue, ils ne sont engagés par aucun voeu, ils ne revêtent aucun costume monastique visible, puisque le grand scapulaire s’étend sous les vêtements. Leur réunion rentre donc dans la catégorie des associations littéraires qui sont dispensées de demander l’autorisation préalable.
Il n’est pas admissible, d’autre part, que l’un des locataires ne puisse donner l’hospitalité à un moine, au moins, habillé, s’il le fallait, en simple prêtre ; il n’y a pas encore de loi qui interdise d’héberger un ami — et dès lors l’oblature est formée.
En attendant que ces beaux rêves se réalisent pour les autres, — moi qui ne les verrai sans doute pas, — je voudrais bien que notre père Abbé nous laissât ici, comme l’espère M. Lampre, quelques religieux ; évidemment cela va être sinistre ; nous n’aurons plus que de très misérables offices, mais enfin, tant que la messe et que les vêpres seront chantées, tous les jours, la vie de l’oblature sera possible ; je n’ai point le choix d’ailleurs, soupira-t-il en montant dans le train, à moins que je ne file du Val des Saints, mais pour chercher quoi ? pour aller où ? à Paris ; ah ! ce que je n’y tiens pas !