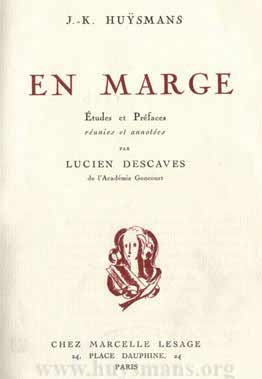Il paraît que la jeunesse littéraire devient mystique. Ce bruit courut récemment dans Paris et de sagaces reporters s’empressèrent de nous annoncer cette étonnante aubaine.
Elle nous fut confirmée par d’importants témoins. A cette occasion, quelques icoglans échappés des haras de l’Ecole Normale où l’on n’avait même pas eu la peine de les hongrer, intervinrent pour expliquer le néo-christianisme aux foules. L’un d’eux, une sorte de Suisse, du nom de Desjardins, constata la gestation aérienne de la jeunesse et, dans un opuscule intitulé "Le Devoir présent", il prêcha l’idéalisme gai et prétendit apporter aux âmes endolories un réconfort.
D’autre part, diverses revues se fondèrent pour proclamer la nécessité d’être mystique. Ce fut alors une pluie de choses pieuses. Les poètes lâchèrent Vénus pour la Vierge et ils traitèrent les Bienheureuses comme des Nymphes. Aux Déités du Paganisme si longtemps choyées par le Parnasse, on substitua Sainte Madeleine; les autres Saintes furent épargnées, la science hagiographique des débutants étant à peu près nulle; puis des poètes tentèrent des hymnes laïques en l’honneur de la Madone et des innovations enfantines surgirent; l’on s’empara des formes liturgiques pour les appliquer aux passions humaines et l’on rabaissa jusqu’au niveau des cuvettes ces bas pastiches. Enfin une pratique du Midi se déclara tout à la fois mage et mystique; mais nous entrons avec elle sur les territoires du Satanisme. Bornons-nous donc à constater que ses boniments servirent aux journaux à étayer leur opinion que l’art aiguillait décidément sur destations religieuses à destination du Ciel.
Toutes ces fariboles seraient, en somme, demeurées stériles, sans intérêt pour les gens qui s’occupent de la santé d’un temps, si le théâtre ne s’en était mêlé. Alors le mufiisme fusa, s’épanouit en gerbe. M. Darzens commit une "Amante du Christ"; M. Haraucourt versifia je ne sais plus quoi qui fut débité dans un cirque; enfin M. Grandmougin alla plus loin: il atteignit le pur sacrilège en mettant le Golgotha sur la scène et il trouva sans trop de peine, je pense, un cabot qui osa représenter le Christ.
Ces gens s’imaginèrent sans doute que la Passion était un sujet comme un autre; et, désireux d’enlever un succès, ils ramassèrent la boue des théâtres et ils en barbouillèrent la patiente Face.
Ce ne fut pas tout encore; des entreprises de marionnettes et d’ombres chinoises sévirent et l’on vit, pour célébrer la Noël, des guignols qui sautaient autour d’un poupon de bois allaité par une pantine.
Du coup, le public fut résolument convaincu que les tendances de l’art étaient mystiques.
En eût-il douté que la peinture l’eût raffermi dans cette croyance. L’an dernier, M. Béraud peignit jésus dans une salle à manger, assis au milieu de banquiers juifs. Les cigarettes étaient allumées et le café servi. A plat ventre une fille s’hystérisait sur les pieds du Christ. Dans la pensée du peintre, cette drôlesse représentait Sainte Madeleine. C’était, comme on le voit, d’un goût capiteux et d’un tact sûr. Encouragé par l’abjection du public qui vanta cette toile, ce même individu peignit, cette année, un crucifiement à Montmartre. Lâchant le ghetto pour la bibine, il modela un Christ en bougie qu’il fit détacher de son moule par des voyous.
De son côté, un autre peintre du nom de Blanche installa le Rédempteur dans un peignoir japonais, au milieu d’apôtres en redingotes. Représenté, après l’apéritif, je pense, au moment du repas, le Sauveur regarde les. convives et rompt le pain. M. Blanche a sans doute voulu rajeunir la scène de la Pâque, la mettre à la portée des gens du monde. Il y a réussi et je ne doute pas que ceux-ci ne halètent devant son oeuvre.
En face d’aussi piètres attentats, il n’y a pas lieu de s’indigner, je crois; ii suffit de hausser les épaules; serait-on compris d’ailleurs si l’on déclarait que ces torchons de couleur ne sont que de pénibles blasphèmes? Laissons-les donc, mais constatons que ces exhibitions ont, une fois de plus, aidé le public à se convaincre que décidément la piété était en hausse.
Aussi quelques feuilles libres penseuses s’émurent et déplorèrent cet état d’âme. Ah! qu’elles se rassurent! A cette question: l’art sera-t-il maintenant mystique? l’on peut répondre avec certitude: non!
Et la raison en est bien simple.
C’est que l’on ne fait pas de la mystique comme on fait du roman naturaliste ou psychologique. Il ne suffit point d’être instruit, d’être ingénieux, de s’assimiler plus ou moins bien les oeuvres des autres; il ne suffirait même pas d’être un grand, d’être un initial artiste; il faut d’abord et avant tout avoir la Foi; il faut ensuite la cultiver dans une vie propre.
Sans user ici de définitions théologiques, l’on peut dire de la Mystique qu’elle est l’âme et qu’elle est l’art de l’Église même. Or, elle appartient au catholicisme et elle est à lui seul. Il ne faut pas, en effet, confondre le vague à l’âme, ou ce qu’on appelle l’idéalisme et le spiritualisme, ou même encore le déisme, c’est-à-dire de confuses postulations vers l’inconnu, vers un au-delà plus ou moins trouble, voire même vers une puissance plus ou moins occulte, avec la Mystique qui sait ce qu’elle veut et où elle va, qui cherche à étreindre un Dieu qu’elle connaît et qu’elle précise, qui veut s’abîmer en Lui, tandis que Lui-même s’épand en elle.
La Mystique a donc une acception délimitée et un but net et elle n’a aucun rapport avec les élancements plus ou moins littéraires dont on nous parle; c’est elle qui a produit les plus grandes oeuvres qui aient jamais existé, les tableaux des Primitifs dans la peinture; les oeuvres de saint Bernard, de saint Bonaventure, de saint Thomas d’Aquin, de saint Jean de la Croix, de sainte Thérèse, d’Angèle de Foligno, de Ruysbroeck et de combien d’autres! dans les poésies et dans les proses; c’est elle qui a créé le plain-chant, dans la musique; le roman et le gothique, dans l’architecture.
Le don de la grâce qui est indispensable pour enfanter une oeuvre mystique semble maintenant refusé aux artistes de ce sale temps. Une seule fois, à un certain moment de sa vie, après une crise d’âme, ce don magnifique fut dévolu à un poète alors repentant, à Paul Verlaine. Il nous valut l’admirable livre qu’est "Sagesse".
A nul autre de ma connaissance, une telle faveur ne fut cédée, mais il convient de le dire aussi, pour que le Très-Haut la dispense, cette faveur, encore faut-il qu’il trouve une âme simple et qui croit et qui la veuille et qui ne soit point délayée et toute en boue. Or, que sont les quelques-uns qui parlent aujourd’hui de la Mystique ou qui s’imaginent la posséder en art? Ce sont des gens fort occupés à brasser des filles, à tapoter des absinthes et à lamper des bocks; ce sont des gens qui ne vivent même pas à l’écart d’une société infâme, qui subissent les honteuses promiscuités des lettres; ce sont des gens qui n’ont pas compris surtout que tant qu’une femme reste dans votre vie, aucune mystique n’est possible, que pour se rapproprier, il importe de se libérer du servage encombrant des chairs et de vivre, dans la prière, seul.
Il est donc évident que, pour qu’un artiste fasse un volume mystique, un volume blanc, il faut tout d’abord qu’il possède ou qu’il ait retrouvé la Foi, et, pour qu’elle jaillisse hors de lui, dans une oeuvre, il est nécessaire qu’il répudie cette vaine existence que nous menons tous, dans les Lettres. A défaut de couvent, de refuge, il est indispensable de vivre dans les églises, à ces heures solitaires où des femmes prostrées demandent au Seigneur l’apaisement de leurs maux.
Il importe de renoncer au véhicule des péchés, à l’alcool, de se cogner avec sa chair et de la mater. Il sied enfin de se confesser, de s’approcher des Sacrements; et puis... et puis... il faut encore que le Christ veuille bien répondre au désir de l’âme qui l’appelle, il faut bien des choses, il en faut tant que les journaux libres penseurs peuvent dormir en paix. Ils ne rencontreront pas d’artistes qui aient le courage, même en se rendant compte de l’inanité de leurs passions et de l’absurdité de leur vie, de se renverser de fond en comble, de se renoncer, de vivre en plein Paris, dans leurs cellules, comme des moines.
La littérature mystique n’a donc aucune chance d’éclore; saint Jean de la Croix, Ruysbroeck restent jusqu’à nouvel ordre sans géniture. Le mouvement que des pions de l’Ecole Normale et que des feuilles ont annoncé est donc, en somme, nul. Il se trouvera peutêtre de vagues dilettantes, quelques sceptiques qui rôderont, en littérature, autour des choses pieuses et les saliront en y touchant, et ce sera tout; il en sera de même pour les arts; on découvrira, comme à l’exposition des Rose-Croix, des peintres qui choisiront l’article religieux, s’il est en vogue, et dessineront des personnages frustes qu’ils cercleront avec du fil de fer, après les avoir remplis de couleurs crues. Ce seront de froides singeries, de faux décalques des Primitifs, ce sera tout ce que l’on voudra, sauf l’oeuvre de peintres originaux et croyants; tout cela n’aura rien à voir avec la Mystique dont on invoquera, une fois de plus, le nom.
Mes espoirs en une jeunesse littéraire qui serait mystique et qui nous sauverait au moins de l’implacable sottise de celle qui ne l’est point, sont donc bien peu vivaces, mais, on doit le déclarer aussi, l’Église qui devrait ensemencer les âmes arables se désintéresse de ces cultures; elle se détourne des flores rares, ne prépare, ni n’aide les vocations en art. Elle encourage tout juste les oeuvres d’érudition, ne se préoccupe même pas des livres qui éclaireraient au moins une partie de la question, en étudiant les origines de la langue mystique, en montrant la succession ininterrompue des écrivains qui la créèrent (1). Si nous mettons de côté la substantielle histoire de la littérature au moyen âge d’Ebert, les fermes études sur les hymnes du Bréviaire romain de l’abbé Pimont, quelques parties tout à la fois fades et sèches des Institutions Liturgiques du savant Dom Guéranger, certaines monographies d’écrivains pieux, certaines études spéciales d’Ozanam, de Léon Gautier, etc., et une terne et molle histoire de la poésie chrétienne de Félix Clément, parue, autrefois, chez Gaume, nous n’apercevons, en France, du moins, sur le latin mystique, aucun livre qui nous permette de le suivre dans sa marche et de le voir se profiler dans son ensemble.
Encore, ces ouvrages sont-ils, pour la plupart, volumineux et gastralgiques, de mastication difficile et de rasade lourde. Ce qui manquait, c’était une étude alerte et condensée qui ne fût pas rédigée par d’affreux cuistres; et rien n’était plus malaisé à faire que cette étude; outre, en effet, qu’il s’agissait surtout de trier des textes et de les enrober dans le coulis d’une savoureuse et brève glose, il fallait aussi être singulièrement détaché des préjugés universitaires pour se dédier à une semblable tâche. Il fallait encore sentir l’âme du latin même, se convaincre de cette vérité que cet idiome qui fut, pendant tant de siècles, un idiome de servitude terrestre et d’esclavage sensuel, se mourait, avachi par les gaudrioles du Paganisme, exténué par les mesquines emphases de ses rhéteurs, lorsqu’au pied de la croix des Saints le recueillirent.
Il pela entre leurs mains et changea de peau. Il abandonna l’immobile indigence de sa syntaxe, agrandit les sentiers de son lexique, usant de tournures nouvelles, d’armatures neuves, parvint à forer les tréfonds des âmes, à rendre ces sentiments que fit éclore la venue du Christ: les adorations et les puretés, les contritions et les transes. Cette langue qui sentait le cautère et la rose s’arrêta de puer; le christianisme la désinfecta, fit repousser ses chairs, aviva leur pâleur d’anémone avec I’orfroi des chapes.
La langue latine parlée au moyen âge est assez dédaigneusement désignée sous le nom de latin de cuisine. Il est bien évident que le vocabulaire populacier est sans gloire, mais encore ne sied-il pas de le rebuter, puisque de nombreux mots français y cherchèrent leur origine. Orne saurait, assurément, proclamer que des termes tels que: "barberius", barbier; "claqua", claque; "plancha", planche; "paillardus", paillard; "moustarderius", marchand de moutarde; "demanda", demande; "servietta", serviette; que des verbes tels qu’ "empoysonare", "bêchare", "ronflare", que des synonymes ridiculement longs comme "honorificabilitudinatas" employé à la place du mot "honor" étaient d’une beauté vraiment altière; mais cette basse latinité se révèle souvent moins infirme et moins fruste; parfois elle devient ironique lorsqu’elle désigne la concubine d’un prêtre sous le nom de "coquilla"; parfois encore, elle se vêt d’images colorées ainsi que celles de l’argot. Au pluriel, l’adjectif "mollis" finit par signifier tout à la fois "des empreintes, des forceps et des bardaches", et le verbe "cucurbitare", poser des ventouses, prend un sens charnel et indique les ébats serrés des couples. Toute une gaieté de peuple s’ébaudit dans le lexique qui se met à tirer la langue, à grimacer comme une gargouille.
Eh bien, de même qu’elle laissa se jouer de fantasques sculptures sur le porche de ses cathédrales, l’Église admit aussi quelques-uns des mots de la langue parlée, dans ses proses. Avec un tact imperturbable, avec un art indéfectible, elle fouille dans le pêle-mêle de ces rogatons et elle en sort d’indispensables termes. Avec eux, avec les néologismes qu’elle invente, avec les emprunts qu’elle fait aux dialectes des pays voisins et qu’elle sème dans le latin reprisé de la vieille Rome, elle se forge le verbe magnifique et qui dit tout. Elle seule a atteint le style grandiose et simple, définitif, dans la Vulgate, et, lorsque, lasse de planer, elle vient se mettre à la portée des humbles, elle invente des tendresses, des piétés d’expressions, joue, maternelle, avec la série des diminutifs, trouve ces caresses de mots "angelubus", "angelotus", le petit ange, "animola", l’âme des nouveau-nés, crée même dans les Actes des Saints un "Jesulus" pour manifester les grâces enfantines du petit jésus.
Certes, ces quelques remarques ne sauraient attester que le latin d’église fut toujours impeccable et qu’il atteignit, du premier coup, à la perfection de la langue mystique de saint Bonaventure, au style glorieux de l’office du Saint Sacrement de saint Thomas, à la forme admirable de saint Bernard. Non, il resta longtemps roide et dur comme ces figures véhémentes et glacées du moyen âge, comme ces vierges rigides dans leurs robes cassées à longs plis ou bouillonnées par de petites ondes; mais ainsi qu’elles déjà il se dresse, solennel et plaintif, sanglote de pures larmes, s’exalte en de célestes envolées, suit, sans s’évaguer, les visions du dedans. On peut le dire, nous sommes, dès la première heure, très loin avec le latin ecclésiastique du verbe rampant du Paganisme, du langage subalterne balbutié pendant tant d’années à Rome!
Eh bien, le livre qui devait affirmer tout cela, M. Rémy de Gourmont l’a fait; et il vient à son temps pour montrer aux gens épris de ce soi-disant départ religieux auquel nous assistons, ce que fut la mystique et quel art merveilleux elle créa au moyen âge.
M. de Gourmont n’a dans ce volume abordé que les poètes catholiques, mais il complétera sans doute son ouvrage en nous donnant, un jour, l’histoire de la prose latine chrétienne.
Tel qu’il est, dans sa brièveté voulue, ce compendium, farci de textes enserrés dans d’essentiels commentaires, rétablit les poésies inhumées dans la patrologie de Migne, des séquences perdues dans d’inattaquables in-folios, dans les bréviaires périmés de la province. Après l’abbé Pimont, il nous présente, complètes, les hymnes abrégées pour les besoins des offices ou dépecées et altérées par le vandalisme des Santeul. Par de doctes persuasions, il nous impose de probables dates pour des chefs-d’oeuvre, tels que les Dies irae et le Stabat; dans tout le choix des pièces disparues, des oeuvres égarées, M. de Gourmont se révèle vraiment expert. Quelle sévère et puissante page d’Odon de Cluny il nous exhibe sur les vains et sur les dégoûtants appas des femmes! Quelles sagaces études il écrit sur les Litanies, les horloges de la Passion, sur saint Anselme, sur Pierre le Diacre, sur saint Ambroise! Avec quelle charitable compréhension il présente et défend le grand poète que fut Prudence, l’austère mystique que fut Damien! Avec quelle adresse il déterre et époussette le vieux traité de la chasteté de Fulbert dont il aurait bien dû réimprimer aussi les magnifiques répons pour la Nativité de la Vierge, qui ne se chantent plus, hélas! que dans les églises du Mans, le jour de l’Assomption, avant la messe.
Je laisse maintenant de côté une partie du livre qui, je l’avoue sincèrement, me gêne un peu, celle des traductions. Souvent, elles me paraissent rester inertes et parfois elles ne sont pas, à mon avis du moins, suffisamment iittérales et exactes. Mais, sauf cette réserve, il est légitime de glorifier le livre, car, en dehors même de sa parfaite chimie qui parvient à condenser en de brèves pages la masse de documents épars dans de copieux bouquins, il relève et assaisonne des sujets jusqu’alors cuits à l’étuvée et dans de l’eau de pompe par de bas cuistres.
La preuve de cette assertion est, dès les premières lignes du volume, visible. Si i’on veut bien, par exemple, se reporter à la page 16, on y trouvera une phrase pénétrante sur le Stabat, une phrase qui semble trainee avec les fils en argent dédoré d’une vieille étole.
On peut citer encore le début du chapitre sur saint Ikrn.trd, écrit dans une langue vraiment haute, et, dans ce même chapitre. savourer plus loin un juste et féroce alinéa mur la peur que suscite maintenant la mort. Nous sommes tout de même loin, avec ces passages-là, des éternelles futaines, couleur de pierre ponce, tissées dans les Sorbonnes!
M. de Gourmont a proclamé dans le vestibule de son livre que "seule la littérature mystique convenait à notre immense fatigue". Il est, en effet, certain qu’à l’heure actuelle la littérature divague et s’abandonne dans ses langes; le naturalisme est mort et aucun des essais qui tentèrent de le supplanter ne semble viable. Partout, dans les Lettres, il y a foison de vanité et disette d’art. Le talent n’abonde pas précisément chez les jeunes. Pour les quelques-uns qui lisent encore, il n’y a plus maintenant de délices à attendre d’un volume neuf.
Les seules soirées à Paris qui valent, celles où l’on est solitaire, chez soi, à l’abri des mufles, exigent l’alternance des lectures et des raves. Et où les chercher sinon dans les vieux mystiques qui nous enlèvent loin du cloaque pestilentiel de ce temps, qui nous permettent d’oublier les vaines ou les malpropres journées que nous vécûmes?
Pour ces quelques-uns qui, n’attendant plus rien des présomptions du siècle, aiment à s’isoler dans l’oubli silencieux des livres, l’ouvrage de M. de Gourmont sera propice. Il les mettra sur la piste d’oeuvres admirables et inconnues et il leur assurera — s’ils n’ont pas l’âme par trop fétide — la joie d’inoubliables heures.
(1) Il faut dire, à la décharge de l’Église, que le parti catholique est inégalablement hostile a la science et bouché a l’art. Il y a quelques années, parut une Revue "Les Lettres Chrétiennes" qui contint des études vraiment remarquables sur l’archéologie, sur le latin religieux, sur tout le moyen age. Elle est morte, faute de lecteurs!
Preface au livre de Rémy de Gourmont: LE LATIN MYSTIQUE, les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au moyen âge, miniature de Filiger. Mercure de France, 1892, grand in-8. Edition des souscripteurs, à 220 ex. numérotés et signés par l’auteur.
La préface de Huysmans disparut de deux éditions grand in-8 que Rémy de Gourmont, brouillé avec l’auteur de Là-Bas, publia en 1895. Gourmont avait toujours été, d’ailleurs, mécontent de cette présentation, et il ne le cachait pas.