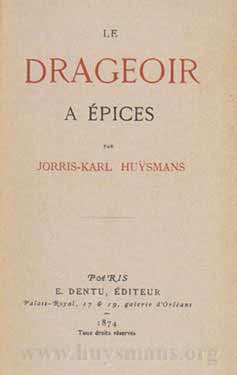Un beau matin, le poète Amilcar enfonça sur sa tête son chapeau noir, un chapeau célèbre, d’une hauteur prodigieuse, d’une envergure insolite, plein de plats et de méplats, de rides et de bosses, de crevasses et de meurtrissures, mit dans une poche, sise au-dessous de sa mamelle gauche, une pipe en terre à long col et s’achemina vers le nouveau domicile qu’avait choisi un sien ami, le peintre José.
Il le trouva couché sur un éboulement de coussins, l’oeil morne, la figure blafarde.
— Tu es malade, lui dit-il.
— Non.
— Tu vas bien alors ?
— Non.
— Tu es amoureux
— Oui.
— Patatras ! et de qui ? bon Dieu !
— D’une Chinoise.
— D’une Chinoise ? tu es amoureux d’une Chinoise !
— Je suis amoureux d’une Chinoise.
Amilcar s’affaissa sur l’unique chaise qui meublait la chambre.
— Mais enfin, clama-t-il lorsqu’il fut revenu de sa stupeur, où l’as-tu rencontrée, cette Chinoise ?
— Ici, à deux pas, là, derrière ce mur. Ecoute, je l’ai suivie un soir, j’ai su qu’elle demeurait ici avec son père, j’ai loué la chambre contiguë à la sienne, je lui ai écrit une lettre à laquelle elle n’a pas encore répondu, mais j’ai appris par la concierge son nom : elle s’appelle Ophélie. Oh ! si tu savais comme elle est belle, cria-t-il en se levant ; un teint d’orange mûrie, une bouche aussi rose que la chair des pastèques, des yeux noirs comme du jayet !
Amilcar lui serra la main d’un air désolé et s’en fut annoncer a ses amis que José était devenu fou.
A peine eut-il franchi la porte, que celui-ci fit dans la muraille un petit trou avec une vrille et se mit aux aguets, espérant bien voir sa douce déité. Il était huit heures du matin, rien ne bougeait dans la chambre voisine ; il commençait à se désespérer quand un bâillement se fit entendre, un bruit retentit, le bruit d’un corps sautant a terre, et une jeune fille parut dans le cercle que son oeil pouvait embrasser. Il reçut un grand coup dans l’estomac et manqua défaillir. C’était elle et ce n’était pas elle ; c’était une Française qui ressemblait, autant que peut ressembler une Française à une Chinoise, à la fille jaune dont le regard l’avait bouleversé. Et pourtant c’était bien le même oeil câlin et profond, mais la peau était terne et pâle, le rouge de la bouche s’était amorti ; enfin, c’était une Européenne ! Il descendit l’escalier précipitamment. « Ophélie a donc une soeur ? dit-il à la concierge. — Non. — Mais elle n’est pas Chinoise alors ? — La concierge éclata de rire. « Comment, pas Chinoise ! ah çà ! est-ce que j’ai une figure comme elle, moi qui ne suis pas née en Chine ? » poursuivit le vieux monstre en mirant sa peau ridée dans un miroir trouble. José restait debout, effaré, stupide, quand une voix forte fit tressaillir les carreaux de la loge. « Mlle Ophélie est là ? » José se retourna et vit en face de lui, non une figure de vieux reître, comme semblait l’indiquer la voix, mais celle d’une vieille femme, gonflée comme une outre, le nez chevauché par d’énormes besicles, la bouche dessinant dans la bouffissure des chairs de capricieux zigzags. Sur la réponse affirmative de la portière, cette femme monta, et José s’aperçut qu’elle tenait à la main une boîte en toile cirée. Il s’élança sur ses pas, mais la porte se referma sur elle ; alors il se précipita dans sa chambre et colla son oeil contre le trou qu’il avait percé dans la cloison.
Ophélie s’assit, lui tournant le dos, devant une grande glace, et la femme, s’étant débarrassée de son tartan, ouvrit sa valise et en tira un grand nombre de petites boites d’estompes et de brosses. Puis, soulevant la tête d’Ophélie comme si elle la voulait raser, elle étendit avec un petit pinceau une pâte d’un jaune rosé sur la figure de la jeune fille, brossa doucement la peau, pétrit un petit morceau de cire devant le feu, rectifia le nez, assortissant la teinte avec celle de la figure, soudant avec un blanc laiteux le morceau artificiel du nez avec la chair du véritable ; enfin elle prit ses estompes, les frotta sur la poudre des boites, étendit une légère couche de bleu pâle sous l’oeil noir qui se creusa et s’allongea vers les tempes. La toilette terminée, elle se recula à distance pour mieux juger de l’effet, dodelina la tête, revint vers son pastel qu’elle retoucha, resserra ses outils et, après avoir pressé la main d’Ophélie sortit en reniflant.
José était inerte, les bras lui en étaient tombés. Eh quoi ! c’était un tableau qu’il avait aimé, un déguisement de bal masqué ! Il finit cependant par reprendre ses sens et courut à la recherche de l’émailleuse. Elle était déjà au bout de la rue ; il bouscula tout le monde, courut à travers les voitures et la rejoignit enfin. « Que signifie tout cela ? cria-t-il ; qui êtes-vous ? pourquoi la transfigurez-vous en Chinoise ? — Je suis émailleuse, mon cher Monsieur ; voici ma carte ; toute à votre service si vous avez besoin de moi. — Eh ! il s’agit bien de votre carte ! cria le peintre tout haletant ; je vous en prie, expliquez-moi le motif de cette comédie.
— Oh ! pour ça, si vous y tenez et si vous êtes assez honnête pour offrir à une pauvre vieille artiste un petit verre de ratafia, je vous dirai tout au long pourquoi, tous les matins, je viens peindre Ophélie.
— Allons, dit José, en la poussant dans un cabaret et en l’installant sur une chaise, dans un cabinet particulier, voici du ratafia, parlez.
— Je vous dirai tout d’abord, commença-t-elle, que je suis émailleuse fort habile ; au reste, vous avez pu voir... Ah ! çà mais, à propos, comment avez-vous vu ? ... — Peu importe, cela ne peut vous regarder, continuez. — Eh bien ! je vous disais donc que j’étais une émailleuse fort habile et que si jamais vous... — Au fait ! au fait ! cria José furieux. — Ne vous emportez pas, voyons, là, vous savez bien que la colère... — Mais tu me fais bouillir, misérable ! hurla le peintre qui se sentait de furieuses envies de l’étrangler, parleras-tu ? — Ah ! mais pardon, jeune homme, je ne sais pourquoi vous vous permettez de me tutoyer et de m’appeler misérable ; je vous préviens tout d’abord que si... — Ah ! mon Dieu, gémit le pauvre garçon en frappant du pied il y a de quoi devenir fou.
— Voyons, jeune homme, taisez-vous et je continue ; surtout ne m’interrompez pas, ajouta-t-elle en dégustant son verre. Je vous disais donc... — Que vous étiez une émailleuse fort habile ; oui, je le sais, j’ai votre carte ; voyons, passons : pourquoi Ophélie se fait-elle peindre en Chinoise ?
— Mon Dieu, que vous êtes impatient ! Connaissez-vous l’homme qui habite avec elle ? — Son père ? — Non. D’abord, ce n’est pas son vrai père, mais bien son père adoptif. — C’est un Chinois ? — Pas le moins du monde ; il est Chinois comme vous et moi ; mais il a vécu longtemps dans le Thibet et y a fait fortune. Cet homme, qui est un brave et honnête homme, je vous avouerai même qu’il ressemble un peu à mon défunt qui... — Oui, oui, vous me l’avez déjà dit. — Bah ! dit la femme, en le regardant avec stupeur, je vous ai parlé d’Isidore ? — De grâce, laissons Isidore dans sa tombe, buvez votre ratafia et continuez. — Tiens, c’est drôle ! il me semble pourtant que... Enfin, peu importe, je vous disais donc que c’était un brave et digne homme. Il se maria là-bas avec une Chinoise qui l’a planté là au bout d’un mois de mariage. Il faillit devenir fou, car il aimait sa femme, et ses amis durent le faire revenir en France au plus vite. Il se rétablit peu à peu et, un soir, il a trouvé dans la rue, défaillante de froid et de faim, prête à se livrer pour un morceau de pain, une jeune fille dont les yeux avaient la même expression que ceux de sa femme. Elle lui ressemblait même comme grandeur et comme taille ; c’est alors qu’il lui a proposé de lui laisser toute sa fortune si elle consentait à se laisser peindre tous les matins. Il est venu me trouver, et chaque jour, à huit heures, je la déguise ; il arrive à dix heures et déjeune avec elle. Jamais plus, depuis le jour où il l’a recueillie, il ne l’a vue telle qu’elle est réellement. Voilà ; maintenant, je me sauve, car j’ai de l’ouvrage. Bonsoir, Monsieur.
Il resta abruti, inerte, sentant ses idées lui échapper. Il rentra chez lui dans un état à faire pitié.
Amilcar arriva sur ces entrefaites, suivi d’un de ses amis qui était médecin. Ils eurent toutes les peines du monde à faire sortir de sa torpeur le malheureux José, qui ne parlait rien moins que de s’aller jeter dans la Seine.
— Ce n’est, ma foi ! pas la peine de se noyer pour si peu, dit derrière eux une petite voix aigrelette ; je suis Ophélie, mon gros père, et ne suis point si cruelle que je vous laisse mourir d’amour pour moi. Profitons, si vous voulez, de l’absence du vieux, pour aller visiter les magasins de soieries. J’ai justement envie d’une robe ; je vous autoriserai à me l’offrir. — Oh ! non, cria le peintre, profondément révolté par cette espèce de marché, je suis guéri à tout jamais de mon amour.
Entendre de telles paroles sortir de la bouche de sa bien-aimée ou recevoir sur la tête une douche d’eau froide, l’effet est le même, observa le poète Amilcar, qui dégringola les escaliers et, chemin faisant, rima immédiatement un sonnet qu’il envoya le lendemain à la belle enfant, sous ce titre quelque peu satirique :
O Fleur de nénuphar !