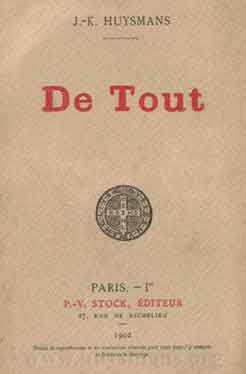LES CARMELS DE PARIS
I
LA fondatrice des Carmélites réformées en France fut, on le sait, Mme Barbe Avrillot, épouse de M. Acarie, maître des comptes. Une vision de sainte Térèse lui ordonnant d’établir la réforme du Carmel dans le royaume la décida à faire convoquer par son directeur, dom Beaucousin, prieur des Chartreux de la rue d’Enfer à Paris, des amis qui pouvaient l’assister dans cette oeuvre, MM. Gallemant, curé d’Aumale, et Du Val, docteur en Sorbonne, saint François de Sales et le P. Pacifique, Capucin, MM. de Bérulle et de Quintanadoine de Brétigny, prêtres ; ce dernier, issu d’une ancienne famille de Burgos, avait déjà vainement tenté d’établir un monastère de Carmes espagnols, à Rouen.
Après diverses réunions, il fut convenu que l’on décernerait le titre de fondatrice à la princesse de Longueville ; que l’on achèterait le prieuré bénédictin de Notre-Dame-des-Champs, au faubourg Saint-Jacques ; enfin que M. de Brétigny, accompagné d’une amie de Mme Acarie, Mme Jourdain, et de plusieurs autres personnes, partirait pour l’Espagne et en ramènerait des Carmélites formées à la vie contemplative par sainte Térèse même.
Les Carmes auxquels M. de Brétigny s’adressa, dès son arrivée à Madrid, refusèrent formellement de laisser passer en France leurs religieuses ; alors cet ecclésiastique appela à la rescousse M. de Bérulle qui arriva, muni d’un bref de jussion, obtenu à Rome par le crédit de la princesse de Longueville ; ce bref forçait, sous peine d’excommunication, le general des Carmes à céder. Il s’inclina et M. de Brétigny emmena avec lui six Carmélites dont deux surtout célèbres par leur sainteté et choisies parmi les préférées de sainte Térèse, la mère Anne de Jésus et la soeur Anne de Saint-Barthélemy.
Le 16 octobre 1604, elles firent leur entrée à Paris et, le lendemain, Mme de Longueville les installa dans leur nouvelle demeure ; leurs premières novices furent choisies dans une sorte de séminaire de jeunes filles que Mme Acarie avait organisé chez elle, au grand déplaisir de son mari que les leçons d’ascétisme n’égayaient guère.
Jusqu’ici, cette histoire, que je résume d’après de copieux bouquins, paraît très simple et pourtant elle a donné lieu à d’obscurs débats qui se sont répercutés jusqu’à nos jours et ont divisé les Carmels de France en deux camps : les Bérullistes et les Térésiens.
Il est assez malaisé d’établir brièvement en quoi ces deux : groupes diffèrent ; d’abord, il y a une question de constitutions assez mal résolue par ceux qui les citèrent ; puis les textes qui racontent ces litiges demeurent contradictoires ; enfin, parmi les livres de combat écrits pour l’une ou pour l’autre des deux causes, quelques-uns sont retirés du commerce ou interdits.
J’ai pu me les faire prêter néanmoins et c’est, en partie, avec les documents qu’ils recèlent que je vais pouvoir fournir divers renseignements sur les cloitres les plus incormus et les plus verrouillés qui soient à Paris, sur les cloîtres oùi seul l’archevêque et son suppléant ont le droit de pénétrer.
La lutte qui, pour certains motifs que je tâcherai d’expliquer, se poursuivait entre les deux branches des Carmels semblait, depuis le XVIIe siècle, presque assoupie, ou du moins le public n’en entendait plus parler, lorsqu’en 1872, M. l’abbé Houssaye, alors vicaire à la Madeleine, édita chez Plon un livre intitulé : M. de Bérulle et les Carmels de France. Ce livre ne tarissait pas d’éloges sur le cardinal, prônait les prieurés soumis à son observance, attaquait en dessous les autres, s’employait surtout à dénigrer l’ordre des Carmes.
La réplique ne se fit pas attendre. Un petit volume, paru en 1873, chez Poussielgue, sous ce titre : Notes historiques. — Les origines et la réforme Térésienne de l’ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et signé : « Un prêtre de la communauté de Saint-Sulpice », prit le contre-pied de l’ouvrage de l’abbé Houssaye et la bataille s’engagea.
Pour l’abbé Houssaye, M. de Be’rulle, qui avait été nommé l’un des directeurs de ce premier Carmel érigé en France, avait fort sagement agi lorsqu’il avait voulu faire de ces Carmélites non des Espagnoles comme celles qu’iI avait amenées de leur pays, mais des Françaises. Aussi avait-il introduit divers changements dans leur manière de vivre, en supprimant certaines observances, en pliant aux besoins du climat et de l’époque quelques coutumes qui avaient leur raison d’être en Espagne et non en France. II entendait, d’autre part, que les religieuses suivissent les règles primitives de l’ordre, telles qu’elles furent adoptées, en 1581, sous l’inspiration de sainte Tér’ese, par le chapitre d’Alcala, et non les règles adultérées par les modifications qu’elles subirent, en 1592, avee l’approbation du Saint-Siège. Et cette thèse paraît soutenable.
Puis, toujours, selon l’abbé Houssaye, les mères Espagnoles faisaient preuve à Paris de rigueurs déplacées ; elles avaient des préventions contre les Françaises ; elles traitaient de « sensualité leur délicatesse et de dissipation leur vivacité » ; la prieure, Anne de Jésus, était bien une sainte, mais une sainte du genre pas aimable ; elle était froide et dure pour elle-même et pour les autres ; les punitions pleuvaient que M. de Bérulle, plus indulgent, devait lever ; de 1à, des tiraillements qui finirent par nécessiter le départ de la mère Anne de Jésus et de la mere Anne de Saint-Barthélemy ; elles s’en allèrent fonder des cloîtres en Flandre et se mirent, comme elles étaient en Espagne, sous la juridiction des Carmes.
Et nous, touchons, ici, le fond de la question, — car tout le reste n’est qu’un amas de broussailles qui l’obscurcissent, — la question de savoir à qui revient la direction des Carmels, aux évêques dans les diocèses desquels ils sont situés ou aux pères Carmes. Le P. de Bérulle les voulait soumis à l’Ordinaire, la mère Anne de Jésus aux pères de son ordre.
Sans prendre parti pour l’une ou pour l’autre de ces opinions, il semble, à première vue, qu’il est beaucoup plus rationnel que ce soit un Carme qui gouverne des Carmélites, qu’un prêtre désigné par un evêque, car, en fin de compte, celui-là est, la plupart du temps, inapte à diriger les, consciences d’un institut auquel il n’appartient pas et dont il ne connaît ni l’esprit, ni les usages, ni les règles.
Tel n’est pas l’avis de l’abbé Houssaye. Son livre s’acheminait vers un mémorable oubli, quand l’auteur anonyme des « Notes », qui n’était autre que M. Gramidon, premier vicaire honoraire de Saint-Sulpice, se rua, tête baissée, dessus. L’attaque était à la fois poussive et imprudente et il écopa dans les grands prix.
Il avait d’abord déniché un certain texte dont les Bérullistes ne parlaient guère et qui constituait un engagement formel de M. de Bérulle envers le général des Carmes en Espagne. En obéissant, contraint et forcé, au bref du Saint-Père lui prescrivant de remettre des Carmelites entre les mains de MM. de Brétigny et de Bérulle, le général avait formulé plusieurs conditions acceptées par les deux Français, entre autres celle-ci que « les nouveaux Carmels seront sujets aux pères de l’ordre, lorsque ceux-ci seront établis en France ».
Or les Carmes vinrent créer un monastère à Paris, en 1611. Cette fondation effara M. de Bérulle ; il se sentit menacé de perdre l’autorité qu’il avait prise sur le Carmel de cette ville ; il se démena, fit agir sur les moines par M. de Marillac, alors conseiller du roi et maître des requêtes ; et ceux-ci, menacés, s’ils résistaient, de ne pas obtenir du Parlement l’enregistrement des lettres patentes concédées par la Cour pour l’érection de leur communauté, déclarèrent par écrit qu’ils renonçaient à tout pouvoir sur leurs soeurs.
M. de Bérulle avait donc éludé la promesse qu’il avait faite au supérieur des Carmes et arraché en quelque sorte, par une menace sous conditions, le désistement de ces religieux.
Telle la version du belliqueux Gramidon.
Autre est celle des Carmels de Paris. L’abbé Houssaye et, avant lui, les « Chroniques de l’ordre des Carmélites », parues, en 1846, à Troyes, affirment qu’au contraire les mères du premier monastère de Paris tenaient trop à la juridiction de leurs supérieurs ecclésiastiques pour vouloir changer de maîtres ; ce furent donc elles qui prierent les Carmes de ne point s’immiscer dans leurs affaires, ce qu’ils firent, assurent-elles, très volontiers.
Bien ; mais, alors, pourquoi les mères Anne de Jésus et Anne de Saint-Barthélemy se sont-elles empressées, dès qu’elles l’ont pu, de se soustraire à la direction de M. de Bérulle pour aller se mettre sous le gouvernement des Carmes, en Flandre ?
Il faut bien dire que M. Gramidon, qui n’a certainement pas tous les torts dans ce conflit, a raison sur ce point. Seulement, agacé sans doute par les flagorneries que l’abbé Houssaye ne cesse de prodiguer — aux dépens de la vérité — à la mémoire du cardinal, tout le long de son livre, il nous peint, à son tour, M. de Bérulle sous l’aspect du plus rusé des compères. Nettement, il l’accuse d’avoir manqué a ses engagements, d’avoir opprimé et torturé les prieures du Carmel par ses exigences, d’avoir voulu introduire dans leur cloître des devotions de son crû, entre autres des voeux de servitude et ceux d’une adoration quotidienne du St-Sacrement impossibles à concilier avec les règles de l’ordre ; il lui reproche encore d’avoir voulu faire du couvent de Paris une congrégation distincte des autres Carmels et d’avoir tenté de substituer son propre esprit à celui de sainte Térèse.
Et de même que, pour les besoins de sa cause, l’abbé Houssaye fait un portrait peu flatté d’Anne de Jésus qui fut cependant une des grandes moniales de sainte Térèse, de même l’abbé Gramidon insinue, afin de rétorquer son adversaire, tout ce qu’il peut trouver de plus désagréable pour M. de Béruile, prêtre de grand savoir et de haute vertu pourtant.
Il aurait pu, pendant qu’iI y était, opposer aussi au côté rêche que l’abbé Houssaye attribue à la mère Anne de Jésus, le côté non moins revêche de la grande amie de M. de Bérulle, Mme Acarie, qui fut également mêlée à cette affaire ; elle etait une sainte personne, mais elle n’avait ni la largeur d’esprit ni le côté aimable et charmant de sainte Térèse. Une anecdote le prouve. Un jour qu’un seigneur se permettait de la complimenter sur sa beauté, elle se dressa sur ses ergots et le rabroua : dans une circonstance analogue, sainte Térèse se montra plus spirituelle et plus douce. Tandis qu’elle montait dans une voiture, elle entendit quelqu’un s’extasier, d’un ton moitié gracieux et moitié railleur, sur la finesse de sa cheville ; elle ne se fâcha point et lui dit en souriant : « Regardez-la bien, senor, car vous ne la verrez plus. » Seulement, à partir de cette époque, elle changea pour elle et pour ses filles la forme de leurs sandales et leur fit couvrir davantage le pied.
Mais M. Gramidon a l’air d’ignorer complètement l’existence de Mme Acarie qui resta d’ailleurs à la cantonade des Carmels jusqu’au moment où elle revêtit dans le cloître d’Amiens la robe des converses ; et il ne parle guère de M. de Brétigny et de M. Gallemant qui fut cependant le premier directeur de la maison de Paris ; c’est au seul M. de Bérulle qu’il en veut, comme, il faut bien le dire aussi, c’est devant le seul M. de Bérulle que l’abbé Houssaye se pâme.
Toujours est-il que les « Notes », de M. Gramidon furent hargneusement attaquées dès qu’elles parurent. II fut accusé de « mauvaise foi », et de « déloyauté » ; c’étaient de bien gros mots pour qualifier les quelques erreurs qui avaient pu lui échapper ; il les rectifia avec mauvaise grâce du reste, puis, pris de peur, il les retira du commerce et se terra.
La question paraissait pour longtemps close, quand, en 1886, un Carme, le P. Albert de Saint-Sauveur, fit éditer chez Poussielgue le premier tome de trois énormes livres intitulés : « Une Persécution qui ne désarme pas ». Il exhuma l’infortuné Gramidon, pila le cardinal de Bérulle et les Carmels de son observance, conculqua le malheureux Houssaye qu’il réduisit à l’état de loques. Ce qui est certain, c’est que son volume, très documenté et très bien fait, démontre que M. de Bérulle s’est conduit ainsi qu’un homme impérieux et cassant envers les premières prieures du Carmel.
A leur tour, les Carmélites ripostérent par deux formidables bouquins présentés sous le titre de : « Mémoire sur la fondation, le gouvernement et l’observance des Carmélites déchaussées », mais on leur enjoignit de rengainer leur ouvrage et le combat cessa.
Telle est la situation de nos jours. A dire vrai ces différences sont bien platoniques, car les Carmes paraissent avoir peu de chance de régir désormais tous les Carmels de France. à l’heure actuelle, les Carmélites n’ont plus de voeux solennels, plus de visiteur général et perpétuel ; elles relèvent partout de la juridiction de l’Ordinaire ; leur clôture est simplement épiscopale ; elles dépendent de l’évêque qui est leur supérieur et leur visiteur ; chaque monastère se gouverne séparément et nul n’a le droit de commander aux autres.
Ce qui n’empêche que quelques-uns, celui de Meaux pour en citer un, se sont agités et, selon l’expression de M. Gramidon, leur défenseur, « se sont établis dans une situation qu’ils jugent les rapprocher davantage de la pensée de sainte Térèse et les unir d’une manière plus intime à la réforme de cette séraphique Mère et assurer une plus grande stabilité aux règles et observances ».
Que pent bien signifier cette obscure filandre ? Il y a lieu de croire qu’elle cache, dans la pensée de son auteur, l’appel à un retour offensif des Carmes, bien que, devenu prudent, il s’empresse de protester, avec de beaux saluts, que « Nos Seigneurs les évêques exercent la plus Iégitime autorité sur tons les monastères des Carmélites établis en France ».
Pour nous, peu importe que ces convents soient Bérullistes ou Térésiens ; les très saintes filles qu’ils renferment n’en remplissent pas moins, les unes comme les autres, l’oeuvre de réparation et de satisfaction que voulut leur vraie fondatrice, l’admirable Térèse de Jésus. Par l’oraison et par la pénitence, elles travaillent à l’expiation des péchés des autres, à la conversion des hérétiques et des pécheurs ; elles s’efforcent de réparer les avaries des prêtres, d’obtenir des grâces pour le clergé qui en a fort besoin ; elles peinent, en un mot, pour le triomphe de l’Église. Prier et souffrir, c’est le Carmel.
II
ET c’est pour de bon que l’on y prie et que l’on y souffre, dans les Carmels ; en fait de vêtements, qu’iI fasse chaud ou qu’il fasse froid, l’on porte une chemise de serge, une robe de bure de couleur enfumée sans teinture, un scapulaire de même étoffe de quatre doigts plus court que l’habit, une coiffe de grosse toile, un manteau de laine blanche, des sandales de corde aux pieds et sur la tête un voile noir ou blanc, selon que l’on est professe ou novice. Ces habits sont, l’été surtout, pénibles a endurer et cependant, an temps de sainte Térèse, plusieurs de ses filles demandèrent à l’aggraver, en s’affublant de tuniques de dessous, grossières et poilues comme des couvertures de cheval. La sainte, qui était la sagesse et la discrétion même, sourit doucement et ne s’y opposa point ; le résultat de ce changement fut une invasion têtue de puces qui résistèrent à toutes les chasses ; il fallut pour s’en débarrasser que la sainte se mît en prière ; l’on renonça pour toujours à cette tunique, mais il est avéré que, depuis les exorations de sainte Térèse, les Carmels sont généralement exempts des visites de ces importunes bêtes.
Le nombre des moniales pour chaque couvent est ainsi fixé par l’article 10 des Constitutions de la sainte :
« Nous ordonnons, dit-elle, que dans les monastères qui sont pour être pauvres et non rentés, it n’y pourra avoir, en aucune sorte, plus de treize ou quatorze religieuses pour le choeur ; et en ceux qui seront rentés il ne pourra y en avoir plus de vingt ; cela s’entend, comprises les soeurs layes que l’on reçoit pour les offices de la maison ; au reste, dans tous les monastères rentés on non, il ne pourra y avoir plus de trois soeurs layes ».
Il n’existe donc pas, parmi les ascétères de cette observance, de grands reclusages contenant des cinquantaines de nonnes ainsi que dans les cloitres des autres ordres.
Si aujourd’hui, l’on ne mange plus, dans les Carmels, ces feuilles de vigne frites et ces glands que les professes d’Avila durent consommer, faute de pain, la nourriture n’en est pas moins et médiocre et brève ; le maigre est perpétuel ; les jeûnes presque quotidiens ; le sommeil est court, cinq heures et demie de repos, à peine ; l’on se donne la discipline, chaque jour ; l’on ne travaille pas en commun et les séances à la chapelle sont de huit heures.
L’horaire fixé par la sainte est celui-ci :
Ses filles se Ièvent à 5 heures, depuis le jour de Pâques jusqu’à la Croix de septembre ; à 6 heures, dans les autres temps ; après le lever, une heure d’oraison et de récitation des petites heures ; — à 8 heures, en été, à 9, en hiver, messe, puis retour dans la cellule. — Le dîner, composé tantôt de poissons, tantôt de Iégumes cuits à l’eau ou de laitage, a lieu, les jours de jeûne de l’Église, à 11 heures et demie, les jours de jeûne de l’ordre, à 11 heures, les autres jours, à 10 heures. Après ce repas, la récréation est prise en commun, puis chacune regagne sa cellule. A 2 heures, Vêpres, lecture spirituelle, travaux en commun jusqu’à Complies, suivies d’une heure d’oraison. et d’une collation de Iégumes bouillis ou de fruits. Quelques instants encore de récréation, puis à 9 heures Matines et Laudes ; l’office terminé, elles font l’examen de conscience et préparent leurs, sujets de méditation du lendemain. Ces exercices durent jusqu’à 11 heures, parfois jusqu’à 11 heures et demie et l’on se couche.
Cet horaire a subi quelques modifications appropriées aux tempéraments et aux climats. Souvent les Complies antécèdent le souper du soir et dans les pays chauds, en Algérie, par exemple, le lever est à quatre heures et demie du matin, mais une sieste est permise, après le diner, à midi.
Quant à la cellule où la Carmélite vit de longues heures, elle est la même partout et elle est d’enuée du plus agreste des conforts. La voici, décrite d’après une photographie et aussi d’après un oeuf dans la coque vidée duquel une soeur s’est amusée à introduire une réduction très exacte du mobilier qu’elles possèdent : une pièce passée an lait de chaux ; au fond, près de la fenêtre, un lit de planches posées sur deux tréteaux, couvert d’une paillasse, d’un drap de laine, d’un oreiller de paille. Aucune table et pas de chaise ; l’on s’assoit sur le carreau et l’on travaille sur ses genoux ; dans un coin par terre, une écuelle d’eau, et sur une tablette du linge, une petite lanterne et quelques livres. A la tête du lit, une croix de bois brun, sans Christ, une image de papier et, pendues au mur une discipline de fer et une coquille servant de bénitier ; c’est tout.
L’on pourrait croire qu’avec une si dure existence ces moniales sont tristes. Il n’en est rien ; d’ailleurs, Sainte Térèse considérait la mélancolie comme un danger et si une postulante se montrait disposée à devenir chagrine, cela suffisait pour l’évincer ; les Carmels ne sont, pas plus que les Trappes, les refuges des coeurs déçus ; on y entre par vocation, par appel divin et non par lassitude de la vie on amour contrarié, ainsi que tant de gens le supposent.
Sainte Térèse voulait des filles qui fussent à la fois gaies et obéissantes, humbles et pieuses ; elle les voulait aussi viriles. Agissez « en hommes et non comme de petites femmes », disait-elle. Enfin, ce qu’elle traquait le plus impitoyablement chez ses novices, c’était l’afféterie et la contrainte. La plus exquise, et l’une des plus parfaites sujettes qu’elle ait formées, était une jeune fille d’une rare intelligence, Ursule des Saints. Elle exigea d’elle la naiveté et la simplesse des petits enfants et elle l’obtint. Une après-midi, alors qu’Ursule était en bonne santé, Sainte Térèse lui enjoignit d’aller aussitôt se coucher à l’infirmerie, en lui déclarant qu’elle était très malade. Elle s’y rendit sans tarder et, aux soeurs qui vinrent la visiter et s’apitoyer sur ses maux, elle répondait : « Je ne sens pas mon mal ; je ne sais pas où je souffre, mais je suis, certainement très malade puisque notre mère m’a envoyée à l’infirmerie. »
Sainte Térèse elle-même, avec toute sa grande intelligence et son prodigieux génie, était d’une simplicité admirable avec Dieu. Elle Le considérait tel qu’un père auquel sa fille peut se permettre de lancer, sans qu’il se fiche, une boutade. Une réponse de ce genre qu’elle Lui fit est à citer en exemple : un jour qu’accablée d’épreuves de toutes sortes elle se plaignait et demandait une minute de grâce, Jésus lui dit : « Ne te plains pas, ma fille ; c’est ainsi que je traite mes amis », et, familièrement, elle répliqua : « Eh ! Seigneur, c’est pour cela que vous en avez si peu ! »
Le corps broyé et l’âme quand même joyeuse, telles furent ses Carmélites et telles elles sont restées.
Mais venons-en aux trois Carmels que détient Paris.
Ainsi qu’il fut narré dans le chapitre précédent, les religieuses amenées par MM. de Bérulle et de Brétigny, en France, furent installées à Paris, dans le prieuré bénédictin de Notre-Dame-des-Champs, qui prit, suivant le désir de la fondatrice, la princesse de Longueville, le titre de monastère de l’Incamation ; mais les bâtiments du cloître tombaient en ruines et, en attendant qu’on les réédifiât sur un plan tracé par sainte Thérèse avant sa mort et rapporté d’Espagne par M. de Brétigny, elles campérent dans la maison particulière de l’ancien prieur, la seule demeurée habitable, dans ce couvent.
Elles y furent fort à l’étroit, si à l’étroit que les premières novices logeaient dans une seule chambre divisée en plusieurs cellules, au moyen de gros draps de bure attachés à des cordes et remplaçaiit les cloisons. Il n’y eut, en tant que couches, que des paillasses étendues sur le sol et la nourriture y fut, pour les postulantes Françaises, atroce.
Les Mères Espagnoles n’aimaient pas ce qu’elles appelaient les « épluchotteuses », c’est-à-dire les Françaises auxquelles leur cuisine de sauvage faisait mal, et elles n’admettaient point le manque d’appétit des pauvres filles devant une morue cuite avec des pruneaux et condimentée d’affreuses épices qu’on leur servait, en guise de régal, les jours de grande fête.
Il ne faudrait pourtant pas s’imaginer que ces novices fussent délicates et portées sur leur bouche ; elles demandaient des mets digérables et voilà tout ; elles jeunaient et se macéraient impitoyablement, d’ailleurs ; beaucoup ont passé des années sans dormir plus d’une heure par nuit et d’autres ont vécu, pendant des semaines, au pain et à l’eau ; elles étaient, du reste, encouragées dans ces rigueurs par leur prieure, la mère Anne de Jesus, qui trouvait les Françaises moins endurantes que ses Espagnoles et avait pour maxime « qu’on devait encore jeûner trois semaines après avoir pense que l’on n’en pouvait plus ».
II faut bien avouer que devant ce manque de discrétion certaines réprimandes de M. Bérulle à la mère Anne de Jésus s’expliquent.
Ces premières novices façonnées, ainsi qu’il fut dit, à la vie intérieure par les soins de Mme Acarie, s’appelaient : Mlle d’Hanidel, Mme Jourdain et Andrée Levoix, cette demière, femme de chambre de Mme Acarie. Le jour de leur arrivée an cloître, la mère Anne de Jésus voulut que ce frit Andrée Levoix qui entrât la première, justement parce qu’elle e’tait la plus pauvre et la moins bien née ; et ce fut elle aussi qui prit, la première, l’habit et devint ainsi la première Carmélite de France.
C’est done de ce convent de l’lncarnation que sont sortis tous nos Carmels. Ce convent existe encore au numéro 25 de la rue Denfert-Rochereau, mais entouré de maisons et privé d’air ; les jardins sont englobés dans l’amas de batisses compris entre la rue Denfert, la rue du Val-de-Grâce et la rue Saint-Jacques ; on aperçoit le mur qui le termine, hérissé sur sa crête de palissades, au fond de la cour du numéro 282 de cette derni6re rue.
L’immeuble a conservé l’empreinte du temps ; sur la rue Denfert, un corps de logis formant une sorte de tour carrée flanque une gigantesque porte cochère munie d’un guichet en écumoire ; on entre dans une maigre cour oùi des jardinets tentent de verdir, en un coin ; an fond, une grande construction blanche surmontée d’une statue de la sainte Vierge et, à droite, les communs qui sont loués à des personnes pieuses. La chapelle est sans faste ; contrairement aux autres sanctuaires des Carmels qui sont précéd’es par de nombreuses marches et s’ouvrent à la hauteur d’un premier etage, celle-là demeure au ras du sol. Imaginez une cave avec deux tout petits bras dessinant d’exigus transepts, une cave voûtée à plein cintre, à peine éclairée, d’un seul côté, par quelques fenêtres, et vous avez l’églisette de l’Incarnation. On trébuche en y pénétrant, tant il y fait sombre ; puis l’on s’habitue à l’obscurité et l’on distingue à sa droite et à sa gauche, pre’s de la porte, deux confessionnaux et d’un côté une effigie aussi médiocre que possible du Sacré-Coeur et de l’autre une statuette bariolée du Bienheureux Réginald de saint-Gilles, un chanoine de l’église Saint-Aignan, à Orléans, auquel saint Dominique donna la robe de frère-prêcheur, après l’avoir guéri, par ses prières, d’une maladie incurable. Ce moine qui mourut en 1220, fut inhumé en cet endroit qui était alors, à Paris, le lieu de sépulture de son ordre. Arrivé là, la cave s’éclaircit, car l’on approche du transept dans le bras droit duquel est une croisée à moitié bouchée par un autel et écartelée d’une longue croix ; dans l’autre bras est un deuxième autel voué à la Vierge figurée par un plâtre de la rue Saint-Sulpice ; enfin, l’on touche au choeur, précédé des statues de sainte Térèse et de saint Joseph, en vis-à-vis ; le fond de l’abside s’arrondit en conque et s’accompagne de deux renfoncements : l’un barré, du côté de l’Évangile, par la grille de la clôture ; l’autre troué, du côté de l’Épître, par une porte menant à la sacristie.
Le maître-autel est surmonté d’un tableau de l’Annonciation quelconque et, entre la nef et la table de communion, une statue en marbre du cardinal de Bérulle à genoux, sculpté au XVIIe siècle, par Sarazin, s’avance entre deux médiocres toiles de la même époque.
En somme, cette chapelle est laide, mais elle est recueillie et très intime. A part quelques dévotes du quartier et les quelques gens qui habitent sur la cour d’entrée et qui assistent aux offices, il n’y a jamais une âme.
Je me rappelle y avoir assisté, un hiver, à une grand’messe, à une messe de navrement ; derrière la grille noire, les Carmélites chantaient leur lamento si lent et la surprise vous, venait d’entendre gémir de la sorte le Gloria in excelsis qui est une hymne d’allégresse et de gloire. Le Kyrie eleison, ainsi égoutté, tombant des Ièvres comme des larmes des yeux, se comprend, puisque cette prière est un appel à la pitié, une plainte, mais le Gloria sangloté devient un contresens. Rien n’est donc plus déconcertant et plus sinistre qu’une grand’messe dans un couvent de cette observance ; la règle est, du reste, formelle dans toutes les communautés de sainte Térèse, le chapitre V des Constitutions dit, en effet, que le « chant ne sera jamais avec note, mais en ton, les voix égales. »
Ce couvent de l’Incarnation eut de grandes moniales : les Mères Anne de Jésus et Anne de Saint-Barthélemy dont nous avons dejà parlé ; puis Isabelle des Anges, de caractère plus doux et d’abord plus facile ; Béatrice de la Conception, la Mère Madeleine de Saint-Joseph, la première prieure Française ; les mères Éléonore de Saint-Bernard, Isabelle de Saint-Paul, d’autres, sans compter Mlle de la Vallière qui prit le voile sous le nom de soeur Louise de la Miséricorde, toutes célèbres par leur science de la vie ascétique et leur sainteté.
Dans ce siècle, les Carmélites de ce cloître n’ont pas démérité de leurs ancêtres. En outre des très pieuses nonnes qu’elles formèrent, elles eurent des soeurs érudites et des historiennes. La plupart des renseignements dont cette baudruche de Victor Cousin fit un si plat usage dans ses monographies de femmes du XVIIle siècle lui ont été fournis par l’ancienne prieure de ce monastère qu’il s’empressait d’aller consulter Iorsqu’il était en peine de livres.
Les deux énormes volumes que j’ai précédemment cités et qui ont pour titre : « Mémoire sur la fondation, le gouvernement et l’observance des Carmélites déchaussées » parus, en 1894, chez Dubois-Poplimont, à Reims, sont l’oeuvre des religieuses de la rue Denfert. Ces livres sont très documentés, soigneusement écrits ; et ils témoignent d’une dialectique rare chez les femmes.
Toujours je me demande, quand je regarde ce petit ascétère, comment des êtres si pauvrement nourris peuvent vivre, en étant dénués d’air ; à ce point de vue, leur maison est la plus mal partagée des Carmels de Paris, car, bien qu’enclavés, eux : aussi, dans des constructions particulières, les autres sont moins resserrés, possèdent des jardins plus grands, sont situés, en tout cas, dans des quartiers mieux aérés et dominés par des maisons moins hautes ; mais il y a évidemment des grâces d’état et, en dépit de toute vraisemblance, les soeurs de l’Incamation suivent strictement leurs règles et vivent.
III
EN 1616, un second Carmel fut fondé à Paris par les soins de dame Catherine de Gonzagues-Clèves, duchesse de Longueville ; elle avait un fils dont l’épaule était déjetée et que les médecins déclaraient incurable ; elle demanda, à Mme Acarie, alors novice dans le couvent d’Amiens, d’intercéder pour lui, s’engageant, si ses prières étaient accueillies, à créer un monastère. Notre-Seigneur apprécia les suppliques de sa servante et la duchesse établit un petit cloître, rue Chapon.
Il fut transféré plus tard sur la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, dans l’hôtel dit de Châlons, puis il disparut, en 1790, après avoir donné naissance à plusieurs communautés Térésiennes, parmi lesquelles figurent les prieurés de Poitiers et de Chartres.
Nous le marquons donc, simplement, pour mémoire, et nous arrivons à un autre ascétère qui existe encore, de nos jours, au no 26 de l’avenue de Saxe.
II fut érigé, non dans cette avenue, mais dans la rue du Bouloy par Marie-Térèse, reine de France, à la suite d’événements qui se peuvent résumer en quelques lignes.
Pendant les troubles de la Fronde, les religieuses du premier couvent de l’Incarnation, qui habitaient hors Paris, furent obligées de fuir ; les unes se réfugièrent au monastère de Pontoise, les autres s’enfermèrent dans la maison de la rue Chapon ; d’autres encore restèrent rue Denfert, mais elles y vécurent dans de si continuelles alarmes qu’elles sollicitérent du roi la permission d’acquérir, dans l’enceinte même de la ville, un immeuble qui pût leur servir d’asile, en cas d’émeutes.
Louis XIV les autorisa, en mars 1657, à acheter quatre maisons sises dans la rue Coquillière et la rue du Bouloy ; elles les réunirent et formèrent, sous le nom d’hospice, un cloîtrion deependant du prieuré de l’Incarnation et régi par une sous-prieure, Françoise de la Croix.
Quelques années se passèrent. Le roi épousa Marie-Térèse, infante d’Espagne. Peu de temps après son entrée à Paris, Marie-Térèse apprit qu’il existait, non loin de son palais du Louvre, un petit couvent de Carmélites dont la supérieure parlait espagnol. Elle s’y rendit, revint souvent visiter ces nonnes, avec la reine-mère Anne d’Autriche, et les prit sous sa protection. Mais, un beau jour, les deux souveraines ne trouvèrent plus au parloir une des soeurs, qu’elles avaient connue dans le monde, Mlle de Ramenecour. Elle venait, en effet, d’être rappelée par la prieure de la rue Denfert. Marie-Térèse, très mécontente, résolut alors de faire de cette petite succursale de l’Incarnation un monastére indépendant, ne relevant plus de l’autorité de la maison-mère, et n’étant plus exposé, par conséquent, à perdre ses sujettes ; et, le 12 janvier 1664, le nouveau monastère fut érigé sous le titre de Sainte-Térèse.
Leurs Majestés continuèrent alors, de visiter cette maison dans laquelle retourna leur amie et elles y amenèrent souvent le dauphin. Il semble s’y être comporté tel qu’un moutard fort turbulent ; un précieux autographe signé de sa main et conservé dans lea archives du Carmel Porte en tête :
« Mémoire de ce que moy, fils unique du Roy, ay casse aux petites Carmélites, cette année 1665. »
Et parmi ses dégâts, assez longs à énumérer, figurent : « une phiole de cristal de roche, un petit bateau de papier marbré, l’âne de la crèche auquel il a arraché les oreilles ainsi que le boeuf dont il a rompu les cornes », et c’est signé « Moy, Dauphin, fils unique ».
Les religieuses vécurent dans leur cloître de la rue du Bouloy encore quelques années, puis leur nombre augmenta et l’habitation, qui avait toujours été malsaine, surplombée par d’autres bâtisses, devint trop étroite ; elles la vendirent et achetérent à la place dans le faubourg Saint-Germain, rue de Grenelle, un immeuble qu’entouraient de grands jardins ; et, le 23 septembre 1689, elles y furent conduites en carrosse « avec toute la décence requise à leur profession », dit le rapport de l’Official chargé d’assurer leur transfèrement.
Mais les épreuves ne tardèrent pas à compenser ces pauvres aises. Les deux reines qui les protégeaient et subvenaient à leurs besoins moururent et l’argent manqua ; leur détresse fut telle que, certains, jours, on restait au réfectoire devant une assiette vide, puis, après avoir écouté la lecture spirituelle, l’on s’en allait réciter, le ventre creux, les grâces. Un matin, elles renouvelèrent la nourriture du prieuré d’Avila et firent frire pour dîner les feuilles de vigne de leur jardin ; la maîtresse des novices, qui était très myope, prit ces feuilles pour des soles et elle se demandait, surprise, ce que signifiait cette aubaine, quand sa fourchette toucha l’illusoire poisson qui tomba en miettes ; et elle demeura comme les autres une fois de plus, à jeun.
Enfin touchés de tant de misère, Mme de Maintenon et l’archevêque de Paris en parlèrent au roi qui, en souvenir de Marie-Térèse, prescrivit qu’on leur payât, chaque année, une somme de six mille francs.
La Révolution les dispersa. Elles étaient alors trente et une soeurs dont la plus jeune avait trente ans et la plus vieille quatre-vingts. Grâce à l’une d’elles, Mlle de Soyecourt, en religion mère Camille de l’Enfant-Jésus, elles purent, après la tourmente, se réinstaller dans le couvent des Carmes devenu un lieu d’internement et de massacres pendant la Terreur ; mais, le 23 avril 1845, elles durent quitter l’immeuble qui fut cédé à l’École normale catholique et aux Dominicains, et elles s’établirent, plus loin, dans la rue de Vaugirard. En 1849, la Ville les expropria et ouvrit sur leur domaine une nouvelle voie ; alors elles achetèrent, sur le conseil de M. Riant qui avait, deux années auparavant, fondé un troisième Carmel, avenue de Messine, une terre située près de l’École militaire, dans l’avenue de Saxe, et, le samedi 22 avril 1857, elles partirent de la rue de Vaugirard et campèrent, en attendant que leur maison fût construite, à Issy, dans une dépendance de la communauté de Notre-Dame.
La première pierre de leur prieuré de l’avenue de Saxe fut posée le 16 mai 1854 et elles y entrèrent définitivement le 21 août 1855.
Elles n’en ont plus bougé ; leur cloître s’étend dans le pâté de bâtisses circonscrit par l’avenue de Saxe, les avenues de Ségur et de Suffren et la rue Pérignon. Leur mur de clôture s’entrevoit au fond de la cour du no. 13 de l’avenue de Suffren et du 18 de la rue Pérignon. Les immeubles qui les avoisinent ne sont pas très bauts et, plus heureuses que les nonnes de la rue Denfert, elles respirent ; seulement, elles subissent les sonneries de clairons des casernes sises à quelques pas et entendent peut-être les « une, deusse », des conscrits qui font l’exereice, le matin, devant leur porte.
L’église, surélevée de nombreuses marches qui symbolisent la montée du Carmel, se dresse au fond de la cour, cernée de communs occupés, comme au monastére de l’Incarnation, par de pieuses gens. L’édifice est de style gothique ; sa nef est plus sombre encore que le cellier de la rue Denfert. Le jour est obscurci par de grandes figures peintes sur d’horribles vitres ; mais le vaisseau et son minuscule transept gagnent à se perdre dans cette ombre. Tout le côté défectueux d’un médiocre pastiche disparaît et il ne reste plus, dans des contours indécis, qu’un autel dont l’or brasille à la lueur d’un petit cierge et vaguement dans les ténèbres l’on discerne, à gauche, la grille hérissée de la clôture, et, à droite, une chapelle de la sainte Vierge.
Ce sanctuaire devient singulièrement mystérieux quand, dans cette nuit, l’on écoute gémir les Carmélites ; il sort ainsi qu’un vent d’hiver de leur grille et 1’âme se replie, glacée sur elle-même, et s’examine. L’on pent s’y faire souffrir dans cette église-là, et c’est bon.
Le bras gauche du transept est curieux. Éclairé par une veilleuse allumée devant une Sainte-Face, il contient une statue de Marie de l’Incarnation, à genoux, et un grand christ blanc placé dans une boîte de verre. Ce christ est probablement le crucifix qui fut donné, en 1675, par Louis XIV aux Carmélites de la rue du Bouloy ; il avait été rapporté du siège de Besançon où il se tenait debout et intact, sur un monceau. de cendres, dans un ermitage abattu par les boulets de canon et entièrement brûlé.
Le dernier Carmel de Paris est enfin situé au no. 23 de l’avenue de Messine ; il est la seule maison de cette avenue, bordée de constructions de luxe, qui soit propre ; il apparaît recueilli et charmant, dans sa petite robe gothique, au milieu de tous ces hôtels qui s’alignent, prétentieux et rigides, neufs et bêtes. Ce Carmel qui touche presque au parc Monceau, a derrière lui un grand jardin dont les murailles s’aperçoivent, surmontées de volets, dans le square de Messine. Au point de vue de l’hygiène, il paraît être le mieux agencé de tous ; il est tout jeune, ayant été fondé, comme je l’ai dit plus haut, le 22 mai 1847, par M. Riant, avec l’aide de sa première prieure, la mère Isabelle de Saint-Paul ; il n’a done pas d’histoire, mais il a dejà rendu un sérieux service aux fidèles épris de la Mystique, car c’est l’une de ses filles qui a traduit — et excellemment — les oeuvres de saint Jean de la Croix que l’on connaissait à peine avant elle.
Un fait intéressant doit cependant être noté dans ses annales. Le 17 mai 1871, en pleine nuit, un commissaire de police auquel l’on adjoignit un serrurier, fut envoyé par les tenanciers de la Commune, avec mission de perquisitionner dans le couvent et d’y saisir l’argent que l’on y pourrait découvrir. Après avoir forcé les serrures des portes et vainement scruté toutes les cellules du cloitre, ils finirent par entrer dans la chapelle. L’argousin la traversa, monta à l’autel, fit cambrioler le tabernacle, s’empara du saint ciboire et l’ouvrit, en criant : voilà ce que je cherchais ! Il prit des hosties, en offrit à son compagnon : « Goûte, dit-il, pour voir quel goût ça a. » Et tous deux : en mangèrent, tandis que les nonnes à genoux derrière la grille de clôture récitaient à haute voix le « Parce Domine », et le « Miserere ».
Aussi commémorent-elles l’anniversaire de ce sacrilège par des prières réparatrices et s’imposent-elles, chaque an, cette nuit-là, à l’intention des deux malheureux, les plus douloureuses des pénitences.
Quelques personnes vont encore prier à la rue Denfert et à l’avenue de Saxe ; mais ici, à l’avenue de Messine, il semble que jamais âme ne vienne, car, dans la semaine, la porte de l’église est toujours close. Il faut demander la clef à la tourière pour y pénétrer. On gravit alors une série de marches et l’on a le pied, à la hauteur de la crête du mur, au-dessus de l’avenue, quand on arrive à la porte d’entrée ; la chapelle est plus petite et plus somptueuse que les deux autres ; elle se compose seulement d’une nef sans transept et elle est de style gothique et peinte ; il n’y fait pas très clair et son atmosphère est douce et tiède ; on sent qu’elle a été façonnée pour des dévotes, plus riches et plus difficiles à contenter que celles de la paroisse de Saint-François-Xavier ou de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Le maître-autel, précédé de sept marches, est paré d’un tableau représentant sainte Véronique debout, tenant le linge sur lequel s’est imprimée la Sainte-Face ; deux : autres toiles sont des portraits de sainte Térèse et de saint Jean-de-la-Croix ; enfin les vitraux sont agrémentés d’ornements et de fleurs ; ils sont laids, moins cependant que les carreaux à personnages de l’avenue de Saxe.
Cette petite église est, en somme, aimable et elle est un havre dans ce quartier si peu religieux, dans cette avenue habitée par des propriétaires, par des agents de change, par des banquiers, et il faut avouer qu’elles ont bien à prier, les braves sceurs, pour compenser les immondices commises par la tourbe des juifs établis à deux : pas de chez elles, près du parc !
Si nous récapitulons maintenant les senteurs des trois chapelles, nous trouvons que celle de la rue Denfert-Rochereau est une cave laide et glacée ; mais elle fleure l’église de village et elle est intime ; celle de l’avenue de Saxe est inquiétante ; elle invite aux appréhensions et aux pleurs ; elle rappelle ces sanctuaires de l’Espagne où des christ de cire saignent dans l’ombre ; elle est, à la fois, terrible et douce, car si elle vous, force à se laminer, après elle console ; enfin celle de l’avenue de Messine est avenante ; elle tient du boudoir, est presque coquette ; elle est, pour tout dire, un oratoire de rive droite.
Tels, les trois Carmels de Paris. Il en existait jadis encore un, fondé en 1625, par Mlle de Viole, en religion Mère Anne du Saint-Sacrement, non à Paris même, mais dans le département de la Seine, à Saint-Denis, le Carmel où la princesse Louise de France prit l’habit, sous le nom de soeur Térèse de Saint-Augustin, et mourut, le 23 décembre 1787, comme une sainte et une aimable sainte, car c’est elle qui s’adressant, un jour, à des novices en mal d’ennui, proféra cette boutade dont la joyeuseté rappelle les reparties de Sainte Térèse : « Croyez-vous, leur dit-elle, que nous sommes venues aux Carmélites pour rechercher ce qui nous amuse et que la société des douze Apôtres ait toujours été bien amusante pour N.-S. Jésus-Christ ? »
Ce monastère de Saint-Denis a vécu jusqu’aux premiers mois de l’année 1895. Cette année-là, en février, une epidémie de grippe infectieuse s’abattit sur la ville et des vingt-sept religieuses que contenait le prieure, vingt-six furent atteintes. S. E. le cardinal Richard dut faire lever la clôture, afin de permettre de les soigner et finalement, ce couvent fut abandonné et reconstitué à Versailles.
Pour compléter son histoire, ajoutons qu’au moment les Carmélites étaient malades les conseillers municipaux socialistes et francs-maçons de la ville votérent, à l’unanimité, l’expulsion des pauvres filles, en déclarant que des scandales avaient eu lieu et que des enfants nouveaux-nés avaient été trouvés à proximité de leur refuge.
Les épouvantables imbéciles et les malpropres mufles !