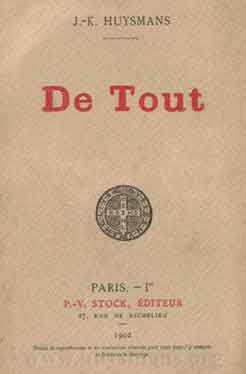L’ABBAYE DE LIGUGE
IL semble qu’il en soit un peu des rivières de même que des hommes : les unes s’élancent à travers champs, laborieuses et pressées, et les autres se promènent le long de leurs rives, paresseuses et lentes. Il en est qui filent droit devant elles, se hâtant d’atteindre le terme de leur parcours, et il en existe aussi qui ondulent, qui se divisent en plusieurs bras, flânent dans les prés, ont l’air de retarder le plus possible l’instant où elles perdront la personnalité de leurs eaux pour se mêler à la foule d’un fleuve.
Parmi ces dernières, l’une des plus sinueuses et des plus musardes est la petite rivière du Clain, en Poitou. Elle symbolise l’extraordinaire sournoiserie et l’incomparable fainéantise de cette race mesquine qu’est la race des Poitevins ; en attendant qu’elle déborde comme en cachette et ravage un petit peu les champs, elle baguenaude, s’amuse à se disperser et à se réunir, traverse une large vallée aux horizons fermés par de vertes collines, passe entre des haies de hauts peupliers dont les feuillages font un bruit de mer qui déferle, quand il vente.
C’est a 8 kilomètres au sud de Poitiers que ce Clain, qui s’est, malgré tout, sanctifié en réverbérant, pendant des siècles, dans le miroir azuré de ses eaux, tant de figures de saints, s’attarde, quitte ainsi qu’à regret, pour s’en aller refléter au loin des êtres quelconques et des sites profanes, le premier monastère créé en France et assis sur ses bords, le vieux monastère de Ligugé.
Saint Martin, qui fut le fondateur de ce cloître, naquit à Sabarie, en Hongrie, vers la fin de l’an 316 ou dans la première moitié de l’année 317, entre le 8 novembre 316 et le 25 juillet 317, précise Lecoy de La Marche.
Après avoir servi dans la milice romaine et tenu garnison dans les forteresses de la France du nord, entre autres à Amiens où, un jour d’hiver, il coupa son manteau pour en remettre une partie à un pauvre, saint Martin reçut le baptême, donna sa démission de l’armée, se rendit à Trêves auprès de saint Maximin, revint en Gaule mais cette fois dans le Poitou, et après être retourné évangéliser la Hongrie et avoir séjourné dans l’Italie où il mena la vie érémitique en l’île des Poules, il regagna de nouveau Poitiers dont l’évêque était saint Hilaire ; et c’est alors, vers l’an 360, qu’il entreprit d’installer un groupe d’ermites à Ligugé.
Comme le dit très justement, dans sa Vie de saint Martin, Lecoy de La Marche, nul monastère en France ne saurait produire un acte de naissance authentique plus ancien que celui-là ; mais il faut s’entendre sur le mot « monastère », car l’on ne désignait pas du tout par ce vocable, dans ce temps-là, une maison conventuelle, un couvent où des religieux vivaient ensemble.
La conception monastique n’était pas, en effet, la même que la nôtre, au IVe siècle. En Orient où le monachisme prit naissance, les moines demeuraient dans des laures, se livrant exclusivement à la vie contemplative. Saint Martin emprunta leur système, posta ses disciples dans de petites huttes séparées et surtout sans doute dans ces grottes qui subsistent encore sur les territoires de Saint-Benoît de Quincey et de Ligugé, mais il ne les destina pas simplement à s’abîmer ainsi que les Pères du désert, en Dieu ; il en fit — et son exemple a été suivi par presque tous les instaurateurs d’ordres en Occident — il en fit des missionnaires joignant à une vie de méditations et de prières une vie active ; ils évangélisèrent la contrée dont ils défrichèrent le sol ; ils instruisirent le peuple et soignèrent les malades ; ils attirèrent à eux les habitants du pays, les groupèrent autour de leurs cabanes ; ils formèrent, en un mot, des villages.
Et telle fut, en effet, l’origine du hameau de Ligugé.
Ce fut là que saint Martin accomplit le premier de ses miracles que l’on connaisse, le miracle du catéchumène.
Le voici, en quelques lignes : Un jeune homme s’était joint aux novices réunis autour de la celle du saint. Or, un jour, il fut atteint si violemment de langueur et de fièvre qu’il mourut, avant qu’on eût pu le baptiser. Quand saint Martin, qui était alors absent, revint, il s’enferma avec le cadavre et, à force de prières et de larmes, il le ressuscita.
A l’endroit même où s’opéra ce miracle, se dresse maintenant une chapelle qui est un des lieux de pèlerinage du Poitou. Ajoutons qu’une légende attribue le trépas du catéchumène non à une maladie, mais à une piqûre de vipère ; aussi les fidèles croient-ils que, grâce à la puissance du thaumaturge, les vipères rouges et noires qui infestent encore les environs ne peuvent plus nuire à personne ; et le fait est que, de mémoire d’homme, à Ligugé, l’on ne se rappelle point que ces bêtes aient jamais attaqué quelqu’un.
Saint Martin paraît être resté pendant treize ans dans son monastère, puis il fut enlevé par ruse et placé, malgré lui, sur le siège épiscopal de Tours.
Nous le laisserons dans cette ville, pour ne plus nous occuper que de son abbaye, dont nous résumerons succinctement l’histoire, d’après une monographie de son savant prieur, le R. P. Dom Chamard.
La communauté créée par saint Martin allait toujours en s’augmentant ; aussi devint-il nécessaire d’édifier un cloître et de bâtir une église, qui fut construite sur l’emplacement du logis du saint et de la cellule du catéchumène, et nous voyons, parmi la foule des chrétiens accourus pour visiter ce sanctuaire et ce couvent, saint Grégoire de Tours qui nous raconte la guérison d’un paralytique obtenue par l’intercession de saint Martin, en ces lieux.
Au VIIe siècle, le monastère adopta la règle bénédictine et devint alors un centre actif et révéré.
Malheureusement, du siècle suivant jusqu’au XIe siècle, les musulmans ravagèrent le Poitou et détruisirent l’église. Elle fut relevée par Theudelin, abbé de la congrégation bénédictine de Maillezais, de la réforme de Cluny ; la vie monastique y reprit et les pèlerinages, un peu oubliés dans ces tourmentes, recommencèrent. Successivement l’on note, parmi les noms célèbres des hôtes recueillis dans le cloître saint Fulbert de Chartres, Guibert, abbé de Gembloux, les papes Urbain II et Clément V.
L’histoire révèle même que ce dernier s’y purgea.
Au XIVe siècle, la basilique et les bâtiments conventuels furent jetés bas par les Anglais, les moines furent disperses et les biens vendus.
L’évêque de Maillezais parvint néanmoins à rentrer en possession des décombres, qu’il restaura tant bien que mal ; à ce moment, la vie religieuse était presque éteinte à Ligugé. Pour l’achever, l’abbaye tomba en commende ; mais, plus heureuse que d’autres, elle finit par trouver, en 1504, un abbé commendataire, Geoffroi d’Estissac, qui, au lieu de la ruiner, la dota.
C’est lui qui a construit l’église actuelle et certaines parties encore debout du cloître.
Ce d’Estissac était un grand seigneur, très généreux et très lettré, et parmi les nombreux amis qu’il recevait dans son reclusage, figure Rabelais qui logeait dans une tour que l’on voit encore près de la porterie et à laquelle il a prêté son nom.
En novembre 1607, Ligugé devint la propriété des pères jésuites. Ils y édifièrent un corps de logis — aujourd’hui l’aile méridionale du monastère, — et ils occupèrent l’immeuble jusqu’en 1763, époque à laquelle leur compagnie fut supprimée.
Enfin la Révolution vola le couvent et les terres, transmua le sanctuaire en une salle d’assemblée communale ; mais il fut réconcilié après le Concordat et rendu au culte.
L’abbaye, elle, était morte, et il a fallu attendre jusqu’en 1853 pour qu’elle revînt, telle que le catéchumène, à la vie.
Ce fut à cette époque que l’évêque de Poitiers, Mgr Pie, de glorieuse mémoire, accomplit ce miracle avec l’aide d’une famille dont le nom n’a pas été sans faire un certain bruit dans les tristes annales de notre temps, la famille des du Paty de Clam.
Il appela une petite colonie de Solesmes, et cette colonie prospéra et se mua, de prieuré qu’elle était, en 1863, en une abbaye. Elle est aujourd’hui l’une des plus importantes maisons bénédictines de France, et elle a essaimé et ressuscité à son tour l’antique abbaye de San Domingo de Silos, dans la Vieille-Castille ; de Saint-Wandrille, dans la Normandie, et fondé à Paris même, rue de la Source, no. 5, un prieuré.
A l’heure présente, elle prie dans le plus gai et le plus frais des paysages, sur le bord de ce Clain qui a repris ses habitudes séculaires et continue, comme autrefois, à mirer le va-et-vient noir des moines ; dans son église qui est commune aux habitants du village et aux religieux, la splendeur des liturgies se déroule.
Les jours de grande fête, les halliers en feu des cierges incendient la nef qui semble onduler avec l’or des chasubles et des chapes ; des théories blanches et noires de moines évoluent dans les brumes azurées des thuribules ; l’abbé mitré et crossé resplendit sous ses ornements dont les pierres aux flammes des cires s’allument et le vent des grandes orgues emporte les chants dont les claires volutes se dispersent, sous les arcs enfumés des voûtes.
Les cérémonies des églises parisiennes ne peuvent donner aucune idée de ces féeries liturgiques admirablement réglées et dont chaque mouvement répond à une intention symbolique, dont chaque geste a un sens.
La vie quotidienne du Bénédictin est celle-ci :
Il se lève à 4 heures pour psalmodier Matines et Laudes ; il récite, à 7 heures, Prime ; à 9 heures, il assiste à Tierce, à la messe chantée, puis à Sexte. A midi, il dîne ; à 4 heures, il retourne encore à l’église pour psalmodier None et chanter Vêpres. A 7 heures, il soupe ; à 8 heures, il récite les Complies et il se couche.
Le reste du jour, il travaille et assiste à des conférences spirituelles et à des cours ; le jeudi, il y a promenade dans l’après-midi ; et, le lundi et le vendredi, à la fin de l’office de Prime, chacun fait sa coulpe au chapitre, autrement dit, s’accuse des manquements commis contre la règle et il les répare au réfectoire où il s’agenouille devant la table abbatiale et se tient dans cette position jusqu’à ce que d’un signe l’abbé le relève.
Si on la compare au régime des Trappes, l’existence des Bénédictins est douce ; mais encore ne faut-il pas trop s’y fier ; le maigre sévit les deux tiers de l’année et alors que l’époque des jeûnes et des longues abstinences est venue, la vie devient singulièrement pénible et j’ajouterai, quitte à choquer quelques cénobites épris de macérations, très périlleuse.
Au Moyen Age, lorsque les tempéraments étaient robustes, les rigueurs des Carêmes avaient leur raison d’être ; en sus de la pensée de pénitence qu’elles impliquent, elles servaient à mâter les turbulences du sang, à débiliter des tempéraments trop vigoureux qui eussent éclaté sans elles sous la pression du cloître ; et cela est si vrai qu’en sus de cet usage d’une adroite famine, l’on employait des haires et des disciplines et que l’on soumettait les patients à ce qu’on appelait alors la « minution »,c’est-à-dire à la saignée. On arrivait de la sorte à épurer l’âme, en déprimant le corps. Aujourd’hui l’on détraque la partie spirituelle quand on affaiblit la coque de chairs qui l’interne ; aussi ne sont-ce plus des soutirages mais bien des injections de sang qu’il serait nécessaire de pratiquer, car les privations et le manque d’exercice, suivis de ces insomnies persistantes, qui sont si fréquentes dans la vie du cloître, déterminent, chez la plupart des religieux de notre temps, un état de déséquilibre nerveux et d’anémie qui se traduit par des impatiences, par des agacements, par des lassitudes dont le diable profite ; les moines qui appartiennent à la solide génération de Dom Guéranger ignorent les péchés de ces névroses, mais combien, parmi ceux qui sont plus jeunes, tombent dans l’acedia et, malgré toute leur charité, s’irritent ? Le manque de viande et d’oeufs est maintenant une source de tentations, un exorde de fautes ; c’est ridicule à déclarer, mais une tranche de gigot rassérène l’âme ; et c’est là l’une des plus tristes humiliations que désormais le Seigneur nous impose.
Ils mènent donc, en réalité, une existence beaucoup plus dure que celle que l’on s’imagine, mais il faut le dire également, il y a des grâces d’état ; les messes pour les religieux qui sont prêtres, les communions fréquentes pour ceux qui ne le sont point, les offices sans cesse répétés, aident à supporter les déboires des mauvais jours ; et, somme toute, ces gens sont heureux.
Et leur vie s’écoule toujours différente et pourtant pareille ; pareille, car le milieu où ils évoluent ne bouge pas et l’horaire des oraisons ne varie guère ; différente, car la liturgie se transforme selon le Propre du Temps et ils accompagnent pas à pas, de la crèche au calvaire, la marche du Christ ; sans compter que chaque matin amène, dans le cycle liturgique, un nouveau saint et que, par conséquent, avec le calendrier, les lectures changent.
L’abbaye de Ligugé se compose, ainsi que la plupart des édifices conventuels, d’un cloître formant carré avecjardinet au centre ; deux étages se dressent au-dessus des arcades, occupés par des cellules blanchies au lait de chaux, meublées d’un petit lit en fer, d’un vague matelas et d’une couverture dont la nuance est celle d’une farine délayée de lin ; l’on y voit, en outre, une table surmontée d’un casier pour les livres, deux chaises de paille, une cruche, un crucifix de bois et une amicale image en couleur de la Vierge, qui est l’ouvre des Bénédictins de la Congrégation de Beuron.
Une nouvelle bibliothèque, parée de créneaux de plâtre, rappelant, paraît-il, le style gothique anglais, a été récemment érigée dans la cour d’entrée par un architecte qui n’a rien de commun, je prie de le croire, avec le Père Mellet dont j’ai parlé à propos des constructions de Solesmes.
Un grand jardin s’étend derrière le couvent, coupé en deux par la ligne du chemin de fer de Paris à Bordeaux ; il détient, en deçà du remblai, une prairie longée par le Clain et bordée par une haie déchirée d’arbres et il renferme, du côté de l’abbaye, de larges allées, d’épaisses charmilles et un berceau ombreux de vignes au bout duquel, dans une spacieuse cage qui s’étend au pied d’une statue de saint Joseph, des colombes se becquètent et roucoulent.
On les élève, en souvenir de la sour de saint Benoît, de sainte Scholastique dont l’âme s’envola sous cet aspect au ciel ; et le jour de la fête de la sainte, on laisse ces oiseaux s’ébattre dans le réfectoire et picorer à l’aise, près des moines, les miettes.
Puisque j’en suis encore au réfectoire, ajoutons que les personnes qui viennent pour la première fois dans un monastère de l’obédience de saint Benoît éprouvent, si elles sont conviées à partager le repas de ses fils, la surprise de se trouver subitement reculées de plusieurs ères, transportées en plein Moyen Age, dans un milieu demeuré, depuis tant de siècles, intact.
L’abbé, tenant à la main une aiguière, les attend à l’entrée du réfectoire, assisté de deux moines portant, l’un un bassin et l’autre une serviette. En signe de bienvenue, il verse un peu d’eau sur les mains de ses invités, auxquels on offre pour les essuyer un linge. Puis ils sont conduits à la table des hôtes, placée en face de celle où, seul, le père abbé mange. Tout le monde est debout ; l’abbé récite le Benedicite, auquel répondent les religieux alignés devant leurs tables, le long des murs. Le lecteur de semaine, installé dans une petit chaire au bout de la salle, chante sur un ton grave : Jube, Domine, benedicere; l’abbé profère la formule de la bénédiction à laquelle tous répliquent par un amen ; et, servi par les pères, à tour de rôle, le repas commence.
Il rappelle, comme qualité celui des collèges et des séminaires ; il se poursuit et s’achève, tandis que le lecteur lit, en détachant les phrases, un volume de piété ou d’histoire ecclésiastique que tous doivent écouter en silence. Soudain, l’abbé frappe un coup sec avec un petit marteau, l’hebdomadier n’achève même pas sa phrase, mais changeant aussitôt de ton, il ferme le livre et lance de sa chaire : Tu autem, Domine, miserere nobis. Tous se lèvent, l’abbé récite les grâces, puis, à la queue leu leu, en psalmodiant le Miserere, l’on se rend à la chapelle, et quand les prières sont terminées, l’abbé, revenu dans le cloître, emmène les hôtes et leur offre, dans une salle à part, du café ; pendant ce temps les moines, dont c’est l’heure de récréation, se promènent dans les jardins et causent ; puis, dès que la cloche sonne, ils regagnent sans bruit leurs cellules.
En somme, le dîner et le souper monastiques complètent la série des offices canoniaux qu’ils séparent. Dieu y est révéré ainsi qu’à l’église et nul, même en ces moments de détente, ne le quitte ; ce sont, en un mot, des agapes de prières, car l’âme y entend célébrer, tandis que le corps se sustente, la gloire de Notre-Seigneur et de ses Saints.