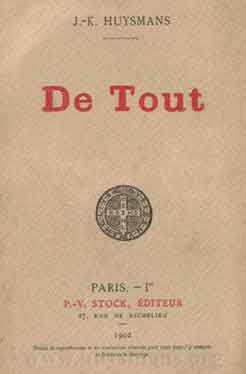LE LUXE POUR DIEU (SOLESMES)
IL existe des idées religieuses pourtant très simples et qu’il est presque impossible de faire comprendre, je ne dirai pas à des mécréants, ce qui serait presque naturel, mais à des croyants, ce qui l’est moins.
Combien de catholiques pratiquants ouvrent des yeux qui semblent bâiller lorsqu’on leur parle de la vie contemplative et finissent par vous servir l’inévitable phrase : « Je conçois fort bien les services que rendent les fiIles de Saint-Vincent de Paul et les petites sceurs des Pauvres, mais je ne vois pas l’utilité d’ordres tels que les Carmels et les Trappes ; et pour peu qu’on les pousse, ils ajoutent : « Évidemment, puisqu’ils ne font rien. »
Pour ces gens, en effet, l’expiation des péchés des autres par les mortifications et les pénitences et la louange de Dieu par la récitation régulière de l’office sont tâches oiseuses et besognes vaines ; et c’est sans doute pour cela que les communautés qui ne vivent point de la vie active, comme les Clarisses, sont, la plupart du temps, aussi pauvres. On ne leur donne point, ainsi qu’aux autres, parce que ce serait de l’argent dont on ne pourrait surveiller l’emploi, de l’argent qui ne rapporterait aucun bénéfice visible, aucun résultat palpable, avant la mort.
Mais, parmi ces concepts mystiques si peu intelligibles à la majorité des ouailles, il en est un plus obscur, plus fermé encore s’il est possible, celui du luxe pour Dieu ; à ce point de vue, l’ordre Bénédictin dont la raison d’être dans l’Église est justement d’entourer le Sauveur de tout le luxe, de tout le confort possible, si l’on peut dire, est de tous, à coup sûr, celui qui suggère les méprises les plus certaines, les idées les plus fausses.
Comme je l’écrivais dans la Cathédrale, « le but véritable du fils de saint Benoît est de psalmodier et de chanter la louange divine, de faire l’apprentissage, ici-bas, de ce qu’il fera là-haut, de célébrer la gloire du Seigneur en des termes inspirés par Lui-même, en une langue que Lui-même a parlée par la voix de David et des Prophètes... C’est une oeuvre d’allégresse et de paix, une avance d’hoirie sur la succession jubilaire de l’au delà, l’oeuvre qui se rapproche le plus de celle des purs Esprits, la plus élevée qui soit sur la terre, en somme. »
J’ajouterai maintenant que ces psalmodies et que ces chants font partie d’un ensemble de cérémonies, s’accompagnent de gestes et de pratiques séculaires, d’ornements et d’objets particuliers dont les symboles permettent à l’Église d’énoncer et de manifester son amour envers l’Époux ; et cet ensemble, ce tout, c’est la Liturgie.
Les Bénédictins célèbrent donc l’office liturgique non tel qu’on le gargote dans la plupart des Chapitres, avec des chantres qui graillonnent et crachent à la galopade, les uns du côté de l’Épître, les autres du côté de l’Évangile, des monceaux de versets, mais tel qu’il doit se célébrer, avec ferveur et respect, avec science et soin.
Pour l’exécuter de la sorte, il a d’abord fallu, en sus d’une direction et d’une culture d’âme spéciales, réformer de nombreux usages et se débarrasser avant tout de cette musique de caillasse qui dégouline que les maîtres de chapelle s’obstinent encore à confondre avec le vrai plain-chant.
Puis, en même temps qu’ils restauraient la musique de l’Église, ils recherchaient les contours, gâtés par le mauvais goût des temps, des objets du culte, reprenaient la forme abolie des chasubles du Moyen Age, jugeant sans doute que ces manteaux modernes de carton, galonnés et écartelés d’une croix d’or, qui tombent droits, après avoir dessiné l’image d’une oreille d’âne penchée, aux écoutes, sur l’épaule du prêtre, ne décelaient pas un sens bien avéré de l’art ; et il en fut de même pour la couleur des vêtements sacerdotaux ; ils substituèrent aux rouges et aux verts crus, aux blancs plats, aux violets de vin du Midi et aux ors bruts qui font du dos de l’officiant à l’autel une cible de souffrances pour la vue, les tons délicats et fondus, les caresses des teintes liturgiques d’antan.
Ils voulurent que la Beauté suprême fût adulée par ce qui survit de surélevé chez l’homme, depuis la Faute, par cette inspiration, par cet art que sainte Hildegarde définit « une réminiscence à moitié effacée d’une condition primitive dont nous sommes déchus depuis l’Éden. »
Ainsi que l’exprime très nettement le P. Dom Besse, dans un très intéressant livre d’enthousiasme, le Moine Bénédictin, paru à l’abbaye de Ligugé, « la construction et l’ornementation des églises monastiques et le caractère artistique des objets consacrés au culte n’importent pas moins à la régénération sociale d’un pays que l’érection des écoles ou des hôpitaux et que l’établissement de maisons de missionnaires. »
Et il atteste encore que « le laid fait horreur aux Bénédictins. » Ils y voient, dit-il, « un désordre, un je ne sais quel péché dont la présence dans le temple ou à son ombre blesse le regard des anges, tandis que l’art est comme le reflet de la beauté de l’ineffable Jesus. »
De là, la pompe des offices Bénédictins, leurs chants magnifiques, leurs armées de moines évoluant avec une précision extraordinaire ; de là, l’apparat des liturges, l’opulence des cérémonies, la tenue somptueuse de l’abbé dont la crosse est parfois en ivoire sculpté et dont la mitre est souvent pavée de gemmes.
Cette idée de l’homme offrant à Celui qu’il aime, à Celui qu’il doit aimer, ce qu’il a de mieux, me semble parfaitement juste et parfaitement claire ; mais il n’en est pas du tout ainsi et c’est parce que je suis las de batailler à ce sujet avec nombre de laïques et de prêtres, que je veux répondre, une bonne fois, à ceux qui, après avoir visité Solesmes, reprochent à ce monastère le luxe de ses nouvelles constructions, le gala de ses offices canoniaux, la splendeur de ses chapes et de ses mitres.
Un brave curé murmurait, un jour, en sortant de la sacristie de ce cloître « Il y a de tout, ici, sauf de la misère ! » — Il n’y en a pas, en effet, et il n’y a point de motifs pour qu’il y en ait, puisque le rôle du Bénédictin n’est pas, comme celui d’autres instituts, de pratiquer les macérations et de vivre d’aumônes.
Il faudrait pourtant bien se mettre dans la tête que les oeuvres de l’Église sont les plus dissemblables et les plus variées, qu’il y a des communautés d’assistance et d’éducation, de propagande et de prêche, d’expiation et de pénitence, de liesse et de louange ; toutes ont leur raison d’être et toutes servent ; mais il va de soi que l’aspect de chacune diffère. La pauvreté des chapelles, les chandeliers de bois, les vitres incolores des Trappistes et des Clarisses, le lamento du chant des Carmélites sont aussi naturels chez ces parangons des austérités et des sacrifices que le luxe de l’église chez les moines noirs qui sont plus particulièrement voués à une existence de travaux spirituels et d’offices.
Puis ce bon curé qu’ébroua une mitre — qui est un cadeau, du reste — parce qu’elle est incrustée de pierres dont les sens symboliques semblent lui échapper s’imagine-t-il donc que c’est pour son plaisir personnel qu’un abbé la porte ? Ne sait-il donc pas que dans un monastère l’abbé représente le Christ et que ce n’est qu’à cause de cette effigie qu’il se pare ? La gloire en revient à Jésus et non à lui. Il y a mieux, d’ailleurs, sur cette question dans un autre couvent que je connais, les tentures intérieures du tabernacle sont constellées de clous de diamants. Or, personne ne les voit, sauf le prêtre qui ouvre, un instant, ce tabernacle, pour y prendre le saint-ciboire. Comment douter dès lors que c’est pour magnifier le Sauveur seul qu’ils sont là ?
L’on peut remarquer du reste que si ces pierreries étaient fausses, comme celles qui ornent maintenant la plupart des autels et des monstrances, personne n’y trouverait rien à redire. L’on n’oserait offrir à quelqu’un que l’on estimerait des verroteries et des strass ; seulement, quand il s’agit de Notre-Seigneur, c’est autre chose ; pour Lui, le toc est assez bon !
Mais laissons cela et arrivons à ces fameuses constructions dont la presse illustrée a donné de bien médiocres images qui ne rendent nullement l’ampleur et la force de ce monument.
Un fait est certain, c’est que presque tous les cloîtres édifiés à notre époque sont, au point de vue de l’art, absolument nuls ; les galeries ont l’air d’être en cartonpâte, les colonnes ressemblent à des rouleaux de bois passés au lait de chaux, les voûtes sont en papier mâché et, quant aux ornements, mieux vaut, pour ne pas s’irriter, les négliger ; tout cela sent la construction moderne, si prétentieuse et si hâtive, si peu résistante et si truquée.
L’on ne voit plus maintenant d’architectes qui soient de taille à bâtir un cloître. Mais en admettant même qu’il en existe, ce serait loin des écoles et loin de Paris qu’il les faudrait chercher.
Des artistes parfaitement inconnus, gens très pieux, vivant à l’écart, au fond d’une province, comme Paul Bord, ce peintre mystique dont j’ai parlé dans la Cathédrale, réalisent parfois une oeuvre intéressante, mais cette oeuvre n’est jamais, en comparaison de celles des autres, qu’un mieux. Il y manque toujours quelque chose et surtout l’idéal monastique n’y est point ; enfin, faute de temps et d’argent suffisant peut-être, le côté débile d’une tâche pressée s’atteste. Ces cloîtres sont établis pour quelques années et non pour l’éternité, suivant l’expression de jadis.
La vérité est qu’il est très difficile à un laïque, qui n’a pas vécu dans un monastère, d’en ériger un. Il sera toujours dénué d’un sens spécial, issu de la particularité même d’une existence confinée, en un milieu clos dans les exercices de cette liturgie et l’étude de ces symboles sans lesquels aucune oeuvre d’architecture mystique n’est possible. Seul, un véritable artiste qui serait en même temps un saint et un savant moine serait donc à même de retrouver l’état d’âme et la science du Moyen Age nécessaires pour édifier une abbaye ; et c’est justement ce problème qui semble si malaisé à résoudre qu’a résolu Solesmes.
Ce monastère avait parmi ses pères un architecte de talent, dom Mellet, qui avait renoncé à l’art pour entrer au cloître. L’abbé le chargea de reconstruire ce couvent dans lequel il vivait depuis bien des années et qui était devenu insuffisant et menaçait ruines. Il se mit au travail et il a réalisé la seule oeuvre moderne d’architecture monacale qui existe,en France au moins, dans notre siècle.
Vu d’en bas, de la rive de la Sarthe, au-dessus de laquelle il s’élève, cet édifice apparaît formidable ; taillé en plein granit, flanqué de tours massives, il se dresse à des hauteurs vertigineuses et l’on reste suffoqué par la puissance de cette masse jaillissant entre des reliefs géants de contreforts. Invinciblement, l’on songe à une architecture claustrale et militaire, à un mont SaintMichel, à l’un de ces couvents fortifiés, tels qu’en fonda l’ordre de saint-Benoit, au Moyen Age.
Et il y a, en effet, de cela dans l’assurance imposante, dans la force tranquille de ce monument.
Le premier moment de surprise passé, si l’on examine cette façade, l’on y découvre que, sous son apparence de grandeur et de simplicité, elle recèle les plus curieux des détails. Avec son alliance de l’ogive et du plein. cintre, avec les fenêtres de ses tours qu’on croirait avoir bondi les unes au-dessus des autres avant de se fixer, l’aspect monotone que présenteraient ces immenses murailles, si elles étaient régulières dans toutes leurs parties, n’est pas ; et rien n’est plus séduisant que les hautes baies ogivales dessinées par les contreforts, enveloppant des ouvertures qui paraissent se chevaucher et dont aucune ne se ressemble.
Et l’intérieur n’est pas moins varié. Le réfectoire a l’envergure d’une cathédrale, avec ses énormes piliers qui supportent l’envolée des voûtes ; et là encore, dans cette salle, des motifs imprévus enchantent ; une haute cheminée à hotte en égaie tout un pan et les chapiteaux des colonnes sont comme un mémorial délicieux et bizarre, sculptés de hiboux qui rêvent dans des cercles de corbeaux chers à saint Benoît, de coupes empoisonnées brisées par le signe de croix du saint, de bêtes et d’objets rappelant des épisodes de la vie du Patriarche, se rapportant au légendaire de l’Ordre.
Le reste de l’abbaye n’est pas encore terminé ; mais quelle impression de donjon monastique, de cloître armé, quelle senteur de pur Moyen Age, dans ces escaliers dont les uns se tordent en vis de saint-Gilles et dont les autres s’entrecoupent, détruisant cette symétrie dont les architectes contemporains sont si fiers ! Et il y a, au bout de galeries interminables, des perspectives inattendues, des changements d’étages se diversifiant, resserrant l’allée, la brisant, l’élargissant, ouvrant subitement, à un détour, une échappée sur le clair paysage que baigne la Sarthe.
En somme, — et c’est là ce que les gens qui bavardent à tort et à travers devraient bien s’efforcer de comprendre, — le luxe ou plutôt la beauté de ces nouvelles constructions de saint-Pierre de Solesmes sert à magnifier la gloire de Dieu et du saint en l’honneur duquel elles sont élevées ; puis, à un autre point de vue, cette abbaye est, ainsi que je viens de le dire, le seul effort d’art vraiment monastique de notre temps. C’est donc une véritable, oeuvre qu’ont réalisée et l’abbé qui la voulut et le moine qui la conçut.