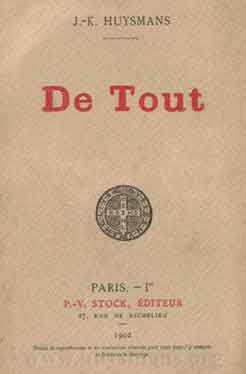LE SLEEPING-CAR
HUIT heures du soir. Sur le triste quai de la gare du Nord, la foule des passagers s’empresse. Au milieu du train déjà envahi par des familles qui luttent, les bras levés, contre les filets des wagons et les valises, le sleeping-car érige son interminable caisse de tôle noire. Dès que l’on a franchi le marchepied et pénétré dans le corridor qui parcourt la voiture d’un bout à l’autre, l’idée déjà suggérée par la sombre armature de ce véhicule, qu’on entre dans une prison, s’affirme. Partout, en effet, dans le couloir, de minuscules portes ferment sur d’étroites cellules qu’éclairent des fenêtres par le cadre desquelles le corps d’un enfant ne saurait passer. L’on rêve de menées dolosives, de délations, d’exil, d’arrêts inexpliqués et sans recours.
Le gardien, à la livrée marron bordée de filets jaune sparadrap, reçoit les billets d’écrou. L’on s’installe, l’on examine les murs exigus de sa geôle, les hauts divans tendus de reps gris à ramages olive, le tapis en accord avec les nuances serrées du reps, le plafond simulant un ciel pommelé, traversé d’oiseaux dont les ailes écorniflent la lune en verre d’une lanterne ronde qui descend au centre, et l’appréhension d’une irréductible captivité s’efface. L’on sourit, allégé, presque requis par la dignité, par le confort de cette pièce et l'on se débat, plus à l’aise, contre sa malle dont la serrure pareille à toutes les serrures des malles, s’écrie, à chaque tour de clef, et ne s’ouvre pas.
Le gardien apparaît, vous refoule poliment dans le couloir, enlève son veston, le plie, se rue sur les murs, empoigne et brasse à pleins bras comme un geindre les divans qui tournent sur eux-mêmes et se dédoublent. Une moitié monte, s’agrafe par des attaches de cuivre et des courroies en l’air, tandis que l’autre rase, immobile, le plancher du train.
L’homme dépiote des paquets, déboucle des ceintures, tend des amarres, appuie sur des ressorts, aplatit de petits matelas rayés de barres rouges, extrait d’on ne sait où des traversins pour poupées, des oreillers pour nains, couvre, en guise de draps, de serviettes à thé cette literie qui, ballottée par le tangage, évoque la future vision d’un berceau dorloté à la vapeur, d’une enfance endormie à la machine.
L’illusion n’est plus maintenant possible ; la confiance que tolérait la mansuétude de cette pièce a disparu. Quatre couchettes superposées, deux par cloisons, sont côte à côte. Ainsi que dans un préau couvert, les détenus réunis dans le corridor songent aux douloureuses lenteurs d’une nuit passée dans ce Mazas comprimé, qui roule. Ils aspirent la dernière bouffe de leurs cigarettes et rentrent à la queue-leu-leu, dans les cellules dont le gardien ferme aussitôt les portes.
Demeuré seul, dans le couloir, je me console, pensant que sur les quatre compagnons qui devraient partager ma pièce, un seul est présent, un monsieur d’une cinquantaine d’années, adipeux et flétri, très chauve. Je scrute son dos qu’il tourne obstinément. Il bouge. J’entrevois une oreille vineuse, des sourcils en soies de porc, une narine refoulée par des joues bouffies, le demi-cercle d’un ventre sur lequel clapote un médaillon au bout d’une chaîne.
Vêtu d’une cheviote d’un gris meunier, quadrillée de rose, il mâchonne le tronc d’un corpulent cigare, sifflote, crache, tient tout à la fois du maquignon qui prospère et du caissier qui fuit.
Il va occuper le lit situé au-dessus du mien. Par la porte entr’ouverte de la geôle dont la lanterne maintenant voilée d’un épais rideau semble éteinte, je l’aperçois, déshabillé, huché en caleçon de coutil, sur un escabeau. Il tente l’escalade dans les ténèbres d’une invisible couche ; sans doute cramponné à des embrasses, il s’élève peu à peu vers le plafond, agitant des jambes blanches, emportant à la force des bras un absurde derrière qui se tord en d’inhabiles acrobaties contrariées par le mouvement du train.
A mon tour, j’entre et je m’étends sur mon matelas, écoutant, anxieux, les craquements du lit pendu au-dessus de ma tête, me demandant si les crochets qui le retiennent ne vont point fléchir. L’idée que le gros monsieur qui git là-haut pourrait être brusquement versé sur moi, m’effare ; puis dans le cliquetis des ferrailles, dans les cris déchirants des essieux et des freins, dans le roulement sourd et comme gras des roues, mes émois se dispersent et je ne songe plus qu’à me caler, afin d’éviter les secousses. Je me sens, en effet, balancé par les pieds et par la nuque, ainsi qu'un homme que l’on va jeter à l’eau. Brandi en avant je crois que je vais perforer la cloison avec mes jambes et me ficher, en vibrant, tel qu'une pointe de flêeche, dans les champs qui longe le rail ; et aussitôt le mouvement en sens inverse s’effectue, je m’imagine filer en arrière, faire la planche, piquer une tête à la renverse, sur l’autre voie.
Vainement j’essaie de reprendre mon équilibre, je tire, d’une main, ma chemise qui remonte, se boule en tapons sous mes reins, se volute sur mon ventre en crêpe et, de l’autre, je contiens la couverture et les draps qui se sauvent dans ces gambades insensées d’un lit !
Je tente de diverses postures ; je m’allonge de côté, le nez dans la ruelle, mais, à un changement d’aiguilles, la cloison devient élastique et m’envoie rebondir sur l’autre bord ; d’un saut de carpe, je me retourne, je me blottis le dos contre le mur mais un cahot me repousse et je coule dans la sente dont le parquet tapissé chancelle. Je m’agrippe, d’un bras au matelas et j’abrite, de l’autre, mon crane qui bat, éperdu, l’oreiller de crin.
Alors je me recroqueville, je m’atténue, je me casse en chien de fusil, mais mes genoux se frappent et mes talons devenus fous, m’éperonnent. Exaspéré, je m’étale sur le ventre, mais au premier choc, je saute ainsi qu’une grenouille et je me rabote l’échine sur le dessous de l’autre lit. N’en pouvant plus, je me détermine enfin à me mettre sur mon séant, à m’accroupir les jambes croisées tel qu’un tailleur, mais j’ai beau plier les épaules et baisser le front, je reçois encore de ce lit qui me surplombe une formidable claque.
Et l’express continue de rouler à toute vapeur ; il fait le lacet, gronde et mugit, patine et siffle. Je valse, emporté par une danse Saint-Guy qu’accélère un orage de culbutes et de gifles. A moitié nu, en bannière, je flotte comme un gonfalon, je dégringole comme un sac de lest, je ricoche comme une balle, je crois, à certains moments, que je vais défoncer d’un coup de front le toit du véhicule et crever d’un coup de pied son sol. Je deviens à la fois, tourniquet et toton, bobine et fusée, jet d’eau et boule !
Mon derrière est en feu, mon crâne en miettes ; le vide se fait en moi ; impossible de me récupérer, de me rencoigner en moi-même ; je n’ai plus que cette sensation : ma tête est une courge longtemps oubliée dans laquelle s’entrechoquent des pépins secs.
Le sommeil m’accable, mes yeux ramonent en se fermant des sables durs ; je me survis, mais je n’ai plus la force de me garer des saccades et des chocs. Je vais à l’abandon sur le dos, ainsi qu’un noyé qui danse au gré des remous. Je perds enfin connaissance. Le convoi s’arrête ; le recul de la voiture, le heurt des tampons m’éveillent.
Ces sommes interrompus et repris et encore interrompus me brisent. J’ai des nausées à sentir ces berceaux qui divaguent et ce wagon qui tourne. Je parviens cependant à me recenser et je me persuade que mieux vaudrait demeurer debout, les yeux au clair et passer la nuit dehors. Je mets un pied par terre ; un bruit de voix dans le couloir me cloue sur place. Le gardien du sleeping cause avec deux femmes qui se proposent de louer deux lits ; la porte s’ouvre, je rentre au plus vite sous ma couverture ; l’homme s’avance, décroche des rideaux avec lesquels il obstrue le seul côté par lequel je pouvais humer de l’air. Je suis, cette fois, vraiment inhumé dans un cercueil houleux qui flotte.
Une odeur d’héliotrope blanc s’ébruite et un bas de robe balaie le rideau dont la subite ondulation m’évente. Je revis et j’écoute. Des femmes chuchotent, déplorent que le wagon soit occupé, émettent sur ce contre-temps de longues réflexions dont la disette d’imprévu m’émeut, puis elles se déshabillent, j’entends les lacets qui sifflent, les jupes qui craquètent, les bottines dont les talons carambolent contre les malles.
L’express siffle, s’ébranle, se remet en marche, dévide à la hâte les rubans en acier des rails ; dans les ténèbres de ma bière, des éclats fracassants de lumière, des galops de lueurs m’aveuglent puis s’éteignent, alors que les stations qui flamboient sont dépassées et rejetées dans la nuit, au loin.
Je manque d’air, j’étouffe ; le compartiment est trop exigu pour qu’on y puisse respirer trois. J’entends le put-put d’une bouche féminine qui souffle des pois et le glou-glou d’un nez sans doute masculin qui pompe. Je finis par râler, par tomber dans un sommeil concassé, sans repos. Je rêve de carrières qui s’éboulent, de charrois qu’on me décharge sur la poitrine. Je me réveille en sursaut, inondé de sueur.
Un jet de clarté pénètre dans le wagon. Je consulte ma montre ; il est cinq heures. Je me glisse au bout du lit, j’écarte la tenture de la fenêtre, il fait jour. Des poteaux de télégraphe, des plaines, des maisons, des ravins, des arbres courent à toute vapeur, dans le sens inverse du train ; aucun bruit dans ma geôle. J’entr’ouvre le rideau qui me sépare de ma voisine. Impossible de la voir, sa jupe est accrochée par des épingles au chevet du lit. J’aperçois seulement, à ses pieds, un mirobolant corset de soie cerise qui, mis debout par le tangage, danse tout seul, dans un rayon de lumière, avec ses hanches et ses seins vides.
L’odeur de ma cabine m’asphyxie. Des parfums dénoués dans un souffle d’éther se mêlent aux senteurs dévergondées des femmes, après la danse. J’ai le coeur qui défaille dans cet air raréfié, chargé d’aromes, je me lève, je m’habille sans bruit, je pousse doucement la porte, je suis dans le couloir ; — personne — j’allume une cigarette, j’ouvre une nouvelle porte qui donne accès sur la plateforme, au dehors. Je respire enfin, mais le vent soulevé par le rapide m’aplatit contre les parois en même temps qu’une pluie fine de suie me picote le visage et les mains de points noirs. Il faut rentrer. Le gardien du sleeping se promène en pantoufles dans le corridor ; il m’apprend que mes voisines sont montées à Liège, qu’elles venaient de Spa ; qu’elles se rendent à Cologne.
— Sont-elles jolies ? demande un Monsieur qui nous rejoint dans le couloir.
Il répond avec un accent allemand et dans un français de frontière :
— Elles ne sont pas mauvaises.
— Et, elles sont jeunes ?
— Sans qu’il y en ait plus.
Il se tait, puis hochant la tête
— Pour moi, elles ne méritent pas.
Ne méritent pas quoi ? Je finis par comprendre qu’il déplore de loger des femmes seules, parce qu’elles ne dispensent point de plantureux pourboires ; et la mélancolique justesse de cette réflexion me touche car cela est vrai ; autant une femme est généreuse alors qu’elle est accompagnée par un homme et que c’est l’argent de cet homme qu’elle fait distribuer ou qu’elle-même cède, autant elle devient d’une impénitente ladrerie, alors qu’il lui faut desserrer sa propre bourse.
Peu à peu le wagon s’éveille. Le convoi s’arrête, des douaniers montent, vous croient sur parole, ne se hâtent point ainsi que les gabelous de France d’être impolis. Et le train repart. Les timbres des cabines sonnent ; le gardien me quitte, s’élance dans les réduits, revient, apporte des verres de porto et de rhum, rentre et ressort, ahuri par les femmes qui veulent toutes savoir si décidément Cologne est proche. Les portes s’entre-bâillent, des gens harassés passent la tête, se dirigent, gênés, vers les cabinets où la trépidation du plancher les retient. Des femmes apparaissent, clignant dans des traits dépareillés des yeux qui fondent. Haves sous la sauce séchée des fards, elles s’essaient à recuire le ragoût de leur teint ; elles s’installent devant des glaces insérées dans des portes aux extrémités du couloir, se tapotent les joues pour les chauffer, se mouillent les lèvres avec la langue, les frottent avec l’index pour les rougir, enroulent des frisettes de cheveux autour de leurs doigts en bigoudis, se secouent, se sourient, chantonnent, sautillent à l’aise comme chez elles.
Les timbres continuent de retentir, dans la fuite enragée du train. Le geôlier court, fait la navette, déclôt les étables qui dégorge le bétail riche. Pour quelques Français aux mines insignifiantes, pour quelques Allemands doux et poilus, que de physionomies mal famées et hostiles ! La racaille de l’Amérique du Sud, la fripouille de l’Italie et de la Grèce, les rastaquouères aux joues bistrées, gaufrées, piquées de tannes, les aigrefins aux yeux noirs et vernis, aux moustaches en boucles, aux toisons en copeaux pommadés d’ébène, abondent. Le sleeping est devenu un garni dans lequel s’agite le personnel d’une maison de jeu. Ce port ostentatoire, cette tenue courtoise et grave, dont il s’affublait, hier, à Paris, n’est plus. L’on aperçoit dans les chambres, le fumier des litières, la crasse des matelas, le saccage des oreillers et des couvertures, toute une bauge, dominée par le ridicule enfantillage de ces plafonds que décore un vieux ciel peint. L’on ne peut même plus assimiler ces galetas aux cabines des transatlantiques dont les lits également conjugués s’étagent ; une seule comparaison s’impose, celle d’une voiture de saltimbanque, d’une maringote en marche, au point du jour ; et cette similitude se confirme, si l’on considère le débraillé matinal et le teint de grande route des chenapans de Caracas et des camelots Grecs.
Je songe aussi aux exercices de haute voltige que exécutai pendant la nuit et il me semble que je n’ai point déparé la troupe des nomades qui bâille, fourbue, dans chaque pièce. Je voudrais bien, en attendant, rentrer dans ma cabine, car je titube ainsi qu’un homme saoul, je bascule à chaque bifurcation des rails et je dois m’accrocher aux embrasses des fenêtres pour ne pas choir, mais le monsieur qui dormait au-dessus de ma tête vient de sortir précipitamment, comme chassé de la pièce. Je me hasarde néanmoins, je pousse doucement une porte qu’un bras retient, j'entrevois le corset de soie cerise qui s’emplit.
Décidément, il faut renoncer à se peigner, à s’asseoir et céder sa place à des femmes dont le sans-gêne ose des déshabillages qu’aucun homme ne se croirait permis ; je m’appuie de nouveau contre une croisée, je regarde les plaines qui se chevauchent et détalent des deux côtés du train, et j’abaisse un peu la vitre, car l’odeur du wagon se désordonne.
C’est un bouquet concentré où il entre de l’air malade et de la parfumerie morte ; c’est aussi un extrait salé par de l’alcali, chauffé par de la grasse fumée de houille.
J’ai la paume des mains qui fourmille, les yeux arides, la bouche cuivrée, la langue sèche ; mes cheveux sont poicrés de cambouis ; je mouche des choses sombres ; j’ai beau me curer les ongles, ils demeurent quand même noirs, car ils sont embrenés d’une sorte de poix qui s’étale et pénètre dans la peau, dès qu’on y touche. Ma hâte d’arriver, de me laver à grande eau, de mettre enfin le pied sur un sol qui soit immobile et ferme attise encore la fièvre que les abois de l’insomnie allument ; maintenant, tous les voyageurs consultent leurs montres, bivaquent dans le corridor encombré de malles.
Ma cabine s’ouvre et les femmes qui l’occupèrent si délibérément s’avancent. Ce sont deux locatis dont la lointaine enfance fut peut-être fraîche, mais, à cette heure, dans la surprise d’un réveil dénué de réparatrices lotions et de secourables pâtes, elles surgissent comme de vieilles farceuses dont les fanons balochent ; elles jabotent, se mutinent, s’évaporent, s’apprêtent à devenir insupportables quand le train se ralentit et siffle.
Ah ! ce que je rêve de ne plus voir la tête de mes voisins et ce que je souhaite de ne plus désormais subir l’indigent confort, le gala de camelote du wagon-lit ! Enfin, le convoi s’arrête. Il est huit heures, nous sommes à Cologne ! des voix clament dans des fonds enroués de gorge : Kœhn ! Kœhn !
Alors le couloir grouille et dans la bousculade des colis, je descends, courbé sous l’œil stratégique du gardien qui tente de m’extirper encore d’exubérants pourboires.