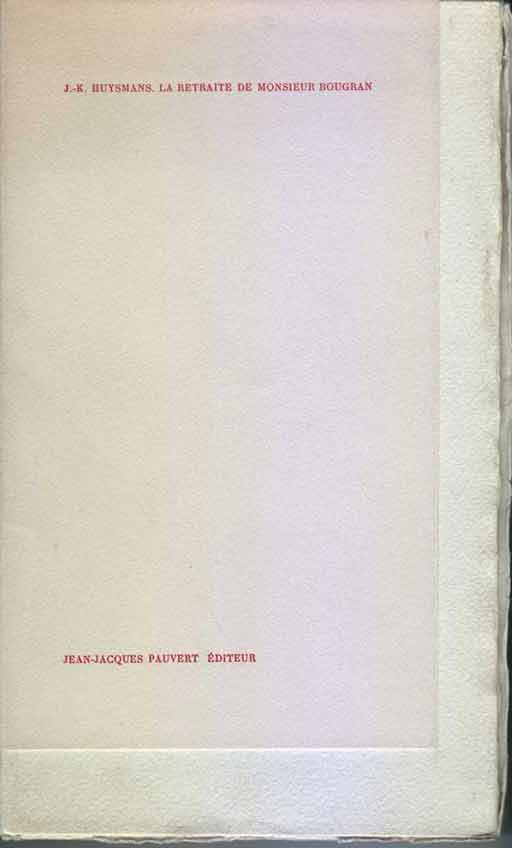M. Bougran regardait accablé les fleurs inexactes du tapis.
— Oui, poursuivit, d’un ton paterne, le chef de bureau M. Devin, oui, mon cher collaborateur, je vous ai très énergiquement défendu, j’ai tâché de faire revenir le bureau du Personnel sur sa décision, mes efforts ont échoué; vous êtes, partir du mois prochain, mis la retraite pour infirmités résultant de l’exercice de vos fonctions.
— Mais je n’ai pas d’infirmités, je suis valide!
— Sans doute, mais je n’apprendrai rien à un homme qui possède aussi bien que vous la législation sur cette matière; la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles permet, vous le savez... cette interprétation; le décrets du 9 novembre de la même année, qui porte règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi, dispose dans l’un de ses articles... — L’article 30, soupira M. Bougran.
— ... J’allais le dire... que les employés de l’État pourront être mis à la retraite, avant l’âge, pour cause d’invalidité morale, inappréciable aux hommes de l’art.
M.Bougran n’écoutait plus. D’un oeil de bête assommée il scrutait ce cabinet de chef de bureau où il pénétrait d’habitude sur la pointe des pieds, comme dans une chapelle, avec respect. Cette pièce sèche et froide, mais familière, lui semblait devenue soudain maussade et bouffie, hostile, avec son papier d’un vert mat à raies veloutées, ses bibliothèques vitrées peintes en chêne et pleines de bulletins des lois, de "recueils des actes administratifs," conservés dans ces reliures spéciales aux Ministères, des reliures en veau jaspé, avec plats en papier couleur bois et tranches jaunes, sa cheminée ornée d’une pendule-borne, de deux flambeaux Empire, son canapé de crin, son tapis à roses en formes de choux, sa table en acajou encombrée de paperasses et de livres et sur laquelle posait un macaron hérissé d’amandes pour sonner les gens, ses fauteuils aux ressorts chagrins, son siège de bureau à la canne creusée aux bras, par l’usage, en demi-lune.
Ennuyé de cette scène, M. Devin se leva et se posa, le dos contre la cheminée, dont il éventa, avec les basques de son habit, les cendres.
M. Bougran revint à lui et, d’une voix éteinte, demanda:
— Mon successeur est-il désigné, afin que je puisse le mettre au courant, avant mon départ?
— Pas que je sache; je vous serai donc obligé de continuer jusqu’à nouvel ordre votre service.
Et, pour hâter le départ, M. Devin quitta la cheminée, s’avança doucement vers son employé qui recula vers la porte; là, M. Devin l’assura de ses profonds regrets, de sa parfaite estime.
M. Bougran rentra dans sa pièce et s’affaissa, anéanti, sur une chaise. Puis il eut l’impression d’un homme qu’on étrangle; il mit son chapeau et sortit pour respirer un peu d’air. Il marchait dans les rues, et, sans même savoir où il était, il finit par échouer sur un banc, dans un square.
Ainsi, c’était vrai; il était mis à la retraite à cinquante ans! lui qui s’était dévoué jusqu’à sacrifier ses dimanches, ses jours de fête pour que le travail dont il était chargé ne se ralentît point. Et voilà la reconnaissance qu’on avait de son zèle! Il eut un moment de colère, rêva d’intenter un recours devant le Conseil d’État, puis, dégrisé, se dit: je perdrai ma cause et cela me coûtera cher. Lentement, posément, il repassa dans sa tête les articles de cette loi; il scrutait les routes de cette prose, tâtait ses passerelles jetées entre chaque article; au premier abord ces voies semblaient sans danger, bien éclairées et droites, puis, peu à peu, elles se ramifiaient, aboutissaient à des tournants obscurs, à de noires impasses où l’on se cassait subitement les reins.
Oui, le législateur de 1853 a partout ouvert dans un texte indulgent des chausse-trapes; il a tout prévu, conclut-il; le cas de la suppression d’emploi qui est un des plus usités pour se débarrasser des gens; on supprime l’emploi du titulaire, puis on rétablit l’emploi quelques jours après, sous un autre nom, et le tour est joué. Il y a encore les infirmités physiques contractées dans l’exercice des fonctions et vérifiées par la complaisance pressée des médecins; il y a, enfin — le mode le plus simple, en somme — la soi-disant invalidité morale, pour laquelle il n’est besoin de recourir à aucun praticien, puisqu’un simple rapport, signé par votre Directeur et approuvé par la Direction du Personnel, suffit.
C’est le système le plus humiliant. Être déclaré gâteux! c’est un peu fort, gémissait M. Bougran.
Puis il réfléchissait. Le Ministre avait sans doute un favori à placer, car les employés ayant réellement droit à leur retraite se faisaient rares. Depuis des années, l’on avait pratiqué de larges coupes dans les bureaux, renouvelant tout un vieux personnel dont il était l’un des derniers débris. Et M. Bougran hochait la tête.
De mon temps, disait-il, nous étions consciencieux et remplis de zèle: maintenant tous ces petits jeunes gens, recrutés on ne sait où, n’ont plus la foi. Ils ne creusent aucune affaire, n’étudient à fond aucun texte. Ils ne songent qu’à s’échapper du bureau, bâclent leur travail, n’ont aucun souci de cette langue administrative que les anciens maniaient avec tant d’aisance; tous écrivent comme s’ils écrivaient leurs propres lettres!
Les chefs mêmes, racolés pour la plupart au dehors, laissés pour compte par des séries de Ministres tombés du pouvoir, n’ont plus cette tenue, tout à la fois amicale et hautaine, qui les distinguait autrefois des gens du commun; et, oubliant sa propre mésaventure, en une respectueuse vision, il évoqua l’un de ses anciens chefs M. Desrots des Bois, serré dans sa redingote, la boutonnière couverte, comme par le disque d’arrêt des trains, par un énorme rond rouge, le cràne chauve ceint d’un duvet de poule, aux tempes, descendant droit, sans regarder personne, un portefeuille sous le bras, chez le Directeur.
Toutes les têtes s’inclinaient sur son passage. Les employés pouvaient croire que l’importance de cet homme rejaillissait sur eux et ils se découvraient, pour eux-mêmes, plus d’estime.
Dans ce temps-là, tout était à l’avenant, les nuances, maintenant disparues, existaient. Dans les lettres administratives, l’on écrivait en parlant des pétitionnaires: "Monsieur", pour une personne tenant dans la société un rang honorable, "le sieur" pour un homme de moindre marque, "le nommé" pour les artisans et les forçats. Et quelle ingéniosité pour varier le vocabulaire, pour ne pas répéter les mêmes mots; on désignait tour à tour le pétitionnaire "le postulant", "le suppliant", "l’impétrant", "le requérant". Le Préfet devenait, à un autre membre de phrase, "ce haut fonctionnaire"; la personne dont le nom motivait la lettre se changeait en "cet individu", en "le prénommé", en "le susnommé"; parlant d’elle-même l’administration se qualifiait tantôt de "centrale" et tantôt de "supérieure", usait sans mesure des synonymes, ajoutait, pour annoncer l’envoi d’une pièce, des "ci-joints, des ci-inclus, des sous ce pli". Partout s’épandaient les protocoles; les salutations de fins de lettres variaient à l’infini, se dosaient à de justes poids, parcouraient une gamme qui exigeait, des pianistes de bureau, un doigté rare. Ici, s’adressant au sommet des hiérarchies, c’était l’assurance "de la haute considération", puis la considération baissait, de plusieurs crans, devenait, pour les gens n’ayant pas rang de Ministre, "la plus distinguée, la très distinguée, la distinguée, la parfaite", pour aboutir à la considération sans épithète, à celle qui se niait elle-même, car elle représentait simplement le comble du mépris.
Quel employé savait maintenant manipuler ce délicat clavier des fins de lettres, choisir ces révérences très difficiles à tirer souvent, alors qu’il s’agissait de répondre à des gens dont la situation n’avait pas été prévue par les dogmes imparfaitement imposés des protocoles! Hélas! les expéditionnaires avaient perdu le sens des formules, ignoraient le jeu habile du compte-gouttes! — et! qu’importait au fond — puisque tout se délitait, tout s’effondrait depuis des ans. Le temps des abominations démocratiques était venu et le titre d’Excellence que les Ministres échangeaient autrefois entre eux avait disparu. L’on s’écrivait d’un Ministère à l’autre, de pair à compagnon, comme des négociants et des bourgeois. Les faveurs mêmes, ces rubans en soie verte ou bleue ou tricolore, qui attachaient les lettres alors qu’elles se composaient de plus de deux feuilles, étaient remplacées par de la ficelle rose, à cinq sous la pelote!
Quelle platitude et quelle déchéance! Je me sentais bien mal à l’aise dans ces milieux sans dignité authentique et sans tenue, mais... mais... de là, à vouloir les quitter... et, soupirant, M. Bougran revint à sa propre situation, à lui-même.
Mentalement, il supputait la retraite proportionnelle à laquelle il aurait droit dix-huit cents francs au plus; avec les petites rentes qu’il tenait de son père, c’était tout juste de quoi vivre. Il est vrai, se dit-il, que ma vieille bonne Eulalie et moi, nous vivons de rien.
Mais, bien plus que la question des ressources personnelles, la question du temps à tuer l’inquiéta. Comment rompre, du jour au lendemain, avec cette habitude d’un bureau vous enfermant dans une pièce toujours la même, pendant d’identiques heures, avec cette coutume d’une conversation échangée, chaque matin, entre Collègues. Sans doute, ces entretiens étaient peu variés; ils roulaient tous sur le plus ou moins d’avancement qu’on pouvait attendre à la fin de l’année, supputaient de probables retraites, escomptaient même de possibles morts, supposaient d’illusoires gratifications, ne déviaient de ces sujets passionnants que pour s’étendre en d’interminables réflexions sur les événements relatés par le journal. Mais ce manque même d’imprévu était en si parfait accord avec la monotonie des visages, la platitude des plaisanteries, l’uniformité même des pièces!
Puis n’y avait-il pas d’intéressantes discussions dans le bureau du Chef ou du Sous-Chef, sur la marche à imprimer à telle affaire; par quoi remplacer désormais ces joutes juridiques, ces apparents litiges, ces gais accords, ces heureuses noises; comment se distraire d’un métier qui vous prenait aux moelles, vous possédait, tout entier, à fond?
Et M. Bougran secouait désespérément la tête, se disant : je suis seul, célibataire, sans parents, sans amis, sans camarades; je n’ai aucune aptitude pour entreprendre des besognes autres que celles qui, pendant vingt ans, me tinrent. Je suis trop vieux pour recommencer une nouvelle vie. Cette constatation le terrifia.
Voyons, reprit-il, en se levant, il faut pourtant que je retourne à mon bureau! — ses jambes vacillaient. Je ne me sens pas bien, si j’allais me coucher. Il se força à marcher, résolu à mourir, s’il le fallait, sur la brèche. Il rejoignit le Ministère et rentra dans sa pièce.
Là, il faillit s’évanouir et pour tout de bon. Il regardait, ahuri, les larmes aux yeux, cette coque qui l’avait, pendant tant d’années, couvert; — quand, doucement, ses Collègues, à la queue leu leu, entrèrent.
Ils avaient guetté la rentrée et les condoléances variaient avec les têtes. Le commis d’ordre, un grand secot, à tête de marabout, peluchée de quelques poils incolores sur l’occiput, lui secoua vivement les mains, sans dire mot; il se comportait envers lui comme envers la famille d’un défunt, à la sortie de l’église, devant le corps, après l’absoute. Les expéditionnaires hochaient la tête, témoignaient de leur douleur officielle, en s’inclinant.
Les rédacteurs, ses Collègues, plus intimes avec lui, esquissèrent quelques propos de réconfort.
— Voyons, il faut se faire une raison — et puis, mon cher, songez qu’en somme, vous n’avez ni femme, ni enfants, que vous pourriez être mis à la retraite dans des conditions infiniment plus dures, en ayant, comme moi, par exemple, une fille à marier. Estimez-vous donc aussi heureux qu’on peut être en pareil cas.
— Il convient aussi d’envisager dans toute affaire le côté agréable qu’elle peut présenter, fit un autre. Vous allez être libre de vous promener, vous pourrez manger au soleil vos petites rentes.
— Et aller vivre à la campagne où vous serez comme un coq en pate, ajouta un troisième.
M. Bougran fit doucement observer qu’il était originaire de Paris, qu’il ne connaissait personne en province, qu’il ne se sentait pas le courage de s’exiler, sous prétexte d’économies à réaliser, dans un trou; tous n’en persistèrent pas moins à lui démontrer qu’en fin de compte, il n’était pas bien à plaindre.
Et comme aucun d’eux n’était menacé par son âge d’un semblable sort, ils exhibaient une résignation de bon aloi, s’indignaient presque de la tristesse de M. Bougran.
L’exemple de la réelle sympathie et du véridique regret, ce fut Baptiste, le garçon de bureau, qui le servit; l’air onctueux et consterné, il s’offrit à porter lui-même chez M. Bougran les petites affaires, telles que vieux paletot, plumes, crayons, etc., que celui-ci possédait à son bureau, laissa entendre que ce serait ainsi la dernière occasion que M. Bougran aurait de lui donner un bon pourboire.
— Allons, Messieurs, fit le Chef qui entra dans la pièce. Le Directeur demande le portefeuille pour 5 heures.
Tous se dispersèrent; et, hennissant comme un vieux cheval, M. Bougran se mit au travail, ne connaissant plus que la consigne, se dépêchant à rattraper le temps qu’il avait, dans ses douloureuses rêveries sur un banc, perdu.
II
Les premiers jours furent lamentables. Réveillé, à la même heure que jadis, il se disait à quoi bon se lever, traînait contrairement à ses habitudes dans son lit, prenait froid, bâillait, finissait par s’habiller. Mais à quoi s’occuper, Seigneur! Après de mûres délibérations, il se décidait à aller se promener, à errer dans le jardin du Luxembourg qui n’était pas éloigné de la rue de Vaugirard où il habitait.
Mais ces pelouses soigneusement peignées, sans tache de terre ni d’eau, comme repeintes et vernies, chaque matin, dès l’aube ; ces fleurs remontées comme à neuf sur les fils de fer de leurs tiges; ces arbres gros comme des cannes, toute cette fausse campagne, plantée de statues imbéciles, ne l’égayait guère. Il allait se réfugier au fond du jardin, dans l’ancienne pépinière sur laquelle maintenant tombaient les solennelles ombres des constructions de l’Ecole de Pharmacie et du Lycée Louis-le-Grand. La verdure n’y était ni moins apprêtée, ni moins étique. Les gazons y étalaient leurs cheveux coupés ras et verts, les petits arbres y balançaient les plumeaux ennuyés de leurs têtes, mais la torture infligée, dans certaines plates-bandes, aux arbres fruitiers l’arrêtait. Ces arbres n’avaient plus forme d’arbres. On les écartelait le long de tringles, on les faisait ramper le long de fils de fer sur le sol; on leur déviait les membres dès leur naissance et l’on obtenait ainsi des végétations acrobates et des troncs désarticulés, comme en caoutchouc. Ils couraient, serpentaient ainsi que des couleuvres, s’évasaient en forme de corbeilles, simulaient des ruches d’abeilles, des pyramides, des éventails, des vases à fleurs, des toupets de clown. C’était une vraie cave des tortures végétales que ce jardin où, à l’aide de chevalets, de brodequins d’osier ou de fonte, d’appareils en paille, de corsets orthopédiques, des jardiniers herniaires tentaient, non de redresser des tailles déviées comme chez les bandagistes de la race humaine, mais au contraire de les contourner et de les disloquer et de les tordre, suivant un probable idéal japonais de monstres!
Mais quand il avait bien admiré cette façon d’assassiner les arbres, sous le prétexte de leur extirper de meilleurs fruits, il traînait, désoeuvré, sans même s’être aperçu que cette chirurgie potagère présentait le plus parfait symbole avec l’administration telle qu’il l’avait pratiquée pendant des ans. Dans les bureaux, comme dans le jardin du Luxembourg, l’on s’ingéniait à démantibuler des choses simples; l’on prenait un texte de droit administratif dont le sens était limpide, net, et aussitôt, à l’aide de circulaires troubles, à l’aide de précédents sans analogie, et de jurisprudences remontant au temps des Messidors et des Ventôses, l’on faisait de ce texte un embrouillamini, une littérature de Magot, aux phrases grimaçantes, rendant les arrêts les plus opposés à ceux que l’on pouvait prévoir.
Puis, il remontait, allait sur la terrasse du Luxembourg où les arbres semblent moins jeunes, moins fraîchement époussetés, plus vrais. Et il passait entre les chaises, regardant les gamins faire des pâtés avec du sable et de petits seaux, tandis que leurs mères causaient, coude à coude, échangeant d’actives réflexions sur la façon d’apprêter le veau et d’accommoder, pour le déjeuner du matin, les restes.
Et il rentrait, harassé, chez lui, remontait, bâillait, se faisait rabrouer par sa servante Eulalie, qui se plaignait qu’il devînt "bassin", qu’il se crût le droit de venir "trôler" dans sa cuisine.
Bientôt l’insomnie s’en mêla; arraché à ses habitudes, transporté dans une atmosphère d’oisiveté lourde, le corps fonctionnait mal; l’appétit était perdu; les nuits jadis si bonnes sous les couvertures s’agitèrent et s’assombrirent, alors que, dans le silence noir, tombaient, au loin, les heures.
Il s’avisa de lire, dans la journée, quand il plut, et alors, fatigué de ses insomnies, il s’endormit; et la nuit qui suivait ces somnolences devenait plus longue, plus éveillée, encore. Il dut, quand le temps se gâta, se promener quand même, pour se lasser les membres et il échoua dans les musées, — mais aucun tableau ne l’intéressait; il ne connaissait aucune toile, aucun maître, ambulait lentement, les mains derrière le dos, devant les cadres, s’occupant des gardiens, assoupis sur les banquettes, supputant la retraite qu’eux aussi, en leur qualité d’employés de l’État, ils auraient un jour.
Il se promena, las de couleurs et de statues blanches, dans les passages de Paris, mais il en fut rapidement chassé; on l’observait; les mots de mouchard, de roussin, de vieux poirot, s’entendirent. Honteux il fuyait sous l’averse et retournait se cantonner dans son chez lui.
Et plus poignant que jamais, le souvenir de son bureau l’obséda. Vu de loin, le Ministère lui apparaissait tel qu’un lieu de délices. Il ne se rappelait plus les iniquités subies, son sous-chèfat dérobé par un inconnu entré à la suite d’un Ministre, l’ennui d’un travail mécanique, forcé; tout l’envers de cette existence de cul-de-jatte s’était évanoui; la vision demeurait, seule, d’une vie bien assise, douillette, tiède, égayée par des propos de Collègues, par de pauvres plaisanteries, par de minables farces.
Décidément, il faut aviser, se dit mélancoliquement M.Bougran. Il songea, pendant quelques heures, à chercher une nouvelle place qui l’occuperait et lui ferait même gagner un peu d’argent; mais, même en admettant qu’on consentît à prendre dans un magasin un homme de son âge, alors il devrait trimer, du matin au soir et il n’aurait que des appointements ridicules puisqu’il était incapable de rendre de sérieux services, dans un métier dont il ignorait les secrets et les ressources.
Et puis ce serait déchoir! — Comme beaucoup d’employés du Gouvernement, M. Bougran se croyait, en effet, d’une caste supérieure et méprisait les employés des commerces et des banques. II admettait même des hiérarchies parmi ses congénères, jugeait l’employé d’un Ministère supérieur à l’employé d’une Préfecture, de même que celui-ci était, à ses yeux, d’un rang plus élevé que le commis employé dans une Mairie.
Alors, que devenir? que faire? et cette éternelle interrogation restait sans réponse.
De guerre lasse, il retourna à son bureau, sous le prétexte de revoir ses Collègues, mais il fut reçu par eux comme sont reçus les gens qui ne font plus partie d’un groupe — froidement. L’on s’inquiéta d’une façon indifférente de sa santé; d’aucuns feignirent de l’envier, vantèrent la liberté dont il jouissait, les promenades qu’il devait aimer à faire.
M. Bougran souriait, le coeur gros. Un dernier coup lui fut inconsciemment porté. Il eut la faiblesse de se laisser entraîner dans son ancienne pièce; il vit l’employé qui le remplaçait, un tout jeune homme! Une colère le prit contre ce successeur parce qu’il avait changé l’aspect de cette pièce qu’il aimait, déplacé le bureau, poussé les chaises dans un autre coin, mis les cartons dans d’autres cases; l’encrier était à gauche maintenant et le plumier à droite!
Il s’en fut navré. — En route, soudain, une idée germa qui grandit en lui. — Ah! fit-il, je suis sauvé peut-être, et sa joie fut telle qu’il mangea, en rentrant, de bon appétit, ce soir-là, dormit comme une taupe, se réveilla, guilleret, dès l’aube.
III
Ce projet qui l’avait ragaillardi était facile à réaliser. D’abord M. Bougran courut chez les marchands de papiers de tentures, acquit quelques rouleaux d’un infâme papier couleur de chicorée au lait qu’il fit apposer sur les murs de la plus petite de ses pièces; puis, il acheta un bureau en sapin peint en noir, surmonté de casiers, une petite table sur laquelle il posa une cuvette ébréchée et un savon à la guimauve dans un vieux verre, un fauteuil canné, en hémicycle, deux chaises. Il fit mettre contre les murailles des casiers de bois blanc qu’il remplit de cartons verts à poignées de cuivre, piqua avec une épingle un calendrier le long de la cheminée dont il fit enlever la glace et sur la tablette de laquelle il entassa des boîtes à fiches, jeta un paillasson, une corbeille sous son bureau et, se reculant un peu, s’écria ravi : « M’y voilà, j’y suis ! »
Sur son bureau, il rangea, dans un ordre méthodique, toute la série de ses porte-plume et de ses crayons, porte-plume en forme de massue, en liège, porte-plume à cuirasses de cuivre emmanchés dans un bâton de palissandre, sentant bon quand on le mâche, crayons noirs, bleus, rouges, pour les annotations et les renvois. Puis il disposa, comme jadis, un encrier en porcelaine, cerclé d’éponges, à la droite de son sous-main, une sébille remplie de sciure de bois à sa gauche; en face, une grimace contenant sous son couvercle de velours vert, hérissé d’épingles, des pains à cacheter et de la ficelle rose. Des dossiers de papier jaunâtre un peu partout; au-dessus des casiers, les livres nécessaires: Le Dictionnaire d’Administration de Bloch, Le Code et les Lois usuelles, le Béquet, le Blanche; il se trouvait, sans avoir bougé de place, revenu devant son ancien bureau, dans son ancienne pièce.
Il s’assit, radieux, et dès lors revécut les jours d’antan. Il sortait, le matin, comme jadis, et d’un pas actif, ainsi qu’un homme qui veut arriver à l’heure, il filait le long du boulevard Saint-Germain, s’arrêtait à moitié chemin de son ancien bureau, revenait sur ses pas, rentrait chez lui, tirant dans l’escalier sa montre pour vérifier l’heure, et il enlevait la rondelle de carton qui couvrait son encrier, retirait ses manchettes, y substituait des manchettes en gros papier bulle, le papier qui sert à couvrir les dossiers, changeait son habit propre contre la vieille redingote qu’il portait au Ministère, et au travail!
Il s’inventait des questions à traiter, s’adressait des pétitions, répondait, faisait ce qu’on appelle "l’enregistrement", en écrivant sur un gros livre la date des arrivées et des départs. Et, la séance de bureau close, il flânait comme autrefois une heure dans les rues avant que de rentrer pour dîner.
Il eut la chance, les premiers temps, de s’inventer une question analogue à celles qu’il aimait à traiter jadis, mais plus embrouillée, plus chimérique, plus follement niaise. Il peina durement, chercha dans les arrêts du Conseil d’État et de la Cour de Cassation ces arrêts qu’on y trouve, au choix, pour défendre ou soutenir telle ou telle cause. Heureux de patauger dans les chinoiseries juridiques, de tenter d’assortir à sa thèse les ridicules jurisprudences qu’on manie dans tous les sens, il suait sur son papier, recommençant plusieurs fois ses minutes ou ses brouillons, les corrigeant dans la marge laissée blanche sur le papier, comme le faisait son Chef, jadis, n’arrivant pas, malgré tout, à se satisfaire, mâchant son porte-plume, se tapant sur le front, étouffant, ouvrant la croisée pour humer de l’air.
Il vécut, pendant un mois, de la sorte; puis un malaise d’âme le prit. Il travaillait jusqu’à 5 heures, mais il se sentait harassé, mécontent de lui-même, distrait de pensées, incapable de s’abstraire, de ne plus songer qu’à ses dossiers. Au fond, il sentait maintenant la comédie qu’il se jouait; il avait bien restitué le milieu de l’ancien bureau, la pièce même. Il la laissait, au besoin, fermée pour qu’elle exhalât cette odeur de poussière et d’encre sèche qui émane des chambres des Ministères, mais le bruit, la conversation, les allées et venues de ses Collègues manquaient. Pas une âme à qui parler. Ce bureau solitaire n’était pas, en somme, un vrai bureau. Il avait beau avoir repris toutes ses habitudes, ce n’était plus cela. — Ah! il aurait donné beaucoup pour pouvoir sonner et voir le garçon de bureau entrer et faire, pendant quelques minutes, la causette.
Et puis... et puis... d’autres trous se creusaient dans le sol factice de cette vie molle; le matin, alors qu’il dépouillait le courrier qu’il s’envoyait la veille, il savait ce que contenaient les enveloppes; il reconnaissait son écriture, le format de l’enveloppe dans laquelle il avait enfermé telle ou telle affaire, et cela lui enlevait toute illusion! Il eut au moins fallu qu’une autre personne fît les suscriptions et usât d’enveloppes qu’il ne connaîtrait point!
Le découragement le prit; il s’ennuya tellement qu’il se donna un congé de quelques jours et erra par les rues.
— Monsieur a mauvaise mine, disait Eulalie en regardant son maître. Et, les mains dans les poches de son tablier, elle ajoutait je comprends vraiment pas qu’on se donne tant de mal à travailler, quand ça ne rapporte aucun argent!
Il soupirait et, quand elle sortait, se contemplait dans la glace. C’était pourtant vrai qu’il avait mauvaise mine et comme il était vieilli ! Ses yeux d’un bleu étonné, dolent, ses yeux toujours écarquillés, grand ouverts, se ridaient et les pinceaux de ses sourcils devenaient blancs. Son crâne se dénudait, ses favoris étaient tout gris, sa bouche même soigneusement rasée rentrait sous le menton en vedette; enfin son petit corps boulot dégonflait, les épaules arquaient, ses vêtements semblaient élargis et plus vieux. Il se voyait ruiné, caduc, écrasé par cet âge de cinquante ans qu’il supportait si allègrement, tant qu’il travaillait dans un vrai bureau.
— Monsieur devrait se purger, reprenait Eulalie quand elle le revoyait. Monsieur s’ennuie, pourquoi donc qu’il irait pas à la pêche; il nous rapporterait une friture de Seine, ça le distraierait.
M. Bougran secouait doucement la tête, et sortait.
Un jour que le hasard d’une promenade l’avait conduit, sans même qu’il s’en fût aperçu, au Jardin des Plantes, son regard fut tout à coup attiré par un mouvement de bras passant près de sa face. Il s’arrêta, se récupéra, vit l’un de ses anciens garçons de bureau qui le saluait.
Il eut un éclair; presqu’un cri de joie.
— Huriot, dit-il. L’autre se retourna, enleva sa casquette, mit une pipe qu’il tenait à la main au port d’armes.
— Eh bien, mon ami, voyons, que devenez-vous?
— Mais rien, Monsieur Bougran, je bricole, par ci, par là, pour gagner quelques sous en plus de ma retraite; mais, sauf votre respect, je foutimasse, car je suis bien plus bon à grand-chose, depuis que mes jambes, elles ne vont plus!
— Écoutez, Huriot, avez-vous encore une de vos tenues de garçon de bureau du Ministère?
— Mais, Monsieur, oui, j’en ai une vieille que j’use chez moi pour épargner mes vêtements quand je sors.
— Ah!
M. Bougran était plongé dans une méditation délicieuse. Le prendre à son service, en habit de bureau, chez lui. Tous les quarts d’heure, il entrerait comme autrefois dans sa pièce en apportant des papiers. Et puis, il pourrait faire le départ, écrire l’adresse sur les enveloppes. Ce serait peut-être le bureau enfin!
— Mon garçon, voici, écoutez-moi bien, reprit M. Bougran. Je vous donne cinquante francs par mois pour venir chez moi, absolument, vous entendez, absolument comme au bureau. Vous aurez en moins les escaliers à monter et à descendre; mais vous allez raser votre barbe et porter comme jadis des favoris et remettre votre costume. Cela vous va-t-il?
— Si ça me va! — et, en hésitant, il cligna de l’oeil; vous allez donc monter un établissement, quelque chose comme une banque, M. Bougran?
— Non, c’est autre chose que je vous expliquerai quand le moment sera venu; en attendant voici mon adresse. Arrangez-vous comme vous pourrez, mais venez chez moi, demain, commencer votre travail.
Et il le quitta et galopa, tout rajeuni, jusque chez lui.
— Bien, voilà comme Monsieur devrait être, tous les jours, dit Eulalie qui l’observait et se demandait quel évènement avait pu surgir dans cette vie plate.
Il avait besoin de se débonder, d’exhaler sa joie, de parler. Il raconta à la bonne sa rencontre, puis il demeura inquiet et coi devant le regard sévère de cette femme.
— Alors qu’il viendrait, ce Monsieur, pour rien faire, comme ça manger votre argent, dit-elle, d’un ton sec!
— Mais non, mais non, Eulalie, il aura sa tâche, et puis c’est un brave homme, un vieux serviteur bien au courant de son service.
— La belle avance! tiens pour cinquante francs il serait là à se tourner les pouces, alors que moi qui fais le ménage, qui fais la cuisine, moi qui vous soigne, je ne touche que quarante francs par mois. — C’est trop fort, à la fin des fins! — non, Monsieur Bougran, ça ne peut pas s’arranger comme cela; prenez ce vieux bureau d’homme et faites-vous frotter vos rhumatismes avec de la flanelle et de ce baume qui pue la peinture, moi, je m’en vais; c’est pas à mon âge qu’on supporte des traitements pareils!
M. Bougran la regardait atterré.
— Voyons, ma bonne Eulalie, il ne faut pas vous fâcher ainsi, voyons, je vais si vous le voulez augmenter un petit peu vos gages...
— Mes gages! oh ce n’est pas pour ces cinquante francs que vous m’offrez maintenant par mois, que je me déciderais à rester; c’est à cause de la manière dont vous agissez avec moi que je veux partir!
M. Bougran se fit la réflexion qu’il ne lui avait pas du tout offert des gages de cinquante francs, son intention étant simplement de l’augmenter de cinq francs par mois; mais devant la figure irritée de la vieille qui déclarait que, malgré tout, elle allait partir, il courba la tête et fit des excuses, essayant de l’amadouer par des gracieusetés et d’obtenir d’elle qu’elle ne fît pas, comme elle l’en menaçait, ses malles.
— Et où que vous le mettrez, pas dans ma cuisine toujours? demanda Eulalie qui, ayant acquis ce qu’elle voulait, consentit à se détendre.
— Non, dans l’antichambre; vous n’aurez ni à vous en occuper, ni à le voir; vous voyez bien, ma fille, qu’il n’y avait pas de quoi vous emporter comme vous l’avez fait!
— Je m’emporte comme je veux et je ne l’envoie pas dire, cria-t-elle, remontant sur ses ergots, décidée à rester, mais à mâter ces semblants de reproches.
Harassé, M. Bougran n’osa plus la regarder quand elle sortit, d’un air insolent et fier, de la pièce.
IV
— Le courrier n’est pas bien fort, ce matin!
— Non, Huriot, nous nous relâchons; j’ai eu une grosse affaire à traiter, hier, et comme je suis seul, j’ai dû délaisser les questions moins importantes et le service en souffre!
— Nous mollissons, comme disait ce pauvre Monsieur de Pinaudel. Monsieur l’a connu?
— Oui, mon garçon. Ah! c’était un homme bien capable. Il n’avait pas son pareil pour rédiger une lettre délicate. Encore un honnête serviteur, qu’on a mis, comme moi, à la retraite, avant l’âge!
— Aussi, faut voir leur administration maintenant, des petits jeunes gens qui songent à leur plaisir, qui n’ont que la tête à ça. Ah! Monsieur Bougran, les bureaux baissent!
M. Bougran eut un soupir. Puis, d’un signe, il congédia le garçon et se remit, au travail.
Ah ! cette langue administrative qu’il fallait soigner! Ces "exciper de", ces "En réponse à la lettre que vous avez bien voulu m’adresser, j’ai l’honneur de vous faire connaître que", ces "Conformément à l’avis exprimé dans votre dépêche relative à...". Ces phraséologies coutumières "l’esprit sinon le texte de la loi", "sans méconnaître l’importance des considérations que vous invoquez à l’appui de cette thèse...". Enfin ces formules destinées au Ministère de la Justice où l’on parlait de "l’avis émané de sa Chancellerie", toutes ces phrases évasives et atténuées, les "j’inclinerais à croire", les "il ne vous échappera pas", les "j’attacherais du prix à", tout ce vocabulaire de tournures remontant au temps de Colbert, donnait un terrible tintouin à M. Bougran.
La tête entre ses poings, il relisait les premières phrases dont il achevait le brouillon. Il était actuellement occupé aux exercices de haute école, plongé dans le pourvoi au Conseil d’État.
Et il ânonnait l’inévitable formule du commencement:
"Monsieur le Président,
La Section du Contentieux m’a transmis, à fins d’avis, un recours formé devant le Conseil d’État par M. un tel, à l’effet de faire annuler pour excès de pouvoirs ma décision en date du..."
Et la seconde phrase:
"Avant d’aborder la discussion des arguments que le pétitionnaire fait valoir à l’appui de sa cause, je rappellerai sommairement les faits qui motivent le présent recours."
C’est ici que cela devenait difficile. — Il faudrait envelopper cela, ne pas trop s’avancer, murmurait M. Bougran. La réclamation de M. un tel est en droit fondée. Il s’agit de sortir habilement de ce litige, de ruser, de négliger certains points. En somme, j’ai, aux termes de la loi, quarante jours pour répondre, je vais y songer, cuire cela dans ma tête, ne pas défendre le Ministère à l’aveuglette...
— Voici encore du courrier qui arrive, dit Huriot en apportant deux lettres.
— Encore! — ah la journée est dure! comment, il est déjà 4 heures. — C’est étonnant tout de même, se dit-il, en humant une prise d’air quand le garçon fut sorti, comme ce Huriot pue et l’ail et le vin! — Tout comme au bureau, ajouta-t-il, satisfait. Et de la poussière partout, jamais il ne balaye toujours comme au bureau. — Est-ce assez nature!
Ce qui était bien nature aussi, mais dont il ne s’apercevait guère, c’était l’antagonisme croissant d’Eulalie et d’Huriot. Encore qu’elle eût obtenu ses cinquante francs par mois, la bonne ne pouvait s’habituer à ce pochard qui était cependant serviable et doux et dormait, dans l’antichambre, sur une chaise, en attendant que l’employé le sonnât.
— Feignant, disait-elle, en remuant ses casseroles et ses cuivres; quand on pense que ce vieux bureau ronfle toute la journée, sans rien faire!
Et pour témoigner son mécontentement à son maître, elle rata volontairement des sauces, n’ouvrit plus la bouche, ferma violemment les portes.
Timide, M. Bougran baissait le nez, se fermait les oreilles pour ne pas entendre les abominables engueulades qui s’échangeaient entre ses deux domestiques, sur le seuil de la cuisine; des bribes lui parvenaient cependant où, unis dans une opinion commune, Eulalie et Huriot le traitaient ensemble: de fou, de braque, de vieille bête.
Il en conçut une tristesse qui influa sur son travail. Il ne pouvait plus maintenant s’asseoir en lui-même. Alors qu’il lui eût fallu, pour rédiger ce pourvoi, réunir toute l’attention dont il était capable, il éprouvait une évagation d’esprit absolue; ses pensées se reportaient à ces scènes de ménage, à l’humeur massacrante d’Eulalie, et comme il tentait de la désarmer par l’implorante douceur de son regard moutonnier, elle se rebiffait davantage, sûre de le vaincre en frappant fort. Et lui, désespéré, restait, seul, chez lui, le soir, mâchant un exécrable dîner, n’osant se plaindre.
Ces tracas accélérèrent les infirmités de la vieillesse qui pesait maintenant sur lui; il avait le sang à la tête, étouffait après ses repas, dormait avec des sursauts atroces.
Il eut bientôt du mal à descendre les escaliers et à sortir pour aller à son bureau; mais il se roidissait, partait quand même le matin, marchait une demi-heure avant que de rentrer chez lui.
Sa pauvre tête vacillait; quand même, il s’usait sur ce pourvoi commencé et dont il ne parvenait plus à se dépêtrer. Tenacement, alors qu’il se sentait l’esprit plus libre, il piochait encore cette question fictive qu’il s’était posée.
Il la résolut enfin, mais il eut une contention de cerveau telle que son crâne chavira, dans une secousse. Il poussa un cri. Ni Huriot, ni la bonne ne se dérangèrent. Vers le soir, ils le trouvèrent tombé sur la table, la bouche bredouillante, les yeux vides. Ils amenèrent un médecin qui constata l’apoplexie et déclara que le malade était perdu.
M. Bougran mourut dans la nuit, pendant que le garçon et que la bonne s’insultaient et cherchaient réciproquement à s’éloigner pour fouiller les meubles.
Sur le bureau, dans la pièce maintenant déserte, s’étalait la feuille de papier sur laquelle M. Bougran avait, en hâte, se sentant mourir, griffonné les dernières lignes de son pourvoi:
"Pour ces motifs, je ne puis, Monsieur le Président, qu’émettre un avis défavorable sur la suite à donner au recours formé par M. un tel."