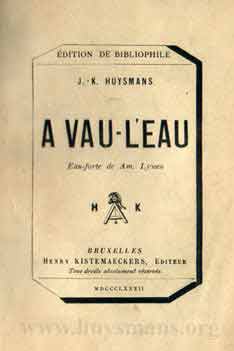Le garçon mit sa main gauche sur la hanche, appuya sa main droite sur le dos d’une chaise et il se balança sur un seul pied, en pinçant les lèvres.
— Dame, ça dépend des goûts, dit-il ; moi, à la place de monsieur, je demanderais du Roquefort.
— Eh bien, donnez-moi un Roquefort.
Et M. Jean Folantin, assis devant une table encombrée d’assiettes où se figeaient des rogatons et de bouteilles vides dont le cul estampillait d’un cachet bleu la nappe, fit la moue, ne doutant pas qu’il allait manger un désolant fromage ; son attente ne fut nullement déçue ; le garçon apporta une sorte de dentelle blanche marbrée d’indigo, évidemment découpée dans un pain de savon de Marseille.
M. Folantin chipota ce fromage, plia sa serviette, se leva, et son dos fut salué par le garçon qui ferma la porte.
Une fois dehors, M. Folantin ouvrit son parapluie et pressa le pas. Aux lames aiguës du froid vous rasant les oreilles et le nez, avaient succédé les fines lanières d’une pluie battante. L’hiver glacial et dur qui sévissait depuis trois jours sur Paris se détendait et les neiges amollies coulaient, en clapotant, sous un ciel gonflé, comme noyé d’eau.
M. Folantin galopait maintenant, songeant au feu qu’il avait allumé, chez lui, avant que d’aller se repaître dans son restaurant.
A dire vrai, il n’était pas sans craintes ; par extraordinaire, ce soir-là, la paresse l’avait empêché de réédifier, de fond en comble, le bûcher préparé par son concierge. Le coke est si difficile à prendre, songeait-il ; et il grimpa, quatre à quatre, ses escaliers, entra, et il n’aperçut, dans la cheminée, aucune flamme.
— Dire qu’il n’existe pas de femmes de ménage, pas de portiers qui sachent apprêter un feu, grogna-t-il, et il mit sa bougie sur le tapis et, sans se déshabiller, le chapeau sur la tête, il renversa la grille, l’emplit à nouveau, méthodiquement, ménageant dans sa construction des prises d’air. Il baissa la trappe, consuma des allumettes et du papier et il se dévêtit.
Soudain, il soupira, car il arrachait à sa lampe de profonds rots.
— Allons, bon, il n’y a pas d’huile ! Ah bien, en voilà une autre, c’est complet maintenant ! et il considéra, navré, la mèche qu’il venait de lever, une mèche éventée et jaune, à la couronne calcinée et tailladée de dents noires.
— Cette vie est intolérable, se dît-il, en cherchant des ciseaux ; tant-bien que mal, il répara son éclairage, puis il se jeta dans un fauteuil et s’abîma dans ses réflexions.
La joumée avait été mauvaise ; depuis le matin, il broyait du noir ; le chef du bureau où il était commis, depuis vingt ans, lui avait, sans politesse, reproché son arrivée plus tardive que de coutume.
M. Folantin s’était rebiffé et, tirant son oignon : « Onze heures juste », avait-il dit, d’un ton sec.
Le chef avait à son tour extrait de sa poche un puissant remontoir.
— Onze vingt, avait-il riposté, je vais comme la Bourse et, d’un air méprisant, il avait consenti à, excuser son employé, en s’apitoyant sur l’antique horlogerie qu’il exhibait.
M. Folantin vit, dans cette ironique manière de le disculper, une allusion à sa pauvreté et il répliqua vivement à son supérieur qui, n’acceptant plus alors les écarts séniles d’une montre, se redressa et, dans des termes comminatoires, reprocha de nouveau à M. Folantin d’être inexact.
La séance, mal commencée, avait continué d’être insupportable. Il avait fallu, sous un jour louche salissant le papier, copier d’interminables lettres, tracer de volumineux tableaux et écouter en même temps les bavardages du collègue, un petit vieux qui, les mains dans les poches, s’écoutait parler.
Celui-là récitait tout entier le journal et il l’allongeait encore par des jugements de son crû, ou bien il blâmait les formules des rédacteurs et il en citait d’autres qu’il eût été heureux de voir substituer à celles qu’il expédiait ; et il entremêlait ces observations de détails sur le mauvais état de sa santé qu’il déclarait s’améliorer un tantinet pourtant, grâce au constant usage de l’onguent populéum et aux ablutions répétées d’eau froide.
A écouter ces intéressants propos, M. Folantin finissait par se tromper ; les raies de ses états godaient et les chiffres couraient à la débandade, dans les colonnes ; il avait dû gratter des pages, surcharger des lignes, en pure perte d’ailleurs, car le chef lui avait retourné son travail, avec ordre de le refaire.
Enfin, la journée s’était terminée et, sous le ciel bas, au milieu des rafales, M. Folantin avait dû piétiner dans des parfaits de fange, dans des sorbets de neige, pour atteindre son logis et son restaurant et voilà que, pour comble, le dîner était exécrable et que le vin sentait l’encre.
Les pieds gelés, comprimés dans des bottines racornies par l’ondée et par les flaques, le crâne chauffé à blanc par le bec de gaz qui sifflait audessus de sa tête, M. Folantin avait à peine mangé et maintenant la guigne ne le lâchait point ; son feu hésitait, sa lampe charbonnait, son tabac était humide et s’éteigtiait, mouillant le papier à cigarette de jus jaune.
Un grand découragement le poigna ; le vide de sa vie murée lui apparut, et, tout en tisonnant le coke avec son poker, M. Folantin, penché en avant sur son fauteuil, le front sur le rebord de la cheminée, se mit à parcourir le chemin de ses quarante ans, s’arrêtant, désespéré, à station.
Son enfance n’avait pas été des plus prospères ; de père en fils, les Folantin étaient sans le sou, les annales de la famille signalaient bien, en remontant à des dates éloignées, un Gaspard Folantin qui avait gagné dans le commerce des cuirs presqu’un million ; mais la chronique ajoutait qu’après avoir dévoré sa fortune, il était resté insolvable ; le souvenir de cet homme était vivace chez ses descendants qui le maudissaient, le citaient à leurs fils comme un exemple à ne pas suivre et les menaçaient continuellement de mourir comme lui sur la paille, s’ils fréquentaient les cafés ou couraient les femmes.
Toujours est-il que Jean Folantin était né dans de désastreuses conditions ; le jour où la gésine de sa mère prit fin, son père possédait pour tout bien un dizain de petites pièces blanches. Une tante qui, sans être sage-femme, était experte à ce genre d’ouvrage, dépota l’enfant, le débarbouilla avec du beurre et, par économie, lui poudra les cuisses, en guise de lycopode, avec de la farine raclée sur la croûte d’un pain. — Tu vois, mon garçon, que ta naissance fut humble, disait la tante Eudore, qui l’avait mis au courant de ces petits détails, et Jean n’osait espérer déjà, pour plus tard, un certain bienêtre.
Son père décéda très jeune et la boutique de papeterie qu’il exploitait rue du Four fut vendue pour liquider les dettes nécessitées par la maladie ; la mère et l’enfant se trouvèrent sur le pavé ; Madame Folantin se plaça chez les autres et devint demoiselle de magasin, puis caissière dans une lingerie et l’enfant devint pensionnaire dans un lycée ; bien que madame Folantin fût dans une situation réellement malheureuse, elle obtint une bourse et elle se priva de tout, économisant sur ses maigres mois, afin de pouvoir parer plus tard aux frais des examens et des diplômes.
Jean se rendit compte des sacrifices que s’imposait sa mère et il travailla de son mieux, emportant tous les prix, compensant aux yeux de l’économe le mépris qu’inspirait sa situation de pauvre hère, par des succès au grand concours. C’était un garçon très intelligent et, malgré sa jeunesse, déjà rassis. A voir la misérable existence que menait sa mère, enfermée, du matin au soir, dans une cage de verre, toussant, la main devant la bouche, sur des livres, demeurant timide et douce dans l’insolent brouhaha d’un magasin plein d’acheteurs, il comprit qu’il ne fallait compter sur aucune clémence du sort, sur aucune justice de la destinée.
Aussi eut-il le bon sens de ne pas écouter les suggestions de ses professeurs qui le chauffaient en vue d’exhausser leur réputation et de gagner des grades et, tâchant d’arrache-pied, il passa son baccalauréat, après sa seconde.
Il lui fallait sans tarder une place qui allégeât le pesant fardeau que supportait sa mère ; il demeura longtemps sans en découvrir, car son aspect chétif ne prévenait pas en sa faveur et sa jambe gauche boitait, par suite d’un accident survenu au collège, dans son enfance ; enfin, la malchance sembla tourner ; Jean concourut pour une place d’employé dans un ministère et il fut admis avec les appointements de quinze cents francs.
Quand son fils lui annonça cette bonne nouvelle Madame Folantin sourit doucement : « Te voilà ton maître, dit-elle, tu n’as plus besoin de personne, mon pauvre garçon, il était grand temps » ; et en effet sa santé débile s’altérait de jour en jour ; un mois après, elle mourut des suites d’un gros rhume gagné dans la cage ventilée où elle demeurait, l’hiver comme l’été, assise.
Jean resta seul ; la tante Eudore était enterrée depuis longtemps ; ses autres parents étaient ou dispersés ou morts ; il ne les avait d’ailleurs pas connus ; c’est tout au plus s’il se souvenait du nom d’une cousine actuellement en province, dans un monastère.
Il se fit quelques camarades, quelques amis, puis arriva le moment où les uns quittèrent Paris et où les autres se marièrent ; il n’eut pas le courage de nouer de nouvelles liaisons et, peu à peu, il s’abandonna et vécut seul.
— C’est égal, la solitude est douloureuse, pensait-il maintenant, en remettant, un à un, des bouts de coke sur sa grille, et il songea à ses anciens camarades. Comme le mariage brisait tout ! On s’était tutoyé, on avait vécu de la même existence, l’on ne pouvait se passer les uns des autres et c’est à peine si l’on se saluait à présent lorsqu’on se rencontrait. L’ami marié est toujours un peu embarrassé, car c’est lui qui a rompu les relations, puis il s’imagine aussi qu’on raille la vie qu’il mène et enfin, il est, de bonne foi, persuadé qu’il occupe dans le monde un rang plus honorable que celui d’un célibataire, se disait M. Folantin, qui se rappelait la gêne et un peu la morgue d’anciens camarades entrevus depuis leur mariage. Tout cela, c’est bien bête ! Et il sourit, car le souvenir de ces compagnons de jeunesse le ramenait forcément au temps où il les fréquentait.
Il avait vingt-deux ans alors et tout l’amusait. Le théâtre lui apparaissait comme un lieu de délices, le café comme un enchantement, et Bullier, avec ses filles cabrant le torse, au son des cymbales et chahutant, le pied, en l’air, l’allumait, car dans son ardeur, il se les figurait déshabillées et voyait sous les pantalons et sous les jupes la chair se mouiller et se tendre. Tout un fumet de femme montait dans des tourbillons de poussière et il restait là, ravi, enviant les gens en chapeaux mous qui cavalcadaient en se tapant sur les cuisses. Lui, boitait, était timide, et n’avait pas d’argent. N’importe, ce supplice était doux, puis de même que bien des pauvres diables, un rien le contentait. Un mot jeté au passage, un sourire lancé par-dessus l’épaule, le rendaient joyeux et, en rentrant chez lui, il rêvait à ces femmes et s’imaginait que celles-là qui l’avaient regardé et qui lui avaient souri étaient meilleures que les autres.
Ah ! si ses appointements avaient été plus élevés ! Dépourvu d’argent comme il l’était, ne pouvant prétendre à lever des filles dans un bal, il s’adressait aux affûts des corridors, aux malheureuses dont le gros ventre bombe au ras du trottoir ; il plongeait dans les couloirs, tâchant de distinguer la figure perdue dans l’ombre ; et la grossièreté de l’enluminure, l’horreur de l’âge, l’ignominie de la toilette et l’abjection de la chambre ne l’arrêtaient point. Ainsi que dans ces gargotes où son bel appétit lui faisait dévorer de basses viandes, sa faim charnelle lui permettait d’accepter les rebuts de l’amour. Il y avait même des soirs où sans le sou, et par conséquent sans espoir de se satisfaire, il trainait dans la rue de Buci, dans la rue de l’Egout, dans la rue du Dragon, dans la rue Neuve-Guillemin, dans la rue Beurrière, pour se frotter à de la femme ; il était heureux d’une invite, et, quand il connaissait une de ces raccrocheuses, il causait avec elle, échangeait le bonsoir, puis il se retirait, par discrétion, de peur d’effaroucher la pratique, et il aspirait après la fin du mois, se promettant, dès qu’il aurait touché son traitement, des bonheurs rares.
Le beau temps ! — Et dire que maintenant qu’il était un peu plus riche, maintenant qu’il pouvait goûter à de meilleures pâtures et s’épuiser sur des couches plus fraîches, il n’avait plus envie de rien ! L’argent était arrivé trop tard, alors qu’aucun plaisir ne le séduisait.
Mais une période intermédiaire avait existé, entre celle où ces turbulences du sang le bouleversaient et celles où, incurieux, presque impuissant, il restait là, chez lui, dans un fauteuil, auprès du feu. Vers les vingt-sept ans, le dégoût l’avait pris des femmes en carte, éparses dans son quartier ; il avait désiré un peu de cajolerie, un peu de caresse ; il avait rêvé de ne plus se précipiter à la hâte sur un divan, mais bien de temporiser et de s’asseoir. Comme ses ressources l’obligeaient à n’entretenir aucun fille, comme il était malingre et ne possédait aucun talent de société, aucune gaîté libertine, aucun bagou, il avait pu, tout à son aise, réfléchir sur la bonté d’une Providence qui donne argent, honneur, santé, femme, tout aux uns et rien aux autres. Il avait dû se contenter encore de banales dînettes, mais comme il payait davantage, il était expédié dans des salles plus propres et dans des linges plus blancs.
Une fois, il s’était cru heureux ; il avait fait connaissance d’une fillette qui travaillait ; celle-là lui avait bien distribué des à-peu-près de tendresse, mais, du soir au lendemain, sans motifs, elle l’avait lâché, lui laissant un souvenir dont il eut de la peine à se guérir ; il frémissait, se rappelant cette époque de souffrances où il fallait quand même aller à son bureau et quand même marcher. Il est vrai qu’il était encore jeune et qu’au lieu de s’adresser au premier médecin venu, il avait eu recours aux charlatans, sans tenir compte des inscriptions qui rayaient leurs affiches dans les rambuteaux, des inscriptions véridiques comme celle-ci : « remède dépuratif... » ; oui, pour la bourse ; — menaçantes comme celle-là : « on perd ses cheveux » ; — philosophiques et résignées comme cette autre : « vaut encore mieux coucher avec sa femme » ; — et, partout, l’adjectif gratuit accolé au mot traitement était biffé, creusé, ravagé à coups de couteaux, par des gens qu’on sentait avoir accompli cette besogne avec conviction et avec rage.
Maintenant les amours étaient bien finies, les élans bien réprimés ; aux halètements, aux fièvres, avaient succédé une continence, une paix profondes ; mais aussi quel abominable vide s’était creusé dans son existence depuis le moment où les questions sensuelles n’y avaient plus tenu de place !
— Tout cela ce n’est pas risible, pensait M. Folantin, en hochant la tête et il ajoura son feu. — On gèle ici, murmura-t-il, c’est dommage que le bois soit si cher, quelles belles flambées, on ferait ! — Et cette réflexion l’amena à songer au bois qu’on leur distribuait à gogo, au ministère, puis à l’administration elle-même et enfin à son bureau.
Là encore, ses illusions avaient été de courte durée. Après avoir cru qu’on arrivait à des positions supérieures par la bonne conduite et le travail, il s’aperçut que la protection était tout ; les employés nés en province étaient soutenus par leurs députés et ils arrivaient quand même. Lui, était né à Paris, il n’était aidé par aucun personnage, il demeura simple expéditionnaire et il copia et recopia, pendant des années, des monceaux de dépêches, traça d’innombrables barres de jonction, bâtit des masses d’états, répéta des milliers de fois les invariables salutations des protocoles ; à ce jeu, son zèle se refroidit et maintenant, sans attente de gratifications, sans espoir d’avancements, il était peu diligent et peu dévoué.
Avec ses 237 fr. 40 c. par mois, jamais il n’avait pu s’installer dans un logement commode, prendre une bonne, se régaler, les pieds au chaud, dans des pantoufles ; un essai malheureux tenté, un jour de lassitude, en dépit de toute vraisemblance, de tout bon sens, avait été d’ailleurs décisif et, au bout de deux mois, il avait dû naviguer de nouveau, au travers des restaurants, s’estimant encore satisfait d’ètre débarrassé de sa femme de ménage, madame Chabanel, une vieillesse haute de six pieds, aux lèvres velues et aux yeux obscènes plantés audessus de bajoues flasques. C’était une sorte de vivandière qui bâfrait comme un roulier et buvait comme quatre ; elle cuisinait mal et sa familiarité dépassait les bornes du possible. Elle posait les plats, bout-ci, bout-là, sur la table, puis s’asseyait en face de son maître, faisant chapelle sous ses jupes et roussinait, en rigolant, le bonnet de côté et les mains aux hanches.
Impossible d’être servi ; mais M. Folantin eût peut-être encore supporté cet humiliant sans-gêne, si cette étonnante dame ne l’avait dévalisé ainsi que dans un bois ; les gilets de flanelle et les chaussettes disparaissaient, les savates devenaient introuvables, les alcools se volatilisaient, les allumettes même brûlaient toutes seules.
Il avait pourtant fallu mettre un terme à cet état de choses ; aussi, M. Folantin rassembla son courage et, de peur que cette femme ne le pillât complètement pendant son absence, il brusqua la scène et, un soir, séance tenante, il la congédia.
Madame Chabanel devint cramoisie et sa bouche béa, vidée de dents ; puis elle se mit à gigoter et à battre de l’aile lorsque M. Folantin dit d’un ton aimable : — Puisque je ne mangerai plus désormais chez moi, je préfère vous faire profiter des provisions qui restent plutôt que les perdre ; nous allons donc, si vous le voulez bien, les passer en revue, ensemble.
Et alors il avait ouvert les armoires.
— Ça, c’est un sac de café et cette bouteille contient de l’eau-de-vie, n’est-ce pas ?
— Oui, Monsieur, c’en est, avait gémi Madame Chabanel.
— Eh bien, c’est bon à conserver et je la garde, disait M. Folantin, et ainsi de tout ; la mère Chabanel n’héritait en fin de compte que de deux sous de vinaigre, d’une poignée de sel gris et d’un petit verre d’huile à lampe.
Ouf ! s’était écrié M. Folantin, alors que cette femme descendait l’escalier, en trébuchant contre les marches ; mais sa joie s’était vite éteinte ; depuis ce temps-là, son intérieur avait marché tout de guingois. La veuve Chabanel avait été remplacée par le concierge, qui trépignait le lit de coups de poing et apprivoisait les araignées dont il ménageait les toiles.
Depuis ce temps, la victuaille avait été aussi invraisemblable qu’indécise ; les stations chez les nourrisseurs du quartier n’avaient plus cessé et son estomac s’était rouillé ; la période des eaux de Saint-Galmier et des eaux de Seltz, de la moutarde masquant le goût faisandé des viandes et attisant la froide lessive des sauces, était venue.
A force d’évoquer toute la séquelle de ces souvenirs. M. Folantin tomba dans une affreuse mélancolie. Il avait subi vaillamment, depuis des années, la solitude, mais, ce soir-là, il s’avoua vaincu ; il regretta de ne pas s’être marié et il retourna contre lui les arguments qu’il débitait quand il prêchait le célibat pour les gens pauvres. — Eh bien, quoi ? les enfants, on les élèverait, on se serrerait un peu plus le ventre. — Parbleu, je ferais comme les autres, je m’attellerais à des copies, le soir, pour que ma femme fût mieux mise ; nous mangerions de la viande le matin seulement et, de même que la plupart des petits ménages, nous nous contenterions au dîner d’une assiettée de soupe. Qu’est-ce que toutes ces privations à côté de l’existence organisée, de la soirée passé entre son enfant et sa femme, de la nourriture peu abondante mais vraiment saine, du linge raccommodé, du linge blanchi et rapporté à des heures fixes ? — Ah ! le blanchissage, quel aria pour un garçon ! — On me visite quand on a le temps et l’on m’apporte des chemises molles et bleues, des mouchoirs en loques, des chaussettes criblées de trous comme des écumoires et l’on se fiche de moi lorsque je me fâche ! — Et puis, comment tout cela finira-t-il, à l’hospice ou à la maison Dubois, si la maladie se prolonge ; ici, invoquant la pitié d’une garde-malade, si la mort est prompte.
Trop tard... plus de virilité, le mariage est impossible. Décidément, j’ai raté ma vie. — Allons, ce que j’ai de mieux à faire, soupira M. Folantin, c’est encore de me coucher et de dormir. — Et, pendant qu’il ouvrait ses couvertures, et disposait ses oreillers, des actions de grâces s’élevèrent dans son âme, célébrant les pacifiants bienfaits du secourable lit.
II
Ni le lendemain, ni le surlendemain, la tristesse de M. Folantin ne se dissipa ; il se laissait aller à vau-l’eau, incapable de réagir contre ce spleen qui l’écrasait. Mécaniquement, sous le ciel pluvieux, il se rendait à son bureau, le quittait, mangeait et se couchait à neuf heures pour recommencer, le jour suivant, une vie pareille ; peu à peu, il glissait à un alourdissement absolu d’esprit.
Puis, il eut, un beau matin, un réveil. Il lui sembla qu’il sortait d’une léthargie ; le temps était clair et le soleil frappait les vitres damasquinées de givre ; l’hiver reprenait, mais lumineux et sec ; M. Folantin se leva, en murmurant : fichtre, ça pince ! Il se sentait ragaillardi. Ce n’est pas tout cela, il s’agirait de trouver un remède aux attaques d’hypocondrie, se dit-il.
Après de longues délibérations, il se décida à ne plus vivre ainsi enfermé et à varier ses restaurants. Seulement, si ces résolutions étaient faciles à concevoir, elles étaient, en revanche, difficiles à mettre en pratique. Il demeurait rue des Saint-Pères et les restaurants manquaient. Le VIe arrondissement était impitoyable au célibat. Il fallait être ordonné prêtre pour trouver des ressources, des dîners spéciaux dans des tables d’hôtes réservées aux ecclésiastiques, pour vivre dans ce lacis de rues qui enveloppent l’église de Saint-Sulpice. Hors la religion, point de mangeaille, à moins d’être riche et de pouvoir fréquenter des maisons huppées ; M. Folantin, ne remplissant pas ces conditions, devait se borner à prendre ses repas chez les quelques traiteurs disséminés, çà et là, dans son voisinage. Décidément, il semblait que cette partie de l’arrondissement ne fût habitée que par des concubins ou des gens mariés. Si j’avais le courage de l’abandonner, soupirait de temps à autre M. Folantin. Mais son bureau était là, puis il y était né, sa famille y avait constamment vécu ; tous ses souvenirs tenaient dans cet ancien coin tranquille, déjà défiguré par des percées de nouvelles rues, par de funèbres boulevards, rissolés l’été et glacés l’hiver, par de mornes avenues qui avaient américanisé l’aspect du quartier et détruit pour jamais son allure intime, sans lui avoir apporté en échange des avantages de confortable, de gaîté et de vie.
Il faudrait traverser l’eau pour dîner, se répétait M. Folantin, mais un profond dégoût le saisissait dès qu’il franchissait la rive gauche ; puis il avait peine à marcher avec sa jambe qui clochait, et il abominait les omnibus. Enfin, l’idée de faire des étapes, le soir, pour chercher pâture, l’horripila. Il préféra tâter de tous les marchands de vins, de tous les bouillons qu’il n’avait pas encore visités, dans les alentours de son domicile.
Et tout aussitôt il déserta le gargot où il mangeait d’habitude ; il hanta d’abord les bouillons, eut recours aux filles dont les costumes de soeur évoquent l’idée d’un réfectoire d’hôpital. Il y dîna quelques jours, et sa faim, déjà rabrouée par les graillonnants effluves de la pièce, se refusa à entamer des viandes însipides, encore affadies par les cataplasmes des chicorées et des épinards. Quelle tristesse dégageaient ces marbres froid, ces tables de poupées, cette immuable carte, ces parts infinitésimales, ces bouchées de pain ! Serrés en deux rangs placés en vis-à-vis, les clients paraissaient jouer aux échecs, disposant leurs ustensiles, leurs bouteilles, leurs verres, les uns au travers des autres, faute de place ; et, le nez dans un journal, M. Folantin enviait les solides mâchoires de ses partners qui broyaient les filaments des aloyaux dont les chairs fuyaient sous la fourchette. Par dégoût des viandes cuites au four, il se rabattait sur les oeufs ; il les réclamait sur le plat et très cuits ; généralement, on les lui apportait presque crus et il s’efforçait d’éponger avec de la mie de pain, de recueillir avec une petite cuiller le jaune qui se noyait dans des tas de glaires. C’était mauvais, c’était cher et surtout c’était attristant. En voilà assez, se dit M. Folantin, essayons d’autre chose.
Mais partout il en était de même ; les inconvénients variaient en même temps que les râteliers ; chez les marchands de vins distingués, la nourritures était meilleure, le vin moins âpre, les parts plus copieuses, mais en thèse générale, le repas durait deux heures, le garçon étant occupé à servir les ivrognes postés en bas devant le comptoir ; d’ailleurs, dans ce déplorable quartier, la boustifaille se composait d’un ordinaire, de côtelettes et de beefstecks qu’on payait bon prix parce que, pour ne pas vous mettre avec les ouvriers, le patron vous enfermait dans une salle à part et allumait deux branches de gaz.
Enfin, en descendant plus bas, en fréquentant les purs mannezingues ou les bibines de dernier ordre, la compagnie était répulsive et la saleté stupéfiante ; la carne fétidait, les verres avaient des ronds de bouches encore marqués, les couteaux était dépolis et gras et les couverts conservaient dans leurs filets le jaune des oeufs mangés.
M. Folantin se demanda si le changement était profitable, attendu que le vin était partout chargé de litharge et coupé d’eau de pompe, que les oeufs n’étaient jamais cuits comme on les désirait, que la viande était partout privée de suc, que les légumes cuits à l’eau ressemblaient aux vestiges des maisons centrales ; mais il s’entêta ; à force de chercher, je trouverai peut-être ; et il continua à rôder par les cabarets, par les crèmeries ; seulement, au lieu de se débiliter, sa lassitude s’accrut, surtout quand, descendant de chez lui, il aspirait, dans les escaliers, l’odeur des potages, il voyait des raies de lumière sous les portes, il rencontrait des gens venant de la cave, avec des bouteilles, il entendait des pas affairés courir dans les pièces ; tout, jusqu’au parfum qui s’échappait de la loge de son concierge, assis, les coudes sur la table, et la visière de sa casquette ternie par la buée montant de sa jatte de soupe, avivait ses regrets. Il en arrivait presque à se repentir d’avoir balayé la mère Chabanel, cet odieux cent-garde. — Si j’avais eu les moyens, je l’aurais gardée, malgré ses désolantes moeurs, se dit-il.
Et il se désespérait, car à ses ennuis moraux se joignait maintenant le délabrement physique. A force de ne pas se nourrir, sa santé, déjà fréle, chavirait. Il se mit au fer, mais toutes les préparations martiales qu’il avala lui noircirent, sans résultat appréciable, les entrailles. Alors il adopta l’arsenic, mais le Fowler lui éreinta l’estomac et ne le fortifia point ; enfin il usa, en dernier ressort, des quinquinas qui l’incendièrent ; puis il mêla le tout, associant ces substances les unes aux autres, ce fut peine perdue ; ses appointements s’y épuisaient ; c’étaient chez lui des masses de boîtes, de topettes, de fioles, une pharmacie en chambre, contenant tous les citrates, les phosphates, les proto-carbonates, les lactates, les sulfates de protoxyde, les iodures et les proto-iodures de fer, les liqueurs de Pearson, les solutions de Devergie, les granules de Dioscoride, les pilules d’arséniate de soude et d’arséniate d’or, les vins de gentiane et de quinium, de coca et de colombo !
Dire que tout cela c’est de la blague et que d’argent perdu ! soupirait M. Folantin, en regardant piteusement ces vains achats, et, bien qu’il n’eût pas voix au chapitre, le concierge était de cet avis ; seulement il époussetait la chambre, plus mal encore, sentant son mépris d’homme robuste s’accroître pour ce locataire étique qui ne vivait plus qu’en avalant des drogues.
En attendant, l’existence de M. Folantin persistait à être monotone. Il n’avait pu se décider à rentrer dans son premier restaurant ; une fois il était allé jusqu’à la porte, mais, arrivé là, l’odeur des grillades et la vue d’une bassine de crème violette au chocolat, l’avaient fait fuir. Il alternait marchands de vins et bouillons et, un jour par semaine, il s’échouait dans une fabrique de bouillabaisse. Le potage et le poisson étaient passables ; mais il ne fallait point réclamer d’autre pitance, les viandes étant ratatinées comme des semelles de bottes et tous les plats dégageant l’âcre goût des huiles à lampes.
Pour se raiguiser l’appétit, encore émoussé par les abjects apéritifs des cafés : — les absinthes puant le cuivre ; les vermouths : la vidange des vins blancs aigris ; les madères : le trois-six coupé de caramel et de mélasse ; les malagas : les sauces des pruneaux au vin ; les bitters : l’eau de Botot à bas prix des herboristes ; — M. Folantin essaya d’un excitant qui lui réussissait dans son enfance ; tous les deux jours, il se rendit aux bains. Cet exercice lui plaisait surtout parce qu’ayant deux heures à tuer, entre la sortie de son bureau et son repas, il évitait ainsi de rentrer chez lui, de demeurer tout botté, tout habillé, consultant sa pendule, attendant l’heure du dîner. Et, les premières fois, ce furent des moments délicieux. Il se blottissait dans l’eau chaude, s’amusait à soulever avec ses doigts des tempêtes et à creuser des maelstroms. Doucement, il s’assoupissait, au bruit argentin des gouttes tombant des becs de cygnes et dessinant de grands cercles qui se brisaient contre les parois de la baignoire ; tressautant, alors que des coups furieux de sonnettes partaient dans les couloirs, suivis de bruits de pas et de claquements de portes. Puis le silence reprenait avec le doux clapotis des robinets, et toutes ses détresses fuyaient à la dérive ; dans la cabine, voilée d’une vapeur d’eau, il rêvassait et ses pensées s’opalisaient avec la buée, devenaient affables et diffuses. Au fond, tout était pour le mieux ; il s’embêtait. Eh ! mon Dieu, chacun n’at-il pas ses ennuis ? Il avait, dans tous les cas, évité les plus douloureux, les plus poignants, ceux du mariage. Il fallait que je fusse bien bas, le soir où j’ai pleuré sur mon célibat, se dit-il. Voyez-vous cela, moi, qui aime tant à m’étendre, en chien de fusil, dans les draps, forcé de ne pas bouger, de subir le contact d’une femme, à toutes les époques, de la contenter alors que je souhaiterais simplement de dormir !
Et encore, si l’on ne procréait aucun enfant ! si la femme était vraiment stérile ou bien adroite, il n’y aurait que demi-mal ! — mais, est-on jamais sûr de rien ! et alors ce sont de perpétuelles nuits blanches, d’incessantes inquiétudes. Le gosse braille, un jour, parce qu’il lui pousse une quenotte ; un autre jour, parce qu’il ne lui en pousse pas ; ça pue le lait sûr et le pipi, par toute la chambre ; enfin, il faudrait au moins tomber sur une femme aimable, sur une bonne fille ; oui, va-t’en voir si elles viennent, Jean ; avec ma déveine couttimière, j’aurais épousé une pimbêche, une petite chipie, qui m’aurait intarissablement reproché les gênes utérines survenues après ses couches.
Non, il faut être juste : chaque état a ses inquiétudes et ses tracas ; et puis, c’est une lâcheté lorsqu’on n’a pas de fortune que d’enfanter des mioches ! — C’est les vouer au mépris des autres quand ils seront grands ; c’est les jeter dans une dégoûtante lutte, sans défense et sans armes ; c’est persécuter et châtier des innocents à qui l’on impose de recommencer la misérable vie de leur père. — Ah ! au moins, la génération des tristes Folantin, s’éteindra avec moi ! — Et, consolé, M. Folantin lappait sans se plaindre, une fois sorti du bain, l’eau de vaisselle de son bouillon, et déchiquetait l’amadou mouillé de sa viande.
Tant bien que mal, il atteignait la fin de l’hiver et la vie devint plus indulgente ; l’intimité des intérieurs cessait et M. Folantin ne regretta plus si vivement les douillettes somnolences au coin du feu ; ses promenades le long des quais recommencèrent.
Déjà les arbres se dentelaient de petites feuilles jaunes ; la Seine, réverbérant l’azur pommelé du ciel, coulait avec de grandes plaques bieues et blanches que coupaient, en les brouillant d’écume, les bateaux-mouches. Le décor environnant semblait requinqué. Les deux immenses portants, représentant, l’un, le pavillon de Flore et toute la façade du Louvre ; l’autre, la ligne des hautes maisons jusqu’au Palais de l’Institut, avaient été ranimés et comme repeints et la toile du fond, de nouveau tendue, découpait sur un outremer adouci, tout neuf, les poivrières du Palais de Justice, l’aiguille de la Sainte-Chapelle, la vrille et les tours de Notre-Dame.
M. Folantin adorait cette partie du quai, comprise entre la rue du Bac et la rue Dauphine ; il choisissait un cigare, dans le débit de tabac situé près de la rue de Beaune, et il musait, à petits pas, allant un jour à gauche, fouillant les boîtes des parapets, et un autre jour à droite, consultant les rayons, en plein vent, des livres en boutique.
La plupart des volumes entassés dans les caisses étaient des rancarts de librairie, des rossignols sans valeur, des romans morts-nés, mettant en scène des femmes du grand monde, racontant, dans un langage de pipelette, les accidents de l’amour tragique, les duels, les assassinats et les suicides ; d’autres soutenaient des thèses, attribuaient tous les vices aux gens titrés, toutes les vertus aux gens du peuple ; d’autres enfin poursuivaient un but religieux ; ils étaient revêtus de l’approbation de Monseigneur un tel et ils délayaient des cuillerées d’eau bénite dans le mucilage d’une gluante prose.
Tous ces romans avaient été rédigés par d’incontestables imbéciles et M. Folantin filait vite, ne reprenant haleine que devant les volumes de vers qui battaient de l’aile à toutes les brises. Ceux-là étaient moins dépiotés et moins souillés, attendu que personne ne les ouvrait. Une charitable pitié venait à M. Folantin pour ces recueils délaissés. Et il y en avait, il y en avait ! des vieux datant de l’entrée de Malekadel dans la littérature, des jeunes, issus de l’école d’Hugo, chant le doux Messidor, les bois ombreux, les divins charmes d’une jeune personne qui, dans la vie privée, faisait probablement la retape. Et tout cela avait été lu en petit comité et les pauvres écrivains s’étaient réjouis. Mon Dieu ! ils ne s’attendaient pas à un retentissant succès, à une vente populaire, mais seulement à un petit bravo de la part des délicats et des lettrés ; et rien ne s’était produit, pas même un peu d’estime. Par ici, par là, une louange banale dans une feuille de chou, une ridicule lettre du Grand-Maître pieusement conservée, et ç’avait été tout.
Ce qu’il y a de plus triste, pensait M. Folantin, c’est que ces malheureux peuvent justement exécrer le public, car la justice littéraire n’existe pas ; leurs vers ne sont ni meilleurs, ni pires que ceux qui se sont vendus et qui ont mené leurs auteurs à l’Institut.
Tout en rêvant de la sorte, M. Folantin, rallumait son cigare, reconnaissait les bouquinistes qui, bavards et hâlés, se tenaient, comme l’année précédente, près de leurs boîtes. Il reconnaissait aussi les bibliomanes qui piétinaient, au dernier printemps, tout le long des parapets, et la vue de ces individus qu’il ne connaissait pas le charmait. Tous lui étaient sympathiques ; il devinait en eux de bons maniaques, de braves gens tranquilles, passant dans la vie, sans bruit, et il les enviait. Si j’étais comme eux, songeaient-il ; et déjà, il avait tenté de les imiter, de devenir bibiophile. Il avait consulté des catalogues, feuilleté des dictionnaires, des publications spéciales, mais il n’avait jamais découvert de pièces curieuses et il devinait d’ailleurs que leur possession ne comblerait pas ce trou d’ennui qui se creusait lentement, dans tout son être. — Hélas ! le goût des livres ne s’apprenait pas, et puis, en dehors des éditions épuisées que ses faibles ressources lui interdisaient d’acheter, M. Folantin n’avait guère de volumes à se procurer. Il n’aimait ni les romans de cape et d’épée, ni les romans d’aventure ; d’un autre côté, il abominait le bouillon de veau des Cherbuliez et des Feuillet ; il ne s’attachait qu’aux choses de la vie réelle ; aussi sa bibliothèque était restreinte, cinquante volumes en tout, qu’il savait par coeur. Et ce n’était pas l’un de ses moindres chagrins que cette disette de livres à lire ! En vain, il avait essayé de s’intéresser à l’histoire ; toutes ces explications compliquées de choses simples ne l’avaient ni captivé, ni convaincu. Vaguement il furetait, n’espérant plus dépister un bouquin qu’il joindrait aux siens. Mais cette promenade le distrayait, puis, quand il était las de remuer la poussière des imprimés, il se penchait au-dessus des berges et la vue des bateaux aux coques goudronnées, aux cabines peintes en vert poireau, au grand mât abattu sur le pont, lui plaisait ; il demeurait là, enchanté, contemplant la cocotte mijotant sur un poêle de fonte, à l’air, l’éternel chien noir et blanc courant, la queue en trompette, le long des péniches ; les enfants très blonds, assis près du gouvernail, les cheveux sur les yeux et les doigts dans la bouche.
Ce serait gai de vivre ainsi, pensait-il, souriant, malgré lui, de ces envies puériles, et il sympathisait même avec les pêcheurs à la ligne, immobiles, en rang d’oignons, séparés par des boîtes d’asticots les unes des autres.
Ces soirs-là, il se sentait plus dispos et plus vert. Il consultait sa montre et si l’heure du dîner était lointaine encore, il traversait la chaussée, suivait le trottoir qui faisait face à celui qu’il venait de quitter et il remontait le long des maisons. Il flânait fouillonnant encore des livres dont les dos s’alignaient aux devantures des boutiques, s’extasiant sur d’anciennes reliures aux plats de maroquin rouge, estampés d’armes en or ; mais celles-là étaient enfermées sous verre, comme des choses précieuses que des initiés pouvaient seuls toucher ; et il repartait, examinait les magasins pleins de vieux chênes si bien réparés qu’ils ne conservaient plus un morceau du temps, les assiettes de vieux Rouen fabriquées aux Batignolles, les grands plats de Moustiers cuits à Versailles, les tableaux d’Hobbéma, le petit ru, le moulin à eau, la maison coiffée de tuiles rouges, éventées par un bouquet d’arbres enveloppé dans un coup de lumière jaune ; des tableaux étonnamment imités par un peintre, entré dans la peau du vieux Minderhout, mais incapable de s’assimiler la manière d’un autre maître ou de produire, de son crû, la moindre toile ; et M. Folantin essayait de percer la profondeur des boutiques, d’un coup d’oeil au travers des portes ; jamais il n’y voyait de chalands ; seuie, une vieille femme était généralement assise, dans le pêle-mêle des objets où elle s’était réservé une niche, et, ennnuyée, eile ouvrait la bouche en un long bâillement qui se communiquait au chat campé sur une console.
C’est drôle tout de même, se disait M. Folantin, comme les marchandes de bric-à-brac changent. Les rares fois où j’ai cheminé au travers des quartiers de la rive droite, je n’ai jamais vu, dans les débits de bibeiots, de bonnes vieilles dames comme ceile-ci, mais j’ai toujours aperçu derrière les vitrines de belles et hautes gaillardes, de trente à quarante ans, soigneusement pommadées et la figure très travaillée au plâtre.
Une vague odeur de prostitution s’échappait de ces magasins où les oeillades de la négociante devaient abréger les marchandages des acheteurs. — Allons, le bon enfant disparaît ; d’ailleurs, les centres se déplacent ; maintenant tous les antiquaires, tous les vendeurs des livres de luxe végètent dans ce quartier et ils fuient, dès que leurs baux expirent, de l’autre côté du fleuve. Dans dix ans d’ici, les brasseries et les cafés auront envahi tous les rez-de-chaussée du quai ! Ah ! décidément Paris devient un Chicago sinistre ! — Et, tout mélancolisé, M. Folantin se répétait : profitons du temps qui nous reste avant la définitive invasion de la grande muflerie du Nouveau-Monde ! — Et il reprenait ses flânes, s’arrêtant devant les marchands d’estampes aux montres tendues d’images du XVIIIe siècle, mais au fond les gravures en couleur de cette époque et les gravures à la manière noire anglaise qui les flanquaient, dans la plupart des étalages, ne le passionnaient guère et il regrettait les estampes de la vie intime flamande, maintenant reléguées dans les cartons, par suite de l’engouement des collectionneurs pour l’école française.
Quand il était las de baguenauder devant ces boutiques, il entrait, pour varier ses plaisirs, dans la salle des dépêches d’un journal, une salle garnie de dessins et de peintures représentant des Italiennes et des almées, des bébés embrassés par des mères, des pages moyen âge grattant de la mandoline sous des balcons, toute une série évidemment, destinée à l’ornementation des abat-jour, et il se détournait, passait, préférant encore regarder les photographies d’assassins, de généraux et d’actrices, de tous les gens qu’un crime, qu’un massacre ou qu’une chansonnette mettait pendant une semaine en évidence.
Mais ces exhibitions étaient, en somme, peu récréatives, et M. Folantin, gagnant la rue de Beaune, admirait davantage l’inébranlable appétit des cochers attablés chez des mastroquets et il prenait comme une prise de faim. Ces platées de boeuf reposant sur des lits épais de choux, ces haricots de mouton emplissant la petite et massive assiette, ces triangles de brie, ces verres pleins, lui communiquaient des fringales et ces gens aux joues gonflées par d’énormes bouchées de pain, aux grosses mains tenant un couteau la pointe en l’air, au chapeau de cuir bouilli montant et descendant en même temps que les mâchoires, l’excitaient et il filait, tâchant de conserver cette impression de voracité pendant la route ; malheureusement dès qu’il s’installait dans le restaurant, sa forge se recroquevillait, et il contemplait piteusement sa viande, se demandant à quoi servait le quassia qui marinait, à son bureau, dans une carafe.
Malgré tout, cette promenade écartait les pensées trop sombres et il écoula ainsi l’été, traînant le long de la Seine, avant le dîner et, une fois sorti de table, s’attablant à la porte d’un café. Il fumait, humant un peu de fraîcheur, et malgré le dégoût que lui inspiraient les bières de Vienne fabriquées avec du chicotin et de l’eau de buis, sur la route de Flandre, il en lapait deux bocks, peu désireux de se mettre au lit.
La journée meme, pendant cette saison, était moins lourde à vivre. En manches de chemise, dans sa pièce, il somnolait, entendant confusément les histoires de son collègue, se réveillant pour s’éventer avec un almanach, travaillant le moins possible, combinant des promenades. L’ennui de quitter, l’hiver, son bureau chauffé, pour courir au dehors, dîner, les pieds trempés, et rentrer dans une chambre froide, n’existait plus. Au contraire, il éprouvait un soulagement en s’échappant de sa pièce empuantie par cette odeur de poussière et de renfermé que dégagent les cartons, les liasses et les pots d’encre.
Enfin, son intérieur était mieux tenu ; le portier n’avait plus à préparer le feu et si le lit continuait à être mal battu et pas bordé, peu importait, puisque M. Folantin couchait nu sur les draps et les couvertures.
La pensée de s’étendre seul, par ces nuits d’orage où l’on sue comme dans une étuve, où l’on se retourne dans des draps poissés, le réjouissait aussi. Je plains les gens qui sont à deux, se disait-il, en roulant sur le lit, à la recherche d’une place plus fraîche. Et la destinée lui semblait, à ces moments là, plus hospitalière, moins rétive.
III
Bientôt les chaleurs accablantes s’atténuèrent, les longues journées s’écourtèrent, l’air fraîchit, les ciels faisandés perdirent leur bleu, se peluchèrent comme de moisissure. L’automne revenait, ramenant les brouillards et les pluies ; M. Folantin prévit d’inexorables soirées et, effrayé, il dressa de nouveau ses plans.
D’abord il se résolut à rompre avec sa sauvagerie, à tâter des tables d’hôtes, à se lier avec des voisins d’assiettes, à fréquenter même les théâtres.
Il fut servi à souhait ; il rencontra, un jour, sur le seuil de son bureau, un monsieur qu’il connaissait. Ils avaient, pendant un an, mangé côte-à-côte, se préservant, l’un l’autre, des mets défectueux ou gâtés, se prêtant le journal, discutant sur les vertus des fers différents qu’ils avalaient, buvant, pendant un mois, ensemble, de l’eau de goudron, émettant des pronostics sur les changements de temps, cherchant, à eux deux, des alliances diplomatiques pour la France.
Leurs relations s’étaient bornées là. Ils se donnaient une poignée de main, se tournaient le dos une fois sur le trottoir, et cependant le départ de ce corelégionnaire avait attristé M. Folantin.
Ce fut avec plaisir qu’il l’aperçut.
Tiens, M. Martinet, dit-il, comment va ?
— M. Folantin ! bah ! — et comment vous portez-vous, depuis les temps fous que nous ne nous sommes vus ?
— Ah ! vous êtes un joli lâcheur, riposta M. Folantin. Voyons, que diable êtes-vous devenu ?
Et ils avaient échangé leurs confidences, M. Martinet était maintenant l’hôte assidu d’une table d’hôte et il en fit immédiatement un chimérique éloge. Quatre-vingt-dix à cent francs, par mois ; c’est propre, bien tenu ; on en a à sa faim, on se trouve en bonne compagnie. Vous devriez venir dîner là ?
— Je n’aime guère la table d’hôte, disait M. Folantin ; je suis un peu ours, vous le savez ; je ne puis me décider à converser avec les gens que je ne connais point.
— Mais vous n’êtes pas forcé de parler. Vous êtes chez vous. L’on n’est pas tous autour d’une table, c’est la même chose que dans un grand restaurant. Tenez, essayez-en, venez ce soir.
M. Folantin hésita ; il balançait entre l’agrément de ne pas se repaître seul et la crainte que lui inspiraient les repas de corps.
— Allons ! vous n’allez pas refuser, insista M. Martinet. Je vais vous traiter, à mon tour, de lâcheur si, pour une fois que je vous rencontre, vous me laissez en plan.
M. Folantin eut peur d’être malhonnête et il suivit docilement son compagnon, au travers des rues. — Nous y voici, montons. — Et M. Martinet s’arrêta sur le palier, devant une porte à tambour vert.
Là sonnaient de grands bruits d’assiettes sur un bourdonnement ininterrompu de voix ; puis la porte s’ouvrit et, en même temps qu’un violent hourvari, des gens en chapeau se précipitèrent dans l’escalier en battant la rampe avec leurs cannes.
M. Folantin et son camarade se garèrent, puis ils poussèrent à leur tour la porte et s’introduisirent dans une salle de billard. M. Folantin, pris à la gorge, recula. Cette pièce était noyée dans une épaisse fumée de tabac, traversée par des coups de queues ; M. Martinet entraîna son invité dans une autre pièce, où la buée était peut-être plus intense encore, et çà et là, dans des chants de pipes bouchées, dans des écroulements de dominos, dans des éclats de rire, des corps passaient presque invisibles, devinés seulement par le déplacement de vapeur qu’ils opéraient. M. Folantin resta là, ahuri, cherchant à tâtons une chaise.
M. Martinet l’avait quitté. Vaguement, dans un nuage, M. Folantin l’aperçut, sortant d’une porte. Il faut attendre un peu, dit M. Martinet, toutes les tables sont pleines ; oh, ce ne sera pas long !
Une demi-heure s’écoula. M. Folantin eût donné bien des choses pour n’avoir jamais mis le pied dans cet estaminet, où l’on pouvait fumer, mais où l’on ne se nourrissait pas. De temps à autre, M. Martinet s’échappait et allait s’assurer que les sièges étaient toujours occupés. Il y a deux messieurs qui en sont au fromage, dit-il d’un air satisfait, j’ai retenu leurs places.
Une autre demi-heure s’écoula. M. Folantin se demanda s’il ne ferait pas bien de se diriger vers l’escalier tandis que son compagnon guettait les tables. Enfin, M. Martinet revint, lui annonça le départ des deux fromages et ils pénétrèrent dans une troisième pièce où ils s’assirent, serrés comme des harengs dans une caque.
Sur la nappe tiède, dans les éclaboussures de sauce, dans les mies de pain, on leur jeta des assiettes, et l’on servit un boeuf coriace et résistant, des légumes fades, un rosbif dont les chairs élastiques pliaient sous le couteau, une salade et du dessert. Cette salle rappela à M. Folantin le réfectoire d’une pension, mais d’une pension mal tenue, où on laisse brailler à table. Il n’y manquait vraiment que les timbales au fond rougi par l’abondance, et l’assiette retournée pour étaler sur une place moins sale les pruneaux ou les confitures.
Certes, la pâture et le vin étaient misérables, mais ce qui était plus misérable que la piâture et plus misérable que le vin, c’était la compagnie au milieu de laquelle on mâchait ; c’étaient les maigres servantes qui apportaient les plats, des femmes sèches, aux traits accentués et sévères, aux yeux hostiles. Une complète impuissance vous venait, en les regardant ; on se sentait surveillé et l’on mangeait, découragé, avec ménagement, n’osant laisser les tirants et les peaux, de peur d’une semonce, appréhendant de reprendre d’un plat, sous ces yeux qui jaugeaient votre faim et vous la refoulaient au fond du ventre.
— Eh bien, que vous disais-je, affirmait M. Martinet, c’est gai, n’est-ce pas ? et, ici, c’est de la vraie viande.
M. Folantin ne soufflait mot ; autour de lui, les tables vacarmaient avec un bruit terrible.
Toutes les races du Midi emplissaient les sièges, crachaient et se vautraient, en mugissant. Tous les gens de la Provence, de la Lozère, de la Gascogne, du Languedoc, tous ces gens, aux joues obscurcies par des copeaux d’ébène, aux narines et aux doigts poilus, aux voix retentissantes, s’esclaffaient comme des forcenés, et leur accent, souligné par des gestes d’épileptiques, hachait les phrases et vous les en-fournait, toutes broyées, dans le tympan.
Presque tous faisaient partie de la jeunesse des écoles, de cette glorieuse jeunesse dont les idées subalternes assurent aux classes dirigeantes l’immortel recrutement de leur sottise ; M. Folantin voyait défiler devant lui tous les lieux communs, toutes les calembredaines, toutes les opinions littéraires surannées, tous les paradoxes usés par cent ans d’âge.
Il jugeait l’esprit des ouvriers plus délicat et celui des calicots plus fin. Avec cela, la chaleur était écrasante. Une vapeur couvrait les assiettes et voilait les verres ; les portes brusquement secouées envoyaient des exhalaisons de tabagie ; des troupeaux d’étudiants arrivaient encore et leur attente impatientée pressait les gens à table. De même que dans le buffet d’une gare, il fallait mettre les bouchées doubies, avaler son vin en toute hâte.
Ainsi, c’est là la fameuse table d’hôte qui distribuait jadis la becquée aux débutants de la politique, songeait M. Folantin, et, la pensée que ces gens qui emplissaient les salles de leur bacchanale deviendraient, à leur tour, de solennels personnages, gorgés et d’honneurs et de places, lui fit lever le coeur.
S’empiffrer de la charcuterie chez soi et boire de l’eau, tout, excepté de dîner ici, se dit-il.
— Prenez-vous du café ? demanda M. Martinet d’un ton aimable.
— Non, merci, j’étouffe, je vais respirer un peu. Mais M. Martinet n’était pas disposé à le quitter. Il le rejoignit sur le palier et lui saisit le bras.
— Où me menez-vous ? dit Folantin, découragé.
— Voyons, mon cher camarade, répondit M. Martinet, j’ai compris que ma table d’hôte ne vous plaisait guère ...
— Mai si ... mais si... pour le prix c’est même surprenant... seulement il faisait bien chaud, riposta timidement M. Folantin, qui craignait d’avoir blessé son hôte, par sa mine renfrognée et par sa fuite.
— Eh bien, nous ne nous voyons pas assez souvent pour que je veuille que vous vous sépariez de moi avec une mauvaise impression, fit M. Martinet d’un ton cordial. A propos, comment allons-nous tuer la soirée ? Si vous aimiez le théâtre, je vous proposerais d’aller à l’Opéra-Comique. — Nous avons le temps, dit-il, en examinant sa montre. On joue ce soir Richard Coeur-de-Lion et le Pré-aux-Clercs. Hein, qu’en dites-vous ?
— Tout ce que vous voudrez. — Après tout, pensa M. Folantin, peut-être arriverai-je à me distraire, et puis comment refuser la proposition de ce brave homme, dont j’ai déjà froissé tous les enthousiasmes ? — Voulez-vous me permettre de vous offrir un cigare, fit-il, en entrant chez un marchand de tabac.
Ils s’épuisèrent en vain pour activer la combustion de ces londrès, qui avaient un goût de chou et ne tiraient pas. — Encore un plaisir qui s’en va, se dit M. Folantin ; même en y mettant le prix, on ne peut plus se procurer maintenant un cigare propre ! Nous ferons mieux d’y renoncer, poursuivit-il en se tournant vers M. Martinet, qui aspirait de toutes ses forces sur le londrès dont la peau se crevait en fumant un peu. Du reste, nous voici arrivés ; — et il courut au guichet et rapporta deux stalles d’orchestre.
Richard commençait, dans une salle vide.
M. Folantin éprouva, pendant le premier acte une impression étrange ; cette série de chansons pour épinettes lui rappelait le tourniquet à musique d’un marchand de vins qu’il avait quelquefois hanté. Lorsque les ouvriers mettaient en branle la manivelle, un clapotis d’airs vieillots sonnait, quelque chose de très lent et de très doux, avec de temps à autre des notes cristallines et aiguës, sautant sur le tapotement mécanique des ritournelles.
Au second acte, une autre impression lui vint. L’air « Une fièvre brûlante » évoqua en lui l’image de sa grand-mère, qui le chevrotait sur le velours d’Utrecht de sa bergère ; et il eut, pendant une seconde, dans la bouche, le goût des biscottes qu’elle lui donnait, tout enfant, lorsqu’il avait été sage.
Il finit par ne plus suivre du tout la pièce ; d’ailleurs, les chanteurs n’avaient aucune voix et ils se bornaient à avancer des bouches rondes au-dessus de la rampe, tandis que l’orchestre s’endormait, las d’épousseter la poussière de cette musique.
Puis, au troisième acte, M. Folantin ne songea plus ni au tourniquet du marchand de vins, ni à sa grand-mère, mais il eut subitement dans le nez l’odeur d’une antique boîte qu’il avait chez lui, une odeur moisie, vague, dans laquelle était resté comme un relent de cannelle. Mon Dieu ! que tout cela est donc vieux !
— Joli opéra-comique, n’est-ce pas ? fit M. Martinet, en lui lançant un coup de coude.
M. Folantin tomba de son haut. Le charme était rompu ; ils se levèrent, pendant que la toile baissait, saluée par des salves de claque.
Le Pré-aux-Clercs, qui succédait à Richard, atterra M. Folantin. Jadis, il s’était pâmé aux airs connus ; maintenant toutes ces romances lui semblaient troubadour et dessus de pendule, et les interprètes l’irritaient. Le ténor se tenait en scène comme un frotteur et il nasillait, quand par hasard il lui coulait de la bouche un filet de voix. Costumes, décors, tout était à l’avenant ; on eût sifflé dans n’importe quelle ville de l’étranger et de la province, car nulle part on n’eût supporté un chanteur aussi ridicule et des cantatrices aussi baroques. Et la salle s’était emplie pourtant, et le public applaudissait aux passages soulignés par l’implacable claque.
M. Folantin souffrait réellement. Voilà que le Pré-aux-Clercs, dont il avait conservé un bon souvenir, s’effondrait aussi.
— Tout fiche le camp, se dit-il, avec un gros soupir.
Aussi, quand M. Martinet, enchanté de sa soirée, lui proposa de renouveler de temps à autre ces petites parties, d’aller ensemble, s’il le désirait, aux Français, M. Folantin s’indigna et, oubliant les réserves, qu’il s’était promis d’observer, il déclara violemment qu’il ne mettait plus les pieds dans ce théâtre.
— Mais pourquoi ? questionna M. Martinet.
— Pourquoi ? Mais d’abord, parce que s’il existait une pièce vivante et bien écrite — et je n’en connais aucune pour ma part, — je la lirais chez moi, dans un fauteuil, et ensuite parce que je n’ai pas besoin que des cabots, sans instruction pour la plupart, essaient de me traduire les pensées du Monsieur qui les a chargés de débiter sa marchandise.
— Mais enfin, dit M. Martinet, vous admettrez bien que des comédiens du Théâtre-Français...
— Eux ! s’écria M. Folantin, allons donc ! ce sont des Vatel de Palais-Royal, des sauciers, et voilà tout ! — Ils ne sont bons qu’à enduire les portions qu’on leur apporte, de l’immuable sauce blanche, s’il s’agit d’une comédie, et de l’éternelle sauce rousse, s’il s’agit d’un drame. Ils sont incapables d’inventer une troisième sauce ; d’ailleurs, la tradition ne le permettrait pas.
Ah ! ce sont de bien vulgaires routiniers que ces êtres-là ! Seulement, il faut leur rendre justice, ils s’entendent à la réclame, car ils ont emprunté aux grands magasins d’habits l’homme décoré qui se tient bien en vue dans les rayons et qui rehausse par sa présence le prestige de la maison et attire la clientèle !
— Oh ! voyons, Monsieur Folantin...
— Il n’y a pas de « voyons », c’est ainsi, et, au fond, je ne suis pas fâché de cette occasion qui se présente de donner mon avis sur le magasin de M. Coquelin. — Sur ce, cher Monsieur, me voici à destination. Je suis enchanté de notre rencontre. A bientôt, j’espère, et à l’avantage de vous revoir.
Les conséquences de cette soirée furent salutaires. Au souvenir de cette fatigue, de cette gêne, M. Folantin s’estimait content de dîner où bon lui semblait et de demeurer, pendant toute une soirée, dans sa chambre ; il jugea que la solitude avait du bon, que ruminer ses souvenirs et se conter à soimême des balivernes, était encore préférable à la compagnie des gens dont on ne partageait ni les convictions, ni les sympathies ; son désir de se rapprocher, de toucher le coude d’un voisin cessa et, une fois de plus, il se répéta cette désolante vérité : que lorsque les anciens amis ont disparu, il faut se résoudre à n’en point chercher d’autres, à vivre à l’écart, à s’habituer à l’isolement.
Puis il essaya de se concentrer, de prendre de l’intérêt aux moindres choses, d’extraire de consolantes déductions des existences remarquées près de sa table ; il alla dîner, pendant quelque temps, dans un petit bouillon près de la Croix Rouge. Cet établissement était généraiement fréquenté par des gens âgés, par de vieilles dames qui venaient, chaque jour, à six heures moins le quart, et la tranquillité de la petite salle le dédommageait de la monotonie de la nourriture. On eût dit des gens sans famille, sans amitiés, cherchant des coins un peu sombres pour expédier, en silence, une corvée ; et M. Folantin se trouvait plus à l’aise dans ce monde de déshérités, de gens discrets et polis, ayant sans doute connu des jours meilleurs et des soirs plus remplis. Il les connaissait presque tous de vue et il se sentait des affinités avec ces passants, qui hésitaient à choisir un plat sur la carte, qui émiettaient leur pain et buvaient à peine, apportant, avec le délabrement de leur estomac, la douloureuse lassitude des existences traînées sans espoir et sans but.
Là, pas d’appels bruyants, pas de cris ; les servantes consultaient les clients à voix basse. Mais si aucune de ces dames, aucun de ces messieurs, n’échangeait un propos, tous du moins se saluaient gracieusement, en entrant et en sortant, et ils apportaient des habitudes de salon dans cette gargote.
Je suis encore pius heureux que tout ce monde-là, se disait M. Folantin. Eux regrettent peut-être des enfants, des femmes, une fortune perdue, une vie jadis debout et maintenant par terre.
A force de plaindre les autres, il finit par se moins plaindre ; il rentrait chez lui et pensait tout de même que ses détresses étaient bien creuses et ses misères bien peu profondes. — Combien d’individus, à l’heure qu’il est, arpentent le pavé, sans gîte ; combien envieraient mon grand fauteuil, mon feu, mon paquet de tabac où je peux puiser à ma fantaisie ! et il activait les flammes de la cheminée, rôtissait ses pantoufles, confectionnait des grogs dorés et chauds. — S’il paraissait en librairie des livres réellement artistes, la vie serait, en somme, très supportable, concluait-il.
Plusieurs semaines s’écoulèrent ainsi, et son collègue de bureau déclara que M. Folantin rajeunissait. Il causait maintenant, écoutait avec une patience angélique tous les papotages, s’intéressait même aux infirmités de son copain ; puis, avec le froid qui commençait, l’appétit agissait plus régulièrement, et il attribuait cette amélioration aux vins créosotés et aux préparations de manganèse qu’il absorbait. — J’ai donc enfin expérimenté une médication moins infidèle et plus active que les autres, pensait-il. Et il la recommandait à toutes les personnes qu’il rencontrait.
Il atteignit ainsi l’hiver ; mais, aux premières neiges, sa mélancolie reparut. Le bouillon où il stationnait depuis l’automne le lassa et il recommença à brouter, au hasard, tantôt ici et tantôt là. Plusieurs fois il franchit les ponts et tenta de nouveaux restaurants ; mais, dans une bousculade, des garçons filaient, ne répondant pas aux appels ou bien ils vous lançaient votre plat sur la table et fuyaient quand on leur réclamait du pain.
La nourriture n’était pas supérieure à celle de la rive gauche et le service était arrogant et dérisoire. M. Folantin se le tint pour dit et il resta désormais dans son arrondissement, bien résolu à ne plus en démarrer.
Le manque d’appétit lui revint. Il constata une fois de plus l’inutilité des stomachiques et des stimulants, et les remèdes qu’il avait tant prônés allèrent rejoindre les autres, dans une armoire.
Que faire ? La semaine s’égouttait encore, mais c’était le dimanche qui lui pesait.
Jadis, il badaudait dans des quartiers déserts ; il se plaisait à longer les ruelles oubliées, les rues provinciales et pauvres, à surprendre, par les fenêtres des rez-de-chaussée, les mystères des petits ménages. Mais, aujourd’hui, les rues calmes et muettes étaient démolies, les passages curieux, rasés. Impossible de regarder par les portes entrouvertes des vieilles bâtisses, d’apercevoir un bout de jardinet, une margelle de puits, un coin de banc ; impossible de se dire que la vie serait moins rechignée, moins rogue, dans cette cour, de rêver à l’époque où l’on pourrait se retirer dans ce silence à réchauffer sa vieillesse dans de l’air plus tiède.
Tout avait disparu ; plus de feuillages de massifs, plus d’arbres, mais d’interminables casernes s’étendant à perte de vue ; et M. Folantin subissait dans ce Paris nouveau une impression de malaise et d’angoisse.
Il était l’homme qui détestait les magasins de luxe, qui, pour rien au monde, n’eût mis les pieds chez un coiffeur élégant ou chez un de ces modernes épiciers dont les montres ruissellent de gaz ; il n’aimait que les anciennes et simples boutiques où l’on était reçu à la bonne franquette, où le marchand n’essayait pas de vous jeter de la poudre aux yeux et de vous humilier par sa fortune.
Aussi avait-il renoncé à se promener, le dimanche, dans tout ce luxe de mauvais goût qui envahissait jusqu’aux banlieues. D’ailleurs, les flânes dans Paris ne le tonifiaient plus comme autrefois ; il se trouvait encore plus chétif, plus petit, plus perdu, plus seul, au milieu de ces hautes maisons dont les vestibules sont vêtus de marbre et dont les insolentes loges de concierge arborent des allures de salons bourgeois.
Pourtant, une partie de son quartier demeurée intacte, près du Luxembourg mutilé, était restée pour lui bienveillante et intime : la place Saint-Sulpice.
Parfois, il déjeunait chez un marchand de vins dont la boutique faisait l’angle de la rue du Vieux-Colombier et de la rue Bonaparte, et là, à l’entresol, par la fenêtre, il plongeait sur la place, contemplait la sortie de la messe, les enfants descendant du parvis, des livres à la main, un peu en avant des père et mère, toute la foule qui s’épandait autour d’une fontaine décorée d’évêques, assis dans des niches, et de lions accroupis au-dessus d’une vasque.
En se penchant un peu sur la balustrade, il apercevait le coin de la rue Saint-Sulpice, un terrible coin, balayé par le vent de la rue Férou et oceupé, lui aussi, par un marchand de vins qui possédait la clientèle assoiffée des chantres. Et cette partie de la place l’intéressait, avec sa vue de gens vacillant sur leurs pieds, la main au chapeau, sous la tourmente, près des grands omnibus de la Villette, dont les larges caisses rouge-brun s’alignent, au ras du trottoir, devant l’église.
La place s’animait, mais sans gaieté et sans fracas ; les fiacres dormaient à la station, devant un cabinet à cinq centimes et un trinckhall ; les énormes omnibus jaunes des Batignolles sillonnaient, en ballottant les rues, croisés par le petit omnibus vert du Panthéon et par la pâle voiture à deux chevaux d’Auteuil ; à midi, les séminaristes défilaient, deux à deux, les yeux baissés, avec un pas mécanique d’automates, se déroulant de Saint-Sulpice au séminaire, en une longue bande noire et blanche.
Sous un coup de soleil, la place devenait charmante : les tours inégales de l’église blondissaient ; l’or des annonces pétillait tout le long des débits de chasubles et de saints ciboires, le vaste tableau d’un déménageur avivait ses couleurs qui éclataient plus crues, et, sur l’armure d’un urinoir, une réclame de teinturier : deux chapeaux écarlates, jaillissant sur un fond noir, évoquait, dans ce quartier de bedeaux et de dévotes, les fastes d’une religion, les hautes dignités d’un sacerdoce.
Seulement, ce spectacle n’offrait à M. Folantin aucun imprévu. Combien de fois, dans sa jeunesse avait-il piétiné sur cette place, afin de regarder le vieux sanglier que possédait autrefois la maison Bailly ; combien de fois, le soir, avait-il écouté la complainte d’un chanteur en plein vent, près de la fontaine ; combien de fois avait-il flâné, les jours de marché aux fleurs, près du séminaire ?
Depuis longtemps déjà, il avait épuisé le charme de ce lieu tranquille ; pour le savourer à nouveau, il fallait maintenant qu’il espaçât ses visites, qu’il ne le parcourût qu’à de rares intervalles.
Aussi, la place Saint-Sulpice ne lui était-elle plus d’aucun secours le dimanche et il préférait les autres jours de la semaine, car, allant à son bureau, il était moins désoeuvré ; ah ! décidément, le dimanche devenait interminable ! Ce matin-là, il déjeunait un peu plus tard que de coutume et il s’éternisait à table, pour laisser au portier le temps de nettoyer la chambre, et jamais elle n’était rangée quand il revenait ; il butait contre les tapis en rouleaux, et il avançait dans le nuage soulevé par les balais. Une, deux, le pipelet retapait les draps, étendait les tapis et il partait sous prétexte qu’il ne voulait pas déranger monsieur.
M. Folantin récoltait de la poussière sur tous les meubles avec ses doigts, rangeait ses habits entassés sur un fauteuil, envoyait çà et lit un coup de plumeau et remettait de la cendre dans son crachoir ; ensuite, il comptait le linge que rapportait parfois la blanchisseuse ; un tel dégoût l’assaillait à la vue de la charpie de ses chemises, qu’il les fichait, sans plus les examiner, dans un tiroir.
La journée s’égrappait encore facilement jusqu’à quatre heures. Il relisait de vieilles lettres de parents et d’amis depuis longtemps morts ; il feuilletait quelques-uns de ses livres, en dégustait quelques passages, mais vers les cinq heures, il commençait à souffrir ; le moment approchait où il allait falloir se rhabiller ; l’idée seule de déguerpir lui réprimait la faim, et, certains dimanches, il ne bougeait pas — ou bien s’il appréhendait un tardif appétit, il descendait en pantoufles et il acquérait deux petits pains, un pâté ou des sardines. Il avait toujours un peu de chocolat et de vin dans un placard et il mangeait, heureux d’être chez lui, de jouer des coudes, de s’étaler, d’éviter, pour une fois, la place restreinte d’un restaurant ; seulement, la nuit était mauvaise ; il se réveillait, en sursaut, avec des tiraillements et des frissons ; quelquefois l’insomnie durait une heure, et l’obscurité animant toutes les idées tristes, il se rabâchait les mêmes plaintes que dans le jour et il en arrivait à regretter de n’être pas un concubin. Le mariage est impossible, à mon âge, se disait-il. — Ah ! si j’avais eu, dans ma jeunesse une maîtresse et si je l’avais conservée, je finirais mes années avec elle, j’aurais, à mon retour, ma lampe allumée et ma cuisine prête. Si la vie était à recommencer je la mènerais autrement ! je me ferais une alliée pour mes vieux jours ; décidément, j’ai trop présumé de mes forces, je suis à bout. — Et, le matin venu, il se levait les jambes brisées, la tête étourdie et molle.
Le moment était du reste pénible ; l’hiver sévissait et le froid de la bise rendait enviable le chez soi et odieux le séjour des traiteurs dont on ouvre constamment les portes. Tout à coup, un grand espoir bouleversa M. Folantin. Un matin, dans la rue de Grenelle, il avisa une nouvelle pâtisserie qui s’installait. Cette inscription flambait en lettres de cuivre, sur les carreaux : « Dîners pour la ville. »
M. Folantin eut un éblouissement. Est-ce que ce rêve si longtemps caressé de se faire monter à dîner chez soi allait pouvoir enfin se réaliser ? — Mais il resta découragé, se rappelant ses inutiles chasses dans le quartier, à la recherche d’un établissement qui consentît à porter au-dehors de la nourriture.
Ça ne coûte rien de demander, se dit-il enfin, et il entra.
— Mais certainement, Monsieur, lui répondit une jeune dame enfouie dans un comptoir et dont le buste était entouré de Saint-Honoré et de tartes. Rien n’est plus facile, puisque vous logez à deux pas. Et à quelle heure désirez-vous qu’on vienne ?
— A six heures, fit M. Folantin, tout palpitant.
— Parfaitement.
Le front de M. Folantin s’assombrit.
— Maintenant, reprit-il, en bredouillant un peu, voilà, je voudrais un potage, un plat de viande et un légume, quel serait le prix ?
La dame parut s’absorber dans des réflexions, murmurant, les yeux au ciel... potage... viande... légume. — Vous ne prenez pas de vin ?
— Non, j’en ai chez moi.
— Eh bien, Monsieur, dans ces conditions-là, ce serait deux francs.
La figure de M. Folantin s’éclaira. — Soit, dit-il, c’est convenu ; et quand pourrons-nous commencer ?
— Mais quand il vous plaira, ce soir, si vous voulez.
— Ce soir même, Madame. — Et il s’inclina et fut salué par une courbette si profonde, dans le comptoir, que le nez de la dame faillit creuser les Saint-Honoré et percer les tartes.
Dans la rue, M. Folantin s’arrêta, après quelques pas. Ça y est ! en voilà une chance, se dit-il ; puis, sa joie se modéra. Pourvu que cette boustifaille ne soit que médiocre. Baste ! j’ai subi, dans ma pauvre vie, tant d’exécrables plats que je n’ai pas le droit de me montrer difficile. — Elle est gentille, cette dame, reprit-il ; ce n’est pas qu’elle soit jolie, mais elle a des yeux bien expressifs ; pourvu qu’elle fasse de bonnes affaires ! Et, tout en reprenant sa trotte, il souhaita la prospérité de la pâtissière.
Ensuite, il s’ingénia à parer au désordre du premier soir ; il commanda chez un épicier six litres de vin, puis, quand il fut arrivé à son bureau, il établit une petite liste des denrées qu’il achèterait :
Confitures ;
Fromage ;
Biscuits ;
Sel ;
Poivre ;
Moutarde ;
Vinaigre ;
Huile.
Je ferai monter, tous les jours, le pain par mon concierge ; ah ! sapristi, si ça peut réussir, je suis sauvé !
Il aspira après la fin de la journée ; sa hâte à jouir de son contentement, tout seul, retardait encore la marche des heures.
Il consultait de temps à autre sa montre.
Son collègue, qu’avait déjà stupéfié l’air extatique de M. Folantin rêvant à son intérieur, sourit.
— Avouez qu’elle vous attend, dit-il.
— Qui ça, elle ? interrogea M. Folantin très étonné.
— Allons, c’est bon, vous voulez apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Voyons, blague à part, elle est blonde ou brune ?
— Oh ! mon ami, répliqua M. Folantin, je puis vous assurer que j’ai vraiment autre chose à penser qu’aux femmes.
— Oui, oui... je sais bien, ça se dit. Ah ! ah ! farceur, vous êtes encore un chaud de la pince, vous !
— Tenez, messieurs, copiez cela, tout de suite ; il me faut ces deux lettres pour la signature de ce soir ; et le chef entra et disparut.
— C’est absurde, il y a quatre pages serrées, grogna M. Folantin ; je n’aurai pas fini avant cinq heures. — Mon Dieu, que c’est donc bête ! reprit-il, s’adressant à son collègue qui ricanait, tout en murmurant : Dame ! mon cher, l’administration ne peut pourtant pas s’occuper de ces détails.
Tant bien que mal, tout en maugréant, il termina sa tâche, puis il retourna chez lui par la voie la plus courte, les bras chargés de paquets, les poches bourrées de sacs ; il respira, une fois enfermé, mit ses chaussons, donna un coup de serviette au peu de vaisselle qu’il possédait, essuya ses verres et, ne trouvant ni planchette ni grès pour récurer les lames de ses couteaux, il les plongea dans la terre d’un vieux pot de fleur et parvint à les faire un peu reluire.
— Ouf ! dit-il en approchant la table du feu, je suis prêt ; six heures tintèrent.
M. Folantin attendait le mitron avec impatience, et il avait un peu en lui de cette fièvre qui l’empêchait, dans sa jeunesse, de tenir en place, quand un ami s’attardait, inexact au rendez-vous.
Enfin à six heures un quart, la sonnerie carillonna et un galopin s’avança entraîné, le nez en avant, par le poids d’une grande boîte en fer-blanc, de la forme d’un seau ; M. Folantin aida à distribuer sur la table les assiettes, qu’il découvrit lorsqu’il fut seul. Il y avait un bouillon au tapioca, un veau braisé, un chou-fleur à la sauce blanche.
Mais ce n’est pas mauvais, se dit-il en goûtant à chacun de ces plats, et il se gava de bon appétit, but un peu plus que de coutume, puis il tomba dans une douce rêverie, en contemplant sa chambre.
Depuis des années, il manifestait l’intention de la décorer, mais il se répétait : Baste ! à quoi bon ? je ne vis pas chez moi ; si plus tard je puis m’arranger une autre existence, j’organiserai mon intérieur. Mais tout en n’achetant rien, il avait déjà jeté son dévolu sur bien des bibelots qu’il reluquait, en rôdant sur les quais et dans la rue de Rennes.
L’idée d’habiller les murs glacés de sa chambre s’implanta tout à coup en lui, tandis qu’il lampait un dernier verre. Son indécision cessait ; il était déterminé à dépenser les quelques sous qu’il entassait depuis des années dans ce but, et il eut une soirée charmante, réglant d’avance la toilette de son réduit. Je me lèverai demain, de bonne heure, conclut-il, et j’irai tout d’abord faire un tour chez les marchands de nouveautés et les bric-à-brac.
Son désoeuvrement prenait fin ; un nouvel intérêt se glissait en lui ; la préoccupation de découvrir, sans trop dépenser d’argent, quelques gravures, quelques faïences, le soutenait et, après son bureau, il déployait une hâte fébrile, escaladait les étages du Bon Marché et du Petit Saint-Thomas, remuant des masses d’étoffes, les trouvant trop foncées ou trop claires, trop étroites ou trop larges, refusant les rebuts et les soldes que les calicots s’efforçaient de tarir, les obligeant à exhiber des marchandises qu’ils réservaient. A force de les tanner, de les tenir en haleine, pendant des heures, il finit par se faire montrer des rideaux tout faits et des tapis qui le séduisirent.
Après ces emplettes et après de féroces discussions chez les débitants de bibelots et d’estampes, il demeura sans le sou ; toutes ses économies étaient épuisées ; mais, comme un enfant à qui l’on vient d’offrir de nouveaux jouets, M. Folantin examinait, remuait ses achats dans tous les sens. Il grimpait sur les chaises pour attacher les cadres et il disposait ses livres en un autre ordre. L’on est bien chez soi, se disait-il ; et, en effet, sa chambre n’était plus reconnaissable. Au lieu de murailles aux papiers éraillés par d’anciennes traces de clous, les cloisons disparaissaient sous les gravures d’Ostade, de Teniers, de tous les peintres de la vie réelle dont il raffolait. Un amateur eût certainement haussé les épaules devant ces estampes sans aucune marge, mais M. Folantin n’était ni connaisseur, ni riche ; il acquérait surtout les sujets de la vie humble qui lui plaisaient, et il se moquait d’ailleurs de l’authenticité de ses vieux plats, pourvu que les couleurs en fussent actives et propres à égayer ses murs.
Il aurait fallu changer aussi mes meubles d’acajou, se dit-il, considérant son lit à bateau, ses deux voltaires au damas roussi, sa toilette au marbre fendu, sa table au plaque rougeâtre, mais ce serait trop cher, et du reste les rideaux et les tapis rajeunissent suffisamment ce mobilier qui, de même que mes vieux vêtements, est fait à mes mouvements et à mes habittides.
Aussi quel empressement à rentrer maintenant chez lui, à éclairer tout, à s’enfoncer dans son fauteuil ! Le froid lui semblait parqué au-dehors, repoussé par cette intimité de petit coin choyé, et la neige qui tombait, qui assoupissait tous les bruits de la rue, ajoutait encore à son bien-être ; dans le silence du soir, le dîner, les pieds devant le feu, tandis que les assiettes chauffaient devant la grille, près du vin dégourdi, était charmant, et les ennuis du bureau, la tristesse du célibat s’envolaient dans cette pacifiante quiétude.
Sans doute, huit jours ne s’étaient pas écoulés et déjà le pâtissier se relâchait. L’invariable tapioca était plein de grumeaux et le bouillon était fabriqué par des procédés chimiques ; la sauce des viandes puait l’aigre madère des restaurants ; tous les mets avaient un goût à part, un goût indéfinissable, tenant de la colle de pâte un peu piquée, et du vinaigre éventé et chaud. M. Folantin poivra vigoureusement sa viande et sinapisa ses sauces ; baste ! ça s’avale tout de même, disait-il ; le tout, c’est de se faire à cette mangeaille !
Mais la mauvaise qualité des plats ne devait pas rester stationnaire et, peu à peu, elle s’accéléra, encore aggravée par les constants retards du petit mitron. Il arrivait à sept heures, couvert de neige, son réchaud éteint, des pochons sur les yeux et des égratignures tout le long des joues. M. Folantin ne pouvait douter que ce garçon déposât sa boîte auprès d’une borne et se flanquât une pile en règle avec les gamins de son âge. Il lui en fit doucement l’observation ; l’autre pleurnicha, jura, en étendant le bras et en crachant par terre, un pied en avant, qu’il n’en était rien et continua de plus belle ; et M. Folantin se tut, pris de pitié, n’osant se plaindre à la pâtissière, de peur de nuire à l’avenir du gosse.
Pendant un mois encore, il supporta vaillamment tous ces déboires ; et pourtant le coeur lui défaillait quand il devait ramasser sa viande tombée dans le fer blanc, car il y avait des jours où une tempête semblait s’être abattue dans la boîte, où tout était sens dessus dessous, où la sauce blanche se mêlait au tapioca, dans lequel s’enlisaient des braises.
Il eut heureusement un temps de répit : le petit pâtissier avait été congédié, sur les plaintes sans doute de personnes moins indulgentes. Son successeur fut un long dadais, une sorte de jocrisse au teint blême et aux grandes mains rouges. Celui-là était exact, arrivait à six heures précises, mais sa saleté était répugnante ; il était vêtu de torchons de cuisine roides de graisse et de crasse, ses joues étaient barbouillées de farine et de suie et son nez mal mouché, coulait en deux vertes rigoles tout le long de la bouche.
M. Folantin para énergiquement ce nouveau coup ; il renonça aux sauces, aux assiettes maculées il transféra sa viande sur une assiette à lui, la racla, la nettoya et la mangea avec du sel.
En dépit de sa résignation, le moment vint où certains plats lui donnèrent des nausées, il tâtait maintenant de tous les godiveaux ratés, de toutes les pâtisseries brûlées ou gâtées par les cendres ; il pêchait de vieilles boulettes de tourtes dans tous les plats ; enhardi par sa bienveillance, le pâtissier mettait de côté toute pudeur, toute vergogne et lui dépêchait tous les résidus de sa cuisine.
L’empoisonneuse ! murmurait M. Folantin, devant la boutique de la pâtissière, qu’il ne jugeait plus si gentille, et il la regardait de côté, ne souhaitant plus du tout, à l’heure présente, la prospérité de ses affaires.
Il eut recours aux oeufs durs. Il en achetait chaque jour, redoutant, pour le soir, un dîner impossible. — Et quotidiennement il se bourra de salades ; mais les oeufs putridaient, la fruitière lui vendant, en sa qualité d’homme qui ne s’y connaissait pas, les oeufs les plus avariés de sa boutique.
Tâchons d’atteindre le printemps, se disait M. Folantin pour se remonter ; mais, de semaines de semaines, son énergie se désarmait, en même temps que son corps, déplorablement nourri, criait famine. Sa gaieté s’effondra ; son intérieur se rembrunit ; le cortège des anciennes détresses cerna de nouveau son existence désoeuvrée. — Si j’avais une passion quelconque ; si j’aimais les femmes, le bureau, si j’aimais le café, le domino, les cartes, je pourrais bouffer au-dehors, ruminait-il, car je ne resterais jamais chez moi. Mais hélas ! rien ne me divertit, rien ne m’intéresse ; et puis mon estomac se détraque ! Ah ! ce n’est pas pour dire, mais les gens qui ont dans leur poche de quoi s’alimenter et qui ne peuvent cependant manger, faute d’appétit, sont tout aussi à plaindre que les malheureux qui n’ont pas le sou pour apaiser leur faim !
IV
Un soir qu’il chipotait des oeufs qui sentaient la vesse, le concierge lui présenta une lettre de faire-part ainsi conçue:
+
M
Les religieuses de la Compagnie de Sainte-Agathe vous supplient très humblement de recommander à Dieu dans vos prières et au Saint Sacrifice de la Messe, l’âme de leur chère soeur Ursule, Aurélie Bougeard, religieuse de choeur, décédée, le 7 septembre 1880, dans la soixante-deuxième année de son âge et la trente-cinquième de sa profession religieuse, munie des Sacrements de Notre Sainte Mère l’Eglise.
De profundis !
Doux coeur de Marie, soyez mon salut !
(300 jours d’ind.)
C’était une cousine à lui qu’il avait autrefois aperçue, dans son enfance ; jamais, depuis vingt ans, il n’avait songé à elle et la mort de cette femme lui porta cependant un grand coup ; elle était sa dernière parente et il se crut encore plus esseulé depuis qu’elle était décédée, dans le fond d’une province. Il envia sa vie calme et muette et il regretta la foi qu’il avait perdue. Quelle occupation que la prière, quel passe-temps que la confession, quels débouchés que les pratiques d’un culte ! — Le soir, on va à l’église, on s’abîme dans la contemplation, et les misères de la vie sont de peu ; puis les dimanches s’égouttent dans la longueur des offices, dans l’alanguissement des cantiques et des vêpres, car le spleen n’a pas de prise sur les âmes pieuses.
Oui, mais pourquoi la religion consolatrice n’est-elle faite que pour les pauvres d’esprit ? Pourquoi l’Eglise a-t-elle voulu ériger en articles de foi les croyances les plus absurdes. Je ne puis cependant admettre, ni la virginité d'une accouchée, ni la divinité d'un comestible qu'en prépare chez un fabricant de pâtes, se disait-il; enfin, l’intolérance du clergé, le révoltait. Et pourtant le mysticisme pourrait seul panser la plaie qui me tire. — C’est égal, on a tort de démontrer aux fidèles l’inanité de leurs adorations, car ceux-là sont heureux qui acceptent comme une épreuve passagère toutes les traverses, toutes les afflictions de la vie présente. — Ah ! la tante Ursule a dû mourir sans regrets, persuadée que les allégresses infinies allaient éclore !
Il pensa à elle, tâcha de se rappeler ses traits, mais sa mémoire n’en avait gardé aucune trace ; alors, pour se rapprocher un peu d’elle, pour s’immiscer un peu dans l’existence qu’elle avait menée, il relut le mystérieux et pénétrant chapitre des Misérables, sur le couvent du Petit-Picpus.
Pristi ! c’est payer cher l’improbable bonheur d’une vie future, se dit-il. Le couvent lui apparut comme une maison de force, comme un lieu de désolation et de terreur. Ah bien, pas de ça ! je ne jalouse plus le sort de la tante Ursule ; mais c’est égal, les malheurs de l’un ne consolent pas les malheurs de l’autre et, en attendant, la boustifaille du pâtissier devient inabordable.
Deux jours après, il reçut, en plein crâne, une nouvelle douche.
Pour faire diversion aux dîners composés de salades et de desserts, il retourna dans un restaurant ; il n’y avait personne, mais le service était lent et le vin fleurait la benzine.
— Enfin, l’on n’est pas foulé, c’est déjà quelque chose, se dit, en guise de consolation, M. Folantin.
La porte s’ouvrit, un soufflet lui éventa le dos ; il entendit un grand frou-frou de jupes et sa table se couvrit d’ombre. Une femme était devant lui, qui dérangeait la chaise sur les barreaux de laquelle il appuyait ses pieds. Elle s’assit, et posa sa voilette et ses gants près de son verre.
— Que le diable l’emporte, grommela-t-il, elle n’a que l’embarras du choix, toutes les tables sont vides ; et elle vient, juste, s’installer à la mienne !
Machinalement, il leva les yeux, qu’il tenait baissés sur son assiette, et il ne put s’empêcher d’inspecter sa voisine. Elle avait une figure de petit singe, une margoulette fripée, avec une bouche un peu grande marchant sous un nez retroussé, et de toutes petites moustaches noires au bout des lèvres ; malgré ses airs folichons, elle lui sembla cependant polie et réservée.
Elle lui dardait de temps à autre un coup d’oeil et, d’une voix très douce, le priait de lui passer la carafe ou le pain. En dépit de sa timidité, M. Folantin dut répondre à quelques questions qu’elle lui lança ; peu à peu la conversation s’était engagée, et au dessert, ils déploraient, ne sachant trop quoi dire, l’aigre bise qui sifflait au dehors, en leur glaçant les jambes.
— C’est des temps où il ferait bon de ne pas coucher seul, fit la femme d’un ton rêveur.
Cette réflexion abasourdit M. Folantin, qui ne crut pas devoir répondre.
— N’est-ce pas, Monsieur, reprit-elle ?
— Mon Dieu !... Mademoiselle... et, comme un poltron, qui jette ses armes, pour ne pas engager une lutte avec son adversaire, M. Folantin avoua sa continence, son peu de besoins, son désir de tranquillité charnelle.
— Avec ça ! dit-elle, en le regardant bien dans les yeux.
Il se troubla, d’autant que le corsage qu’elle avançait exhalait un arôme de new-mown-hay et d’ambre.
— Je n’ai plus vingt ans, et, ma foi, je n’ai plus de prétentions — si j’en ai jamais eu ; — ce n’est plus de mon âge. Et il désigna sa tête chauve, son teint plombé, ses vêtements qui n’appartenaient plus à aucune mode.
— Laissez donc, vous voulez rire, vous vous faites plus vieux que vous n’êtes ; et elle avait ajouté qu’elle n’aimait pas les jeunes gens, qu’elle préférait les hommes mûrs, parce que ceux-là savent se conduire avec une femme.
— Sans doute... sans doute, balbutia M. Folantin, qui demanda l’addition, la femme ne tira pas son porte-monnaie, et il comprit qu’il fallait s’exécuter. Il solda au garçon railleur le prix des deux dîners et il s’apprêtait à saluer la femme, sur le seuil de la porte, lorsqu’elle lui prit tranquillement le bras.
— Tu m’emmènes, dis, monsieur ?
Il chercha des échappatoires, des excuses pour éviter ce mauvais pas, mais il s’embrouillait, il faiblissait sous les yeux de cette femme dont la parfumerie lui serrait les tempes.
— Je ne puis, finit-il par répondre, on n’amène pas de femmes dans ma maison.
— Alors, venez chez moi ; — et elle se pressa contre lui, jacassa et allégua qu’elle avait un bon feu dans sa chambre. — Puis, voyant la morne attitude de M. Folantin, elle soupira : Alors je ne vous plais pas ?
— Mais si, Madame... mais si... seulement on peut trouver une femme charmante et ne point...
Elle se mit à rire. — Est-il drôle ! dit-elle, et elle l’embrassa.
M. Folantin eut honte de ce baiser en pleine rue ; il eut la perception du grotesque qui dégageait un vieil homme boiteux choyé publiquement par une fille. Il allongea les jambes, voulant se soustraire à ces caresses et craignant en même temps, s’il essayait de fuir, une scène ridicule qui ameuterait le monde.
— C’est ici, dit-elle, et elle le poussa légèrement, marchant derrière lui, lui barrant la retraite. Il monta jusqu’à un troisième et, contrairement aux affirmations de cette femme, il ne vit aucun feu allumé chez elle.
Il regarda, très penaud, la chambre dont les murs semblaient trembler, à la lueur vacillante d’une bougie ; une chambre aux meubles couverts de laine bleue et au divan tapissé d’algérienne. Une bottine crottée traînait sous une chaise et une pincette de cuisine lui faisait vis-à-vis sous une table ; çà et là, des réclames de marchands de semoule, de chastes chromos représentant des babys barbouillés de soupe étaient piquées sur le mur par des épingles ; le pied d’un gueux apparaissait sous la trappe mal baissée de la cheminée sur le faux marbre de laquelle s’étalaient, près d’un réveil-matin et d’un verre où l’on avait bu, de la pommade dans une carte à jouer, du tabac et des cheveux dans un journal.
— Mets-toi donc à ton aise, fit la femme, et malgré son refus de se dévêtir, elle saisit les manches de son pardessus et s’empara de son chapeau.
— J. F., je parie que tu t’appelles Jules, dit-elle en regardant les lettres de la coiffe.
Il confessa se nommer Jean.
— C’est pas un vilain nom ; dis donc !... et elle le força à s’asseoir sur un canapé et sauta sur ses genoux.
— Dis donc, chéri, qu’est-ce que tu vas me donner pour mes petits gants ?
M. Folantin sortit péniblement une pièce de cent sous de sa poche et elle la fit prestement disparaître.
— Voyons, tu peux bien m’en donner une autre, je me déshabillerai, tu verras, comme je serai gentille.
M. Folantin céda, tout en déclarant qu’il préférait qu’elle ne fût pas nue, et alors elle l’embrassa si habilement qu’une bouffée de jeunesse lui revint, qu’il oublia ses résolutions et perdit la tête ; puis à un moment, comme il tardait, tout en s’empressant. — Ne t’occupe pas de moi... dit-elle, ne t’occupe pas de moi ... fais ton affaire.
M. Folantin descendit de chez cette fille, profondément écoeuré et, tout en s’acheminant vers son domicile, il embrassa d’un coup d’oeil l’horizon désolé de la vie ; il comprit l’inutilité des changements de routes, la stérilité des élans et des efforts ; il faut se laisser aller à vau-l’eau ; Schopenhauer a raison, se dit-il, « la vie de l’homme oscille comme un pendule entre la douleur et l’ennui ». Aussi n’est-ce point la peine de tenter d’accélérer ou de retarder la marche du balancier ; il n’y a qu’à se croiser les bras et à tâcher de dormir ; mal m’en a pris d’avoir voulu renouveler les actes du temps passé, d’avoir voulu aller au théâtre, fumer un bon cigare, avaler des fortifiants et visiter une femme ; mal m’en a pris de quitter un mauvais restaurant pour en parcourir de non moins mauvais, et tout cela pour échouer dans les sales vol-au-vent d’un pâtissier !
Tout en raisonnant de la sorte, il était arrivé devant sa maison. Tiens, je n’ai pas d’allumettes, se dit-il, en fouillant ses poches, dans l’escalier ; il pénétra dans sa chambre, un souffle froid lui glaça la face et, tout en s’avançant dans le noir, il soupira : le plus simple est encore de rentrer à la vieille gargote, de retourner demain à l’affreux bercail. Allons, décidément, le mieux n’existe pas pour les gens sans le sou ; seul, le pire arrive.