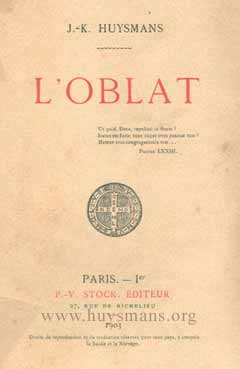CHAPITRE V
Notre ami, dit Mme Bavoil, le mercredi soir, veille du déjeuner, à Durtal, je ne puis pas être à la fois à Dijon et devant mes fourneaux ; il faut donc que vous preniez, demain, le premier train et que vous rapportiez un pâté et des gâteaux.
— Et une bouteille de chartreuse verte, car c’est je crois, la seule liqueur dont Mlle de Garambois ne fasse pas fi.
— Et une bouteille de chartreuse verte, appuya Mme Bavoil.
Le lendemain matin, Durtal débarquait, en effet, à Dijon. Le plus pressé, pensait-il, en sortant de la gare, c’est d’aller entendre la messe à Notre-Dame ; ce après quoi, je m’attarderai longuement auprès de la vierge noire, car j’ai bien des heures à tuer ; enfin pour ne pas les trimbaler avec moi trop longtemps, je m’occuperai des emplettes, en dernier lieu.
Comme d’habitude, lorsqu’il mettait, par un ciel presque clair, les pieds dans cette ville, il se sentait l’âme bénigne et lénifiée, presque joyeuse. Il aimait l’atmosphère intime et la gaieté de bonne commère de Dijon ; il aimait l’accueil avenant et empressé de ses boutiques, la vie populaire de ses rues, le charme un peu désuet de ses vieilles places et de ses squares plantés de grands arbres et parés de jolies fleurs.
Malheureusement, il commençait à en être de cette cité de même que des autres villes qui s’ingénient à simuler la redondante laideur du Paris neuf ; les anciennes rues disparaissaient ; de nouveaux quartiers surgissaient de toutes parts, avec des bâtisses insolentes avançant des balcons chambrés, à l’anglaise, dans des boîtes de fer, aménagées de carreaux de couleur, distribués en cases de jeu de dame, par des losanges divisés de plomb ; l’impulsion était donnée ; en trente ans, Dijon avait plus changé qu’en plusieurs siècles ; il était sillonné maintenant d’amples avenues baptisées de ces noms délabrés de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire, de la république et de Thiers, de Carnot et de la liberté et, pour comble, une statue de cette bruyante ganache de Garibaldi s’élevait, évoquant, dans le coin d’un carrefour pacifique, le souvenir d’un chienlit de guerre, ignoble. La vérité était qu’à l’ancien bourguignon, religieux et boute-en-train, égrillard et frondeur, s’était substitué un autre Bourguignon qui avait conservé ses qualités de terroir mais avait perdu son étampe originale, en perdant la foi. Dijon était devenu en même temps que républicain, indifférent ou athée. La bonhomie et l’alacrité demeuraient, mais la saveur de ce mélange de naïve piété et de liesse rabelaisienne, n’était plus ; et Durtal ne pouvait s’empêcher de le déplorer un peu.
Malgré tout, cette ville est encore l’une des seules où l’on puisse, en province, aimablement flâner, se disait-il en descendant l’avenue de la gare ; il enfila la place Darcy où la gloire qui subsiste encore, en cet endroit, du sculpteur Rude s’affirme en une confiante statue de bronze et, franchissant la porte Guillaume, il s’engagea dans la rue de la liberté, jusqu’à la rue des forges, tourna et arriva devant la façade de Notre-Dame.
Là, il s’arrêta pour contempler, une fois de plus, la grave et maligne église ; malgré les rafistolages qu’elle avait subis, elle était restée bien personnelle, bien à part dans l’art du treizième siècle ; elle ne ressemblait à aucune autre, avec ses deux étages d’arcatures, formant des galeries ajourées, au-dessus des trois baies profondes du grand porche. Et des files de grotesques se succédaient, à chaque étage, en de larges frises, des grotesques réparés et même complètement refaits, mais très habilement, par un artiste ayant eu vraiment le sens du Moyen-Age. Il était assez difficile, à la hauteur où ils se démenaient et, faute d’un recul suffisant, de les bien voir ; l’on discernait néanmoins, ainsi que dans l’habituel troupeau des monstres nichés sur les tours des cathédrales, les deux séries, mal délimitées, des démons et des hommes.
Les démons, sous l’aspect connu des mauvais anges, aux ailes papelonnées d’écailles, au chef hérissé de cornes, arborant un masque de gorgone entre les jambes ; ou d’animaux extravagants, de lions mâtinés de génisse ; de bêtes à mufle de léopard et à pelage d’onagre ou de bouc ; de boeufs à physionomie presque humaines souriant avec des rictus de vieilles ivrognesses qui guignent un litre ; de monstres innommables, ne dépendant d’aucune famille précise, tenant de la panthère et du porc, de la bayadère et du veau. — Les hommes, tordus en des attitudes douloureuses et cocasses, la tête retournée sens devant derrière sur les épaules et les yeux fous ; d’autres, aux figures camuses, aux narines évasées, aux bouches creusées en entonnoirs ; d’autres encore, aux trognes baroques, aux mines de vieux bourgeois hilares et salaces ou de frères-frapparts trop joyeusement repus ; d’autres enfin, à faces grimaçantes de gnomes, couverts de bonnets pareils à des tourtes, ouvrant des gueules qui semblent, en guise de poires d’angoisse, baillonnées par des tricornes ; — et, au milieu de tous ces animaux de démence, de tous ces êtres de cauchemar, une vraie femme, priant, affolée, les mains jointes, une figure de terreur et de foi, prisonnière dans cette ménagerie de larves, implorant les prières des passants, suppliant, éperdue, qu’on l’aide à se sauver, à trouver grâce.
Elle était le seul cri d’âme qui s’échappât de cette église dont la façade rectiligne, inconnue de l’art gothique et empruntée au souvenir de ces constructions romaines qui survécut, pendant le Moyen-Age, en Bourgogne, eût été uniforme et trop austère et bien peu assortie au tempérament railleur des dijonnais, si l’intrusion de la tératologie dans cet édifice n’était venue en interrompre la monotonie et la rigidité.
Sans ce cirque de bouffons et de diables, Notre-Dame eût paru rapportée d’une autre région, étrangère à ce pays qui la bâtit.
L’art ogival réapparaissait pourtant, dans ses allures coutumières, avec les longues et minces tourelles, coiffées de toits en éteignoirs, qui se dressaient de chaque côté de la façade. Sur celle de gauche, s’élevait le célèbre jacquemart, capturé, en 1381, par Philippe Le Hardi, à Courtrai ; mais ce drille flamand chargé de frapper avec un marteau sur un timbre, les heures, n’était plus comme jadis enfermé dans un clocheton bariolé de tons vifs et frotté d’or ; il était interné maintenant dans une cage de fer noir et on lui avait adjoint une compagne, puis un enfant, puis deux. Ils étaient devenus, à vrai dire, des poupées, découpées dans une image d’épinal et agrandies, sans ingénuité suffisante d’art.
Ce bonshommes étaient quand même plaisants et Durtal se rappelait, en les examinant, le seul artiste dont la Bourgogne ne chercha point à s’enorgueillir, Aloysius Bertrand qui, dans son Gaspard de la Nuit, les prôna en des phrases d’un relief rigoureux et d’une couleur singulière ; mais cette cité, confite en la dévotion attardée de ses grands hommes La Monnoye et Piron, Crébillon et Rameau, Dubois et Rude, et privée de celle de Bossuet dont la gloire lui avait été soustraite par la ville de Meaux, paraissait ignorer jusqu’au titre même de ce livre.
Quant au reste de l’édifice, avec ses sages arc-boutants et ses raisonnables contre-forts, il était quelconque ; sa tour centrale, ainsi que ses quatre tourelles à capuces pointus, étaient modernes ; il n’y avait plus de figures sculptées sous les voûtes du portail, car elles avaient été détruites pendant la Révolution par la canaille qui composait, de même que partout alors, le municipe. Somme toute, l’attrait extérieur de Notre-Dame résidait dans sa façade et se confinait là.
En revanche, malgré tous les retapages qu’il avait endurés, l’intérieur avait conservé le charme familier de ses vieux ans. Notre-Dame de Dijon ne possédait pas l’empreinte mystérieuse et l’attitude imposante des grandes églises sombres. Elle était claire et blanche ; elle gardait toujours quelque chose d’un mois de Marie, même pendant la Semaine Sainte ; la disparition de ses anciens vitraux aidait peut-être à se suggérer cette impression qu’elle laissait de fête juvénile et d’aise. L’on ne pouvait évidemment comparer sa nef et ses bas-côtés à ceux des immenses cathédrales, mais elle était, en sa petite taille, svelte et légère, bien prise dans sa ceinture de piliers aux chapiteaux fleuris d’arums et de crosses retournées de fougères et, arrivée au transept, elle tentait un dernier effort, s’élançait dans le vide avec sa lanterne de pierre, reconstruite sur un nouveau plan.
Arrêtée là, au choeur, elle arrondissait derrière l’autel une abside qu’éclairait une panoplie de boucliers et de lames d’épées peintes, en verre. Aucune galerie circulaire ne permettait de déambuler autour du choeur ; l’église était close, à la table de communion, pour les fidèles. Au bout des bras du transept, deux niches se creusaient, occupées, chacune, par un autel. — A droite, l’autel en bronze doré, couvert de fleurs et brasillant de cierges de Notre-Dame de bon espoir, surmonté d’une petite vierge d’un noir de suie, comme calcinée par les flammes des cires, vêtue d’une robe blanche et d’un grand manteau semé d’étoiles, les pieds posés sur une touffe de pampres et de raisins d’or. La statue, ainsi habillée, simulait la forme d’un triangle et prenait l’allure espagnole des madones d’un autre âge. — A gauche, un autel dédié à saint Joseph, au-dessus duquel une fresque du quinzième siècle avait été découverte, sous un tableau qui la cachait, en 1854. Elle représentait un Calvaire, mais le jeu des personnages, inattendu en un tel sujet, la rendait énigmatique et vraiment étrange.
La scène se dispose, en effet, suivant le mode du temps, mais entre les deux larrons branchés sur des gibets en T, il n’y a ni Christ, ni croix ; la Mère, une Madone de l’école de Roger Van der Weyden, déjà âgée et drapée dans une robe bleue, s’affaisse, soutenue par saint Jean, accoutré d’une robe lie de vin et d’un manteau bleuâtre. Il la soutient mais machinalement, en regardant, très affairé, en l’air ; derrière lui, deux femmes, l’une, coiffée d’un turban vermillon à fond blanc, affublée de jaune et ceinturée de noir, lève les yeux au ciel ; l’autre, costumée d’un voile blanc et d’une jupe rouge, ferme ses paupières, abîmée dans sa douleur, comme la Vierge ; plus loin, trois squelettes en linceul examinent le firmament et prient.
Enfin, out au premier plan, un être bizarre, à genoux, une femme à face populacière, osseuse, de garçon de barrière, le col entouré d’un foulard, tend de profil ses bras et, elle aussi, scrute les nuées.
Et pendant ce temps, les deux larrons sur leurs instruments de supplice, agonisent. Le bon, résigné, n’en pouvant plus, se meurt ; le mauvais, un hercule barbu, aux chairs couleur de brique, se tord, une jambe repliée derrière la croix ; il est lourd, tassé, fourbu et un petit diable noir et cornu, la queue en trompette, fond sur lui, les griffes tendues pour saisir l’âme à la sortie de la bouche et l’emporter.
Si l’on ajoute à cette description succincte, une ville à pignons et à châteaux-forts, dans le lointain ; puis sur un retour du mur attenant au tableau, trois étendards, un rouge marqué d’initiales et deux blancs, blasonnés, l’un d’une écrevisse ou d’un scorpion et l’autre d’un aigle à deux têtes, flottant sur des hampes enroulées, de même que des mirlitons, de banderoles roses ou noires, l’on aura un vague aspect de ce décevant et curieux panneau.
Ce qui frape d’abord en la singularité de son ordonnance, c’est que tous les personnages, sauf Marie et la femme en jupe rouge, absorbées par leur détresse, voient et désignent d’un coup d’oeil ou d’un geste quelqu’un en l’air que, nous, nous ne voyons pas.
Le Christ évidemment, mais alors le Christ dans les nuages et avec sa croix. — Une autre conjecture pourrait paraître, au premier abord, possible ; entre les croix des deux larrons, il y en eut peut-être autrefois une, en relief, chargée d’un christ sculpté, et cette pièce, ajustée après coup, a pu être détachée parce qu’elle gênait par sa saillie le tableau qui fut pendant des années placé dessus ; mais, en admettant que la preuve de cette supposition puisse être fournie par des documents d’archives, voire même par les traces de cette ablation qui subsistent sans doute dans le mortier rejoint et râclé des pierres, il n’en resterait pas moins à expliquer l’expression de surprise et la direction même des yeux et du geste des assistants ; et ce sont justement ces attitudes traduisant, d’une façon très exacte, l’introït de la messe de l’ascension : « hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel avec tant d’étonnement ? » qui me semblent pouvoir contredire cette hypothèse.
Ce qui est crtain, en tout cas, poursuivait Durtal, c’est que ce Calvaire, trop amplement retouché, est un très intéressant spécimen de ce réalisme mystique que transférèrent à la cour de Bourgogne les peintres des Flandres ; cette fresque sent son Bruges à plein nez ; sa filiation est sûre.
Et, en attendant que la messe que l’on ne sonnait pas encore commençât, il fit le tour de l’église et s’en fut rendre visite à d’autres fresques découvertes, en 1867, dans les nefs latérales, alors que l’on avait gratté l’épiderme des murs.
Sous les écailles tombées des badigeons, des fragments avaient reparu, une circoncision et un baptême de belle allure mais si expertement ranimés depuis leur retour à la vie et si visiblement repeints que cela finissait par devenir gênant. Le peintre qui avait restauré ces fresques, M Ypermann, était vraiment trop adroit et il était difficile de ne pas crier à la contrefaçon ; par contre, d’autres plus discrètement ravivées, deux surtout, l’une représentant trois figures de saintes, une de saint et deux de donateurs et une autre, sise près de la porte d’entrée, une Vierge tenant un enfant Jésus sur ses genoux, étaient exquises.
La plus séduisante de ces oeuvres, celle des trois saintes, s’attestait ainsi :
Au milieu sainte Venisse, la palme des martyres dans une main et dans l’autre, un livre ; elle était vêtue d’une robe d’un vert tilleul passé et d’un manteau d’un rose moribond à doublure soufre ; — à sa droite, debout également, saint Guille, un évêque mitré de blanc, avec une croix pastorale, et une lourde chape rouge, grénelée de deux rangs de perles, sur les épaules ; — à sa gauche, désignée par ses attributs ordinaires, l’épée et la roue, sainte Catherine d’Alexandrie, serrée dans un corsage d’hermine à manches d’un olive éteint sur lequel était jeté un manteau d’un bleu épaissi par la crème d’un blanc.
Sainte Venisse avit les yeux baissés sur son livre ; saint Guille regardait fixement devant lui, sans voir ; ils étaient exsangues et dolents ; quant à sainte Catherine, elle avait la tête d’une décapitée qui se survit et souffre encore.
Enfin, en bas, au remier plan, deux donateurs à genoux, un bourgeois, les mains jointes, et une femme, emprisonnée dans une grande coiffe, et munie d’un eucologe. Cette figure-là, je l’ai déjà vue quelque part, se disait Durtal ; cette posture, ce genre de coiffe, ces traits communs de grosse matrone, me remémorent une sculpture du quinzième siècle, une Jeanne De Laval, du musée de Cluny. Il y a un air de parenté entre les deux femmes.
Maintenant, saint Gille est évidemment le saint Guillaume des bourguignons, mais qu’est cette Venisse, inconnue dans les tables des hagiologues ? Le nom est écrit en caractères gothiques au-dessus de son auréole. Faut-il lire à la place du v un d et croire alors que Denisse ou Denyse serait la sainte de ce nom qui fut suppliciée en Afrique, au cinquième siècle ? Je l’ignore ; ce qui est certain, par exemple, c’est que ces mélancoliques figures, subitement réveillées, ont gardé dans leur effacement quelque chose de spectral. Elles sont sorties de la tombe, mais les couleurs de la vie ne sont pas revenues encore.
Et il en était de même d’un fragment rencontré dans l’autre bas-côté de l’église, une sainte Sabine, vierge et martyre, au col pareil à un cercle de pourpre et portant ainsi que saint Denys sa tête, une tête dont la chevelure laissait tomber des pleurs de fils blonds, et de la madone située tout près de la porte, une madone, languissante et triste, avec l’enfant sur ses genoux, considérant un prêtre en surplis agenouillé devant elle ; tout cela délavé, pâli, agonisant, en un vague paysage qui s’effume dans les pierres du mur.
C’était, en quelque sorte, une visite à un cimetière de la peinture des Flandres qu’accomplissait là Durtal ; c’était de la fresque sépulcrale ; ces êtres ressuscités tout à coup n’avaient pas encore repris leurs sens et ils semblaient surtout las, désolés de revivre et, devant l’exhumation de ces morts, par une association naturelle des idées, le souvenir l’assaillait de ce passage si suggestif, si divinatoire, de saint Fulgence commentant l’évangile de saint Jean sur la résurrection de Lazare et disant très nettement : « Jésus pleura non pas, comme le crurent les juifs, parce que son ami était mort, mais il pleura parce qu’il allait rappeler celui qu’il aimait aux misères de la vie. »
Et le fait est, ce qu’une fois suffit et amplement ! soupira Durtal qui regagna la chapelle de la vierge où les cierges s’allumaient et il y entendit la messe ; puis il s’installa dans un coin et s’efforça de se recouvrer, de voir un peu clair en lui-même, de se comprendre.
Ce qui le dominait, à l’heure actuelle, c’était une immense fatigue. Encore qu’elle agisse, virtuellement, par elle-même et par la force de l’intention qu’elle recèle, même lorsqu’en la récitant, on pense à autre chose, la prière liturgique exigeait, pour être puissamment efficace, pour être suractive, une attention que rien ne disperse, une étude préalable du texte, une intelligence de l’acceptation qu’il assume, plus spécialement, selon qu’il se place dans tel ou tel office.
Aussi, préparait-il, chaque soir, son itinéraire du lendemain ! Pour les messes, c’était facile ; il existait un paroissien romain, le seul peut-être vraiment complet, « le Missel des Fidèles » , divisé en deux tomes par un Bénédictin de Maredsous, devenu abbé du monastère d’Olinda au Brésil, le père Gérard Van Caloen. En le combinant avec le supplément monastique édité par les Bénédictins de Wisques, il était aisé, après avoir cherché dans l’ordo de la congrégation de France, la fête du jour, de ne pas se tromper ; et il n’y avait plus dès lors qu’à analyser la messe, si elle était une messe propre à une férie ou à un saint ; les autres, par leur répétition fréquente, lui étant depuis longtemps connues.
Mais il n’en était pas de même des offices. Sans parler des matines et des laudes et, en mettant de côté les petites heures qui ne varient que le dimanche et le lundi, il restait les vêpres qui ne sont point, ainsi que les complies, invariables ; et là, c’était, si l’on ne voulait pas trimbaler avec soi les pesants bouquins notés de Solesmes, un véritable casse-tête.
Le petit Diurnal, qu’il utilisait d’habitude, avait été fabriqué par la congrégation d’Angleterre, à son usage, et il était, pour les cloîtres français, aussi mal distribué et aussi incommode que possible. D’abord une foule de saints anglais, vénérés par les monastères d’Outre-Manche ne figuraient pas sur notre bref et beaucoup des nôtres étaient absents de leur calendrier ; aussi fallait-il toujours consulter le supplément français inséré à la fin du livre ; puis, pour enfourner beaucoup de matière en peu d’espace, le volume était imprimé, sur papier fin, en caractères serrés, avec un tel abus de rubriques rouges que l’oeil dansait, en quelque sorte, entre les blancs, sans parvenir à se fixer ; c’était ensuite une série de renvois et d’abréviations incompréhensibles lorsque l’on n’en possédait pas la clef ; enfin, en dehors des offices récemment concédés, d’aucuns se doublaient, tel celui de saint Pantaléon qui se spécialisait dans l’église d’Angleterre, alors qu’il rentrait chez nous dans la série des simples martyrs, dénués d’antiennes particulières et tout juste honoré d’un service de dernière classe ; et pour brocher sur ce tout et ajouter à son incohérence, la pagination se triplait et les renvois du supplément, se reférant à telle ou telle page du Diurnal, étaient régulièrement inexacts.
Et il n’y avait pas de choix, ou employer les bottins religieux de France ou ces volumes portatifs ; l’abbaye de Solesmes n’ayant pas publié de bréviaire de voyage pour les siens.
Quel mastic ! disait Drtal à Dom Felletin qui riait, en lui répliquant : toutes les indications que je vous donnerai ne vous serviront de rien ; seule, la pratique vous guidera dans les méandres de ces heures qui sont, je le confesse, embrouillées comme à plaisir.
Et il avait, en effet, fini par saisir le fil et, en disposant de nombreux sinets pour marquer les pages, il était arrivé à se reconnaître dans ce morcellement de textes, mais à condition de tracer toujours et avec soin ses étapes, car avec les versets et les répons des commémoraisons c’était une course éperdue d’un bout à l’autre du bouquin, bien heureux encore lorsqu’on n’errait pas dans de doubles octaves ou dans des époques telles que l’Avent qui compliquent tout.
Cela fait, les points de repère acquis, il convenait d’étudier le corps même de l’office, d’en comprendre la signification, et de découvrir ce qu’après le service divin des louanges et les suppliques d’intérêt général, l’on pouvait en tirer pour son profit d’âme.
La question qui s’imposat était d’abord celle-ci : s’imprégner assez de l’esprit des psaumes pour se persuader qu’ils avaient été écrits à votre intention personnelle, tant ils correspondaient à vos pensées ; les réciter, ainsi qu’une prière jaillie de ses aîtres, s’approprier, s’assimiler, en un mot, la parole du Psalmiste, user de la façon même de prier du Christ et de ses Préfigures.
C’était parfait en théorie, mais, dans la réalité ce n’était pas toujours facile, car si l’on voyait, reproduit dans les livres inspirés, à mesure que le besoin s’en montrait, son site d’âme ; si l’on découvrait tout à coup que des versets dont la portée vous avait jusqu’alors échappé, s’éclairaient, se précisaient si exactement avec votre état spirituel du moment, que l’on en demeurait ébahi, se demandant comment on ne les avait pas depuis longtemps compris, un terrible dissolvant paraissait à son tour, la routine, qui vous obligeait à dévider les psaumes, comme une mécanique, en n’y adaptant plus alors aucun sens.
Et cette routine était, il faut bien l’avouer, rendue inévitable par la façon même dont se débitait l’office ; pour en appréhender jusqu’aux sous-entendus, pour en bien discerner l’entente, même après l’avoir apprêté, il eût été nécessaire de le psalmodier ou de le chanter lentement, religieusement, de l’écouter en y réfléchissant ; et ce n’était pas possible, car l’office eût été soporeux et interminable, dénué de rythme et d’élan, exonéré de toute beauté, émondé de tout art.
Aussi, concluait Durtal, sied-il d’accepter le caractère talismanique de la liturgie ou alors de ne pas s’en mêler ; cette puissance, elle subsiste à l’état latent ; l’on ne sent pas la force du courant lorsqu’on le subit, tous les jours, mais elle se révèle aussitôt que l’on s’en trouve privé.
Ces excuses ne justifient point, hélas ! Mes écarts de cervelle et n’empêchent que, tandis que je profère des exorations labiales, mon imagination ne parte à la venvole. Je suis, il est vrai, rappelé à l’ordre dans les instants où je suis je ne sais où, très loin de Dieu, à coup sûr ; d’une touche brève, il m’appuie sur l’âme et je reviens à lui ; et alors, je voudrais réellement l’aimer ; puis tout retombe ; la préoccupation terrestre reprend le dessus jusqu’à ce que soudain, à propos de n’importe quoi, Dieu refrappe à la porte du coeur et se fasse ouvrir.
Ah ! l’image la plus exacte de moi-même elle est constamment celle d’une auberge ; tout le monde y entre et tout le monde en sort ; c’est une passoire de pensées voyagères ; mais heureusement que, malgré son exiguïté, l’auberge n’est pas, ainsi que l’hôtellerie de Bethléem, toujours pleine ; une chambre est réservée quand même pour la venue du Christ, une chambre incommode, mal nettoyée, un bouge si l’on veut, mais enfin, lui, qui a eu pour lit le bois de la croix, il s’en contenterait peut-être, si l’hôte était plus attentif et plus serviable. Hélas ! C’est là que gît le point douloureux ! L’importun, le triste accueil que Jésus reçoit lorsqu’il s’annonce ! Je réponds aux badauds, j’accours aux appels d’inutiles intrus, je me dispute avec des placiers en tentations et je ne m’occupe pas plus de lui que s’il n’existait point ; et il se tait ou il s’en va.
Comment remédier au déarroi de mes pauvres aîtres ?
Je suis moins sec cependant, moins aride et aussi moins fluent qu’à Chartres ; mais je suis gavé de prières, saoûl d’oraisons ; je suis accablé de lassitude et de la lassitude naît l’ennui et l’ennui engendre le découragement ; là, est le péril et il est indispensable de réagir. Oh ! Je sais bien, mon seigneur, le rêve est simple : effacer les empreintes, se débarrasser des images, opérer le vide en soi pour que votre fils puisse s’y plaire, devenir assez indifférent à ses plaisirs et à ses soucis, assez désintéressé des alentours pour pouvoir limiter ses sentiments à ceux qu’exprime la liturgie du jour ; en un mot, ne pleurer, ne rire, ne vivre qu’en Vous et avec Vous. Hélas ! L’idéal est inaccessible ; personne ne s’exile ainsi de soi-même ; on ne tue pas le vieil homme, on l’engourdit à peine et, à la moindre occasion, ce qu’il s’éveille !
Les saints y sont pourtant parvenus, à l’aide de grâces spéciales, et encore Dieu leur a-t-il laissé des défauts afin de les préserver de l’orgueil ; mais, pour le commun des mortels, rien de semblable ne se réalise et plus j’y réfléchis et plus je me persuade que rien n’est plus difficile que de se muer en saint.
Certes, beaucoup de gens ont maté la chair, ils pratiquent l’amour de Jésus, l’humilité ; ils refoulent sans doute le plus gros des dispersions ; ils vivent aux écoutes de l’arrivée de Dieu ; ils ne sont pas loin d’être des saints... mais il y a une pelure, un zeste sur lequel ils glissent et qui les fait choir et les rejette dans la foule des saintes gens et les saintes gens ne sont pas des saints, car ce sont ceux qui s’arrêtent en haut de la côte et n’en pouvant plus, se reposent et bien souvent redescendent.
Or, la pierre de touche de la sainteté, elle n’est pas dans les mortifications corporelles et les souffrances-qui ne sont que des véhicules et des moyens — elle n’est pas, non plus, dans l’extinction des forts et des moyens péchés ; avec l’aide du ciel, tout homme vraiment pieux et de bonne volonté peut y prétendre ; — elle est surtout dans la réalité de cette assertion du pater que nous répétons si audacieusement que nous en devrions trembler, « comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés » . Supporter, en effet, les fourberies et les injures, ne conserver aucune rancune des injustices, alors même qu’elles se prolongent et que la haine qui les attise finit par rendre l’existence intolérable ; les désirer presque, par besoin d’humiliations et par convoitise d’amour divin ; ne souhaiter non seulement aucun mal à son bourreau, mais l’aimer davantage et demander, sans arrière-pensée, sincèrement, du fond du coeur, qu’il soit heureux et, cela, naturellement, en excusant sa façon d’agir, en s’attribuant tous les torts, eh bien, cela, à moins d’une action très particulière de la grâce, c’est au-dessus des forces humaines !
Et, en effet, la somme d’humilité et de charité qu’un tel abandon de soi-même comporte, déconcerte.
Des gens qui possèdent des vertus ` un degré héroïque, se cabrent et se désarçonnent, ne fût-ce que pendant l’espace d’une minute, devant l’offense ; et l’offense soudaine, brutale, est soutenable si on la compare au lent taraudage des vexations et des crasses ; on se ressaisit, après un coup de tampon, mais l’on s’agite et l’on s’affole, si l’on endure des piqûres réitérées d’épingles ; leur continuité exaspère ; elle irrigue, en quelque sorte, les terres sèches de l’âme, donne aux péchés de rancune et de colère le temps de pousser, et dieu sait si leurs rejetons sont vivaces !
Et chose plus curieuse, si l’on parvint à se roidir, à se refréner, à obtenir qu’à défaut d’une affection pour son persécuteur, l’oubli, le silence, descendent au moins en soi ; si l’on arrive même à étouffer ses plaintes, à juguler le ressentiment dès qu’il paraît, voilà que l’on s’ébroue sur des riens, que l’on écume pour des vétilles. On a évité de culbuter dans le fossé et l’on se luxe le pied dans un creux et l’on ne s’en étale pas moins, par terre, de tout son long.
L’orgueil est peut-être mort, mas l’amour-propre, mal inhumé, survit ; l’étiage du péché diminue, mais la boue subsiste et le démon y trouve encore et largement son compte.
Ces chutes seraient évidemment très ridicules, si l’on ne connaissait la tactique dont le Malin use ; elle est simple, chacun la comprend et toujours cependant, elle réussit. Contre ceux dont les fautes sont devenues bénignes, il se démène et concentre des efforts sur un seul point ; et, ce qui est lamentable, c’est que, si, se défiant de sa ruse, l’on fortifie ce point, l’on dégarnit les autres et alors il simule l’assaut du rempart armé, consent même à reculer, à s’avouer vaincu et il pénètre pendant ce temps par la poterne que l’on a laissée sans défense, parce qu’on la croyait à l’abri du danger et close ; et l’on ne s’aperçoit de sa présence que lorsqu’il se pavane déjà dans la place.
Ah ! la Sainteté, ce qu’elleest rare ! mais à quoi bon en parler ? si seulement l’on pouvait se taire à soi-même, ne pas retomber dans ses fautes, juste au moment où l’on assure au seigneur que l’on veut, à tout prix, les éviter. Hélas ! Ce sont des serments d’ivrogne et ces pieux châteaux en Espagne ne tiennent pas debout !
L’humiliation de ces confessions fréquentes où l’on rabâche constamment la même chose, où l’on se ressasse ses délits, où l’on se remâche la litière de son vieux foin ! On range, une fois pour toutes, ses péchés, en un ordre convenu ; on lâche le déclic et le treuil tourne. Comme, lorsque la chair n’est plus en jeu, ils sont de minime importance — ce qui est une erreur, du reste, mais on se les imagine tels — il y a des instants où on ne les aperçoit plus, où l’on ignore si, depuis la dernière absolution, on les a, de nouveau, commis, et, de peur de se leurrer et de lésiner avec Dieu, on les accuse derechef, sans certitude, sans repentir ; et puis... et puis... une question plus embarrassante se pose : où commence la faute quand la tentation sévit ? la repousse-t-on assez vite ? N’y cède-t-on pas toujours un peu ? N’y a-t-il pas au moins un soupçon de délectation morose, alors même que l’on regimbe sous l’aiguillon ?
Des visions charnelles vous assaillent ; elles jaillissent, à l’impromptu, en éclair, devant vous ; l’on regarde, surpris ; alors, elles se précisent et une langueur affreusement douce coule en vous ; c’est un narcotique qui vous engourdit. Il y a, en somme, une seconde d’ahurissement, suivie d’une seconde de complaisance ; et l’on parvient à se reprendre mais pas assez vite pour que ce rien de plaisir, dû à un bref oubli de soi-même, ne vous ait été sensible ; trop, sans doute, puisque quelquefois un brin de regret s’insinue d’avoir dû, par devoir, rejeter la séduction du charme. — Tout cela s’effectue en un clin d’oeil, sans que l’on ait le temps de se reconnaître et ce n’est qu’après, à la réflexion, que l’on peut décomposer l’ensemble de l’opération et en discerner les détails. A-t-on péché et dans quelle mesure ? Dieu, seul, le sait.
Pour se consoler, il sied de se répéter que le démon ne peut rien sur la volonté, très peu sur l’intelligence et tout sur l’imagination. Là, il est le maître et il y déchaîne le sabbat ; mais ce bacchanal n’a pas plus d’importance que le vacarme d’une musique militaire qui passe sous vos fenêtres. Les vitres s’ébranlent, les objets s’émeuvent dans la pièce et l’on ne s’entend plus. Il n’y a qu’à se tenir coi et à attendre que le fracas des cuivres et des caisses, en s’éloignant, s’efface. Ce tumulte se produit en dehors de nous, nous le subissons, mais nous n’en sommes pas responsables, à moins, dame, que nous n’allions nous mettre à la croisée pour le mieux écouter, car alors il y aurait assentiment. — Oui, c’est aisé à dire, mais...
Une question bien peu claire aussi est celle de la Charité ; il convient de l’observer envers son prochain, c’est convenu ; mais, en certains cas, où prend-elle naissance et où meurt-elle ? Que deviennent, à certains moments aussi, sous ce couvert de charité, la vérité, la justice, la franchise ? — car enfin, l’hypocrisie, la cagnardise, l’iniquité ne sont très souvent séparées d’elle que par un fil ; on aide au mal, sous prétexte de ménager les personnes ; on nuit aux uns, sous couleur de ne point juger les autres et la lâcheté et le désir de ne pas se créer d’ennuis, sournoisement s’en mêlent. Les limites entre cette vertu et ces vices sont habituellement si étroites que l’on ne sait si, à propos de telle ou telle répartie, on ne les a point franchies. — Oui, je ne l’ignore pas, la théorie théologique est celle-ci : se montrer impitoyable pour les actes répréhensibles et miséricordieux pour ceux qui les commettent ; mais quoi ! Cette doctrine générale ne résoud nullement les cas particuliers-et il n’y a que des cas particuliers en cette matière ! — La frontière à ne point dépasser demeure donc mal délinéée et obscure, sans balustrades qui garantissent du péril, qui préservent des casse-cous !
La misère des âmes confinées en de mesquines fautes ! Et la détresse qu’elles éprouvent à voir qu’elles piétinent constamment sur la même place, qu’elles ne gagnent sur elles aucune avance !
Il faut se dire pour se désattrister pourtant qu’en raison de notre déchéance, il est impossible de rester indemne, qu’il en est des brindilles et des fétus peccamineux comme de ces grains de poussière qui emplissent, qu’on le veuille ou non, les pièces. On les balaie dans de fréquentes confessions, — et, ce nettoyage exécuté, d’autres reviennent ; — c’est toujours à recommencer ; bien heureux encore lorsque ces égrugeures de négligences ne s’accumulent point à votre insu et ne forment pas ces péchés mortels des chambres, ces sortes de boulettes, roulées dans on ne sait quelle bourre, qui s’amoncellent sous les meubles et s’appellent, dans le langage du peuple, des moutons !
Avec tout cela, quelle heure est-il ? reprit Dural, en consultant sa montre. Voyons, au lieu de rêvasser et de remuer des scrupules et de geindre, si j’allais pour tuer le temps, faire un tour.
Il partit au hasard des rues ; çà et là de vieilles maisons l’arrêtaient : les maisons de la rue des Forges, l’hôtel de Vogué, l’immeuble des Cariatides situé dans la rue chaudronnerie, l’échauguette de la rue vannerie, mais bientôt il s’engagea dans les rues commerçantes, puis dans de larges avenues mortes et alors plus de Touring-Club et de Ménagère, plus de bazars parisiens, d’enseignes caduques à Paris et toujours neuves en province, telles que les « Pauvre Diable et les Cent mille paletots » ; plus de ces spécialités de pain d’épices, de cassis, de moutarde, qui marquent au moins d’une empreinte originale les rues marchandes de Dijon. Il n’y avait sur ces grandes voies aucun magasin, aucune boutique ; c’était riche et solitaire, maussade et laid.
Il déboucha sur la place du 30 octobre où pour glorifier les souvenirs de la défense nationale, une statue de la résistance se dresse, feinte par une gourgandine debout sur un fût.
Tiens, fit-il en s’orientant, voici le boulevard arnot ; eh bien, ce serait l’occasion de visiter la chapelle des Carmélites que je ne connais pas ; M Lampre m’a dit qu’elle était sise en face de la Synagogue ; elle ne sera donc pas difficile à dénicher.
Il descendit le boulevard, aperçut en effet sur s droite le dôme du temple devenu nécessaire depuis que le nombre des juifs important la camelote de Paris, s’était accru dans Dijon ; et, sur sa gauche, il vit une de ces hautes et rigides murailles qui semblent bâties sur un modèle uniforme par les Carmels. Une petite porte à judas était entre-baîllée ; il la poussa, pénétra dans un jardinet de curé, soigneusement ratissé, aux plates-bandes diligemment tenues, se dirigea vers une grande porte ouverte au-dessous d’un bâtiment gothique qui ne pouvait être qu’une église et il entra, en effet, dans une chapelle.
Ce sanctuaire moderne, construit dans le style ogival, secomposait d’une simple allée, sans transept. Au fond, près de l’autel, du côté de l’évangile, la grille de clôture croisait ses barreaux de fer noir ; cette églisette n’était ni belle, ni laide, mais ce qui la rendait un tantinet étrange, c’était la clarté que tamisaient les deux couleurs, raisin sec et céruse, de ses vitres, habitées par de grandes figures de saints et de saintes, en costumes de l’ordre, robes d’un brun tournant au violet de la prune de monsieur et manteaux blancs. Des noms désignaient les personnages qui se faisaient vis-à-vis de chaque côté de la nef ; parmi les hommes : Elie, Jean Soreth, saint Albert et saint Jean de La Croix ; parmi les femmes : sainte Térèse, sainte Madeleine de Pazzi, la bienheureuse Archangela et la mère Marie de L’Incarnation.
La chapelle était tiède et déserte ; l’on n’entendait aucun bruit. Durtal se remémorait quelques détails qu’il avait lus dans un intéressant volume de M Chabeuf « Dijon à travers les âges » sur ce Carmel. Ses moniales s’étaient établies en cette ville, au commencement du dix-septième siècle, sous la direction d’une discipline de sainte Térèse, Anne de La Lobère, sur la place charbonnerie ; puis, elles avaient été transférées dans un autre local que la révolution convertit en une caserne ; elles avaient enfin échoué là, sur un boulevard Carnot, en face d’une Synagogue !
La providence les a sans doute placées exprès en cet endroit, ainsi que l’on plante des eucalyptus près des marais contaminés, pour en détruire les miasmes, se dit-il. Dijon ne s’en doute guère, mais c’est une bénédiction pour lui que cet humble cloître. Vient-on au moins, ici, de même qu’à Chartres où la porterie du carmel de la rue des jubelines était toujours pleine de braves gens en quête de prières, pour des enfants malades, pour des conversions, pour des tirages au sort, pour des vocations religieuses, pour tout ? Et de naïves paysannes, tirant leur porte-monnaie, en demandaient pour deux sous ; et les bonnes Carmélites étaient si consciencieuses qu’après avoir récapitulé, chaque jour, les requêtes inscrites par soeur Louise, la tourière, elles récitaient une prière en plus de celles notées sur le registre, de peur que l’on eût oublié d’en marquer une !
Les saintes filles ! Mais, que je suis bête, s’exclama soudain Durtal ; je déambule dans le vide, je me plains de mes diffusions, je n’y découvre point de remèdes, et sainte Térèse a résolu cette question ! Il me revient, en effet, maintenant que je suis chez elle, d’avoir lu dans sa correspondance une lettre adressée à l’un de ses confesseurs, à Don Sanche, je crois, où elle lui dit en substance : les distractions dont vous vous plaignez, je les éprouve autant que vous, mais il n’y a à en faire aucun cas ; cela me paraît, du reste, un mal incurable.
A la bonne heure, au moins ! Ce qu’elle vous liquide un passif d’âme en deux mots et avec cette certitude, qu’il ne peut y avoir, quand elle a parlé, d’erreur.
Quelle femme ! sa règle semble surhumaine et elle est la plus pondérée de toutes. Les machines sous pression divine qu’elle voulut sont munies de soupapes de sûreté ; des récréations distendent l’âme comprimée, permettent de déverser le trop plein, de se détendre ; seulement il lui fallait des caractères enjoués et résolus. Une nonne mélancolique deviendrait, en effet, dans son cloître, une désespérée ou une folle. Comme elle est appelée à prendre à son compte les tentations et les maux des autres, elle peut s’attendre à subir les pires des douleurs, à se débattre même dans les assauts de ces terribles péchés qu’elle attire, telle que la pointe aimantée le tonnerre, pour les résoudre.
Afin d’être en mesure de résister à e pareils chocs, il faut que le corps puisse vraiment sourire, lorsque l’âme est à la torture et que l’âme s’égaie, à son tour, quand le corps souffre. C’est si au-dessus de l’humanité que c’est effrayant, se disait Durtal.
Et pourtant, il y eut plus dur ; dans un carmel, on st en nombre, on se partage les épreuves, on se soutient, on s’aide ; il y a aussi des temps d’arrêt dans la lutte, des diversions ; mais il y eut, au Moyen-Age, avant cette époque surtout, l’expiateur et l’expiatrice de la solitude, les ermites volontaires de la nuit, agenouillés dans une cave, sans lumière, sans horizon, inhumés jusqu’à la mort, entre quatre murs.
Les reclus avaient jadis foisonné dans la vallée d Nil ; des anachorètes avaient jugé que la vie, au grand air, dans une thébaïde, dans une laure voisine parfois des oasis et qu’égayaient les clartés juvéniles des aubes et les fuites en feu des couchants, était trop débonnaire et maudissant ces attraits de la nature qui les empêchaient de trop pâtir, ils s’étaient, tels que saint Antoine, Pierre Le Galate, la vierge Alexandra, cachés dans un sépulcre abandonné ; d’autres, comme Siméon Stylite, s’étaient enfouis au fond d’une citerne à sec ; d’autres encore, ainsi qu’Acepsimas, que sainte Thaïs, que saint Nilammon, s’étaient claquemurés en une cave percée d’un trou pour qu’on pût leur passer des aliments ; d’autres enfin s’étaient relégués dans des cavernes dont ils avaient chassé les fauves.
La réclusion qui prit, de même que le monachisme, nassance en Orient, se répandit dans l’Occident.
Le premier reclus de France dont le nom nous soit parvenu est sain Léonien qui, au cinquième siècle, s’interna dans une logette, d’abord à Autun, ensuite à Vienne ; l’on cite également, à la même époque, saint Aignan qui mourut évêque d’Orléans ; saint Eucher qui, avant d’avoir occupé le siège épiscopal de Lyon, se séquestra, en un cabanon, dans l’île de Léro. — Au sixième siècle, saint Friard et Caluppo qui se retirèrent, l’un près de Nantes, l’autre près de Clermont ; saint Léobard qui se détint dans le creux d’un roc, à Marmoutiers ; Hospitius qui s’écroua près de Nice ; saint Lucipien qui s’enferma dans les murailles d’un vieil édifice et porta par pénitence, sur son crâne, une pierre énorme que deux hommes pouvaient à peine soulever ; Patrolle dont Grégoire de Tours raconte les miracles ; saint Cybard qui se construisit une celle dans les environs d’Angoulême ; saint Libert qui s’incarcéra et mourut, en 583, à Tours. — Au septième, saint Bavon, saint Valérique ou Vaury ; le premier se claustra dans un tronc d’arbre, puis dans une hutte, au milieu d’une forêt près de Gand ; le second vécut, enterré, dans le Limousin. — Au huitième, saint Vodoal, sainte Heltrude ; l’un s’emprisonna dans une avant-cour du couvent des religieuses de Notre-Dame, à Soissons ; l’autre dans le Hainaut et l’hagiologue Belgic de Bauduin Willot note qu’elle mourut et qu’elle repose à Liessies ; et combien d’autres dont je ne me souviens pas ! se disait Durtal.
Mais, reprit-il, poursuivant son soliloque, il semble bien que jusq’au neuvième siècle, la claustration n’a été soumise à aucune règle précise, et qu’elle fut confiée au bon vouloir de chacun qui la rendait, à son gré, impitoyable ou clémente, provisoire ou perpétuelle. Fatalement, des abus survinrent, des défections de gens qui avaient trop présumé de leurs forces et qu’il fallut démurer. Pour parer à ces évents, l’église décida que tout postulant à la réclusion subirait d’abord un noviciat de deux années, en cellule, dans un cloître, puis qu’il devrait, s’il persévérait dans sa résolution et était reconnu apte à mener ce genre de vie, se lier non plus par des voeux temporaires mais par des voeux perpétuels.
Au neuvième siècle, nous trouvons, en effet, un règlement qui s’applique à tous les reclusages d’hommes. Ce règlement, publié par Dom Luc d’Achery, aurait pour auteur Grimlaïc, un prêtre ou un moine, on ne sait au juste.
Après avoir noté les deux ans de probation et l’irévocabilité des engagements que peut rompre cependant une maladie grave, il aborde les détails, édicte que la logette, accolée à l’église, sera bâtie en pierre et entourée de hauts murs, n’ayant de communication avec l’extérieur que par une sorte de guichet, ménagé dans la muraille, à hauteur d’appui, afin de permettre de déposer sur une planchette les plats de nutriment. La cellule devra avoir dix pieds de long sur autant de large ; une fenêtre ou plutôt une lucarne ouvrira sur l’église et elle sera tendue de deux voiles pour empêcher les fidèles d’apercevoir le captif et l’empêcher, lui-même, de les voir. Ces voiles ne se lèveront que devant Dieu, c’est-à-dire devant la très sainte Eucharistie qui sera dispensée, tous les jours, au prisonnier, s’il est un simple laïque. S’il est, au contraire, prêtre, il célèbrera, dans un petit oratoire annexé à la cellule, une messe quotidienne et solitaire ; il pourra, en d’autres termes, officier sans servant et sans assistant pour lui répondre.
Le reclus mangera, mais durant le jour et jamais dans la nuit ou à la lueur d’une lampe, de deux mets apprêtés ou cuits ; au premier repas, des légumes et des oeufs ; au second, des petits poissons, mais seulement les jours de grandes fêtes ; il aura l’hémine de vin, consignée dans la règle de saint Benoît, et il sera revêtu d’habits semblables à ceux que portent les moines de cet Ordre.
Il se couchera sur un lit, composé d’ais de bois et d’un matelas ; il disposera d’un manteau, d’un cilice, d’un oreiller. Il dormira tout habillé.
Il devra se laver le visage et le corps et ne pas laisser croître es cheveux et sa barbe au delà de quarante jours.
S’il vient à tomber dangereusement malade, on brisera le sceau de clôture pour le soigner.
Cette règle, conçue d’après l’esprit de saint Benoît, est indulgente ; nous sommes loin avec elle des anachorètes, se repaissant d’herbes et de racines, dans les cavernes ou les tombeaux.
Mais ce qui contredit résolument l’idée que tout le monde se forme des reclus, c’est que, d’après les prescriptions de Grimlaïc, les détenus ne devaient jamais être moins de deux ou trois ; chacun vivait, séparé, dans sa geôle, mais pouvait avoir des rapports avec son voisin, par une espèce de chattière, pratiquée dans le mur de séparation ; et il leur était loisible, à certains moments, de s’entretenir des saintes écritures, de la liturgie, de recevoir l’instruction spirituelle du plus ancien et du plus savant d’entre eux.
Ajoutons qu’à chaque demeure attenait un jardin où le séquestré cultivait quelques légumes et nous voici singulièrement proches de la règle de saint Bruno, avec la maisonnette pourvue d’un jardinet que possède tout Chartreux.
Ainsi que le remarque très justement monseigneur Pavy, qui a, le premir, entrepris de sérieuses recherches sur les reclusages, ce genre de claustration, au neuvième siècle, n’était, en somme, qu’une miniature de couvent.
Ces ordonnances, bien débonnaires déjà, s’adouciren plus tard encore chez les Camaldules.
Au dixième siècle, saint Romuald, leur fondateur, déclara ue le droit de se prononcer sur la validité de la vocation de ceux de ses moines qui désiraient s’isoler en un cabanon, appartiendrait au chapitre général de l’ordre ; et nul ne pourrait être proposé au chapitre, s’il n’avait passé cinq ans au moins, après sa profession, dans le monastère. Il décida aussi que la détention ne serait plus forcément perpétuelle.
La cellule du religieux en chartre contenait un lit, une table, une chaise, une heminée et quelques images pieuses ; elle s’ouvrait sur un jardin clos de murs ; le reclus avait le droit de converser avec ses frères, les moines, le jour de la saint Martin et le dimanche de la quinquagésime ; il assistait également, tous les vendredis et samedis, à la messe et à none et, pendant la Semaine Sainte, il quittait sa solitude et prenait part aux offices et aux repas de la communauté.
Les autres jours, il récitait les heures canoniales dans sa loge, mais pasaux heures qui lui plaisaient et seulement quand la cloche appelait, pour ces services, les religieux au choeur.
Nous nous rapprochons de plus en plus de la règle des Chartreux, observa Dutal et aussi de la congrégation des Carmels, car en fin de compte, ces moines sont des gens détachés dans des ermitages pour des retraites plus ou moins longues, ainsi que cela a lieu, à certaines époques, dans les cloîtres de sainte Térèse ; ce qui est également sûr, c’est que nous nous éloignons de plus en plus de l’ère héroïque des récluseries.
Et ce relâchement se produit, à son tour, chez les femmes plus courageses pourtant que les hommes.
Au douzième siècle, apparaît la règle du Bienheureux Aelred, Abbé de Riéval, pour les internements de nonnes.
Elle se divise en soixante-dix-huit chapitres et distribue moins des préceptesque des conseils.
La recluse, y est-il dit, devra autant que possible ne pas boire de vin ; néanmoins, si elle juge cette boisson profitable à sa santé, on lui en délivrera une hémine, par jour ; elle mangera d’un seul plat de légumes ou de farineux et si elle fait collation, le soir, elle se contentera d’un peu de lait ou de poisson auxquels elle ajoutera, au besoin, des herbes ou des fruits ; elle jeûnera au pain et à l’eau, les mercredis et vendredis, sauf en cas d’indisposition et elle ne pourra, sous aucun prétexte, orner d’images ou d’étoffes sa cellule.
Elle parlera, si elle le désire, mais à la condition de ne pas engager d’entretiens inutiles ; elle ne sera pas obligée de se servir, elle-même, et aura, si elle le veut, une domestique pour porter l’eau et le bois, pour préparer les fèves et autres légumes.
Cette règle qu’Aelred avait écrite pour sa soeur, consacre dans les reclusages la mansuétude d’une irrémédiable décadence ; elle ne nous rappelle plus en rien les rigoureuses coutumes des premiers siècles ; il ne s’agit décidément plus d’emmurage, de tombe anticipée, de sépulcre avant la lettre !
Quant à la cérémonie des beaux temps de la réclusion, nous nela connaissons que dans son ensemble et les détails précis de la liturgie manquent.
Le reclus et la recluse étaient, de préférence, conduits solennellemet à leur prison, le dimanche, avant la grand’messe. Ils se prosternaient aux pieds de l’évêque, si le reclusage dépendait de son église ou de l’Abbé ou de l’Abbesse, s’il dépendait d’un monastère — et ils promettaient, à haute voix, la stabilité, l’obéissance, la conversion de leurs moeurs. Pendant l’aspersion, ils se tenaient dans le choeur de l’église et aussitôt après la prière « Exaudi » , la procession, croix en tête, les menait, en chantant les litanies, jusqu’à la porte de la geôle qui était murée ou scellée du seing de l’officiant ; et ce, pendant que les cloches carillonnaient, à toute volée, comme pour une importante fête.
Presque toujours, en même temps que le reclus et la recluse conventuels prêtaiet le serment d’obéissance entre les mains de l’abbé ou de l’abbesse, ils lui offraient la propriété de leurs biens, quitte à recevoir d’eux, en échange, la subsistance, leur vie durant ; — et ici, la ressemblance est frappante avec les cérémonies usitées, au Moyen-Age, pour l’admission des oblats et des oblates de saint benoît.
D’ailleurs, il faut bien le dire, à mesure que la tolérance des règles de la claustration s’affirme, l’oblature Bénédictine se montre.
Ces reclus, quand ils ne sont pas des moines, sont, sous un autre nom, des oblats. Beaucoup d’entre eux résidaient auprès des cloîtres de saint Benoît. Mabillon note, en effet, que ce genre de pénitents, suivant de leur cellule les offices de la communauté derrière les voiles du soupirail creusé dans le mur de l’église, était passé à l’état de coutume, dans l’Ordre, au onzième siècle.
Si l’on en juge par les inscriptions conservées dans les obituaires et les archivs, le nombre de ces captifs volontaires fut considérable ; cette institution se propagea, plus ou moins rigide, mais avec une surprenante rapidité, à travers les âges.
Les reclus et les recluses foisonnent en Allemagne et dans les Flandres ; l’on en truve en Angleterre, en Italie, en Suisse ; l’on en découvre, en France, dans l’Orléanais, dans le pays chartrain, dans le Limousin, dans la Touraine, dans presque toutes les provinces. Onze récluseries existèrent à Lyon. À Paris, outre Flore, la recluse de saint-Séverin, l’on signale Basilla, la recluse de saint-Victor, puis Hermensandre, recluse à saint-Médard ; Agnès De Rochier à Sainte-Opportune ; Alix La Bourgotte, Jeanne La Vodrière et Jeanne Painsercelle, aux Saints-Innocents ; l’égyptienne de la paroisse de saint-Eustache ; Marguerite près de saint-Paul ; l’inconnu de l’église de sainte-Geneviève et les détenus et les détenues qui se succédèrent dans la logette du mont Valérien : Antoine, Guillemette De Faussard, Jean De Houssai qui mourut en odeur de sainteté, Thomas Guygadon, Jean De Chaillot, Jean Le Comte, le vénérable Pierre De Bourbon, Séraphin De La Noue, enfin Nicolas De La Boissière qui y décéda, le 9 mai 1669, à l’âge de quarante-six ans.
Après lui, il n’y eut plus, au Mont Valérien, que des ermites vivant en commn, sous une règle presque semblable à celle de Cîteaux. Elle contenait cependant cette clause que ceux des ermites qui voulaient mener l’existence des premiers solitaires seraient, après examen, autorisés à s’interner dans une celle spéciale, à perpétuité ou pendant un an, six ou trois mois, quinze ou huit jours, avec liberté de rentrer dans la fraternité, au bout de ce temps.
La règle de Grimlaïc dut tomber, après un certain nombre d’années en désuétude. Fut-elle même jamais appliquée d’une façon générale ? Cela ne nous est nullement démontré. L’importance qu’on lui attribue tient surtout à ceci que l’on n’en connaît aucune autre, car celle de saint Romuald n’est qu’un règlement intérieur d’abbaye, en somme.
Il en fut de même de l’ordonnance d’Aelred ; nous ignorons si elle eut forc de loi chez les femmes ; ce qui semble probable, c’est que, tout en suivant ces instructions dans leurs grandes lignes, nombre de reclus et de recluses les aggravèrent ou les adoucirent, selon l’endurance plus ou moins attestée de leur santé et l’étiage plus ou moins élevé de leur ferveur. Il y eut sans doute des statuts locaux, ajoutant ou retranchant aux textes de ces édits ; ce qui paraît, en tout cas, certain, c’est qu’à partir du neuvième siècle, les in-pace des débuts de la réclusion avaient disparu. Les logettes étaient devenues des cellules où l’on travaillait et où l’on priait, comme dans les cellules voisines du monastère. Nous possédons quelques renseignements sur ce point.
Hildeburge, qui vécut au douzième siècle, s’était retirée ans une petite demeure construite pour elle, sur le côté nord de l’église de son abbaye, par l’Abbé de saint-Martin de Pontoise et elle s’occupait à confectionner des ornements sacerdotaux et à coudre des habits de moines. à l’Abbaye du Bec, en Normandie, la mère de l’Abbé, le Vénérable Herluin, s’était, elle aussi, installée dans une chambre attenant à la chapelle du cloître et elle lavait les vêtements de la communauté et était chargée de mainte besogne domestique. Mabillon parle également du bienheureux Hardouin, reclus de l’abbaye de Fontenelle qui transcrivit et composa de copieux ouvrages. Ces prisonniers communiquaient donc avec les personnes du couvent et habitaient des pièces éclairées et munies du mobilier nécessaire à leurs travaux.
Il semble avéré, d’autre part, qu’à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle, ce fut pour certains reclusages la déchéance et la honte ; l’on peut, à ce propos, citer un prêtre du nom de Pierre, reclus de Saint-Barthélemy, à Lyon, qui sortait tranquillement de son ermitage et scandalisait les bonnes gens, en parcourant la ville.
Les récluseries continuèrent de subsister pourtant jusqu’à la fin du dix-septième siècle.
Dans le tome III de son dictionnaire des Ordres religieux, Hélyot nous entretient de la mère Jeanne De Cambry, fondatrice de l’institut de la présentation de la Sainte-Vierge, en Flandre, qui voulut achever ses jours dans la solitude, près de l’église saint-André, à Lille, où elle mourut, en 1639 ; et il nous nantit de vagues détails sur la liturgie, usitée à cette époque.
La mère de Cambry, dit-il, vêtue d’une robe de laine naturelle, grise, et accompagneacute;e de deux de ses religieuses, tenant, l’une un manteau bleu, l’autre un voile noir et un scapulaire violet, les couleurs de son ordre, se prosterna aux pieds de l’évêque de Tournai qui l’attendait sur le seuil de l’église. Il la releva, la conduisit devant le grand autel, bénit les objets de la vêture, les imposa à la postulante qui émit ses voeux de clôture perpétuelle et fut menée, en procession, tandis que l’on chantait le « veni sponsa christi » jusqu’à sa cellule où le prélat l’enferma et scella la porte de son seing. Après la mère de Cambry, nous trouvons encore Marguerite La Barge, détenue à Saint-Irénée, à Lyon où elle trépassa, en 1692.
Celle-là est la dernière recluse que nous connaissions...
Aujourd’hui, repit Durtal en souriant, une caricature existe près de Lyon, des anciens recusages. Je me souviens d’avoir autrefois visité, alors que j’étais de passage dans cette ville, l’ermite du Mont-Cindre. On y allait en partie de plaisir. L’ermite était un brave homme, affublé d’une soutane, niché dans une maisonnette avec jardin paré de rochers en coquillages et de statues affreuses. Il vendait des médailles et semblait pieux. Le métier était sans doute bon, car un concurrent bâtissait une bicoque, près de sa hutte. Il est difficile, je crois, d’assimiler ces professionnels modernes aux farouches reclus des premiers temps.
Cette institution de la récluserie, maintenant morte, a fourni des saints célèbres ax hagiologues : sainte Heltrude, sainte Hildeburge, saint Dragon D’épinay, saint Siméon De Trèves, sainte Viborade, sainte Rachilde, sainte Gemme, la bienheureuse Dorothée, la patronne de la Prusse, la bienheureuse Agnès De Moncada, la bienheureuse Julia Della Rena, la vénérable Yvette ou Jutte, du pays de Liége, saint Bavon, le bienheureux Millory, le premier reclus de l’ordre de Vallombreuse, la bienheureuse Diemone et Jutta qui eut pour élève sainte Hildegarde, la bienheureuse ève qui fut, avec Julienne De Cornillon, l’instigatrice de la fête du Saint-Sacrement, et combien d’autres dont les noms m’échappent ! se disait Durtal.
En résumé, la réclusion a fini, comme ont fini les monastères qui tombaient enpoudre lorsque la Révolution les balaya, faute d’amour envers Dieu, faute d’esprit de sacrifice, faute de foi.
Elle a d’abord été terrible, puis indulgente et les peintures du trou aux rats et de lasachette de Notre-Dame de Paris paraissent inexactes, à l’époque où Victor Hugo les mit.
Pour moi, ce qui m’intéresse surtout, en dehors même de ce fait que, pendant les siècles de ferveur, le summum de la vie contemplative, l’effort suprême de l’âme voulant se fondre en Dieu, se sont sûrement produits dans ces geôles, c’est cette ressemblance que je relève dans la suite des âges, entre les reclus et les oblats.
Mais, l’heure s’avance ; assez rêver ; pensons aux choses matérielles et devenons le docile serviteur de la mère Bavoil. Quel malheur tout de même que d’avoir une bobine dans la cervelle et de se dévider ainsi ses récentes lectures ! C’est la faute de ces braves Carmélites dont les dures observances m’ont suscité le souvenir des reclusages ; allons, en voilà assez, filons. Et Durtal, après avoir acquis ses emplettes, se dirigea vers la gare. Il avait l’horreur des paquets et pestait après ces sacs dont les ficelles lui coupaient les doigts. — Tant pis, fit-il, je vais me débarrasser de la bouteille de chartreuse en la fourrant dans mes trousses ; la maman Bavoil en sera quitte pour gémir et me reprocher, une fois de plus, d’avachir les poches de mon pardessus.
Et il resongea à cette femme, en montant dans le train. Elle vivait maintenant dans le noir ; — plus de visions, plus de colloques avec Dieu ; — brusquement les effusions divines avaient cessé ; elle était redevenue ainsi que tout le monde ; elle s’accusait d’avoir évidemment mérité cette disgrâce, en ayant peut-être trop causé de ces faveurs et elle se rongeait avec cette idée, tout en se résignant.
Qui sait, pensa Durtal, si, après la mort de l’abbé Gévresin, qui l’avait dirgée pendant des années et qui était fixé sur l’origine de ses visions, elle n’eût pas éprouvé de terribles ennuis avec de nouveaux confesseurs défiants ou ignares ou même très savants, — car ceux-là n’auraient pu faire autrement, du reste, que de la passer, pour leur gouverne, à la coupelle de l’obéissance et de l’humilité ; — qui sait si ce n’est pas dans l’intérêt de sa tranquillité que le seigneur, en lui retirant des privilèges qui n’importent pas d’ailleurs au salut de son âme, l’a dispensée de leur en parler ? tiens, quand elle s’attristera trop, j’essaierai avec cette opinion de la consoler.
CHAPITRE VI
Punition méritée de la gourmandise, dit Madame Bavoil, en riant.
— Je renonce aux graisserons, s’exclama Durtal, en déposant sur son assiette une sorte d’éponge émincée en tranches et dont on avait calciné les bords.
— C’est ma faute, avoua Mlle de Garambois, très déconfite. J’ai mal grillé les tartines, mais aussi il aurait fallu un autre pain que cette chiffe préparée par le boulanger du village !
Mme Bavoil enleva les décevants graisserons et apporta un gigot que Durtal se mit en devoir de découper.
— Votre petit vin lutine aimablement le goût, fit M Lampre. On sent que le terroir qui le produit serapproche de Beaune.
— N’est-ce pas ?
— Je n’ai point eu le temps d’aller à la grand’messe, reprit Mme Bavoil qui servit des pommes de terre à l’anglaise pour assister le gigot. Il n’est rien survenu de neuf ?
— Non ; si, pourtant ; mais l’événement est maigre ; le père Titoune est arrivé pendant l’introït et il a été forcé d’aller s’agenouiller devant l’autel jusqu’à ce que le père Abbé lui ait permis, en frappant avec son marteau sur le pupitre, de se relever et de lui expliquer les causes de son retard ; et il est probable que ses excuses n’ont pas été reconnues valables, car, au lieu de gagner sa stalle, il a occupé la dernière place, celle des retardataires, au choeur.
— Oh ! fit Durtal, le père Titourne qui est un peu toqué est coutumier du fait ; je confesse ma gaieté lorsque je vois ce grand diable qui a une calotte noire et une figure blême de pierrot, se précipiter, bride abattue, dans l’église. Il a une façon alors de secouer les manches de sa coule qui vole et l’entoure comme d’un tourbillon. L’on dirait d’un Debureau s’agitant dans un bain d’encre.
— Ce qu’il doit en subir des coulpes, celui-là !
— Comment cela ? demanda Mme Bavoil.
— Mais oui, deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, chacun s’accuse devant le chapitre réun des fautes commises contre la règle. Ces fautes sont, cela va de soi, légères. On se reproche de ne pas s’être courbé assez promptement au gloria des psaumes, d’avoir déchiré son vêtement ou renversé son encrier, vous voyez cela d’ici. Le Révérendissime inflige au délinquant une punition qui consiste généralement en une prière et en l’obligation de faire satisfaction au réfectoire, c’est-à-dire de venir s’agenouiller devant sa table où il l’immobilise plus ou moins longtemps, suivant la gravité du délit ; mais ici le bon père Abbé ne laisse pas ses enfants moisir sur le sol, car ils ont à peine fléchi le genou qu’il les autorise d’un signe à retourner s’asseoir.
— Et tous les moines sont soumis à ces punitions qui sont humiliantes lorsqu’on les subit devant leshôtes ?
— Tous, profès, novices, postulants, convers ; le prieur n’en est pas non plus dispensé et l’Abbé même, après que les religieux ont terminé leur coulpe au chapitre, s’excuse devant eux de ses manquements à la règle et en fournit les raisons.
— Une tranche de gigot, Monsieur Lampre. — Non ? Une pomme de terre alors ?
— Non, fit Mlle de Garambois répondant à un appel d’yeux de Durtal ; je me réserve pur le pâté que j’aperçois : donnez-moi, en attendant, la salade qui l’accompagne, afin que je la retourne.
Et lorsqu’ils furent arrivés au dessert, tandis qu’elle grignotait des gâteaux et des pains d’épices, Mlle de Garambois reprit :
— Ne nous pressons pas, car il nous faut attendre le père Felletin pour le café, et il n’est jamai en avance. Puisque nous avons du temps devant nous, monsieur mon frère, ce serait peut-être le cas de tenir la promesse que vous avez toujours éludée jusqu’alors, de nous exhiber les documents que vous possédez sur l’oblature. Apprenez-nous au moins ce qu’elle fut puisque nous ne savons ce qu’elle est.
— Mais c’est une conférence que vous me demandez là !
— Du tout, prenez vo notes qui sont rangées avec soin, j’en suis sûre ; lisez-les simplement et ça nous suffira.
— Je veux bien, moi ; seulement je vous préviens qu’aucune chronologie rigoureuse et qu’aucune dicipline attentive des séries n’existent dans ce déballage de matériaux. Vous me saisissez à l’improviste ; vous devez donc accepter, sans vous plaindre, l’incohérence probable de cette leçon.
— Entendu, à condition cependant que vous ne nous fassiez pas languir.
Durtal sortit et revint, au bout dequelques instants, avec une liasse de cahiers.
— Voyons, fit-il, par oùcommencer ? par ceci d’abord, n’est-ce pas, que l’oblature n’es nullement, comme on le croit, une invention Bénédictine. Elle a fructifié avant qu’elle ne fût implantée dans notre institut, chez les prémontrés, chez les Templiers, dans d’autres Ordres ; on pourrait affirmer qu’elle a été dans le sang du Moyen-Age, tant elle répondait au concept religieux de cette époque.
On la trouve, en tout cas, au sixième siècle, où Séverin, abbé d’Agaune, — l’u des deux saints de ce nom qui servent de patrons à la bonne église saint Séverin de Paris, — régit une sorte de communauté où hommes et femmes vivent dans des maisons séparées et mènent une existence quasi monastique, sans se lier par des voeux ; on la trouve également, au siècle suivant, instaurée par les règles de saint Isidore et de saint Fructueux. Ce dernier décrète que si un laïque se présente dans l’un de ses monastères avec sa femme et de petits enfants, il sera, lui et les siens, assujetti aux règles suivantes : ils seront, les uns et les autres, soumis à la juridiction de l’Abbé qui disposera de leurs biens ; ils n’auront, de leur côté, à se préoccuper ni du vivre, ni du vêtement. Il leur sera interdit de causer ensemble sans permission ; toutefois, les enfants pourront voir leurs parents quand ils voudront, jusqu’au moment où ils seront en âge d’être formés aux coutumes du cloître.
Ajoutons, toujours en guise de préface, que les oblats sont désignés dans les chroniques et les nécrologes moastiques sous les noms : « d’oblati, d’offerti, de dati, de donati, de familiares, de commissi, de paioti, de fratres conscripti, de monachi laïci » et que les documents que j’ai recueillis sur leur compte sont extraits des annales Bénédictines de Mabillon, des annales de Camaldule de Mittarelli, du glossaire de la basse et de la médiocre latinité de Du Cange, surtout d’un travail d’ensemble de Dom Ursmer Berlière, paru, en 1886 et 1887, dans le messager des fidèles, la petite Revue Bénédictine de Maredsous ; malheureusement, dans cette étude, dense et fouillée, la confusion est visible entre les oblats, les converts et les reclus ; et il est, en effet, difficile de les différencier, leur vie étant souvent identique et les textes usant parfois de termes qui s’appliquent indifféremment aux uns et aux autres ; et, de même pour les oblates désignées souvent sous les vocables « d’oblatae, de conversae, d’inclusae » .
Pour Cîteaux, j’ai découvert quelques indications spéciales dans Manrique et le nain, dans les annales d’Aguebelle, dans l’état intérieur des abbayes cisterciennes, au treizième siècle, de D’Arbois de Jubainville ; j’ai déniché aussi des notes dans d’autres bouquins ; c’est une salade mais moins bien retournée que celle que Notre Soeur l’oblate vous a préparée tout à l’heure.
Ces précautions oratoires...
— C’est le mot ! interrompit Mlle de Garambois, en riant.
— Ces précautions oratoires prise, je vous déclarerai qu’il y eut deux sortes d’oblats.
Ceux qi habitaient dans le cloître et ceux qui habitaient dans ses alentours.
La législation cistercienne est à eu près muette sur les seconds ; elle ne s’occupe guère que des premirs et encore est-ce à la cantonade.
Elle appelait de préférence les oblats intérieurs des familiers pour les distinguer de ceux qui restaient dans le monde et ’étaient pas astreints au célibat. Ils recevaient avec la tonsure, un costume à peu près semblable à celui des moines, prêtaient voeu d’obéissance et ne pouvaient changer de maison, sans l’autorisation du père Abbé ; mais ce genre de vie bâtarde devint une cause de dissipation pour les cloîtres et le chapitre général de 1233 les astreignit aux trois voeux de religion comme les pères ; — et celui de 1293 les supprima. Ils ont été rétablis depuis ; — mais je me perds dans mes notes, poursuivit Durtal qui remuait ses paperasses. Je passe, nous les rechercherons plus tard, s’il le faut.
Chez les Bénédictins proprement dits, les renseignements sont nombreux mais combien de fois trop brefs ! Nous savons qu’agrave; la fin du huitième siècle, saint Ludger endossa l’habit et la coule au mont Cassin et qu’il y demeura deux ans et demi, sans s’y attacher par aucune profession monastique ; le même cas se présente, le siècle suivant, à l’abbaye de Fulde. Gontran, le neveu de l’abbé Raban-Maur, bien qu’il ne fût pas lié par les voeux conventuels et qu’il ne fût par conséquent qu’un oblat ou un familier, fut chargé par son oncle de la direction d’un prieuré dépendant de l’abbaye-ce qui prouve, entre parenthèses, que les oblats n’étaient pas moins considérés, au point de vue religieux, que les profès, à cette époque.
Enfin, tout en mentionnant les abus qui résultaient de l’oblature de gens qui se réfugiaient dans les monastères pour échapper aux servitudes des armées, un capitulaire de Charlemagne autorisa les laïques à résider, en faisant donation de leurs biens, dans le cloître de saint Vincent de Volturne.
Au neuvième siècle, au synode d’Aix-la-Chapelle, saint Benoît d’Aniane tenta d’interdire l’entré des oblats dans les ascétères, mais son avis ne prévalut pas, car nous voyons en ce même temps des laïques et des clercs séjourner, après avoir revêtu le froc, dans les agrégations du mont Cassin, de Fulde, de saint Gall ; et, dans cette dernière, l’oblature prospérait, régulière et nombreuse, cent ans après.
Mais ce fut surtout à partir du onzième siècle, qu’elle prit une incroyable extension. Quelle était l’existece de l’oblat dans les cloîtres ? Nous n’ignorons pas qu’il naquit avant le convers, mais sur la façon même dont il vécut, au milieu des pères, nous en sommes réduits à des bribes de documents.
A Hirschau, dans la forêt noire, cinquante oblats remplissaient le rôle qui fut plus tard dévolu aux convers. Ils aidaient à construire les bâtiments, à défricher, à moissonner, et soignaient les malades. Ils semblent bien avoir été les premiers frères-lais, les « converti, les barbati » des cloîtres ; puis, quand ces frères furent créés et organisés, ils durent commencer à occuper cette situation mitoyenne, entre les pères et les convers, qu’ils ont gardée.
Les oblats que l’on appelait « paioti » au quatorzième siècle, subissaient un noviciat de deux ans ; on ne leur accordait pas le titre de frère et ils conservaient le nom et la tenue qu’ils portaient dans le siècle ; ils ne s’engageaient que par les voeux de stabilité et d’obéissance et, de même que les convers, ils n’avaient place, ni au chapitre, ni au choeur. Par contre, ils étaient admis au réfectoire où ils détenaient une place à part et ils profitaient de toutes les immunités et de tous les privilèges de l’Ordre.
— Alors, ils n’avaient pas de costume ? demanda Mlle de Garambois.
— Attendez, répliqua Durtal qui foullait dans ses papiers. D’après cette note sur les paioti que j’ai tiréede l’histoire de l’abbaye de saint Denys de Mme Félicie D’Ayzac, ils n’avaient pas, en effet, de costume ; mais voici d’autres documents qui avèrent qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Dans son livre des coutumes de Cluny, Ulric voulut que les oblats fussent affublés d’une livrée spéciale et le concile de Bayeux, cité par Du Cange, exigea qu’ils eussent un signe distinctif sur leurs habits ; de son côté, Mittarelli, dans ses annales de Camaldule, pense que les oblates de cette branche de l’ordre Bénédictin, s’attifaient d’une tunique et d’un scapulaire blancs et d’un voile noir ; enfin, parmi les planches du dictionnaire des ordres monastiques d’Hélyot, figure un oblat Bénédictin en costume. Il est accoutré d’une robe plus courte que celle des religieux et couvert d’un capuchon qui n’attient pas au vêtement ainsi que celui des moines — en somme ce capuchon est un bonnet mais moins pointu que la coiffure des pères.
— Oui, mais dans cette congrégation d’Hirschau que vous signaliez tout à l’heure, les oblats ne dépouillaient pas la défroque séculière, dit M Lampre, et ils n’arboraient pas, par conséquent, l’uniforme dont vous parlez.
— C’est un peu la bouteille à l’encre ; les coutumes ont changé suivant les abbayes et suivant les siècle. Il est évident aussi que les obligations des oblats dans les cloîtres varièrent, selon leur capacité et selon les âges ; le labeur manuel était réservé aux illettrés et les travaux intellectuels étaient au contraire destinés à ceux qui pouvaient rendre des services, comme traducteurs, comme copistes, comme écrivains ; le bon sens l’indique ; les uns étaient des pseudo-convers et les autres de pseudo-pères.
Plus tard, au seizième siècle, « les Déclarations de saint Maur » nous apprennent encore que chaque abaye de fondation royale possédait un moine appelé « oblat ou lay » dont la nomination appartenait au roi. Il y envoyait généralement un vieux soldat infirme ou blessé ; ses fonctions consistaient à sonner les cloches, à balayer l’église, à en ouvrir et à en fermer les portes ; c’était un simple domestique ; l’abbaye lui assurait le vivre, le coucher et les nippes ou bien il recevait, à son choix, une pension montant de soixante à cent livres. Ce genre d’oblat disparut, en 1670, époque de la fondation de l’hôtel des invalides.
— Vous avez été les ancêtres des invalides ! s’exclama M Lampre.
— Et des petits séminaistes aussi. La vieillesse et l’enfance, les deux extrêmes ; car le chapitre 59 de la règle traite des enfants offerts par leurs parents aux cloîtres ; et, en effet, pendant des siècles, les Bénédictins ont élevé des petits oblats dans leurs maisons ; c’était une pépinière de futurs moines ; à l’heure actuelle, ce système est tombé en désuétude, dans notre pays ; mais il subsiste encore, à ma connaissance, dans une abbaye de l’obédience de Dom Guéranger, à saint Dominique de Silos en Espagne.
— C’est malheureux pour les cérémonies et surtout pour le chant de n’avoir plus de petits garçons dans les cloîtres, fit Mlle de Garambois.
— Evidemment, mais les pensionnats sont un sujet de dissipation et de bruit dans les monastères qui ont besoin de silence et de paix. Ce genr d’oblats n’ayant aucun rapport avec ceux qui nous intéressent, je ne m’y attarderai pas davantage et, pour en finir avec les autres, je note que l’oblature claustrale s’est continuée jusqu’à la fin du dix-huitième siècle. Nous rencontrons encore, à cette époque, des oblats au mont Cassin, à Subiaco, en Allemagne, en France, où ils furent supprimés avec les moines par la Révolution.
L’oblature a repris naissance avec Dom Guéranger lorsqu’il a rétabli, à Solesmes, l’Ordre Bénédictin.
A l’heure présente, les oblats vivant dans l’intérieur des couvents ont le choix entre endosser l’habit monastique et alors leur vie est la même que celle des pères, ou garder le vêtement séculier et alors leur existence est celle des retraitants et des hôtes. M Cartier, qui a traduit sainte Catherine de Sienne et Cassien, écrit une vie de fra Angelico et de denses études sur l’art religieux, a demeuré de la sorte, en laïque, pendant des années, à Solesmes.
Voilà, grosso modo, les informations que j’ai recueillies sur les oblats de l’intérieur des cloîtres. Passons maintenant àla deuxième classe des affiliés, à ceux qui résidaient près ou dans les alentours des prieurés et des abbayes.
Cette classe peut se subdiviser en plusieurs séries.
Ceux qui prêtaient le serment d’obéissance et ne souscrivaient à auune convention pécuniaire. — Ceux qui s’asserissaient au monastère, tout en restant dans leur famille et conservant la propriété et l’usage de leurs biens, à condition de payer un cens dont le taux était fixé par l’Abbé. — Ceux qui faisaient donation de leur avoir à l’abbaye qui le leur rendait à titre de bénéfice, ou leur en laissait l’usufruit, ou leur octroyait en échange la subsistance dans leur propre logis.
— Je m’y perds ! s’écria Mlle de Garambois.
— Mais non, écoutez ; il y avait ceux qui payaient et ceux qui ne payaient pas.
Pour ceux qui conservaient leur argent, ça va out seul ; — pour les autres ce sont seulement les conditions qui varient ; les uns soldaiet un impôt, les autres ne concédaient que la propriété de leur pécune tout en en gardant la jouissance, leur vie durant ; les autres ne donnaient d’une main que pour reprendre de l’autre ; les derniers enfin pratiquaient un échange et, ici, j’appelle votre attention sur ces contrats de réciprocité qui sont absolument les mêmes que ceux usités pour les reclus.
A Cîteaux, j’ai découvert un procédé différent encore ; les oblats mariés allouaient à l’abbaye qui le entretenait pendant leur existence, une sorte de pension de retraite, car leurs biens retournaient au monastère, moitié au décès du mari et moitié au décès de la femme.
La première catégorie de ces oblats extérieurs, de ceux qui ne signaient aucun engagement financier et n’étaient liés que par l voeu d’obéissance, fut la plus nombreuse aux onzième et douzième siècles. On note ces oblats de deux sexes installés près des principaux centres des congrégations de Cluny et d’Hirschau.
La seconde catégorie, celle des gens qui s’asservissaient moyennant un cens et en continuant à être domiciliés hors des clôtures, e nomma en termes vulgaires « les serfs des quatre deniers » . Le glossaire de Du Cange nous fournit des renseignements détaillés sur leur compte. Le rite de la cérémonie était une imitation de l’asservissement féodal.
Le postulant se présentait, nu-pieds, avec une corde quelconque, quand ce n’était pas celle de la cloche, enroulée autour du col ; il se plaçait sur la tête quatre deniers qu’il déposait ensuite avec ses armes sur l’autel ; et, prosterné devant l’Abbé, il lui jurait obéissance, les mains jointes entre les siennes ; les femmes abandonnaient d’habitude, en signe de féauté, un bijou sur l’autel ; et une charte contenant les raisons et les clauses de cette sujétion était ensuite classée dans les archives de l’abbaye.
En voici une transcrite par la petite Revue Bénédictine et extraite du cartulaire du cloître autrichien de Melck. Elle remonte au treizième siècle.
» Qu’il soit porté à la connaissance de tous les fidèles que les parents d’Adélaïde, entièrement libres et nobles et n’ayant jamais été attachés à aucun homme par les liens du service, se sont offerts à Dieu, à la sainte croix et à saint Pancrace, dont les reliques reposent dans ce monastère consacré en l’honneur des saints apôtres Pierre et Paul et de saint Coloman, martyr, sous l’abbé Conrad et son successeur Dom Réginald, à raison de payer un cens annuel de cinq deniers dans ce monastère ; à condition également de trouver auprès des saints susmentionnés une maison de refuge si jamais l’on tentait de les réduire en servage. Les témoins tant défunts que survivants sont inscrits dans le cartulaire dudit monastère. »
— Ce n’est plus quatre, c’est cinq deniers que ceux-là payent, remarqua M Lampre.
— Oui, il est probable que les seigneurs et gens riches acceptaient l’augmentation de ce genre d’impôt ; les quatre deniers étaient ans doute le minimum exigé ; je le pense du moins. Je continue :
Parfois même des seigneurs affranchissaient leurs serfs, sous la réserve qu’ils acquitteraient une redevance à une abbaye.
Voici un modèle de cette sorte de charte ; — celle-là date du onzième siècle et provient du trésor des anecdotes de Bernard Pez.
» Adelard donne à l’abbaye de saint-Emmeran, à Ratisbonne, sa propre serve Théoburge avec ses deux fils Harold et Enold, à lacondition que cette serve paiera, chaque année, la somme de douze deniers à l’autel de saint-Emmeran et ses deux fils, à la mort de leur mère, un cens annuel de six deniers. »
Quant à la troisième série, celle des bénéficiaires et des usufruitiers, elle paraît avoir été nombreuse et justifiée surtout par ceci, qu’en dehors même du désir de participer aux prières des moines, les oblats voulaient obtenir le droit de sépulture au cloître, après leur trépas.
Et les promesses des abbés à ces affiliés n’étaient pas vaines. La preuve est qu’au douzième siècle, entre les deux abbayesd’Admont et de Salzbourg, il fut convenu que dès que l’on aurait appris le décès d’un oblat dépendant de l’un ou de l’autre de ces couvents, on sonnerait le glas et on réciterait pour l’aide du défunt les six psaumes : Verba mea — Domine ne in furore — Dilexi — Credidi — De Profundis — Domine exaudi — puis l’oraison Dominicale, le verset « A porta inferi » et l’oraison « Absolve Domine » et cela pendant sept jours, consécutifs, sans préjudice d’une messe conventuelle et de six cierges brûlés pour le repos de son âme.
— Ah bien ! s’exclama M Lampre, vous pouvez, sauf votre respect, vous taper, si vous vous imaginez que la congrégation de Solesmes reprendra en votre honneur ces us charitables d’antan !
Durtal rit.
— Nous n’en réclamons pas tant, n’est-ce pas, ma soeur l’oblate ?
— Pourquoi pas ? Cette coutume me semblerait à moi très naturelle ; mais avec tout cela, nous ne voyons pas bien quelles étaient, en dehors des taxes d’argent, les obligations de l’oblat.
— Elles ont varié suivant les monastères ; cependant une condition, sine qua non, figure sur toutes les cédules d’oblature, celle de l’obéissance.
— Et vous ne la formulez même point maintenant ! s’écria M Lampre. Cette clause, la seule exigée, la seule dont on soit sûr, n’est même pas mentionnée sur vos rituels d’oblature ; non, je vous l’ai dit, lorsque vous m’avez demandé pourquoi, — moi qui suis un des plus anciens commensaux du Val des Saints, — je n’étais pas votre confrère en saint Benoît, l’oblature, telle que les moines contemporains la conçoivent, est une véritable blague !
— Oh ! protesta Mlle de Garambois.
— Parfaitement et retenez bien ceci, tous les deux : il n’y a rien à tenter avec les Béédictins de France. Pour développer le rameau d’un ordre, il faut d’abord l’aimer et ensuite avoir l’esprit de prosélytisme. Les franciscains ont cela et leurs tertiaires sont pour eux de réels frères. La glorieuse paternité Bénédictine n’acceptera jamais que l’on se rapproche trop d’elle. Vous ne voulez pas me croire... vous verrez... vous verrez.
— Je poursuis, reprit Durtal, — qui ne jugea pas nécessaire de répondre ; — quelquefois, le voeu de chasteté était join à celui de l’obéissance ; et remarquez que ces voeux étaient, ainsi que ceux des profès, perpétuels. Ceux qui s’en déliaient étaient envisagés tels que des renégats et pouvaient être contraints par les lois ecclésiastiques de rentrer sous l’obédience de leurs supérieurs. Ce cas s’est produit à l’abbaye de saint sauveur, à Schaffouse. Dudon, un oblat, — celui-là vivait dans l’intérieur de la maison, — rejeta, un beau jour l’oblature, reprit ses biens et quitta le cloître. L’Abbé en appela au pape Urbain II qui menaça Dudon de le retrancher de la communion des fidèles, s’il ne rétractait pas son apostasie et son sacrilège. Un synode fut réuni, sur les ordres de sa sainteté, à Constance, pour juger le coupable qui fut condamné à réintégrer l’abbaye, à restituer, sans esprit de retour, ses biens ; et il dut, en sus, accomplir la punition que lui infligea pour son crime le père Abbé. On n’y allait pas de main morte en ce temps-là !
— Oui, je sais que les oblats étaient considérés comme personnes ecclésiastiques par le droit canon, et qu’ils étaient dotés du privilège de l’exemption de l’ordinaire, dit M Lampre. Et la liturgie de la prise d’habit et de la profession, avez-vous enfin déterré des renseignements sur elle ?
— Pas encore ; il résulte cependant du texte de Mittarelli que, chez les camaldules, les professions des oblats étaient souvent identiques à celles ds moines, avec cette différence néanmoins que l’église ne les reconnaissait pas solennelles et indissolubles.
Ajoutons, pour achever ce déballage un tantinet incohérent de notes, que les oblats pouvaient être célibataires ou mariés, laïques ou prêtres ; que les oblats pouvaient dépendre d’un couvent de femmes et les oblates d’un couvent d’hommes. Là, les informations abondent. Pour indiquer une source, vous lirez, dans les annales de Mabillon, qu’un certain nombre d’oblats avait fait à l’abbesse de sainte Félicité, à Florence, promesse d’obéissance, de conversion des moeurs et de continence.
— Il ressort de tout cela, monsieur mon frère, que c’était chose fort sérieuse que l’oblature au Moyen-Age.
— Mais oui et le papes la tenaient en haute estime. Tenez, écoutez cette phrase d’une bulle d’Urbain II adressée à l’Abbé d’Hrschau : « L’Oblature ne mérite que des éloges et est digne d’être perpétuée par la raison qu’elle est une reproduction de l’état primitif de l’église. Nous l’approuvons donc, nous l’appelons un institut saint et catholique et nous la confirmons. »
Sa Sainteté Léon XIII n’a donc fait que répéter les éloges de son prédécesseur du onzième siècle lorsqu’il a, dans un bref rendu, le 17 juin 1898, sur la demande de Dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de saint Anselme à Rome et primat de l’ordre de saint Benoît, prôné l’établissement des oblats Bénédictins et déclaré qu’il fallait l’aider et le propager.
Tels sont les documents que je possède sur la classe des oblats de l’extérieur ; j’ai vidé mon sac, Mademoiselle ma soeur ; ne m’en demandez as plus.
— Mais si, parlez-moi plus spécialement des oblates ; vous pouvez bien penser que c’est à elles surtout que je m’intéresse.
— Vous en savez autant que moi puisque, je vous l’ai dit, aucune différence n’a existé entre elles et les oblats de l’autre sexe. — Allons vous avez de la chance, poursuivit Durtal qui fouillait, en lui répondant, dans ses papiers. — Voici des extraits qui les concernent et que j’ai copiés à la bibliothèque de l’abbaye, dans les annales de Mabillon.
Dès le septième siècle, on trouve ces affiliés près des cénobies ; mais c’est surtout au dixième siècle, qu’elles abondet, à saint Alban, à saint Gall, surtout ; au onzième, elles s’attachent aux monastères de la Souabe, et, en France, elles foisonnent. À Flavigny, la mère de Guilbert, abbé de Nogent, se retira dans une cellule construite près de l’église ; à Verdun, la mère de saint Poppon De Stavelot et la bienheureuse Adelwine vinrent se fixer auprès du couvent de saint Vanne. Sainte Hiltrude résida près de l’abbaye de Liessies dont son frère Gondrade était l’abbé ; les deux soeurs de saint Guillaume habitèrent auprès de son monastère de Gellone. Les chroniques de saint Gall nous ont conservé les noms des Wiborade, des Richilde, des Wildegarde. Sainte Wiborade, la plus connue, se réfugia près de l’abbaye où son frère Hitton s’était fait moine ; elle apprenait le psautier, reliait les manuscrits et tissait les étoffes des bélamies et des robes. La mère du bienheureux Jean De Gorze, le réformateur des cloîtres de Lorraine, fut admise à loger dans un bâtiment contigu à la clôture dans laquelle était interné son fils ; elle recevait le vivre des religieux et s’occupait, de son côté, de coudre et de réparer les vêtures.
La plupart d’entre elles étaient oblates et recluses, à la fois, et si vous voulez mon avis net, eh bien, pour moi, plus j’y réfléchis et plus je suis conaincu que la première forme de l’oblature a été la réclusion ; et, ici, je suis en mesure de vous citer sans arrêt des noms : Walburge qui, avant d’avoir été abbesse à Juvigny, avait été l’une des oblates recluses de Verdun ; Cibeline, qui demeurait, dans les mêmes conditions, près de l’ascétère de saint Faron de Meaux et Hodierna près de celui de saint Arnoul, à Metz ; mais la litanie de ces pieuses femmes, Bénédictines ou séquestrées, serait dépourvue de profit.
— Il est, en effet, fort difficile, dit M Lampre, de discerner celles des oblates qui furent recluses de celles qui ne le furent point.
— Pour la majeure partie, c’est impossible ; cependant, d’autres ne peuvent certainement figurer au nombre des prisonnières, par exemple Agnès, l’impératrice d’Allemagne, au onzième siècle, qui fit oblation au monastère de Fructuaria ; elle y passait ses journées dans la prière, confectionnait des habits pour les pauvres, soignait les malades et les visitait fréquemment. Puisqu’elle quittait son couvent pour remplir ces oeuvres de miséricorde, elle n’était pas recluse.
En général, les oblates, qui étaient souvent des mères ou des soeurs de religieux désirant vivre auprès de leur fils ou de leur frère, lavaient et rprisaient le linge de la communauté, brodaient des ornements sacerdotaux, fabriquaient des hosties et d’aucunes pansaient les infirmes des environs. Elles se couvraient d’habitude de la robe monacale et d’un voile noir.
Autre note, continua Durtal, et toujours extraite de Mabillon. à Fontenelle, lors de l’invention du corps de saint Vulfran, les Bénédictins confièrent la garde de ss reliques à une dame qui avait renoncé au monde et revêtu un habit religieux.
— Savez-vous que c’est flatteur pour nous de compter parmi nos ancêtres une impératrice d’Allemagne, dit en souriant, Mlle de Garembois.
— Oh ! elle n’a pas été la seule ; elle a eu pour frères oblats de nombreux monarques. Louis Le Débonnaire fut oblat de saint Denys ; le roi Lothaire, de saint Martin de Metz ; Garcias, roi d’Aragon, de saint Sauveur De Leire ; le roi des germains Conrad, de saint Gall ; Alphonse, souverain de Castille, de Sahagun ; le roi de France, Louis Le Jeune, du monastère du christ de Cantorbéry ; le roi Saint Henri, votre patron, de saint Vanne de Verdun...
— C’était sans doute plus honorifique que réel, remarqua M Lampre.
— C’est possible ; mais il n’en demeure pas moins acquis que l’oblature fut assez bien fréquentée ; du coup, c’est clos, la séance est levée ; je réemballe mes notes.
— Eh bien, et sainte Françoise Romaine, notre patronne, que vous avez oubliée ?
— Tiens, c’est vrai ; elle fut une grande sainte et une admirale visionnaire ; mais son oeuvre, rattachée à la branche des olivétains, est un peu spéciale et n’a plus qu’un rapport déjà lointain avec les oblats vivant autour et dans l’intérieur d’un cloître.
Ses oblates, à elle, furent de véritables religieuses, menant la vie conventuelle et formant un ordre à part voué au traitement des grabataires. Vous en connaissez les règles ; elles sont encore suivies par les moniales de la tour des miroirs qui se sont perpétuées à Rome, depuis sa mort.
Quatre Carêmes par an ; hors ce temps, trois jours de la semaine mais seulement au dîner, permission d’user d’aliments gras. Jeûne les vendredis et samedis ; six heurs de sommeil en tout ; elles ne sont pas cloîtrées et peuvent sortir pour distribuer des secours aux nécessiteux et aux alités, mais c’est toujours en voiture fermée ; elles ont conservé le vêtement des veuves, tel qu’il était au temps de la sainte ; elles pratiquent l’office divin et travaillent en cellule.
Mais j’y pense ; pourquoi, amoureuse comme vous l’êtes de l’oblature, n’êtes-vous pas entrée dans ce couvent ou, si vous jugiez le climat de l’Italie hostile, ne vous êtes-vous pas établie religieuse en France, où une congrégation similaire existe à Angers et à Paris « les Servantes des Pauvres, oblates régulières de saint Benoît » ?
— Merci, moi, je suis de la communauté de Solesmes ; je n’ai rien à démêler avec ces ramilles entées sur le tronc de saint Benoît ; ce ne son pas des Bénédictines proprement dites.
— Bah !
— Je vous fais compliment, ma nièce, fit ironiquement M Lampre ; vous êtes une digne fille de l’agrégation de France. Hors d’elle, point de salut ; ne sont Bénédictins que ceux qui relèvent de Solesmes.
— Evidemment.
— Eh bien, et les Bénédictins de Jouarre qui ont restauré une abbaye d’une certaine célébrité et d’une certaine ncienneté, je pense, ce ne ont pas des Bénédictines ?
— Elles sont indépendantes, tiennent des classes, chantent mal l’office, ne sont pas dirigées par des pères Bénédictins. Ce n’est point cela.
-Et e prieuré des Bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Monsieur, à Paris ?
— Ce sont des Sacramentines.
— Mais saperlotte ! s’exclama M Lampre ; elles observent plus exactement la règle de saint benoît que vos jeunes Bénédictines ; elles ont le service de nuit, le maigre plus fréquent, et elles chantent le plain-chant, d’après la méthode de Dom Pothier, que voulez-vous de plus ?
— Rien, sinon que l’office divin n’est pas leur unique fonction ; tout est là.
— Voilà, dit M Lampre s’adressant à Durtal, voilà les ideacute;es que ma nièce a rapportées de son séjour auprès des cloîtres !
Dural riait de cette dispute entre l’oncle et la nièce ; ce n’était pas d’ailleurs la première à laquelle il assistait.
Toutes les fois qu’il s’agssait de l’ordre de saint Benoît, les querelles commençaient entre ces deux êtres, chacun finissant par exagérer ses opinions, pour exaspérer ’autre ; la vérité était que Mlle de Garambois rééditait, en les prenant au sérieux, les théories du père Titourne, ce toqué dont tout le monde se gaussait au Val des Saints ; de bonne fois, elle et lui, s’imaginaient rehausser le prestige de la congrégation de France, en rabaissant les autres.
— Avec ce système-là, s’écria M Lampre, l’on en arriverait à refuser le droit d’endosser la coule noire aux Bénédictins de la pierre-qui-vire, qui ont été fondés, eux, par un saint ; et cependant les fils du p. Muard, rattachés à la congrégation du Mont-Cassin, suivent la primitive observance, s’éveillent dans la nuit pour les matines et les laudes, pratiquent l’abstinence par tous les temps ; leur régime est à peu près aussi dur que celui des trappes ; et, en outre de l’office divin, ils prêchent, ils défrichent les âmes dans le nouveau-monde ; ils sont, en un mot, les plus fidèles disciples de saint Benoît. N’est-ce pas vrai ?
-Oui, répondit Durtal ; mais je vous avoue que, personnellement, l’idéal surélevé de Dom Guéranger m’enchante. Je ne vois pas l’utilité pour les Bénédictins de prêcher et d’enseigner. Il y a des ordres particuliers, dont c’est la tâche ; d’autre part, des ordres pénitentiels figurent dans la lignée même de saint Benoît ; les moines noirs n’ont donc pas à faire double emploi avec eux. Dom Guéranger a limité leur mission et précisé leur but ; il les a marqués d’une empreinte originale, en les différenciant justement d’avec les autres instituts.
Sa conception de l’ » Opus Dei » , des messes, des heures canoniales exécutées avec art, célébrées en grande pompe, cette idée du luxe pour Die est, selon moi, très belle ; il siérait que les moines, chargés de la réaliser, fussent en même temps des artistes, des savants et des saints ; c’est beaucoup demander, je le sais ; mais enfin, en tenant même compte du déchet, l’oeuvre n’en est pas moins magnifique !
— Voilà donc, s’écria Mlle de Garambois, quelqu’un qui rend justice à Dom Guéranger !
— On juge l’arbre par ses produits, répliqua M Lapre. Qu’est-ce que la congrégation de France a donné ?
— Comment, ce qu’elle a donné ? Mais vous ne l’ignorez pas plus que moi ! Faut-il donc répéter que Dom Guéranger a restauré les études liturgiques, Dom Pothier le plain-chant, et Dom Pitra la symbolique, en réunissant son spicilège qui forme des volumes précieux pour quiconque veut comprendre l’âme et l’art du moyen-âge ; enfin il existe du père Le Bannier une traduction en un vieux français vraiment exquis des méditations de saint Bonaventure : c’est aussi fort, dans son genre, que les contes drôlatiques de Balzac.
— Et maintenant ?
— Maintenant ! dame, je ne suppose pas pourtant que l’ordre soit à bout de sang. En tout cas, il peut revendiquer un maître livre, « Le Traité de l’oraison » de Mme l’Abbesse de sainte Cécile ; rappelez-vous, entre autres inoubliables pages, celle où elle explique les degrés de la vie mystique par les phrases du pater, prises à rebours, c’est-à-dire en commençant par la dernière pour finir par la première. Un autre volume très bien renseigné, très lucide et, qui plus est, écrit dans une langue musclée, toute moderne « Le livre de la prière antique » , par Dom Cabrol, prieur de Farnborough, est à citer aussi ; eh bien mais, il me semble que c’est déjà quelque chose !
— Mon cher, désirez-vous connaître mon opinion, eh bien, vous et ma nièce, vous n’êtes pas au fond des Bénédictins, vous êtes des Guérangistes !
‐ Tiens, voilà qu’on se dispute sur notre dos ! dit le père Felletin qui entra.
— Asseyez-vous, père.
— Et j’apporté le café, fit Mme Bavoil ; vrai, reprit-elle, s’adressant au moine, vous arrivez à temps. J’entends de ma cuisine ce que l’on peut appeler un chiage de vos frocs.
— Voyons, de quoi M Lampre nous accuse-t-il encore ?
— De tout, répondit Mlle de Garambois. Il vous reproche de ne pas fournir de fruits, d’être dévorés par la superbe en vous croyant les seuls Bénédictins du monde ; il se plaint enfin que vous ne suiviez pas les règles du Patriarche.
— C’est bien des griefs à la fois. Les fruits ? Mais l’arbre ne fut point stérile, je pense ; vous n’avez qu’à ouvrir, pour vous en assurer, la bibliographie des Bénédictins de la congrégation de France, éditée par Dom Cabrol. — En histoire, vous trouverez les doctes et les patients ouvrages de Dom Chamart et de Dom De Fonneuve, — en hagiographie, des vies de sainte Cécile, de saint Hughes De Cluny, de sainte Françoise Romaine, de sainte Scholastique, de saint Josaphat, — dans le monasticum, les moines d’Orient de Dom Besse, — dans la liturgie, les savants articles de Dom Plaine, — dans la paléographie musicale, les travaux de Dom Mocquereau et de Dom Cagin, — dans la symbolique, les magistrales études de Dom Legeay.
— Oui, celles-là, je les connais, dit Durtal ; ces travaux sur le sens allégorique des écritures sont, en effet, médullaires et saisissants ; malheureusement, ils sont épars en des brochures et des tirés à part de revues ; aucun éditeur, pas même les cloîtres qui disposent d’une imprimerie, tels que Solesmes et Ligugé, n’ont eu le courage de les réunir et ce serait pourtant autrement glorieux pour la renommée de l’ordre que ces vies de saints dont vous parlez !
— La superbe ? reprit le père Felletin. Ne la confondez-vous pas avec l’esprit de corps qui est une fierté mal placée, injuste quelquefois, mais qui est issue de la solidarité de gens vvant ensemble, enfermés, et dont le champ de vision est fatalement restreint. Dans l’armée, le dragon s’estime supérieur au cavalier du train et le tringlot, parce qu’il monte à cheval, se juge fort au-dessus du fantassin. C’est inévitable ; il faut, pour faire aimer l’état sur lequel on dirige des néophytes, les persuader qu’il est le plus beau et le meilleur de tous. Ce n’est pas bien méchant, en somme.
— Non, et c’est inéluctable, dit Durtal. Il y a dans les ordres, quels qu’il soient, un microscope spécial qui change les fétus en poutres. Un mot, un geste insignifiant, sans portée autre part, prend des proportions inquiétantes dans un cloître ; on rumine sur les actes les plus simples pour y loger des dessous ; la critique la plus bénigne, la plaisanterie la plus inoffensive, deviennent des attentats. Par contre, il suffit qu’un religieux produise une oeuvre quelconque pour qu’aussitôt la gloire du clocher naisse. Il y a le grand homme de monastère, de même qu’il y a le grand homme de province ; c’est puéril et c’est touchant ; mais, vous le dites très bien, cela dérive de l’esprit de corps et d’une existence rétrécie et mal renseignée sur les alentours.
— Quant à ne pas suivre les préceptes de saint Benoît, poursuivit le moine qui sourit à la remarque de Durtal, cela est plus grave. En quoi, mon cher Monsieur Lampre, ne les suivons-nous pas ?
— C’est pourtant clair ; la règle de saint Benoît, ainsi que la plupart des règles des autres instituts d’ailleurs, se compose surtout d’avis généraux et de conseils. Le points, en dehors des prescriptions liturgiques qu’elle précise comme devant être strictement observés, sont plutôt rares. Or, ce sont ceux-là dont vous ne vous souciez guère. Ainsi, les moines doivent coucher tout habillés et en dortoir, ils doivent réciter matines, avant l’aube, ils doivent, sauf les malades et les infirmes, s’abstenir de la chair des quadrupèdes, par tous les temps — et vous couchez déshabillés et en cellules, vous récitez l’office après l’aurore et vous mangez de la viande.
— De quadrupède, s’écria Mlle de Garambois, mais alors la volaille qui n’a que deux pattes est permise !
— Il y a belle lurette, fit Dom Felletin, en souriant, que des accusatins de ce genre ont été lancées contre nous. Sans parler de la querelle de saint Bernard et de Pierre Le Vénérable, à ce sujet, rappelez-vous que dans sa dissertation pour prouver que l’hémine de vin accordée par jour aux moines était de demi-setier, Dom Claude Lancelot, l’un des solitaires de Port-Royal, reprochait déjà aux Bénédictins du dix-septième siècle de tricher sur les heures des repas ; — ce que nous faisons, nous aussi, en carême ; et il déclare que l’on ne doit manger qu’après l’heure de vêpres, c’est-à-dire, le soir.
Or, les Trappistes, si rigoureux pour eux-mêmes, ne peuvent plus supporter cette abstinence. Il est, en effet, impossible de se tenir debout, de deux heures du matin, comme eux ou même de quatre heures, comme nous, sans prendre ucune collation jusqu’à quatre heures du soir ; la tête tourne et les détraquements d’estomac et les névralgies sévissent. Il a bien été nécessaire dès lors de frauder et de situer, en carême, les vêpres, avant midi, c’est-à-dire avant l’heure du repas ; et croyez bien que, malgré cet adoucissement, je dispense encore la plupart de mes novices du jeûne jusqu’à midi. Je leur concède, le matin, le frustulum ; ne fût-il que d’une goutte de café noir et d’une miette de pain, il suffit pour empêcher les vertiges et les migraines. Vous ne vous doutez pas combien, dans une existence, privée d’exercice, la santé se débilite surtout lorsque la nourriture est peu succulente, privée de viandes saignantes et alourdie par l’abus des farineux. À la fin du carême, où le pain même est mesuré et où personne ne mange à sa faim, les caractères sont changés. Tout le monde s’impatiente et s’énerve ; l’on pèche contre la charité à mesure que les austérités s’accroissent ; est-ce enviable ?
— Le rosbif lénifie l’âme et le poisson l’irrite ! dit Durtal, en riant.
— Hélas ! Nous avons des corps débilités de pères en fils maintenant et lers infirmités se répercutent sur le moral ; c’est une humiliation que le seigneur nous inflige ; il est donc prudent de ne point la négliger ; sinon alors, il n’y a plus qu’à renvoyer les meilleurs de nos sujets parce qu’ils ne peuvent résister aux jeûnes, ou à muer le monastère en hôpital !
Et puis, vous vous imaginez que les Bénédictins se nourrissent constamment de viandes et c’est absolument faux ; la vérité est que nous usons d’aliments gras, plusieurs fois la semaine, sauf en Carême et en Avent. Ajoutez à ces deux saisons, où nous sommes voués au maigre, les quatre-temps, les vigiles, la Semaine Sainte, d’autres fêtes et vous constaterez que nous pratiquons l’abstinence, les deux tiers de l’année, et endurons au moins une centaine de jeûnes.
En tous cas, ces atermoiements que voulut l’église, qui a également desserré les observances des fidèles, sont prévus par notre règle et amplement justifiés par l’affaiblissement des onstitutions et par une vie sédentaire d’études qu’il serait impossible de mener avec un nutriment de légumes et d’eau.
Remarquez aussi que si je suis très large pour ceux de mes novices dont le tempérament est délicat, je le suis beaucoup moins pour les autres. Je laisse parfaitement le frère de Chambéon, ce trabucaire du bon Deu, qui est doué d’une complexion de fer, jeûner tant qu’il veut, et éclabousser de sang les murs de sa cellule, tant il se frappe. Il n’en est pas moins joyeux et dispos, c’est parfait ; mais ce genre d’opérations, je l’interdirai toujours aux autres, tant qu’il ne me sera pas démontré qu’ils le subiraient sans dam.
— C’est le vendredi que vous vous fustigez, en récitant le miserere, avec la discipline ?
— Oui, et le mercredi aussi, dans les temps de pénitence ; et chacun est maître d’edosser le cilice, si sa santé le tolère. Nous ne sommes donc pas aussi exempts de macérations que paraît le croire M Lampre.
Quant au système des cellules remplaçant les dortoirs dont parle la règle, il n’a nullement été innové par Dom Guéranger. Il existait déjà, au quinzième siècle, dansles congrégations de sainte Justine et de Valladolid et il s’est continué jusqu’à nos jours ; le dortoir présente d’ailleurs plus d’inconvénients que d’avantages et il en est de même du coucher, tout habillé ; les moines sont libres d’agir, à ce point de vue, comme bon leur semble ; cependant, pour ceux qui sont peu soigneux de leur personne, la malpropreté qui résulte du non déshabillage permet de désirer qu’on le proscrive ; enfin, vous voudrez bien observer qu’en ce qui concerne le changement d’heure des matines, il consiste en une simple transposition de l’horaire et que nous n’y gagnons pas une minute de repos de plus. Ceux qui se lèvent à deux heures de la nuit, ainsi que les cisterciens, se couchent à sept heures, en hiver et à huit en été, mais alors ils ont une heure de sieste, après midi. Nous, nous ne nous couchons guère avant neuf heures et nous sommes debout à quatre. Comptez et vous découvrirez que le sommeil est de sept heures, et qu’il est le même pour les uns et pour les autres.
Et puis, voyez-vous, pour juger équitablement la congrégation de Solesmes, il convient de se référer à ses origines. Dom Guéranger qui la fonda mourut à la peine, après s’être débattu, toute sa vie, dans des questions d’argent ; — et il fallait avoir l’âme robuste et gaie de ce moine pour ne jamais désespérer et poursuivre quand même son oeuvre ! — Eh bien, quand il décéda, il n’était pas encore parvenu à façonner des religieux tels qu’il les concevait ; il ne réalisa son rêve qu’à l’abbaye des moniales de sainte-Cécile — et ce, grâce à Mme l’abbesse qu’il avait formée. — Il trépassa et son successeur Dom Couturier fut un homme excellent mais qui n’avait point l’empan du grand Abbé et les expulsions survinrent. Les Bénédictins vécurent dans le village, sans clôture, sans moule claustral possible. Dom Couturier disparut à son tour et, de par l’énergie et l’intelligence du nouvel abbé, Dom Delatte, les moines, rentrés dans leur monastère, reprirent un train de vie monastique.
Notez, en conséquence, les cahots des débuts, la situation des novices devenus profès, après une existence dispersée aux quatre coins d’un bourg, et avouez qu’après de telles épreuves, la congrégation de France ne s’en est tout de même pas trop mal tirée !
Il y eut un silence.
— Pardon de changer le thème de la conversation, reprit le père Felletin qui était devenu soudain grave; mais vous m’avez troublé avec toutes vos discussions et j’oubliai que j’ai de fâcheses nouvelles à vous annoncer.
— De fâcheuses nouvelles ?
— Oui, d’abord le père Philigone Miné a été frappé d’une attaque, ce matin ; le médecin de Dijon est venu ; il assure qu’il en réchappera mais que la tête, qui n’est déjà plus bien solide, y restera...
— Oh, le pauvre homme !
— Ensuite, le bruit court — et il est malheureusement sérieux — que le gouvernement va nous supprimer la cure du Val des Saints.
— Il va nommer un curé, ici !
— Oui.
— Mais, s’écria M Lampre, l’église, qui est à la fois abbatiale et paroissiale, devra donc être scindée en deux : celle du curé, celle des moines ; c’est absurde !
— Hélas !
— Et le père Abbé que pense-t-il de cela ? demanda Durtal.
— Il est fort attristé, mais que voulez-vous qu’il fasse ? Il ne peut lutter contre la direction des cultes et contre l’Evêque !
— Ah ! l’Evêque est là-dedans !
— C’est-à-dire que, lui, subit aussi la volonté du gouvernement. Il n’aurait pas accompli ce changement de lui-même — il a la main forcée ; c’est du reste un homme âgé et infirmeet qui ne veut pas d’ennuis.
— Vous savez, à propos, lança M Lampre, le joli tour dont il fut victime, alors qu’il était encore grand vicaire dans une autre ville.
— Non.
— Un prêtre qui, à tort ou à raison, lui en voulait et l’accusait d’avoir trahi la cause des ordres religieux près du préfet, fit passer dans les journaux qui n’y virent que du feu un écho que repoduisit, à son tour, la presse de province, relatant que m. le vicaire général Triaurault venait d’être nommé évêque in partibus d’Haceldama.
— Le champ du traître, celui où Judas se pendit ! s’écria Mlle de Garambois.
— Le comique est qu’il reçut de nombreuses visites et de nombreuses cartes le félicitant de son élévation à l’épiscopat. Il faillit en crever de rage.
— Il n’y a que la haine sacerdotale pour effectuer de pareilles trouvailles, dit Durtal.
— Enfin, reprit le moine, voilà la nouvelle ; elle est, vous le voyez, pénible ; quel sera le modus vivendi étabi entre le curé et les Bénédictins ? Je l’ignore. Quel sera le nouveau titulaire du Val des Saints ? Je n’en sais pas davantage ; la seule chose qui soit sûre, c’est que la nomination ne tardera pas.
— Père, dit Mme Bavoil qui venait de rentrer dans la salle à manger, est-ce que les paysans ne vont pas protester et défendre leurs moines ?
Le père Felletin se mit à rire.
— Ecoutez ceci, Madame Bavoil ; ici, le père curé ne touche aucun traitement du gouvernement ; c’est donc une économie pour les contribuables, et, d’autre part, il ne peut — notre règle l’interdit — profiter du casuel auquel tout curé a droit. Donc, on enterre et on marie les pauvres, gratis pro deo, et l’argent touché des obsèques et des noces de gens qui eurent le moyen de payer, est mis de côté pour acheter du bois que l’on distribue, dès que l’hiver approche, aux indigents. Le paysan est donc privilégié dans ce village ; eh bien, il est si bête, si hostile aux religieux qu’il sera enchanté de leur voir enlever la cure ; pourquoi ? Il ne s’en doute même pas, ce ne sera que plus tard, alors qu’il s’apercevra que ce changement atteint sa bourse, qu’il comprendra la bêtise de sa joie.
Quant aux hobereaux, c’est pour eux un triomphe. Ils auront enfin un curé à eux, mais j’aime à croire que tant que nous serons là, l’on interdira au baron des atours et à sa famille de chanter de la musique profane dans notre église...
— C’est à savoir ! s’exclama Durtal ; — allons, une goutte de chartreuse, mademoiselle ma soeur, comment, vous refusez ?
— Vous êtes féroce ; je pleure, en buvant mon petit verre, tant c’est fort ; et elle accompagna cette plainte d’un sourire angélique, tout en achevant de laper la dernière larme.
— Nous traversons pour l’instant une période d’ennuis, reprit le père Felletin qui restait songeur.
— Qu’y a-t-il encore ?
— Il y a, il y a, que j’ai bien peur d’être oblié de renvoyer le plus intelligent de mes novices, le frère Sourche !
— Pourquoi ?
— A cause de ses idées, hélas ! — ce garçon est compréhensif et érudit, et, il est aussi obéissant et pieux ; il a toutes les qualités, mais il rayonne autour delui l’agitation ; il m’effraie, à certains moments, alors que je le vois courir, soufflant comme une machine, dans les corridors ; c’est une nature exubérante et capable d’éclater si on la comprime. J’ai peur, en le gardant, qu’il ne devienne fou. D’autre part, expliquez cela, sa piété très réelle s’accorde avec un scepticisme qui déconcerte. Il est rationaliste dans les moelles ; il est de ces gens qui s’attellent sur un texte, avec l’idée que l’on n’est pas savant si l’on n’arrive à démontrer que ce texte est faux et il nie aussitôt qu’il y découvre des actes qui dépassent sa raison. Quand il est arrivé, ici, il était plein des lectures de mgr Duchesne, il citait à tout propos l’histoire de saint Bernard de l’abbé Vacandard. Il lui a soustrait plusieurs miracles ! s’écriait-il, avec admiration ; nous avons essayé de réagir, mais en pure perte. Or, ce novice trouble les autres avec ses aperçus équivoques et ses marchandages de l’au delà ; et j’estime que, dans l’intérêt même du noviciat, il serait dangereux de le conserver.
Malheureusement, il est sans position, sans fortune, et il serait cruel de le congédier sans avoir d’abord assuré son avenir. Il est décidé à ne pas rentrer dans le monde et persiste à vouloir devenir prêtre ; nous allons dnc tâcher d’obtenir son admission dans un séminaire ; peut-être ses nouveaux maîtres réussiront-ils mieux que nous à le sauver de lui-même.
— Mais, dit Durtal, il ne déparera pas du tout le personnel des séminaires, car, vous n’ignorez point — et c’est là, le péril de l’heure actuelle — que les plus intelligents des élèves sont, tous, des rationalistes.
— Hélas ! fit le P. Felletin.
— Cette nouvelle génération, poursuivit Durtal, entend la foi à sa manière ; elle en accepte et elle en refuse ; elle n’a plus confiance dans les leçons de ses maîtres ; ces jeunes gens sont de ceux qui prennent es lanternes pour des vessies. Le respect humain, l’orgueil, le désir de ne pas paraître plus crédules que les impies, les détraquent. Tous ces gaillards-là ont lu Renan. Ils rêvent d’une religion sensée, raisonnable, ne choquant pas le bon sens du bourgeois par des miracles. Ne pouvant nier ceux des évangiles, car alors ils ne seraient plus catholiques, ils se rejettent sur ceux des saints et ils retournent, ils torturent, ils forcent les textes afin de tâcher de prouver que les témoins oculaires et que les écrivains qui les narrent, avaient tous la berlue ou étaient, tous, des imposteurs. Ah ! ça nous prépare un joli clergé ! — Et, ce qui est étrange et qui sera la caractéristique de notre époque, c’est ceci : un mouvement mystique se dessine actuellement chez les laïques et le mouvement inverse se produit chez les prêtres ; eux font à reculons le pas que nous, nous faisons en avant ; les rôles sont renversés. Il finira par n’y avoir aucune entente possible entre les pasteurs et les ouailles !
— Et ce mouvement gagnera les cloîtres, ajouta M Lampre. Le frère Sourche n’est pas, croyez-le bien, un isolé ; celui-là est franc et se découvre ; d’autres, plus prudents, tairont ces idées jusqu’à e qu’ils se sentent en nombre pour oser les exprimer ; un jour viendra où, pour manifester un esprit large et paraître érudit, un mauvais moine renchérira sur le système de démolissage de la nouvelle école. Nous avons déjà les partisans de la très libre exégèse, les abbés démocrates, nous finirons bien par avoir les frocards protestants !
— Que Dieu nous en préserve ! dit Dom Felletin.
— Un clergé et des religieux, sans mystique, quels troupeaux d’âmes mortes ! s’écria Durtal. Les moines ne seront plus alors que les conservateurs du musée des vieilles traditions et des vieilles formules et les prêtres que lescommis de l’intendance céleste, que les employés préposés au bureau des Sacrements.
— Nous n’en sommes heureusement pas encore là, dit le p. Felletin, en se levant de table ; mais c’est égal, je ne puis m’empêcher de trembler quand j’envisage l’avenir. Qui sait ce que le seigneur nous prépare ?
— Et si la loi sur les associations ne passera pas ?
— Oh ! — et le maître des novices eut un geste d’incrédulité, en les quittant.
— Croyez-vous que ceux-là seront pris au dépouvu quand le parlement votera cette loi, dit Durtal.
— Les Bénédictins ! clama M Lampre, ils s’imaginent que la France les connaît et serait désolée de les voir partir ! quelle illusion ! s’ils se doutaient combien ce malheureux pays, qui les ignore, se fiche qu’ils demeurent ou fuient, ils en béeraient !
CHAPITRE VII
L’hiver était venu ; le froid sévissait, terrible, au Val des Saints.
Malgré ses cheminées bourrées de bûches et la floraison de ses glaïeule feu qui poussaient en chantant, dans les cendres, la maison était froide car la bise pénétrait par tous les interstices des croisées et des portes. Les bourrelets, les paravents s’attestaient vains ; tandis que l’on se grillait les jambes, le dos gelait. Il faudrait luter toutes les ouvertures, les cacheter ainsi que des bouteilles, avec de la cire dans laquelle on aurait fondu du suif, grognait Durtal ; et Mme Bavoil répondait placidement : calfeutrez-vous dans des couvertures ; il n’est pas d’autre moyen pratique de se réchauffer, ici ; et elle donnait l’exemple, accumulant sur elle des cloches de jupes, s’embobelinant la tête dans des amas de bonnets et de fichus ; on ne lui voyait plus que le bout du nez ; elle avait l’air d’une samoyède ; il ne lui manquait que les patins qu’elle avait remplacés par d’énormes sabots, au bec retroussé comme une proue de barque.
Cependant, à force d’entasser, dès l’aube, dans l’âtre, des troncs d’arbres, les chambres, vers les fins d’après-midi, finissaient par devenir presque malléables et quasi douces ; mais au dehors ! En dépit des cabans, des foulards, des capuchons, c’étaient des cents d’épingles dans les oreilles et des pelotes d’aiguilles dans le nez au bout duquel il semblait que l’on eût adjoint, ainsi qu’au goulot d’un flacon de marchand de vins, un stilligoutte ; les yeux ruisselaient de larmes, les moustaches, embuées par l’haleine, coulaient ; le visage apparaissait, à la fois, aquatique et rubescent ; mais il y avait pis que ce froid sec et déchirant, il y avait le dégel. Alors le Val des Saints tournait au cloaque ; on piétinait dans la boue, sans en sortir. Durtal avait essayé des sabots, mais il se tordait le pied et ne pouvait marcher avec ; les essais d’autres espèces de chaussures n’ayant pas mieux réussi, il s’était contenté de simples caoutchoucs ; mais c’était avec eux la glissade dans la compote délayée des terres ; ou bien alors les caoutchoucs se refusaient obstinément à le suivre et, s’il insistait, ils crachaient rageusement le café au lait qu’ils avaient bu dans les mares et finalement lâchaient la bottine pour rester fixés au sol.
Les moments douloureux étaient les matins, quand il s’agissait de descendre, dans une obscurité à trancher au couteau, à l’église.
Réveillé vers les trois heures et demie, il se renfonçait sous ses couvertures et rêivssait, au chaud, jusqu’à quatre heures. Alors, une sonnette tintait très au loin, dans la nuit, la sonnette du cloître commandant l’éveil ; et cinq minutes après, c’était l’appel réitéré des cloches ; dix minutes s’écoulaient encore, et l’on n’entendait plus rien ; et les cloches reprenaient, égouttaient lentement, un à un, cent coups.
C’est peut-être de là que vient l’expression « être aux cent coups » , se disait-il, se figurant la bousculade des cellules, les moines se précipitant dans les escaliers, car, au centième coup, tous devaient être à l’église. Il est vrai que le bon saint Benoît ayant prévu quelque retard, déclare, dans sa règle, que l’on doit réciter un peu longuement, afin d’accorder aux traînards le temps d’arriver, le psaume 66, appelé, à cause même de cette recommandation, le psaume des paresseux ; car, après la récitation du psaume, c’est pour ceux qui ne sont pas rendus à leur place, la coulpe.
Moi, rien ne me presse, ruminait Durtal, car il savait à peu près par la fête du jour, vérifiée, la veille, sur l’ordo, l’étendue du spacieux office qu’est matines accompagné de laudes. Il durait, en effet, plus ou moins ; quelquefois, pour certains semi-doubles, tout était terminé à cinq heures dix minutes ; d’autres fois, alors qu’il s’agissait d’une grande fête, il y en avait jusqu’à six heures moins le quart ; la fin était annoncée par l’Angelus ; et aussitôt les messes commençaient.
Je ne suis, en conscience, tenu qu’à venir, les jours de communion, assister à la première messe, continuait-il ; mais je serais désolé de manquer les laudes et, sur cette remarque, il finissait par s’arracher du lit.
Quand le temps était beau et que le soleil était levé, il n’était pas difficile d’être présent aux heures canoniales de l’aube ; mais, l’hiver, par ces jours où la nuit ne cesse plus, dans cette église, dénuée de paillassons, jamais chauffée et atrocement humide, car elle ne reposait sur aucune crypte, c’était plutôt pénible ; et encore Durtal s’estimait-il heureux, à l’abri dans cette nef, qui paraissait tiède et douillette, alors que l’on s’y réfugiait, après avoir été piqué jusqu’au sang par la bise du dehors.
Il y avait de ces nuits de campagne sinistres, sans lune, où l’on trébuchait, où l’on se cognait sur un mur que l’on croyait bien loin. Ces nuits-là, il se perdait en chemin ; sa lanterne l’égarait plus qu’elle ne l’éclairit ; elle semblait repousser les ténèbres à deux pas devant elle et les épaissir après ; et, les jours de giboulée, l’on avançait, aveuglé, au hasard sous la tourmente, changeant la lanterne de main pour réchauffer dans la poche les doigts gourds, pataugeant dans les ornières, luttant avec les caoutchoucs dans les flaques. Le quart d’heure de marche pour gagner l’église était interminable. Cahin-caha, il atteignait pourtant le porche du sanctuaire. Là, il était guidé par un point de feu, le trou de la serrure qui scintillait tel qu’une braise dans le noir de la porte ; et c’était avec joie qu’il éteignait sa lanterne et tournait le loquet.
Au sortir de l’ombre, au bout de la nef obscure, l’abside resplendissait. Des lampes allumées au-dessus des stalles rabattaient avec leurs abat-jour les lueurs sur les moines immobiles et l’impression de ces chants de pitié et de louange éclatant dans un village endomi, loin de tout, tandis que la neige assoupissait, derrière la porte, tous les bruits, était, en quelque sorte, radieuse comme une oeuvre angélique et, comme une oeuvre surhumaine, accablante.
Durtal arrivait généralement vers la fin des Matines, alors que les religieux debout entonnaient l’hymne brève le « Te decet Laus » et aussitôt après l’oraison, l’on chantait les Laudes.
Cet office, composé tel que celui des Vêpres, avec les psaumes et les antiennes, un cantique de l’Ancien Testament, changé suivant les jours, puis les trois psaumes d’exaltation, que ne sépare aucune doxologie, le capitule, le répons bref, l’hymne différente, selon que l’on est en été, ou en hiver et enfin, à la place du magnificat, le Benedictus et son antienne, était un office superbe, supérieur à celui de Vêpres, en ce sens que ses psaumes avaient une signification précise que ne décidaient point ceux du service des soirs.
En dehors des psaumes de louanges qui avaient baptisé de leur nom les laudes, les autres faisaient tous, en effet, allusion au lever du soleil et à la résurrection du Christ ; et il n’était point de prière du matin plus concentrée, plus précise, plus belle.
Si Durtal avait jamais pu sérieusement douter de la puissance des oraisons liturgiques, il devait bien constater qu’elle existait en ce splendide office, car c’était, après l’avoir écoutée, une légèreté d’élans, une griseri d’âme, une sorte de mise en train pour participer plus activement à la sanctimonie du sacrifice, pour pénétrer plus de l’avant dans l’éloquent mystère de la messe.
Et à la fin des Laudes, dans le silence du choeur, tombé comme mort, avec ses moines agenouillés, la tête dans les mains ou le front poli par la lumière sur le pupitre, l’angélus dégageait du clocher ses trois volées de sons et alors, à leur dernier tire-d’ailes qui se prolongeait dans la nuit, tous se redressaient et les prêtres allaient se vêtir pour dire la messe. Les convers et parfois les novices les servaient ; et c’était souvent le père Abbé, assisté par deux moines, qui célébrait, au grand autel, la première.
Mme Bavoil était friande de celle-là, parce qu’elle y baisait, en communiant, l’anneau du père Abbé ; et, plus courageuse que son maître, elle y descendait, chaque jour ; il est vrai qu’elle méprisait et les lanternes et les ciels d’encre ; elle était semblable aux chats qui regardent le soleil sans broncher et voient dans les ténèbres ; elle marchait son petit pas que n’arrêtait aucune rafale, que n’accélérait aucun gel ; elle traînait d’ailleurs tant de manteaux, tant de capes et de fichus entassés, les uns sur les autres, qu’elle ne pouvait être transpercée par les fils les plus aigus des pluies.
— Quand vous aurez avalé votre café, notre ami, disait-elle, alors qu’ils revenaient ensemble de l’église, il n’y paraîtra plus ; et le fait est qu’il y avait un moment exquis, ce moment où, délivré de cette course dans les frimas et l’ombre, Durtal s’asseyait dans son cabinet de travail, devant une cheminée où les pommes de pins craquaient et s’émiettaient en de rouges écailles dans les flammes orangées des bûches ; et déjà réchauffé, il dégustait, en mangeant une tranche de pain, une allègre tasse de café noir.
— Pour une fois, l’horaire se modifie, dit, un matin, Mme Bavoil ; car nous voici à la veille de noël. A quelle heure auront lieu les matines ?
— Ce soir, à dix heures.
— L’office est-il dans les bréviairs que nous a légués notre père, l’abbé Gévresin ?
— Oui et non ; il y est ; mais je dois vous prévenir que les matines monastiques diffèrent de celles du romain ; les psaumes varient ainsi que les antiennes et si les leçons sont les mêmes, elles sont coupées de façon autre ; puis, il y a le chant de la généalogie, et une hymne brève que le textuaire de Rome ignore. Vous ne pouvez donc suivre les matines avec les livres du brave abbé ; mais je vous prêterai, si vous voulez, un vieux bréviaire du dix-huitième siècle, en latin et français, à l’usage des religieuses Bénédictines de France. Il est volumineux, mais exact.
— S’il y a le français, c’est mon affaire ! Alors, nous descendrons vers dix heures moins le quart ?
— Moi, non ; car il faut que j’aille me confesser ; je me rendrai au cloître à neuf heures, afin d’y joindre le père Felletin dans sa cellule.
Et, en effet, le soir, Durtal alluma sa lanterne et, emmitouflé dans un caban de conducteur d’omnibus il s’en fut barboter dans la bourbe. Je ne sais pas, se dit-il, si le frère Arsène se tient, à cette heure, à la porterie ; c’est peu probable ; il sera pus sage de passer par l’église et d’ouvrir avec ma clef la porte qui donne sous le clocher.
Il gagna donc l’église. Là, au fond du choeur éclairé par un fumignon, Dom d’Auberoche préparait une répétition de la cérémonie avec ses novices. Il les faisait évoluer, tourner, saluer, s’agenouiller, devant le trône de l’Abbé, puis défiler devant l’autel, en esquissant des inclinations médiocres ou profondes et des révérences plus ou moins accentuées, à telle ou telle place.
Et il leur enseignait à lancer, en s’agenouillant, un petit coup de reins pour ramener la robe en arrière et cacher les pieds ; et lorsque le mouvement du corps projeté en avant était raté, il s’agenouillait devant eux afin de leur montrer la façon de s’y pendre et il leur désignait, en tournant la tête, la place couverte de ses talons.
Oh, je suis tranquille, murmura Durtal, il n’y aura pas d’anicroches ; mais quel tintouin il s’inflige, le pauvre père !
Il descendit les quelques marches qui menaient à la première porte du clocher ; celle-là, n’était jamais fermée u’au loquet ; il tomba dans une sorte de vestibule voûté à des hauteurs énormes et le long des murailles duquel flottaient d’énormes cordes pour sonner les cloches et il ouvrit avec son passe-partout la seconde porte communiquant directement, celle-là, avec le cloître.
Il était désert et aucun quinquet n’éclairait les arcades. L’ombre encapuchonnée de Durtal se cassait, aux lueurs de sa lanterne, immense et cocasse, contre les murs. Il longea le réfectoire ; un rais de lumière courait sous la porte et l’on y entendait des bruits de pas.
— Fichtre, se dit-il, est-ce que l’on soupe ? Je ne vais point alors rencontrer Dom Felletin. Il atteignit l’escalier, monta au premier et frappa doucement à l’huis du maître des novices. Nul ne répondit.
Il éleva sa bougie pour vérifier la pancarte vissée sur le panneau et qui énumère les lieux du couvent où le moine, absent de sa chambre, se trouve ; mais le bâtonnet fiché d’habitude dans le trou creusé en face du nom de la pièce désignée sur le papier pendait, sans rien indiquer, au bout d’une ficelle.
Comme il était autorisé à pénétrer dans la cellule du père lorsque celui-ci lui avait assigné un rendez-vous, il tourna la clef restée dans la serrure, posa sa lanterne allumée sur le bureau, s’assit sur une chaise et attendit.
Il regardait ce réduit où il était, tant de fois, venu, une chambre blanche percée de deux portes, l’une joignant la pièce au palier par lequel il était entré, l’autre accédant au noviciat. Entre les deux portes, s’étendait un méchant lit defer et une paillasse sans draps sur laquelle était jetée une couverture couleur de cataplasme. À regarder ce grabat, il était évident que son ami couchait, tout habillé, dessus ; il y avait en outre un lavabo de zinc, un prie-dieu, deux chaises de paille, un assez grand bureau encombré de paperasses et de livres ; sur les murs, étaient cloués une croix de bois sans christ et un cadre de sapin enfermant la vierge en couleur de Beuron, une madone pieuse et réservée, un peu fade mais avenante et douce ; et c’était tout.
Ce qu’on gèle, ici, murmurait Durtal ; pourvu que mon homme n’ait pas oublié le rendez-vous ; un traînement de chaussons dans le couloir le rassura.
— Je suis en retard, dit le religieux, mais nous venons d’avaler au réfectoire, selon l’usage traditonnel, un bol de vin chaud pour nous fouetter le sang, car nous allons être sur pieds et chanter jusqu’à l’aurore. Vous êtes prêt ?
— Oui, père, répondit Durtal, qui s’agenouilla sur le prie-dieu et se confessa : après lui avoir donné l’absolution, placidement, posément, parlant ainsi que dans une conférence à ses novices, Dom Felletin traita de cet avent qui était mort et de cette fête de noël qui allait naître.
Durtal s’était rassis et l’écoutait.
— Ces quatre semaines, disait-il, qui représentent les quatre mille ans écoulés avant la venue du Christ sont enfin closes. Le 1er de l’an civil, le 1er janvier du calendier grégorien est pour le monde un sujet de liesse ; pour nous, le jour de l’an liturgique, qui est le premier dimanche de l’avent, fut un sujet de peines. L’avent, symbole d’Israël, qui appelait, en se macérant et en jeûnant sous la cendre, l’arrivée du messie est, en effet, un temps de pénitence et de deuil. Plus de gloria, plus d’orgue aux féries, plus d’ite missa est, plus de te deum, à l’office de nuit ; nous avons adopté comme marque de tristesse le violet et jadis, en un signe plus énergique d’inquiétudes et de transes, certains diocèses, ainsi que celui de Beauvais, arboraient des ornements cendrés ; d’autres même, ceux du Mans, de Tours, les églises du Dauphiné, renchérissaient encore sur le sens des couleurs désolées, en revêtant la teinte des trépassés, le noir.
La liturgie de cette époque est splendide. Aux détresses des âmes qui pleurent leurs péchés, se mêlent les clameurs enflammées et les hourras des prophètes annonçant que le pardon est proche ; les messes des quatre-temps, les grandes antiennes des O, l’hymne des Vêpres, le rorate coeli du salut, le répons de matines du premier dimanche peuvent être considérés parmi les plus précieux bijoux du trésor des offices ; seuls les écrins du carême et de la passion contiennent des orfèvreries aussi parfaites ; les voici maintenant réintégrées dans leur cassette, pour un an. L’allégresse des souhaits exaucés succède aux anxiétés des échéances ; et pourtant tout n’est pas achevé, car l’avent se réfère non seulement à la nativité du Christ, mais aussi à son dernier avènement, c’est-à-dire à cette fin du monde où il viendra, selon le Credo, juger les vivants et les morts. Il sied, par conséquent, de ne point oublier ce point de vue et d’enter sur la joie rassurante du Nouveau-Né, la crainte salutaire du juge.
L’Avent est donc à la fois le Passé et le Futur ; et il est aussi, dans une certaine mesure, le présent ; car cette saison liturgique est la seule qui doive subsister, immuable, en nous, les autres disparaissant avec le cycle qui tourne ; l’année, elle-même, se termine, mais sans que jusqu’ici l’univers disparaisse en un définitif cataclysme ; et, de générations en générations, nous nous en repassons l’angoisse ; nous devons toujours vivre en un éternel avent, car, en attendant la suprême débâcle du monde, il aura son accomplissement en chacun de nous, avec la mort.
La nature même a pris à tâche de symboliser les soucis de cette saison que nous vécûmes ; la décroissance des jours fut comme l’emblème de nos impatiences et de nos regrets ; mais les jours s’allongent au moment où Jésus naît ; le soleil de justice dissipe les ombres ; c’est le solstice d’hiver et il semble que la terre, délivrée de persistantes ténèbres, se réjouisse.
Nous devons donc, ainsi qu’elle, oublier pour quelques heures la menaçante pensée des châtiments, ne songer qu’à cet événement inexprimable, d’un dieu devenu un enfant pour nous racheter.
Mon cher ami, vous avez bien préparé votre office, n’est-ce pa ? Vous avez déjà lu les exquises antiennes des matines ; vous m’entreteniez tout à l’heure, en confession, de vos défiances et de vos distractions pendant le chant des psaumes ; vous vous plaigniez du chagrin que vous éprouviez à ne pas vous croire suffisamment imprégné de l’atmosphère temporale ; vous vous demandiez si la routine n’annihilait pas l’efficace de vos oraisons ? Vous chercherez donc toujours à liarder avec vous-même ! Mais, voyons, je vous connais assez pour savoir que, cette nuit, vous tressaillerez d’aise, rien qu’en entendant l’admirable invitatoire de l’office. Avez-vous donc besoin de vous appesantir sur chaque mot, de soupeser chaque répons ? Ne sentez-vous pas la présence de Dieu, en cet enthousiasme qui n’a rien à démêler avec la discussion et l’analyse ? Ah ! Vous n’êtes pas simple avec lui ! Vous aimez mieux que personne les proses inspirées des heures et vous voulez vous convaincre que vous ne raisonnez pas assez pour les aimer. C’est fou ! Vous n’aboutirez, avec de tels soupçons, qu’à vous briser tout élan ; et prenez garde, car c’est la maladie du scrupule — dont vous avez tant souffert à la Trappe — qui revient !
Soyez donc meilleur enfant avec vous-même et moins pincé avec Dieu. Il n’exige pas que vous démontiez, ainsi que des pièces d’horlogerie, les sujets de vos suppliques et que vous vous chantourniez l’entendement quand vous commencez de les dire. Il vous mande seulement de les réciter ; tenez, un exemple ; choisissons une sainte dont vous ne récuserez pas la compétence, sainte Térèse ; elle ignorait le latin et ne souhaitait point que ses filles l’apprissent ; et les Carmélites psalmodient cependant l’office en cette langue. Avec la minutie de vos conjectures, elles prieraient mal, alors ! La vérité est qu’elles savent, qu’en agissant de la sorte, elles chantent les louanges du seigneur et l’implorent pour ceux qui ne l’implorent point et cela suffit ; elles saturent de ces pensées ces mots dont elles ne saisissent pas d’une façon précise le sens et qui rendent leurs désirs d’une manière absolue pourtant ; elles rappellent à Jésus ses propres assurances et ses propres plaintes. Leurs prières Lui présentent — si j’ose dire — une traite qu’il signa de son sang et qu’il ne peut laisser protester ; ne sommes-nous pas, en effet, les créanciers de certaines promesses de ses Evangiles ?
Seulement... seulement... continua le moine, après un silence, comme se parlant à lui-même, ces promesses dues à l’immensité de son amour veulent, pour qu’elles se réalisent, que nous usions envers Lui d’un juste retour — mesuré à notre aune, cependant — car, quelle misérable répercussion de l’infini, nous portons en nous ! Ce pauvre amour, il ne s’obtient que par la souffrance. Il faut souffrir pour aimer et souffrir encore lorsque l’on aime !
Mais oublions tout cela ; n’assombrissons pas la joie de ces quelques heures ; nous reviendrons à nous, après ; songeons d’abord à cette incomparable veille, à ce noël, qui a fait pleurer d’attendrissement tous les âges. Les évangiles sont brefs ; ils nous relatent les événements sans réflexions et sans détails ; il n’y avait pas de place à l’hôtellerie et c’est tout ; mais quelle merveilleuse chair liturgique s’est enroulée autour de ce noyau qui paraissait si sec ! L’Ancien Testament est venu compléter le nouveau ; et, ici, c’est l’inverse de ce qui s’opère d’habitude ; ce sont, contrairement à tous les précédents, les textes antérieurs qui parachèvent ceux qui les suivent ; le boeuf, l’âne, ce n’est pas à saint Luc mais à Isaïe que nous les devons ; et ils nous demeurent à jamais acquis dans « l’O magnum mysterium » , l’un des plus magnifiques répons du 2e Nocturne de cette nuit.
Ah ! la radieuse beauté de la Théophanie ! Alors que Jésus vient de naître et qu’il ne peut encore parler, il symbolise d’une façon immédiate, par un acte matériel, les enseignements qu’il proclamera si clairement plus tard. Son premier soin est de mettre en pratique et de confirmer par un exemple le chant de gloire de sa mère « l’Exaltavit humiles » du Magnificat !
Sa première pensée est une pensée de déférence envers elle. Il veut justifier devant tous le cri de victoire de la Vierge et il atteste aussitôt, en effet, que les petits sont ses préférés et qu’ils doivent passer devant lui avant les grands. Il certifie que les riches aurontplus de mal que les pauvres à être admis en sa présence et il le fait comprendre, en imposant un long voyage à ces souverains et à ces savants que sont les mages, alors qu’il dispense de ces fatigues et de ces périls les pâtres qu’il convie, les premiers, à l’adorer et il rehausse la hiérarchie des humbles, en déléguant pour les conduire auprès de lui, non plus la lueur silencieuse d’une étoile, mais une troupe extasiée d’Anges !
Et l’Eglise se conforme aux desseins du Fils. En cette nuit de noël, les mages ne se manifestent qu’à la cantonade et il ne sera vraiment question d’eux, ils n’auront vraiment un office leur appartenant en propre qu’à la fête de l’épiphanie. Aujourd’hui, tout est pour le bergers.
Ajoutons qu’à son tour, Marie a toujours ratifié ce signe, car dans les plus célèbres de ses apparitions, elle s’est toujours adressée à des gardiennes de troupeaux, non à des savants, à des monarques, ou à des femmes riches.
— Sans doute, père dit Durtal, mais pourtant permettez-moi une observation. La leçon d’humilité que vous mentionniez tout à l’heure a tout de même été un peu perdue. Le Moyen-Age qui inventa tant de légendes sur les rois Mages, n’en a pas imaginé une seul pour les pauvres pasteurs ; les reliques des mages, promus au rang des saints, sont encore vénérées à Cologne et personne ne s’est jamais occupé de savoir ce qu’étaient devenus les restes des modestes pâtres et ne s’est demandé s’ils n’étaient pas, eux aussi, des saints !
— C’est vrai, fit en souriant, le moine. Que voulez-vous, l’humanité raffole du mystère ; les mages étaient si énigmatiques, si étranges que tout le moyen-âge a rêvé de ces potentats qui représentaient, pour lui, le comble de la richesse et l’apogée de la pussance ; et il a oublié les bons bergers qu’il ne pouvait concevoir différents de ceux qu’il voyait, tous les jours. C’est l’éternelle chanson : les premiers devant Dieu sont les derniers devant les hommes.
Allez en paix, communiez, mon cher enfant, et priez pour moi.
Durtal se leva pour prendre congé.
— A propos, dit Dom Felletin, j’ai eu quelques renseignements sur l’effet produit dans le public par la lettre du pape relative à la loi des congrégations. On a bien compris qu’elle énonce, en termes plus adoucis, plus diplomatiques, ce qu’affirme plus rigoureusement l’interview de Des Houx, dans le Matin. Léon XIII retirera à la France le protectorat de l’Orient, si elle touche aux ordres ; c’est vous dire que devant un tel ultimatum, le gouvernement reculera et que le danger dont nous menaçait la franc-maçonnerie s’éloigne.
— Et si le ministère, convaincu que sa Sainteté lâchera pied à la première alarme, persiste à faire voter cette loi ?
-Ah ! vous êtes difficile à convaincre !
-Allons, que le seigneur vous entende !
Durtal serra la main du confesseur et desendit l’escalier qui menait au cloître. Il aperçut sous les galeries un cierge qui marchait et il reconnut le céroféraire, le petit frère Blanche. Il s’avançait, devant le père d’Auberoche, en coule, qui tenait sur un plateau des reliques enveloppées d’un voile et ils se dirigeaient ainsi que lui vers l’église.
L’abside ressemblait alors à une ruche ; les novices mettaient la main aux derniers préparatifs de la fête ; c’était dans le choeur mal éclairé, comme un pullulement noir. Tous s’écartèrent et le bourdonnement cessa, quand Dom d’Auberoche passa et déposa son plateau sur l’autel ; il ôta la serviette de lin, campa entre les flambeaux, des phylactères de vermeil et de bronze doré et des novices allumèrent, pour honorer et pour signaler aux fidèles la présence des reliques, des veilleuses d’or pâle, aux coins de l’autel.
Et le père D’Auberoche fit, avant de se retirer, un beau salut à ces pieux détriments, puis une génuflexion, en bas, devant le tabernacle ; et le père sacristain commença d’allumer les lampes et les cierges.
Bientôt le fond du sanctuaire fut en feu.
Tendu d’un tapis d’Orient qui recouvrait ses marches et les pavés du choeur, l’autel, paré de candélabres et de plantes vertes, rutilait ; sur la table, les ornements sacerdotaux du père Abbé étaient rangés et les deux mitres, l’auriphrygiate et la précieuse, brasillaient, l’une du côté de l’épître, l’autre, du côté des évangiles, à chaque bout.
Le choeur était habillé de tentures blanches à franges et, à gauche, érigé sur trois degrés, le trône abbatial, la cathedra de velours rouge, surmontée d’un baldaquin, se détachait sur la draperie blanche, coupée, lucarnée, en quelque sorte, au-dessus du dossier, par un cartel figurant les armes de l’Abbé, peintes.
La place habituelle du révérendissime, un peu en avant des stalles de ses moines, était décorée de velours rouge, à crépines d’or, comme le trône ; et un prie-dieu attifé d’une étoffe verte, se dressait devant l’autel. — Oh, oh ! se dit Durtal ; voici les signes des grands jours, car ici, le tapis de Smyrne et le prie-dieu vert constituent le summum de la hiérarchie des fêtes.
Les cloches sonnaient. Une file de religieux, en aube, le père prieur en tête, sortit de la sacristie et se dirigea vers la porte de l’église ouvrant sur le cloître, pour présenter l’eau bénite à l’Abbé. La nef s’emplissait de paysans ; le curé classait les enfants sur le bancs ; c’était dans l’église, un brouhaha de sabots et de bottes. M Lampre perça la foule et vint s’installer près de Durtal. Le très noble baron des Atours, accompagné de sa famille, entrait. Il jetait un regard protecteur sur ces manants qui s’effaçaient devant lui ; sa face de vieux capitaine d’habillement s’abattit, une fois agenouillé, au premier rang des chaises, entre ses dix doigts qui bientôt se disjoignirent, les uns pour tirer la brosse à dents de sa moustache, les autres pour caresser la boule lisse de son crâne. Sa femme était d’une distinction problématique et sa fille d’une laideur sûre ; elle ressemblait à la maman, avec quelque chose de plus provincial encore et de plus gnolle ; et le fils, un bon jeune homme, instruit dans les plus dévotes institutions, se balançait debout, les mains gantées, sur le pommeau de sa canne dont l’extrémité s’enfonçait dans la paille malade de la chaise.
On se demandait si ces gens savaient lire, car ils n’avaient aucun livre et se bornaient à égrener, qu’ils fussent, à la messe, aux matines ou aux vêpres, de précieux chapelets, montés sur argent, et qui simulaient, avec le cliquetis de leurs médailles, un bruit de cheval secouant son mors.
Et tout à coup, l’orgue éclata en une marche triomphale ; l’Abbé pénétrait dans la nef, précédé de deux maîtres des cérémonies entre lesquels marchait le porte-crosse, en aube, les épaules couvertes de la vimpa, une écharpe de satin blanc à revers de soie cerise dont les très longs pans, ramenés sur la poitrine, servaient à envelopper la tige de la crosse ; et l’Abbé dont la grande traîne noire était portée par un novice bénissait, au passage, les fidèles agenouillés qui se signaient.
Et lui-même était allé se mettre à genoux sur le prie-dieu et toute sa cour de cérémoniaires, de chapiers, de religieux en aube, s’agenouillait aussi et l’on ne voyait plus qu’une volute d’or, dominant un champ de lunes mortes, la crosse debout au-dessus des larges tonsures, rondes et blanches, des têtes.
A un signal du P. d’Auberoche, frappant légèrement dans ses mains, tous se relevèrent ; l’Abbé gagna son trône près duquel se postèrent les trois diacres d’honneur ; et le prie-dieu vert fut remisé.
Le choeur était plein ; les deux rangs des stalles du haut étaient occupés, de chaque côté, par les coules noires des profès et des novices, celles du bas par les coules brunes des convers et, au-dessous d’eux, sur des bancs, fulminaient les robes vermillon des enfants de choeur ; et c’était, das l’espace laissé vide, les allées et venues des cérémoniaires et du porte-crosse, le va-et-vient des autres porte-insignes, du porte-bougeoir et du porte-mitre ; et ces exercices étaient si expertement réglés que, dans une étendue très restreinte, tous évoluaient, se croisaient, les uns dans les autres, sans jamais se gêner.
L’Abbé commença l’office.
Ainsi que l’avait prévu le père Felletin, l’enchantement de l’invitatoire agit aussitôt sur Durtal. On chantait le psaume habituel « Venite exultemus » conviant les chrétiens à adorer le seigneur, coupé, aprè chaque strophe, par le refrain, tantôt abrégé;, « le Christ nous est né » , tantôt complet « le Christ nous est né, adorons-le » .
Et Durtal écoutait ce psaume magnifique, rappelant la création du seigneur et ses droits. Sur une mélodie vaguement dolente et d’une affection si affirmative et si respectueuse, les merveilles de Dieu se déroulaient et aussi ses plaintes sur l’ingratitude de son peuple.
La voix des chantres énumérait ses prodiges : « La mer est à Lui, c’est Lui qui l’a faite et la terre est l’oeuvre de ses mains ; venez, adorons le Seigneur, prosternons-nous devant Lui ; pleurons devant le Seigneur qui nous a créés, car c’est Lui qui est le Seigneur, notre Dieu et, nous, nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. »
Et le choeur reprenait : « Le Christ nous est né, adorons-le. »
Et, après l’hymne glorieuse de saint Ambroise le « Christe Redemptor » , l’office solennel s’ouvrit vraiment. Il se partageait en trois veilles ou nocturnes, composés de psaumes, de lectures ou de leçons et de répons. Ces nocturnes décelaient un sens spécial. Durand, le vieil évêque de Mende du treizième siècle, les explique clairement dans son rational. Le premier nocturne allégorisait le temps écoulé avant la loi donnée à Moïse et, au Moyen-Age, l’autel était dissimulé sous un voile noir qui symbolisait les ténèbres de la loi mosaïque et la condamnation prononcée contre l’homme, dans l’éden ; — le second signifiait le temps passé depuis la loi écrite et l’autel était alors caché sous un voile blanc parce que l’Ancien Testament éclairait déjà avec les lueurs furtives de ses prophéties l’homme déchu ; — le troisième spécifiait l’amour de l’église, les grâces du Paraclet et l’autel se dérobait sous une nappe de pourpre, emblême de l’Esprit Saint et du sang du Sauveur.
L’office se dévidait, tantôt psalmodié et tantôt chanté. Il était d’un ensemble splendide ; mais la suprême beauté il la réservait plus spécialement pour le chant ou le récit de ses Leçons.
Un moine descendait de sa stalle, conduit par un cérémoniaie, devant un pupitre placé au milieu du choeur, et, là, il chantait ou récitait — on ne savait quel terme employer — car ce n’était plus absolument de la psalmodie et ce n’était pas tout à fait du chant. La phrase se dépliait sur une sorte de mélodie grave et languide, lente et plaintive et, en fermant les yeux, en écoutant ces airs qui en étaient à peine, c’était un dodelinement de l’âme, étrange, un serré de coeur très doux, un bercement finissant tout à coup, comme par une larme, sur une note triste.
Ah ! il avait raison, Dom Felletin ! quel superbe office et quelle radieuse nuit ! Alors que le vieux monde pèche ou dort, le messie naît et des bergers, éblouis, l’adorent ; et, au même moment, ces personnages mystérieux, ces êtres de rêve, annoncés bien avant saint Matthieu par Isaïe et par le psalmiste qui les qualifie de rois de Tharsis, d’Arabie et de Saba, galopent, surgissant d’on ne sait où, sur des dromadaires, à la suite d’une étoile, dans la nuit, pour adorer à leur tour l’enfant et disparaître dans un chemin autre que celui par lequel ils sont venus.
En a-t-elle suscité des controverses cette étoile ! Mais ce que toutes les hypothèses des astronomes me semblent, avec leurs inévitables bévues, inhabiles et ce que je leur préfère l’idée du Moyen-Age, extraite du livre apocryphe de Seth et reprise par saint Épiphane et l’auteur du commentarie imparfait de saint Matthieu. Eux, pensaient que l’astre de Bethléem était apparu aux mages avec la figure d’un enfant assis, sous une croix, dans une sphère rayonnante de feux ; et les primitifs représentèrent, en effet, pour la plupart, cette constellation sous cette forme, Roger Van der Weyden, dans un des volets de sa merveilleuse nativité du musée de Berlin, pour en citer, au hasard, un.
Durtal fut tiré de ses réflexions par un flux et reflux de moines dans le choeur. L’on habillait le père Abbé. Le cérémoniaire, debout, devant l’autel, enlevait les vêtements qui y étaient posés, l’aube, le cordon, l’étole, la chape et les distribuait à des novices qui, à la queue-leu-leu, les présentaient, après s’être agenouillés devant le trône, aux habilleurs.
Débarrassé de sa longue cape noire et affublé de l’aube blanche, Dom Anthime Bernard, apparaissait encore plus grand ; il dominait toute l’église, du haut de son siège, et, après qu’il se fut ceint du cordon, dans le mouvement qu’il fit avec son bras pour remettre autour de son col sa croix pectorale que l’un des liturges lui tendait et qu’il baisa, la bague de sa main, allumée par le feu des cires, jeta un éclat bref. Le porte-mitre, les épaules maintenant enveloppées d’une écharpe semblable à celle du porte-crosse et dont les pointes reployées ainsi que des pointes de châle, devaient lui couvrir les doigts pour offrir la mitre ou la reprendre, alors que l’on en décoifferait l’Abbé, s’avança, sur un signe du P. d’Auberoche, près du trône ; et, après avoir endossé l’étole et la chape, le révérendissime entonna le te deum.
Ici, Durtal était bien obligé de modérer son enthousiasme, car des souvenirs l’assaillaient et le te deum des cloîtres ne soutenait pas la comparaison avec celui des églises de Paris, riches. Il est certain, se disait-il, que cet hymne est autrement imposant, à saint-Sulpice, par exemple, quand, soulevée par l’ouragan des orgues, la maîtrise, renforcée de tout le séminaire, le chante et il en est de même du magnificat royal si majestueux et d’une autre ampleur que ces pauvres magnificat, si maigres, si peu étoffés, du répertoire de Solesmes.
Il faudrait d’ailleurs des centaines de religieux ayant, tous, de la voix pour projeter ces énormes et ces magnifiques pièces et où trouver d’aussi puissantes masses chorales dans les monastères ?
Ce désenchantement ne dura guère, car l’Abbé, entouré des chapiers, des maîtres des cérémonies, des céroféraires, du porte-bougeoir chantait, ainsi que devant un pupitre, « la généalogie du Christ » dans l’évangile que tenait de ses deux mains, en l’appuyant sur son front, un moine ; et, dans la mélopée étrange et marrie, monotone et câline, passaient de singulières figures de patriarches suscitées, comme un coup d’éclair, par l’appel de leurs noms et ils retombaient, aussitôt qu’un autre leur succédait, dans l’ombre.
Et lorsque la lecture fut terminée, alors que l’on ôtait la chape du père Abbé pour lui substituer une chasuble, le choeur chanta l’hymne brève, d’origine grecque, le « Te Decet laus » et, sur l’oraison du jour et le « Benedicamus Domino » , l’office fut clos.
Les quatre principaux chantres qui étaient allés se vêtir à la sacristie étaient revenus et Dom Ramondoux, le préchantre, avait planté, dans un anneau près de sa place, l’insigne de son grade, une tige de cuivre surmontée d’une statuette de saint Bénigne, le bâton du préchantre.
Et il était, lui et les autres, assis sur des chaises, haussées d’une marche et à dossiers très bas, installés derrière la barre de communion, à l’entrée du choeur, en vis-à-vis de l’autel. Ils tournaient ainsi le dos au public, des dos splendides aux moires frissonnantes, ocellées dans leur ton d’argent de cercles de soie cerise dans lesquels étaient brodés en fils d’or les monogrammes gothiques de Jésus et de la Vierge.
Ils quittèrent leur siège et, en rond, debout au milieu du choeur, ils chantèrent, tandis que l’Abbé, entouré de sa cour, commençait la messe, l’introït.
Quand on fut arrivé au Kyrie Eleison, les fidèles s’embrasèrent et les filles et les garçons du village, conduits par le père curé, soutinrent les moines. Il en fut de même pour le credo. Durtal eut, à ce moment, la vision précise d’un retour très en arrière, d’un hameau chantant les mélodies de saint Grégoire, au Moyen-Age. Évidemment, cela n’avait pas la perfection du chant de Solesmes, mais c’était autre chose. À défaut d’art, c’était de la projection d’âme un peu brute, d’âme de foule, émue pour un moment ; c’était la reviviscence pendant quelques minutes d’une primitive église où le peuple, vibrant à l’unisson de ses prêtres, prenait une part effective aux cérémonies et priait avec eux, dans le même dialecte musical, dans le même idiome ; et c’était, à notre époque, si parfaitement inattendu que Durtal croyait, en les entendant, s’évaguer, une fois de plus, dans un rêve.
Et la messe se déroulait dans le bruit de grandes eaux des orgues ; l’Abbé, tantôt au trône, tantôt devant l’autel ; l’Abbé chaussé et ganté de blanc ; tête nue ou coiffé d’une mitre orfrazée, puis d’une mitre couturée de gemmes ; l’Abbé, les mains jointes ou tenant sa crosse qu’il remettait ensuite au novice agenouillé qui lui baisait sa bague. Une fumée d’encens voilait les lancettes en ignition des cierges et les veilleuses des reliques dardaient deux flammes de topaze dans la nuée bleue. Au travers des flocons de parfums qui montaient sous les voûtes l’on apercevait la statue d’or immobile, au bas des marches, du sous-diacre portant la patène dans un voile qu’il levait jusqu’à la fin du pater, devant ses yeux, symbolisant ainsi l’Ancien Testament dont il est l’image, comme le diacre est la figure du nouveau, montrant de la sorte que la synagogue ne pouvait voir s’accomplir les mystères de l’église ; et la messe se poursuivait, tous les enfants de choeur, agenouillés, à la file, avec un cierge allumé, durant l’élévation qu’annonçait dans la nuit, le son des cloches ; c’était enfin, à « l’Agnus Dei » l’Abbé donnant à l’autel le baiser de paix au diacre qui descendait les marches et l’imposait à son tour au sous-diacre, lequel, conduit par un cérémoniaire, dans les stalles des moines, embrassait le plus élevé en grade et celui-ci transmettait le baiser aux autres qui s’accolaient et se saluaient ensuite, en joignant les mains.
Ici, Durtal ne regarda plus rien ; le moment de la communion était proche ; les fusées des sonnettes éclataient dans l’abside ; les novices et les convers, deux par deux, s’ébranlaient ; le diacre, courbé devant l’Abbé, chantait sur un mode plus bizarre que contrit, « le Confiteor » ; et devant une longue nappe, saisie, à chaque bout, par un religieux, tous s’agenouillaient pour communier. Puis ce fut la descente de l’autel de l’Abbé, suivi de son cortège d’officiants, et distribuant l’eucharistie aux fidèles, tandis que derrière lui, se rangeait, cierges au poing, la troupe des petits servants de choeur.
Un bruit de galoches et de sabots qui couvrait la voix du père Abbé emplissait l’église. L’on entendait, prononcé à l’italienne, en ous, « Corpus Christi » et le reste s’éteignait dans un vacarme de pas ; et revenu à sa place, Durtal oublia la liturgie, la messe, se bornant agrave; implorer du seigneur le pardon de ses fautes et le bannissement de ses maux.
Il revint vaguement à lui alors que le père Abbé, mitré, debout, appuyé sur sa crosse, chantait la bénédiction pontificale :
— Sit nomen domini benedictum.
Et tous les moines répondaient :
— Ex hoc nunc et usque in saeculum.
— Adjutorium nostrum in noine domini.
— Qui fecit coelum et terram.
— Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Et à chaque nom des personnes invoquées, il traçait en l’air sur la foule un signe de croix, à droite, au milieu, à gauche, de l’autel.
Durtal, tandis que l’on préludait aux laudes, se retira. Il ne sentait plus ses pieds, tant il avait froid. Mme Bavoil vint le rejoindre avec les lanternes qu’ils allumèrent, à la sortie. La nuit était glaciale, la neige tombait. Attendez-nous ! — c’était Mlle de Garambois qui, emmitouflée de fourrures et accompagnée de son oncle, les appelait.
— Je vous emmène à la maison, reprit-elle, non pour souper, ce qui serait peu monastique, mais pour boire un verre de punch chaud, devant un bon feu.
Ils partirent, à la suite les uns des autres, par un sentier qui s’effaçait déjà sous la neige ; l’on apercevait dans toutes les directions des lumières qui couraient et, au loin, les auberges jaillissaient avec leurs carreaux rouges, dans le noir.
Sous prétexte de punch, la brave hôtesse avait accumulé sur une table des masses de pâtisseries et de viandes froides.
La salle à manger était quiète ; c’était la salle à manger bourgeoise, avec le buffet et les chaises Henri II, mais les flambes joyeuses des pins grimpaient, en embaumant la résine, dans l’âtre ; Durtal se rôtissait les souliers.
— Nous sommes victimes d’un guet-apens, disait, en riant, Mme Bavoil ; c’est d’un véritable souper que notre amie nous menace ; enfin, le jour de la nativité, un peu de gourmandise est permis.
Mais elle se contenta, malgré toutes les instances, d’avaler un bout de fromage et de pain.
La neige continuait à choir ; les feux des lanternes avaient disparu sur les routes ; des hurlements d’ivrognes retentissaient de toutes parts ; les paysans ribotaient, au sec.
— Quel dommage ! ils étaient si bien tout à l’heure, quand ils chantaient avec les religieux, remarqua Mme Bavoil.
— Oh ! s’exclama Durtal, ne nous emballons pas. Ceux qui chantaient à l’église sont ceux que le cloître emploie. Ils vont à la messe pour inspirer confiance aux pères, mais attendez que les moines soient partis...
— Dans tous les cas, en admettant, contre toute vraisemblance que ces gaillards-là soient de bonne foi, ils seraient bien dans la tradition du Moyen-Age, fit M Lampre, car la piété n’excluait pas une liesse un tantinet grossière chez nos ancêtres, en Bourgogne surtout. Nous n’avions point en ces temps, honnis par les imbéciles, le bégueulisme. Savez-vous, Madame Bavoil, qu’autrefois, avant la messe de ce jour, l’on célébrait solennellement dans certaines églises la fête de l’âne et, excusez du peu, l’auteur de l’office, paroles et musique, n’était, ni plus, ni moins que mgr Pierre de Corbeil, archevêque de Sens. Mais oui, du treizième au quinzième siècle, le pauvre âne a participé au triomphe du Rédempteur.
— Quand je songe qu’il a servi de monture à Jésus, murmura Mme Bavoil, j’ai envie de l’embrasser sur les naseaux, lorsque je le rencontre.
— Il y eut aussi la fête des fous, reprit M Lampre, en riant ; les acteurs élisaient un évêque qu’ils intrônisaient en des cérémonies rdicules ; et ce bouffon bénissait dans la basilique, le peuple et présidait à des offices dérisoires, tandis que les paysans, barbouillés de moût et déguisés en bateleurs ou en ribaudes, l’enfumaient avec du cuir de vieille savate, brûlé dans l’encensoir.
— Je ne vois pas ce que de semblables bacchanales pouvaient avoir de religieux, observa Mme Bavoil.
— Mais si ; l’origine de ces parodies était liturgique. L’âne était honoré à cause de l’ânesse qui parla et fut, en quelque sorte, cause, par ses remontrances, que Balaam énonça, devant leroi des moabites, sa célèbre prophétie sur la venue du messie. L’espèce asine, qui fut une des anonciatrices du Christ, l’assista dès qu’il fut né, près de la crèche, et le porta en triomphe, le jour des palmes ; elle avait donc sa place toute marquée dans l’anniversaire de Noël.
Quant à la festivité des fous, elle s’appela de son vrai nom la festivité du « Deposuit » par allusion au verset du magnificat « Deposuit potentes de sede » . Elle avait pour but d’abaisser l’orgueil et d’exalter l’humilité. Les évêques, les prêtres n’étaient plus rien, étaient comme déposés, ce jour-là. C’était le peuple, les machicots et les clercs de matines, qui étaient les maîtres et ils avaient le droit, dont ils usaient, de reprocher aux religieux et aux prélats, leurs prévarications, leurs simonies, leurs péchés d’exception, d’autres encore, peut-être. C’était le monde renversé ; mais, en tolérant jusqu’au moment où elles dégénérèrent en pures farces, ces parades revendicatrices, l’église ne fit-elle pas preuve de condescendance et de largeur d’esprit, ne montra-t-elle point, en souriant de ces folies, combien elle était indulgente pour les petits et combien elle était contente de les laisser s’alléger de leurs griefs, en rendant, eux-mêmes, la justice, avant que de se divertir ?
— Le fait est que c’était drôle dans ce temps-là, s’écria Mlle de Garambois. Imaginez-vous que pour se moquer de moi sans doute, mon oncle m’a prêté un livre d’une Bénédictine de je ne me rappelle plus quel siècle...
— Du dizième, fit M Lampre.
— Il s’intitue le théâtre de Hrotsvitha. Je croyais bêtement, moi, que c’était une oeuvre mystique ; or, ce sont des pièces que cette religieuse écrivait pour son cloître et il y en a une, je ne sais vraiment comment expliquer le sujet sans rire ; elle se nomme « la Passion de saint Gandolphe » .
— Eh bien ? Interrogea Mme Bavoil.
— Eh bien, saint Gandolphe qui était prince épousa une femme dissolue qui le trompa. Le pauvre prince s’aperçut de son malheur et se tut ; mais la princesse, irritée de se voir découverte, l’assassina. Aussitôt des miracles éclatèrent sur sa tombe. Elle s’en moqua, disant qu’elle s’en fichait comme une de ces choses que l’on attribue si malhonnêtement aux nonnes, oui, une sorte de beignet, vous comprenez. Et elle fut immédiatement punie par un châtiment approprié aux termes mêmes de son mépris. Tant qu’elle vécut, elle s’éperdit en des fuites sonores — et cela sans arrêt, raconte placidement la joyeuse Hrotsvitha.
— Cela prouve, dit Durtal, — en admettant que les oeuvres de cette moniale ne soient pas apocryphes, — la gaieté simple des cloîtres Bénédictins du dixième siècle. Remarquez d’ailleurs que les plaisanteries scatologiques sont encore chères aux gens d’église et c’est assez naturel ; les autres, celles su les femmes, qui délectent les laïques, aux fins de repas, entre hommes, leur sont interdites ; ils se rattraperont donc sur celles-là qui ne sont ni plus malpropres, ni plus sottes, d’ailleurs ; — et elles ont au moins cet avantage d’être innocentes.
— L’ingénuité un peu barbare fut un des charmes des abbayes d’antan ; allez donc trouver aujourd’hui cette qualité-là dans nos monastères ! reprit M Lampre.
— J’aurais été surprise si vous n’aviez pas encore bêché nos moines, dit Mlle de Garambois ; heureusement, poursuivit-ell, en souriant, que ces débinages ne sont que les blasphèmes de l’amour et que vous serez encore trop content, si les Bénédictins viennent à être chassés d’ici, de vous mettre en quatre pour leur rendre les services dont ils auront besoin.
— Je serai sans doute encore assez godiche pour cela, fit, en riant, M Lampre. Au fond, n’empêche que leur petitesse d’intelligence et de sainteté m’enrage, car je les aime trop pour ne pas les vouloir plus grands et Dieu sait si les mâtins s’acharnent à ne pas pousser !
— Si on allait se coucher, dit Mme Bavoil, la nuit s’avance et il faut quand même se lever, demain !
— Aujourd’hui, ne vous en déplaise, car trois heures sonnent, répondit Durtal qui ralluma les lanternes.
— Ce M Lampre, il est bien instruit, fit Mme Bavoil, en pataugeant dans la neige et je ne doute pas ausi qu’il n’ait bon coeur ; mais il me semble qu’il est vraiment trop mécontent des autres et pas assez de lui-même
— Ah ! vous requérez, vous aussi, des saints. Hélas ! Le coin est quasi brisé et le grand monayeur n’en frappe guère... çà et là, pourtant, en des retraits de province ou des fonds de villes. Il en existe certainement dans les cloîtres. J’en ai personnellement connus à la Trappe de Notre-Dame de l’Atre ; il y en a dans d’autres ascétères, mais ceux-là ne se mêlent point à la vie du dehors et comment les connaître puisque ce sont justement ceux que l’on ne voit point ?
L’un d’eux, que l’on vit beaucoup pourtant, serait récemment décédé dans un couvent Bénédictin de la Belgique, reprit Durtal, après un silence ; mais les renseignements que l’on m’a fournis sur son compte sont contradictoires ; ne les acceptez donc que sous bénéfice d’inventaire.
Ce moine, le P. Paul de Moll aurait été l’un des plus extraordinaires thaumaturges de notre temps. Il guérissait, comme en s’amusant, tous les maux ; il n’en dédaignait aucun, extirpait le mal de dents et la migraine aussi bien que la phtisie et le cancer ; affections incurables et bobos, il les supprimait, sans paraître y attacher la moindre importance ; il soignait indistinctement les hommes et les animaux, pratiquait très simplement, effaçant sa personnalité, prescrivant tout bonnement d’user d’eau dans laquelle on aurait trempé une médaille de saint Benoît.
Ce religieux qui fut notre contemporain, car il naquit en 1824 et mourut en 1896, fit partie du cloître de Termonde ; il rétablit l’abbaye d’Afflighem et fonda le prieuré de Steenbrugge ; il était, du reste, un religieux épris de macérations et féru de sacrifices ; mais il fallait le savoir, tant l’allégresse et la bonne grâce de cet homme fumant doucement sa pipe, pouvait donner le change aux gens !
Maintenant, de tous ces miracles qui se dénombrent par centaines dans les Flandres, que peut-on croire ? Quelques-uns semblent avérés ; d’autres auraient besoin d’être démontrés, car ils ne s’étayent que sur des suppositions et sur des racontars.
Sa biographie écrite par un M Van Speybrouck, avec une bonne foi persuasive, est si incohérente, si en dehors de toute préoccupation historique, que l’on ne saurait s’y fier. Espérons, pour la gloire de l’Ordre, que le P. de Moll ne fut pas un simple sorcier, mais un vrai saint. L’Eglise, seule, est à même de trancher la question et de nous éclairer.
CHAPITRE VIII
Il y eut une détente, le vent devint moins âpre ; le soleil qui semblait perdu reparut par instants dans le ciel de fer et blondit de ses lueurs furtives le sol. Ce fut un réveil momentané du jardin ; des arbustes vivants sortirent d’une terre qui paraissait morte. Les buis, aux petites feuilles orangées creusées en cuillères et devenues cassantes sous le doigt, des genièvres aux aiguilles bleuâtres et aux grains fripés, d’un indigo noir, surgirent comme d’une sorte de couche de cassonade striée par le gel qui fondait, de filets blancs ; les fusains, les aucubas, les taxus, les romarins restés verts, les buissons ardents dont les baies vermillon tournaient maintenant à la teinte du tan, égayèrent de leur verdure les massifs dont toutes les autres plantes n’avaient gardé que des tiges sèches et brûlées par le feu glacé des bises ; mais malgré tout, ces végétations avaient quelque chose de souffreteux ; elles avaient l’air de convalescentes à peine sorties de leur lit de neige.
Une seule famille s’épanouissait à l’aise dans le froid, les hellébores. Celles-là pullulaient le long des allées ; certaines espèces, telles que les roses de Noël étaient en pleine floraison et leurs fleurs d’un rose violâtre, d’une nuance maladive de cicatrice, de plaie qui se ferme, évoquaient bien l’idée d’une plante dangereuse, suant des sucs vénéneux, puant les poisons ; d’autres hellébores noires, aux feuilles déchiquetées, sciées et dentelées sur les bords, aux fleurs en coque roulée, étaient pis encore. À les arracher, on les trouvait munies de racines grêles, pareilles à ces cheveux qui pendent sur la boule des oignons. Les vieux botanistes du seizième siècle les appréciaient, disant qu’elles évacuaient le flegme et la colère et guérissaient la grattelle, l’impétigine, les rognes, les gales blanches et autres vices du sang ; mais elles n’en conservaient pas moins un aspect sinistre, avec leurs feuillages de deuil et le vert de pomme pas mûre de leurs fleurs qui, de même que leurs congénères, les roses de noël, baissaient toutes la tête, n’avaient pas cette allure franche et gaie de la flore saine.
Le jardin n’était rien moins qu’attrayant, à cette époque, avec ses taillis de plantes ratatinées et ses touffes de fleurs louches ; aussi Durtal n’y descendait guère. Il s’y promenait, ce matin-là, pour tuer les dix minutes qui le séparaient de l’heure du train. Pour une fois que le temps était propice, il projetait d’aller à Dijon — afin de réaliser quelques achats de cravates et de bottines retardés par la perspective de geler en wagon et de ne pouvoir se promener dans la ville — et il se disait : je puis d’autant mieux me dispenser d’assister à la grand’messe, ici, que je commence à la connaître par coeur. Elle est la même depuis six jours ; l’octave de l’épiphanie ayant, pour une semaine, refoulé le défilé des saints. Sans doute, cette messe est charmante, malgré son médiocre introït. Le kyrie est très beau, plaintif, un peu précieux, le gloria est allègre et vénérant, et la deuxième phrase du graduel « surge et illuminare Jerusalem » et l’alleluia sont exquis ; à l’offertoire « le reges tharsis » est lancé droit, tel qu’une flèche, et l’on entend jusqu’au dernier vibrement de son parcours ; mais j’ai encore demain pour l’écouter ; une messe basse me suffira aujourd’hui ; profitons de l’occasion de la liturgie et de la bienveillance de la climature ; et il s’était dirigé vers la gare.
Une fois assis dans le train, il avait hélé par la portière le père De Fonneuve qui cherchait une place et Dom Prieur était monté dans le compartiment.
Après avoir bavardé de choses et autres, le moine, parlant du nouveau curé, installé dans la commune depuis quelques jours, demanda à Durtal s’il l’avait vu.
— Oui, il m’a honoré d’une visite, hier, et je vous avoue, si vous tenez à connaître mon opinion, que l’impression laissée par ce prêtre est plutôt hostile. Il m’a produit l’effet d’une jeune paysanne assez mal élevée mais qui ferait, ce qu’on appelle en argot parisien sa « tata » . Il a une façon de se tortiller sur sa chaise, de coqueter, de jouer de l’éventail, d’esquisser des gestes de fillette appréhendant, tout en le désirant, un rapt, qui ne me dit rien qui vaille. Je lui ai pratiqué, dans la conversation, quelques pesées sur l’âme pour la forcer et j’y ai découvert, en sus d’un insens absolu de la mystique et de la liturgie, une vanité qui vous amènera, j’en ai peur, mon père, bien des ennuis. — Mais, voyons, et ces réparations que l’on a commencées à la cure, avancent-elles ?
— Oui, le Maire et le Conseil Municipal, du moment qu’il ne s’agit plus des moines, se montrent aimables. Ils avaient toujours refusé, tant que nous occupions le presbytère, de remettre même une ardoise au toit ; mais maintenant, tout socialistes qu’ils soient, ils miment des risettes et tâchent d’amadouer leur nouveau pasteur. Leur jeu est évidemment de nous brouiller avec lui ; j’espère qu’ils n’y réussiront pas ; nous sommes résolus, du reste, à lui céder autant que possible pour éviter tout conflit. D’ailleurs, si ce petit curé est, et je vous l’accorde, un peu prétentieux et infatué de lui-même, il n’en est pas moins très bien disposé à notre égard et très gentil. Vous l’appréciez sur quelques grimaces, mais nous, qui l’observons depuis huit jours qu’il vit déjà au milieu de nous, dans le monastère où on lui a offert le couvert et le gîte, en attendant que la cure soit habitable, nous sommes satisfaits de lui et convaincus qu’il est un brave petit enfant.
— Père, je me défie un peu de votre bonté ; tout le monde est pour vous un brave petit enfant !
— Mais non ; nous sommes trop enclins, voyez-vous, à juger sévèrement les autres — rien n’est plus injuste car enfin quand bien même un homme vous nuirait, cela ne prouverait pas qu’il n’ait jusqu’à un certain point raison. Il peut obéir à des mobiles qu’il croit équitables, en agissant de la sorte ; il voit différemment de vous et ce n’est pas un motif pour qu’il ait tort ; et il convient de toujours imaginer des causes honorables aux persécutions auxquelles on peut être en butte, afin d’être certain de ne point se tromper. Et puis, mon cher enfant, les humiliations et les souffrances sont excellentes. Vous devez faire Jésus en vous ; comment le ferez-vous si vous ne passez pas les soufflets et les crachats du prétoire ?
— D’accord, mais êtes-vous bien assuré que si la bataille éclatait entre le presbytère et le cloître, vos moines ne préféreraient pas faire, comme vous dites, Jésus en le curé plutôt que d’accepter qu’il le fasse en eux ; ce serait, il est vrai, très charitable, car on ne l’assommerait que pour son bien...
— Quel mauvais garçon vous êtes, ce matin ! dit en riant le père de Fonneuve ; mais nous voici arrivés à Dijon ; je vais chez mes filles du Carmel, vous ne m’accompagnez pas ?
— Non, père, j’ai des achats à effectuer dans la ville. Ils descendirent ensemble jusqu’à la place saint Bénigne ; arrivé à, le vieil historien fut incapable de se séparer de Durtal sans lui avoir préalablement rappelé les fastes monastiques de l’ancienne abbaye dont il ne subsistait plus que le sanctuaire, ressemelé sur toutes les coutures, rétamé de toutes pièces.
— Voici une des plus monumentales gloires de l’ordre Bénédictin, fit-il, en prenant d’un geste qui lui était familier le bras de Durtal et l’attirant à lui pour lui parler, épaule contre épaule ; c’était dans ce monastère de saint Bénigne que les ducs de Bourgogne, qui y venaient pour entrer en possession de leur duché, juraient sur les évangiles, au pied de l’autel, devant la châsse du saint, de ne pas toucher aux privilèges de leurs sujets ; et l’abbé leur ceignait, après le serment, le doigt d’un anneau, pour symboliser le mariage avec leurs villes.
Ce cloître qui fut florissant, au dixième siècle, lorsque le Vénérable Guillaume, envoyé de Cluny avec douze moines par saint Mayeul, parvint à désendormir ses religieux engourdis, dégénéra de nouveau lorsqu’il fut soumis au régime de la commende. Sa superbe collection de manuscrits s’émietta on ne sait où ; il fallut attendre la réforme de saint Maur pour réédifier de vrais moines et saint Bénigne eut alors d’infatigables érudits, tels que Dom Benetot, Dom Lanthenas, Dom Leroy qui exploitèrent les archives des abbayes de notre province, Dom Lanthenas surtout qui fut l’un des collaborateurs de Mabillon ; il est juste de noter aussi Dom Aubrey qui amassa des matériaux pour permettre au père Plancher d’écrire cette histoire de la Bourgogne dont vous avez pu voir les solides in-folios dans notre bibliothèque.
Enfin, comme partout, la révolution détruisit le monastère ; l’église fut seule épargnée, mais quelle drôle d’idée que d’avoir été couvrir ses tours de tuiles de couleurs qui lui donnent l’aspect d’une sparterie ! — Ce qui vaut mieux, par exemple, c’est d’avoir rétabli la crypte que l’on décovrit, un beau jour, en creusant le sol.
Pour nous autres Bénédictins, c’est un lieu bénit, un lieu de pèlerinage que cette cathédrale. L’apôtre de la Bourgogne, le disciple de saint Polycarpe qui l’a baptisée de son nom, saint Bénigne, ne nous est pas très sûrement connu ; néanmoins, dans sa monographie de la cathédrale, l’abbé Chomton semble prouver que ce saint auait subi le martyre, au commencement du troisième siècle. Les anciens hagiologues nous ont, en tout cas, conservé les détails de son supplice ; il aurait été écartelé à l’aide de poulies, on lui aurait enfoncé des alènes sous les ongles, on lui aurait scellé les pieds, avec du plomb fondu, dans une pierre qui existait encore du temps de Grégoire De Tours ; enfin on le fit mordre par des chiens furieux, on lui asséna sur le col des coups de barre de fer et comme il ne se décidait pas à mourir, on le perça d’une pointe de lance pour l’achever et c’est sur son tombeau même que fut bâtie l’église.
Cet élu est naturellement un grand saint, mais naturellement notre dévotion est aussi et, peut-être plus directement acquise, à cet abbé de notre ordre qui fut la gloire et de la Bourgogne et de cette abbaye, le vénérable Guillaume.
Celui-là fut élevé, en qualité de petit oblat, dans le monastère de Locédia, en Italie ; puis il entra à Cluny et il fut, ainsi que je vous l’ai dit tout à l’heure, envoyé par son abbé Dom Mayeul pour amender saint Bénigne qui ne contenait plus qu’une troupe de religieux sans discipline et dont les observances liturgiques étaient nulles. Il y apporta, avec la pratique de la règle de saint Benoît, une passion de la symbolique et de la liturgie, un amour de l’art et de la science, vraiment extraordinaires. Il fonda des écoles libres, absolument gratuites, pour les clercs et pour le peuple : il révisa le chant grégorien dont les chantres avaient altéré les textes : il voulut que les offices fussent impeccables, que le service de Dieu fût magnifique.
Et il se révéla aussi tel qu’un architecte de première force, car il savait tout ce moine ! Il construisit son église abbatiale, disparue, hélas ! Et remplacée par celle qui est là, devant nous. Elle avait neuf tours et toute la symbolique des écritures se déroulait autour de son vaisseau ; elle s’érigeait sur une église souterraine dont la fome reproduisait le t mystérieux d’ézéchiel, image encore imparfaite de la croix, et qui remémorait les temps antérieurs au messie, tandis que la nef, plus élancée, plus claire, représentait la lumière des évangiles, l’église du Christ ; et chaque nuit, pour confirmer le symbole, l’on descendait chanter matines dans la crypte, alors que les offices du jour se célébraient, au contraire, en haut, dans l’église.
Tout était à l’avenant ; les chapiteaux, les piliers, les statues s’associaient à l’idée générale de l’édifice. Ce furent les moines, qui les sculptèrent ; le nom de l’un d’eux, Hunald, nous est resté.
L’abbaye était immense ; après avoir essaimé plus de cent religieux dans diverses fondations, Guilaume en régissait autant à Saint Bénigne et, malgré la fatigue, malgré l’âge, il courait les routes pour régénérer les monastères en déshérence de Dieu. On le voit à Fécamp, à Saint-Ouen, au mont saint Michel, à saint Faron de Meaux, à saint Germain des Prés de Paris ; on le trouve, en Italie, à Saint-Fructuare où il adjoint à un couvent de Bénédictins un cloître de moniales ; on le rencontre partout jusqu’au moment, où épuisé par ces interminables voyages, il meurt en Normandie et, il y fut enterré dans l’abbaye de Fécamp.
Guillaume était un artiste, un érudit, un administrateur prodigieux et il était, ce qui est préférable encore, un admirable saint. Il faudra que je vous prête sa biographie écrite par l’abbé Chevallier ; mais je vous empêche d’aller à la messe et je me mets, moi-même, en retard. Mon dieu, ce que l’on devient bavard lorsque l’on se fait vieux — adieu, mon cher enfant, priez bien la sainte vierge pour moi ; de mon côté, je la prierai, chez mes braves Carmélites, pour vous.
Durtal le regardait s’éloigner d’un pas encore alerte et il pensait : la belle existence que celle de ce bon moine, confinée dans l’étude et la prière ! Et quelle belle vie aussi que cette vie Bénédictine qui plane si haut, par-dessus les siècles et au delà des temps ; l’on ne peut vraiment s’acheminer vers le seigneur avec des mouvements plus chaleureux et des chants plus nobles ; cette vie réalise l’initiation la plus parfaite, ici-bas, de l’office des anges tel qu’il se pratique et tel que nous le pratiquerons, nous aussi, là-haut. On arrive, la marche terminée, devant Dieu non plus comme un novice, mais comme une âme qui s’est préparée par une étude assidue à la fonction qu’elle doit à jamais exercer dans l’éternelle béatitude de sa présence. Quelles sont les occupations si agitées, si vaines des hommes en comparaison de celle-là ?
Ce père de Fonneuve ! — je me rappelle cette impression que j’éprouvai tant de fois, pendant l’été ou l’automne, dans sa cellule, alors que les paléographes de Paris ou de la province, venaient le consulter sur certains points de l’histoire ecclésiastique ou sur l’authenticité de certains textes. J’évoquais très bien alors cette autre celule où, à Saint-Germain Des Prés, Dom Luc D’Achery et son élève Mabillon discutaient avec leurs visiteurs sur les bases de la diplomatique, sur la véracité de telles chartes ou la valeur de tels sceaux. Le P. de Fonneuve est aussi savant que Dom Luc D’Achery, mais quel est celui de ses élèves qui ressemble même de loin à Mabillon, voire même à de plus obscurs satellites de la congrégation de saint Maur ?
Il est seul, de sa taille, ici ; mais, parmi ses clients laïques, quel est celui qui peut se rapprocher de ce prodigieux Du Cange, voir même de Baluze ou de ces studieux libraires que furent les Anisson ? L’étiage a donc baissé dans les deux camps et il n’est pas équitable de ne jeter le discrédit que sur les moines.
Que les savants laïques soient, en général, plu forts que les religieux, cela paraît incontestable ; mais il n’en est pas moins acquis qu’en tenant compte de l’état de la science, à chaque époque, eux aussi, sont, à n’en pas douter, fort inférieurs aux érudits qui fréquentèrent l’abbaye de Saint-Germain des Prés, au dix-septième siècle ; soyons donc modestes et indulgents...
En attendant, avec ma manie de soliloquer à bâtons rompus, je vais finir par manquer l’office, fit-il, en pénétrant dans saint Bénigne. Une messe célébrée au grand autel prenait fin ; il vérifia le tableau des horaires près de la sacristie. Une autre devait la suivre. Il profita des quelques minutes qui allaient s’écouler entre les deux sacrifices, pour faire le tour de la cathédrale.
Elle était à trois nefs, de largeur régulière, de hauteur convenable, mais, mise en parallèle avec les grandes cathédrales, elle était minime et quasi nulle. Elle contenait un certain nombre de statues du dix-septième et du dix-huitième siècles, des oeuvres honnêtes que l’on avait, après les avoir considérées, le désir de ne jamais revoir ; les vitraux anciens avaient disparu et avaient été remplacés par des carreaux blancs ou, ce qui était pis, par cet émétique de la vue, des verrières modernes. Dans le transept de gauche, se dressait une croix gigantesque, vert bouteille, sur laquelle un christ, teint en gris, était couché et deux anges se tenaient, de chaque côté, montrant au sauveur un acte de consécration au sacré-coeur et un plan d’église.
En résumé, autant cette cathédrale était intéressante par les souvenirs monastiques qu’elle émouvait, autant elle était inerte au point de vue de l’art ; elle ne valait sûrement pas cette bâtisse en rotonde édifiée par le vénérable Guillaume et deux de ses anciens bas-reliefs, relégués au musée archéologique de la ville, étaient d’une autre envergure que ce tympan de Bouchardon, emprunté à la vieille église de saint étienne, et qui la décore aujourd’hui !
Durtal s’installa pour entendre la messe que l’on sonnait ; il avait beau la connaître par coeur, cette messe ne parvenait pas à le déravir ; la vérité était que cette fête de l’épiphanie lui était plus suggestive que toute autre.
Que ce fût l’époque ou non de la célébrer, il y revenait sans cesse, car outre la manifestation de rois mages et le souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain, l’église devait remémorer, en l’exaltant, le miracle des noces de Cana.
Ce miracle, lorsqu’il y réfléchissait, lui suscitait de longues rêveries.
Il est, en effet, le premier qu’ait accompli le Christ, et le seul qui ait pour cause un épisode joyeux, car tous ceux qui lui succédèrent ont été effectués dans le but de parer à des besoins de nutriment, dans le but d’opérer des guérisons, d’alléger les douleurs,de tarir des larmes.
Jésus que l’on voit pleurer mais jamais rire dans les écritures, manifeste son pouvoir divin, avant l’époque qu’il paraissait s’être fixé, à propos d’un banquet, pour égayer des convives, pour un motif insignifiant, pour une chose qui ne semble vraiment pas en valoir la peine.
Son premier mouvement lorsque la sainte vierge lui dit : « ils n’ont pas de vin » est le mouvement de recul d’un homme pris à l’improviste et qu’une demande indiscrète gêne ; et il répond : « Femme, qu’est-ce que cela peut bien nous faire ? Mon heure n’est pas venue. » Et Marie, d’habitude si attentive à deviner ses moindres désirs, à obéir à son moindre gré, ne l’écoute même pas. Elle laisse sa réflexion sans réponse et s’adresse aux échansons pour les avertir qu’ils aient à exécuter les ordres que va leur donner son fils.
Et Jésus ne refuse pas, dès lors, de réaliser le miracle et il change l’eau en vin.
Cette scène, unique dans les évangiles, où l’on voit la vierge se dispenser de l’assentiment de Jésus et lui forcer en quelque sorte la main pour obtenir de lui ce prodige qu’elle réclame, est extraordinaire si l’on en extrait le sens symbolique qu’elle recèle.
Il ne s’agit pas, en effet, de contenter les convives dont l’appétit est déjà repu, en les égalant d’un vin plus savoureux que celui qui leur fut jusqu’à ce moment servi ; il ne s’agit pas non plus du mariage d’un homme et d’une femme dont saint Jean n’a même pas cru nécessaire de noter les noms ; il s’agit de l’union entre Dieu et l’église, des joies nuptiales de notre-seigneur et de l’âme ; et ce n’est pas l’eau qui se métamorphose en vin, mais bien le vin qui se transmue en sang.
Ces noces de Cana ne sont qu’un prétexte et qu’un emblème, car tous les exégètes sont d’accord pour reconnaître dans cette scène le symbole de l’Eucharistie.
Il est avéré que l’Ancien Testament préfigure le nouveau, mais ne pourrait-on admettre aussi que certains passages des évangiles préfigurent, à leur tour, d’autres des mêmes livres ? Les noces de Cana ne sont, en effet, que l’image avant la lettre de la Cène. Le premier miracle produit par le messie, au début de sa vie publique, annonce celui qu’il accomplira, la veille de sa mort ; et l’on peut même observer qu’ils se reflètent, l’un l’autre, en une sorte de miroir à l’envers, car saint Jean qui écrivit son évangile pour confirmer et compléter l’oeuvre de ses devanciers, saint Jean dont le livre est postérieur à ceux de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc, est le seul qui relate ce miracle. Les autres n’en parlent pas et, lui, par contre, se tait sur la transsubstantiation du pain et du vin pendant la cène. Il y a en cette histoire, une interversion étrange ; c’est le dernier des évangélistes qui anticipe sur les premiers, qui montre, voilée ainsi que dans l’Ancien Testament, la figure du sacrement que dévoilèrent les synoptiques.
Mais, poursuivait Durtal, les noces de Cana suggèrent encore d’autres remarques. De même que nous avons vu le rédempteur pratiquer, en cette scène, son premier miracle, de même nous voyons Marie user, pour la première fois, de son droit de médiatrice et intercéder pour les nouveaux enfants qu’elle adoptera, au pied du Calvaire, pendant que son fils, étendu sur le lit de la croix, engendrera l’église.
Et elle n’attendit pas que les temps prescrits fussent révolus ; dans son impatience, elle devança l’heure et revendiqua tout, du premier coup ; elle ne procéda pas par gradation, elle ne limita pas d’abord l’objet de ses requêtes, elle alla droit au but, demanda simplement, nettement, le summum des grâces ; elle voulut et obtint la promesse du magistère qui pouvait guérir et sauver es âmes des enfants dont elle allait être appelée à prendre soin, l’Eucharistie.
Et le Christ cède à cette douce violence, et s’il se fait prier, s’il a l’air d’accepter une certaine contrainte, c’est qu’il veut enseigner ainsi que tout ce qu’il accorde, il ne l’accorde que par l’entremise de sa Mère.
Cet épisode de Cana est donc, en somme, le point de départ des deux dévotions, initiales et essentielles du catholicisme : le saint-sacrementet la Sainte-Vierge. Et l’office qui est spécialement consacré à ce mystère, l’office du 2e dimanche après l’épiphanie, ne se célèbre même pas ! — On se borne à en lire les prières et l’évangile à la fin de la messe du saint nom de Jésus qui le supplante.
Il me semble que l’on aurait bien pu le conserver, le mettre, au besoin, un autre jour, à la place d’un saint ! — Mais c’est curieux, continua-t-il, en sortant de la cathédrale et en gagnant à grands pas la place d’armes, puis la place rameau, pour entrer au musée ; c’est curieux comme des miracles d’une importance souveraine passent inaperçus, sont, en tout cas, à peine explorés par les prêtres en chaire et les fidèles !
Quelle abjecte effigie ! soupira-t-il, regardant en bas de l’escalier, menant aux salles de peinture, une statue de la république figurée par une fille aux épaules, aux bras, au buste, aux seins d’une harengère de la halle et à la face chiffonnée d’un trottin de modes, au-dessous de laquelle était gravée l’expression à la fois imbécile et sacrilège : « Stat in aeternum. » — C’était un nommé Coutant qui avait sculpté cela !
Durtal parcourut les galeries de la peinture contemporaine où se prélassaient, en bonne place, un hivernal portrait du pluvieux Carnot, par Yvon — un maréchal vaillant d’Horace Vernet où l’ingéniosité de ce teinturier militaire se décelait par ce petit détail : le maréchal dont la tête était celle d’un notaire à toupet, du temps de Louis-Philippe, ne savait où caser l’un de ses bras et le Vernet avait jugé original de le placer sur un tas de cuirasses qui reposaient, elles-mêmes, sur un tas de fascines jusqu’à la hauteur voulue pour servir d’appui-main, le tout échafaudé dans un paysage de fantaisie aux couleurs grêles et acides ; — puis, une oeuvre de jeunesse de Gustave Moreau, « le Cantique des Cantiques » , une toile plus que médiocre, du genre Chasseriau, qui ne permettait guère de soupçonner le futur talent du peintre de l’Hérodiade ; — enfin, des cocasseries furieuses d’un Anatole Devosge ; celui-là et M François, son père, étaient les gloires bouffonnes de Dijon et le buste de l’un de ces deux grotesques, avec une physionomie d’huissier et des pattes de lapin, le long des joues, se dressait sur un socle, dans l’une des salles. Cet Anatole Devosge il avait brossé une bâche inouïe ; cela s’appelait « Hercule et Phillo » .
La scène représentait une femme enchaînée, étreignant un gosse et s’efforçant de fuir les crocs d’un lion qu’un Hercule en colère étrangle.
Le lion était issu, en droite ligne, d’une lionne de tête de chenet et d’un lion de descente de lit et il semblait, en tirant la langue, surpris d’être traité avec aussi peu de ménagement par cet homme quilui cravatait si étroitement le col. Hercule, lui, était énorme ; il avait le physique d’un auvergnat que l’alcool a rendu fou ; il arborait des muscles outrés et tendait sur des jambes nues et grosses, telles que des poutres, un formidable derrière, quelque chose comme des ballons accouplés, comme des montgolfières conjuguées de percale rose. Quant à la femme, habillée d’une robe abricot et d’un peplum groseille, elle roulait, en signe d’effroi, des yeux blancs et l’enfant pleurait convenablement des pilules d’étain, suivant la formule de l’odieux David dont ce peintre était l’élève. Ah ! ce Devosge, quel pleutre redondant, quelle ganache épique !
L’élément moderne du musée était donc inavouable et pourtant, dans cet amas de phénomènes biscornus et de pannes baroques, un tableau superbe surgissait sur un mur « l’Ex Voto » d’Alphonse Legros.
Il s’ordonnait ainsi :
Neuf femmes priaient devant un petit Calvaire, dans un paysage de tapisserie aux tons de laines demeurées vives. Sur ces neuf femmes sept étaient agenouillées, côte à côte ; et, au premier plan, une, debout, vêtue de blanc, feuilletait un volume, tandis qu’une autre, également debout, et couverte d’un chapeau de paille, au fond de la toile, portait un cierge.
Ces femmes, presque toutes âgées, étaient coiffées de bonnets blancs, accoutrées de toilettes de deuil avec les mains jointes, sous des mitaines noires.
Les visages et les mains de ces vieilles étaient d’une précision et d’une probité d’art qui stupéfiaient, lorsque l’on songeait à la peinture hâtive et galopée de notre temps. Les expressions simples et concentrées de ces orantes recueillies, absorbées, loin des visiteurs, devant la croix, dégageaient une saveur religieuse réelle. Les traits étaient encharbonnés, comme creusés au burin ; et, dans cette oeuvre forte et sobre, qui paraissait exécutée par un peintre graveur de l’école d’Albert Dürer, la femme en blanc évoquait, elle, le souvenir de Manet, mais d’un Manet mieux pondéré, plus savant, plus ferme.
C’était, à coup sûr, la plus belle toile de Legros que Durtal eût encore vue. Que faisait-elle, là, noyée dans ce déballage de loques et ces rebuts, alors qu’elle eût si victorieusement figuré dans le salon de l’école française, au louvre ? Elle était marquée, dans le catalogue, sous le titre de don de l’artiste à sa ville natale. Ah ! Bien, ce que ladit ville semblait plus fière de son Devosge, dont le nom se prélassait à un coin de rue, que de l’auteur de ce présent relégué dans le pêle-mêle de ces pannes.
Ces salles de l’école moderne française mises à part, le musée de Dijon était, en tant que musée de province, abondamment pourvu. Il détenait des collections de bibelots, de faïences, d’ivoires, d’émaux, d’estampes, de bois, vraiment honorables. M His de la Salle l’avait en outre doté de dessins de maîtres, curieux ; mais, là, où il devenait princier, l’égal des grands musées, c’était dans l’ancienne salle des gardes qui contenait les mausolées en marbre de Dinan et en albâtre de Tonnerre, des ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Ces tombeaux, brisés pendant la révolution, avaient été expertement reconstitués avec leurs débris et redorés et repeints.
Le premier avait pour auteurs divers imagiers, le flamand Jehan de Marville qui traça le plan et les dessins et mourut à la tâche. Le hollandais Claus Sluter lui succéda et trépassa à son tour et ce fut son neveu, Claus de Werve qui acheva l’oeuvre de ses deux devanciers, dans quelle mesure ? Il est assez difficile de le dire.
Cette oeuvre était ainsi conçue :
Le corps de Philippe Le Hardi était placé sur une table de marbre noir, entre les pieds de laquelle s’étendait, sous les quatre côtés, un petit cloître gothique, peuplé de minuscules moines et de gens de la suite du prince. Philippe Le Hardi, enveloppé du manteau ducal d’azur, doublé d’hermine, posait ses chaussures, aux lames articulées de fer, sur le dos d’un lion bénévole et sa tête sur un coussin derrière lequel deux anges, aux ailes déployées, soutenaient un heaume.
Le second avait été commandé à un espagnol Jehan de la Huerta ou de La Verta dit D’Aroca ; mais celui-là ne fit rien ou presque rien et ce fut un Antoine Le Moiturier ou Le Mouturier qui termina, s’il ne sculpta pas en entier, le cénotaphe. Son ordonnance était calquée sur celle du premier tombeau.
Le duc Jean et la princesse Marguerite de Bavière, sa femme, étaient couchés, côt à côte, sur une plate-forme de marbre noir, au-dessous de laquelle s’allongeait, entre les quatre pieds, un cloîtrion ogival, aux galeries pleines de religieux. Le chef des époux était appuyé sur des coussins et leurs extrémités sur les reins serviables de petits lions ; et des anges s’agenouillaient derrière eux, les ailes grandes ouvertes, présentant, l’un le casque du duc, l’autre l’écu armorié de la princesse.
Ce mausolée était plus ouvragé que le premier, les sculptures plus surchargées de volutes, de chicorées, de fleurons ; le souvenir s’attestait aussitôt des paraphes, des frisures, des boucles de l’ornementation de l’église de Brou, cette fin du gothique qui, après s’être corrompu, en vieillissant, rejette sa robe de pierre pour mourir, impur, nu, sous un linceul de dentelles.
Les fauves de ce monument étaient des fauves de pendules et il ne leur manquait sous la patte qu’une boule ; les princes et la princesse, gisant sur lame, ne différaient pas, par leur attitude conventionnelle, des statues funéraires de l’époque. La beauté de l’oeuvre n’était point dans ces froides effigies ni même dans ces anges blonds et charmants, mais conçus, eux aussi, d’après une formule que nous retrouvons chez la plupart des primitifs des Flandres, elle résidait dans les figurines debout sous les arcades naines du cloître.
Elles avaient dû portraiturer, toutes, d’abord, des religieux de différents ordres se lamentant sur le trépas des princes ; elles devaient se composer exclusivement de « plorants » , mais la verve des ouvriers d’images avait rompu le cadre restreint de la commande et, au lieu de gens en larmes, ils avaient saisi l’humanité monastique de leur temps, triste ou gaie, flegmatique ou fervente ; et, à vrai dire, la plupart de leurs statuettes ne songeaient à rien moins qu’à déplorer le décès des ducs.
Ils avaient, en tout cas, réalisé des merveilles d’observation, fixé des maintiens pris sur le vif, des postures croquées au vol ; aucune de ces figurines si expressives, mais malheureusement plus ou moins réparées et un peu campées au hasard quand l’on avait reconstitué ces tombes, ne se ressemblait et l’on demeurait véritablement confondu par l’incroyable adresse de ces imagiers qui, mis en face de modèles presque semblables, de visages rasés presque uniformes, de robes quasi pareilles, avaient su diversifier chaque moine d’un autre, exprimer en un simple jeu de physionomie son tréfonds d’âme, faire sourdre de l’ordonnance même des draperies et du cadre des capuchons, abaissés ou relevés, le caractère précis de l’homme qui les portait.
Ils avaient voulu beaucoup moins, en somme, décrire l’effet produit sur des religieux par l’annonce de la mort de l’un ou de l’autre de leurs bienfaiteurs, que donner, comme un instantané de la vie courante des cénobites et ils les avaient effigiés, l’Abbé en tête, mitré et crossé, tenant le livre ouvert de la règle, regardant d’un air impérieux et méfiant des moines qui pleurent ou lisent, méditent ou chantent, égrènent leur rosaire ou, désoeuvrés, s’ennuient ; un même se mouche, tandis qu’un autre se cure tranquillement l’oreille.
L’on pouvait se délecter pendant des heures devant cette oeuvre sculptée par des artistes de belle humeur qui connaissaient bien leurs amis du clergé régulier et s’amusaient sans méchanceté à leurs dépens, tant elle dégageait une joie expansive d’art ; et Durtal se séparait d’elle, à regret, car ces très anciens cloîtriers évoquaient, devant lui, ceux du Val des Saints avec des ressemblances de port, de gestes, souvent frappantes. N’était-ce pas Dom de Fonneuve, ce vieux père, souriant et pensif, le col enfoncé très haut, derrière la nuque, par son capuchon coupé suivant l’antique mode de Saint Maur ? N’était-ce pas Dom d’Auberoche, ce jeune, au cou dégagé, au contraire, par un capuchon moins ample, confectionné selon d’autres coutumes ? N’était-ce pas Dom Felletin, cet autre qui regardait à ses pieds, absorbé par une recherche ? N’était-ce pas aussi le premier chantre Ramondoux, ce gros, qui maniait un graduel, en ouvrant la bouche ? Seul le P. Abbé différait. Celui du Val des Saints n’était, ni impérieux, ni méfiant, mais si débonnaire et si franc !
En comparaison de ces figurines, les deux retables portatifs en bois, du quatorzième siècle, qui meublaient les parois de la salle, paraissaient inexperts et figés.
Il est vrai qu’ils étaient très retapés ; certaines même de leurs parties étaient modernes. Ils avaient été jadis exécutés par le flamand Jacques De Bars ou De Baerze, de Termonde.
Dans l’un, saint Antoine, jeune etimberbe, avait à ses côtés deux diables velus et bruns et une diablesse haut vêtue, avec des cornes sur la tête, des joues d’un rose de pomme d’api, et un nez retroussé dans une face ronde ; elle était une plantureuse servante d’auberge déguisée en reine, et qui ne semblait même point disposée à le tenter ; et le saint, sous les traits d’une iexpressive poupée, dressait, très calme, en l’air, deux doigts pour nous bénir.
Dans un autre compartiment du même retable, figurait une décollation de saint Jean-Baptiste avec une Hérodiade, couverte jusqu’au menton, comme la démone de saint Antoine, une Hérodiade ancillaire qui considérait avec indifférence de ses yeux bleus plus aptes à surveiller les ragoûts qu’à décager les sens, le martyr agenouillé et qui paraissait ne penser à rien, tandis que le bourreau s’apprêtait à le décapiter. En vérité, ces statuettes de bois peint et dorées étaient médiocres, mais, du tas, se détachait un groupe fort supérieur, celui de l’Hérode et de la mère de l’Hérodiade : le roi, accablé de remords, se reculant en un geste de réprobation, et, elle, le rassurant, une main appuyée avec force sur l’épaule et l’autre sur le bras.
Le second retable renfermait une adoration des mages, un Calvaire et une mise au tombeau ; une adoration, avec une madone au teint fleuri, une grande dame, râblée, solide, une flamande moins vulgaire que les autres, d’aspect avenant et de sourire aimable ; l’enfant, penché sur ses genoux, mettait une menotte sur les lèvres d’un mage agenouillé et touchait de l’autre une sorte de ciboire que ce souverain lui tendait ; un deuxième mage, un doigt passé sous sa couronne, esquissait un salut presque militaire, tandis qu’un troisième, à la tête de roulier, levait l’index en signe d’attention et présentait un vase de parfums.
Quant à l’Ensevelissement, il était d’un art plutôt pénible ; saint Jean avait un pif en pied de marmite et il soutenait sans conviction une vierge dans le nez de laquelle il pleuvait ; le tout agrémenté de deux poupées portant, à chaque bout de la scène, des aromates.
Ces retables étaient, si l’on veut, naïfs et amusants, mais l’accent religieux ne s’y décelait pas ils étaient plus réalistes que mystiques ; c’était l’art d’un flamand à fin de foi.
Taillés en forme d’armoires, ils étaient complétés par des peintures appliquées sur les deux battants qui les fermaient. L’artiste qui fut chargé de cette commande Melchior Broederlam, d’Ypres, avait décoré d’une annonciation et d’une visitation le volet de gauche, d’une présentation et d’une fuite en égypte, celui de droite.
Ces oeuvres, peintes sur fond d’or mat et bruni, vaient été largement retouchées car elles avaient, avant d’être abritées dans ce musée, longuement pourri dans l’église de Saint Bénigne ; au milieu de personnages vulgaires, de paysans costumés en Dieu le père ou en saints, elles affirmaient, au moins, dans le type de la vierge, une certaine délicatesse ; ce n’était plus la mère bedonnante et folâtre, la maritorne de Jacques De Bars ; celle-là, avec ses prunelles du ton de la fleur des lins, ses chairs laiteuses, son nez qui s’amenuisait déjà plus droit, s’anoblissait, se patricisait, si l’on peut dire, en s’effilant ; ce n’était pas encore la vierge exquise de Roger Van Der Weyden et de Memlinc, mais c’était déjà un peu Marie, la Mère d’un Dieu.
Seulement, ce bon vouloir de distinction se confinait en elle seule, car le saint Joseph de « la Fuite en Egypte » demeurait un rustre accompli et un parfait manant ; tournant le dos à la vierge, il apparaissait de profil, chaussé de bottes à chaudron, suspendant au bout d’un bâton sur l’épaule, une marmite et des hardes et buvant à même d’un barillet un bon coup.
En outre de ces tableaux d’autel, un troisième, datant du quinzième siècle, et provenant de l’abbaye de Clairvaux, une peinture lisse et trop revernie, s’exhibait, elle aussi, sur la cimaise du mur. De ses panneaux, séparés les uns des autres, par des pilastres, un seul était intéressant à cause de l’idée même qu’avait eue le peintre de reproduire le corps glorieux de Notre Seigneur, au moment de sa transfiguration, par un enduit tout en or. Le visage, le corps, la robe, les mains, étaient frottés de cet or luisant et un peu plat qui revêt les panneaux de Lancelot Blondeel, dans les églises et le musée communal de Bruges.
Cette interprétation naïve de la lumière divine était plaisante, mais le reste du retable, sec et glacé, ne méritait vraiment point qu’on le prônât.
Enfin, un autre panneau, également du quinzième siècle, une adoration, arrêtait moins Durtal pour la valeur de l’oeuvre qui ne l’éperdait guère que pour les réflexions que lui suggérait son origine.
Ce tableau, longtemps attribué à Memlinc, avec l’art duquel il ne s’apparentait que par une lointaine ressemblance, avait fini par retrouver un vague débris de son acte de naissance.
Cette adoration pouvait être prêtée sans trop de discussions au maître de Mérode ou de Flémalle, ainsi qualifié parce qu’un de ses ouvrages avait jadis fait partie de la collection des Mérode et qu’une série de sespeintures, issue de l’abbaye de Flémalle, avait été acquise par l’institut Staedel, de Francfort.
Qu’était cet artiste ? D’après les recherches opérées en Belgique et en Allemagne, ce maître de Flémalle s’appelait de son vrai nom Jacques Daret et il avait été, en même temps que Roger Van Der Weyden, l’élève d’un peintre dont rien ne subsiste, Robert Campin, de Tournai.
Il s’était occupé des décorations de la fête de la Toison d’or et des noces de Chrles le Téméraire qui lui rapportèrent 27 sols par jour, aux entremets. Il avait un frère également peintre, Daniel, natif de Tournai, dont il fut le maître et dont tous les travaux ont disparus ; et c’est à peu près tout ce que l’on sait de lui.
Un de ses tableaux, très curieux et dont Durtal possédait une belle photographie, appartenait au musée d’Aix, une vierge assise sur un large banc, de style gothique, planant au-dessus d’une ville et tenant un enfant Jésus très éveillé, une vierge un peu bouffie dont la tête se détachait sur une étrange auréole de rayons qui suscitait l’idée d’une roue de paon façonnée avec les piquants inégaux d’un hérisson d’or ; et, en bas, un Dominicain priait à genoux, entre un pape et un Evêque assis.
Une autre madone, et, celle-là, Durtal l’avait vue dans la collection de Somzée, à Bruxelles, l’avait depuis des années, hanté et elle surgissait maintenant devant lui, évoquée par le panneau de Dijon.
Elle était vraiment, en son genre, unique.
Dans un intérieur éclairé par une fenêtre ouvrant sur une place et meublé d’une crédence sur laquelle se dressait un calice et d’un banc à coussin rouge sur lequel se posait un livre, Marie, vêtue d’une robe blanche, brisée en de grands plis, s’apprêtait à allaiter l’enfant ; et là encore, la tête se découpait sur un nimbe extraordinaire fait d’une sorte de fond de panier, de van, et le jaune presque soufre de ce fond d’osier s’harmonisait délicieusement avec les tons sourds et doux, avec la teinte de fer délavée de ce tableau dont les personnages se délinéaient, un peu cernés de noir, dans un air gris.
Le type de cette Vierge différait complétement de ceux inventés par Roger Van Der Weyden et par Memlinc. Elle était moins gracile et plus osseuse, un peu boursouflée, avec des yeux singuliers, taillés en boutonnières retroussées des bouts ; les paupières étaient lourdes, le nez long et le menton bref ; la face était moins en forme de cerf-volant que celle des madones de Memlinc, moins en amande que celle des madones de Roger Van Der Weyden.
La vérité était que, lui, créait des bourgeoises angéliques et, eux, des princesses divines. Ses Vierges étaient distinguées, mais elles ne l’étaient pas naturellement et elles s’observaient devant le visiteur ; de là, une certaine afféterie et une certaine gêne. Elles devaient, à force de vouloir montrer qu’elles étaient de bonnes mères, oublier de l’être ; elles manquaient, pour tout dire, de simplesse réelle et d’élans. Aussi ce panneau était-il et maniéré et charmant, et bizarre et froid. Oui, cela le résume assez bien, ruminait Durtal. Ce Daret n’avait pas le sens mystique de son condisciple Van Der Weyden et ses projections colorées d’âme étaient faibles ; mais, pour être juste, il faut ajouter aussitôt que si ses oeuvres sont des oraisons de pinceau mortes, elles effluent au moins une senteur inconnue, qu’elles sont vraiment originales et dans la peinture du temps, à part.
Ici, à Dijon, cette adoration est évidemment inférieure ; elle a du reste souffert de l’humidité et passé par la cuisine des rebouteurs ; mais l’empreinte de l’artiste y semble quand même marquée.
Marie, agenouillée devant l’enfant et tournant le dos à l’étable, avère le type habituel de ses notre dame, mais elle est plus bourgeoise, plus matrone, moins raffinée que les vierges de Bruxeles et d’Aix ; le saint Joseph avec son petit cierge rappelle les saints Joseph de Van Der Weyden dont s’empara Memlic ; les bergers avec leurs cornemuses, les femmes qui adorent sans joie le Jésulus, gringalet comme presque tous les petits Jésus de ce siècle ; les anges qui déroulent des banderoles dans un paysage dont les nuances furent fraîches et claires, sont enviables, mais là encore, il y a je ne sais quoi de contourné et de frigide ; l’allégresse ne sourd pas de l’ensemble. Décidément ce Jacques Daret devait être un homme à ferveurs obturées, à prières sèches.
Avec tout cela, se dit-il, je ne vois pas, parmi cette série de primitifs, les vestiges de cette fameuse école de Bourgogne qui nous a valu, au Louvre, une salle particulière, presque exclusivement composée de tableaux flamands.
J’ai beau fouiller les musées et feuilleter les comptes des divers officiers de la trésorerie de Bourgogne, je ne déniche que des gens originaires de la Hollande ou des Flandres ; je ne trouve aucun peintre qui soit issu des provinces de la France d’alors. N’est-il pas évident d’ailleurs que si de véritables artistes avaient existé, de leur temps, en France, les ducs de Bourgogne ne se seraient pas donné la peine de faire venir à grand frais des étrangers de leur pays ?
Imaginée par cette déraison spéciale qu’est la chauvinite de l’art, cette école n’est donc qu’un attrape-nigauds, qu’un leurre. — Mais, si, au lieu de ratiociner, je filais, reprit-il, en consultant sa montre. Il jeta un dernier coup d’oeil autour de lui. Ce musée, se dit-il, mérite d’être adulé ; malheureusement, tout y est un peu du vieux neuf ; à Dijon, tout est restauré, depuis le Jacqumart, les marmousets, les fresques de Notre-Dame, les façades et les nefs des autres églises, jusqu’aux mausolées des ducs de Bourgogne et aux retables ; mais, n’importe, pour être juste, quel abri délicieux que cette salle des gardes, avec ses tombeaux et ses peintures, — avec sa tapisserie du siège de Dijon, dont les roses fanées et les indigos durcis, saillant de la teinte bleuâtre des laines, sont une caresse pour l’oeil, — avec sa haute cheminée gothique dont le panneau de fermeture est le dossier armorié du siège de Jean Sans Peur.
Il quitta le musée et, en deux pas, il fut sur la place saint Etienne au bout de laquelle s’érige l’église de saint Michel.
Celle-là exhaussait une façade de la renaissance, et des tours encadrées de contreforts et des coupoles octogones, surmontées de boules d’or, qui ressemblaient, vues d’en bas, à deux oranges. Encore qu’il ne raffolât point de ce style, Durtal devait bien se dire que cette église était un des plus purs spécimens du genre ; elle avait subi moins de mésalliances que tant d’autres, devenues des métis dont la filiation restait obscure. Celle-là, du dehors, au moins, avait de la race. Au dedans, c’était autre chose, elle était de style ogival et de nombreuses innovations y avaient été insérées après coup ; elle possédait, en tout cas, à gauche, une petite chapelle de la vierge, un peu hétéroclite avec ses vitres qui représentaient de vagues sybilles et des anges à écussons, une chapelle néanmoins intime, où l’on pouvait en paix se recueillir.
Mais Durtal n’avait pas, ce jour-là, le temps d’y séjourner. Il s’occupa de ses emplettes et rejoignit, après s’être allé lire les journaux dans un café, la gare.
Si les nouvelles précises qu’il cherchait sur la loi des congrégations étaient, ce matin-là, quasi nulles, par contre, les articles de la presse maçonnique débordaient d’injures sur les religieux et les nonnes. Elle poussait furieusement à la roue, exigeait du gouvernement qu’il exterminât les écoles congréganistes et dispersât, en attendant mieux, les cloîtres ; et les diatribes sur les jésuitières, sur les milliards des frocards et des cornettes, se succédaient en un style de voirie, en une langue de terrain vague.
Il est impossible que les vassaux de ces éviers ne soient pas des roussins ou des adultères, des défroqués ou des larrons, car l’étiage de la haine contre Dieu est, pour chacun de ces gens, celui de ses propres fautes ; n’exècre l’église que celui qui craint ses reproches et ceux de sa conscience. Ah ! si l’on pouvait ouvrir l’âme de ces homais en délire, ce qu’on découvrirait, dans l’amalgame de leur fumier de péchés, d’extravagants composts, se disait Durtal, en se promenant sur le quai.
Deux moines sortirent à ce moment d’une salle d’attente, le P. Emonot, le zélateur et le p. Brugier, le cellerier.
— Ah ! ça, firent-ils gaiement, en serrant la main de Durtal, tout le monde est donc à Dijon aujourd’hui, et aussitôt, ils s’entretinrent de mgr Triaurault dont les infirmités s’aggravaient et qui était décidé à donner sa démission et ils citaient les candidats possibles : l’abbé Le Nordez ou un curé de Paris ; puis ils causèrent du nouveau curé du Val des Saints et des conditions qui allaent être infligées aux moines.
— Le père De Fonneuve que j’ai vu, ce matin, ne m’en a pas parlé ! s’écria Durtal.
— Il ignorait les clauses stipulées par l’Evêque ; nous venons, nous, de les apprendre à l’instant, et encore par hasard, en rencontrant dans la rue l’un des gros bonnets de l’évêché.
— Et quelles sont ces conditions ?
— Les voici, répondit le cellerier un fort gaillard, à la face rase et bleue, à l’oeil noir et aux lèvres minces, un méridional qui avait été jadis économe dans un séminaire.
Nous garderons l’église, les jours de la semaine, mais nous n’y mettrons plus les pieds, le dimanche ; ce jour-là, nous nous réunirons dans notre oratoire, car le sanctuaire appartiendra au curé seul ; ensuite, nous n’aurons plus le droit de confesser les personnes du village...
— Comment, nous ne pourrons plus nous confesser aux Bénédictins ! mais c’est monstrueux ; on ne peut cependant obliger les fidèles à s’adresser à un prêtre désigné ; chacun est libre de choisir le directeur qui lui plaît ; le droit est formel et l’arrêt de votre épiscope est nul ; ce qu’il aurait bien fait, dans tous les cas, de démissionner, celui-là, avant de nous jouer un tour de cette façon !
— Oh ! fit le P. Emonot, vous, vous êtes oblat ou du moins vous allez l’être ; vous pouvez par conséquent prétendre que vous relevez de la juridiction de l’Abbé et non de celle de l’évêque ; cette mesure ne vous touche donc pas ; d’ailleurs, oblat ou non, tout homme est libre de venir nous rendre visite dans notre cellule et chez nous, nous n’admettons qu’une autorité, celle du père Abbé ; nous coninuerons donc, avec sa permission, à administrer, comme par le passé, le sacrement de pénitence à nos clients.
— Oui, appuya le P. Brugier, l’interdiction de Mgr Triaurault ne peut porter que sur l’église qui est jusqu’à un certain point paroissiale, mais, qu’il le veuille ou non, elle s’arrête au seuil de notre cloître.
— Bien, mais les femmes ? Mlle de Garambois et ma bonne, par exemple !
— Ah ça, c’est une autre affaire ; elles ne peuvent pénétrer dans la clôture et dès lors la quesion se complique ; mais elle est facile à résoudre ; la défense épiscopale ne s’étend qu’au Val des Saints et, hors de ce bourg, nous conservons tous nos pouvoirs. Il sera par conséquent facile à chacun de nous d’aller, une fois par semaine, à Dijon où nous attendrons nos pénitentes dans un es confessionnaux de la chapelle des Carmélites ou de tout autre Ordre.
— C’est égal, avouez que c’est roide, un prélat voulant imposer de force un confesseur ; c’est un véritable viol de conscience ; mais, voyons, votre père Abbé a dû être consulté ; il ne s’est donc pas défendu ?
— Il a été, tout juste prévenu, dit le P. Brugier.
— Le Révérendissime est ami de la paix, ajouta prudemment Dom Emonot qui changea aussitôt la conversation et se mit à deviser avec le cellerier du noviciat.
Ce père Emonot, il était peu sympathique à Durtal, avec sa grosse tête enfoncée dans le cou et toujours renversée en arrière, son oeil glissant sous ses lunettes, son nez effilé aux narines pochetées, semblables à des bouts de pinces à sucre ; mais ce qui gênait en lui, c’était moins son teint jaune, son air chafouin, son ton doctoral et son rire aigre, que ces mouvements nerveux qui lui agitaient constamment la face.
La vérité était que ces zigzags de traits pouvaient s’appeler les tics du scrupule.
Dom Emonot souffrait, ainsi que beaucoup de prêtres et de nombreux fidèles, de cette terrible maladie de l’âme ; et il sursautait tout à coup, se crispait, repoussait, ainsi que d’un geste de physionomie, une vague tentation, s’assurait par un geste de dénégation, par un petit recul, qu’il la repoussait et ne péchait pas.
Cette infirmité était issue d’une vertu vraiment foncière, d’un ardent désir de perfection et l’on s’expliquait son étroitesse d’esprit, son bégueulisme lorsqu’on songeait que tout était pour lui une cause d’appréhension, un sujet de reproches et de plaintes.
Mais cela dit, il fallait reconnaître qu’il était homme de bon sens, expert à mener les âmes qui pouvaient tolérer son régime, dans les montées de la voie rude, très clairvoyant sur la situation actuelle de son Ordre.
Durtal revenait un peu de ses préventions, en l’entendant s’exprimer fort sagement sur ses élèves.
— On rit, disait-il, du fameux moule, cher aux jésuites, sans s’apercevoir que, sous une empreinte qui semble pareille, il n’y a pas de gens plus différents entre eux que les jésuites. La règle de saint Ignace a plané les défauts, émondé les caractères, mais elle n’a nullement tué la personnalité, comme tant de gens le pensent. Plût à Dieu qu’il en fût ainsi chez nous ! Ce qui nous manque, c’est justement un moule où nous puissions couler les débutants. Je sais bien que, dans certaines maisons de notre congrégation, on juge ces procédés de culture mesquins et déprimants ; l’on n’y parle que de dilater l’âme. Hélas ! on ne la dilate pas, on l’abandonne à elle-même.
Et puis, je veux bien croire que, pendant le temps de la probation, l’on réussira à inculquer l’esprit de discipline, à susciter le goût de la vie intérieure aux novices — et après ? Quand ces âmes, comprimées, auront échappé aux épreuves du noviciat et qu’elles auront franchi le délai, après lequel cesse la surveillance de la jeune paternité, elles détendront leur ressort et c’est à ce moment-là que le danger commence ; il faudrait continuer à les tenir en bride, et les mâter par une occupation absorbante, par un travail assidu, voire même par des labeurs corporels pénibles.
Et c’est le contraire qui a lieu ; le Bénédictin soi-disant mûr, est libre ; ne travaille que celui qui veut ; et c’est bien tentant de ne rien faire ; on finit par se laisser aller, par s’arranger une existence de rentier tranquille ; et le religieux qui ne travaille pas, bavarde, dérange les autres, fomente des brigues. Ainsi que le dit très bien notre père saint Benoît, l’oisiveté est l’ennemie de l’âme « otiostas inimica est animae » .
— Oui, l’on devient des ronds-de-cuir pieux et l’office lui-même sent la conserve, avec ses psaumes marinés dans la saumure de leur chant.
Le P. Emonot sourit d’assez mauvaise grâce.
— Vous avez une façon naturaliste d’envisager les choses et de les résumer qui est plus que singulière.
— Je blague, repartit Durtal, mais n’empêche, mon père, que vous n’ayez mille fois raison ; un moine inoccupé est un moine à moitié perdu, car enfin le travail... c’est du péché en moins !
— Certes, fit le cellerier, mais il est plusfacile de signaler le péril que de le conjurer. Il convienrait de changer le système du noviciat, de relever le niveau des études qui est faible ; il conviendrait surtout de ne pas admettre e paresseux. Cela regarde Dom Felletin ; il est assez intelligent pour le comprendre.
— Sans doute, dit le père Emonot, c’est un remarquable maître des novices.
— Puis il y a de la sainteté en lui, poursuivit Dom Brugier.
— La sainteté de saint Pierre ! jeta Dom Emonot dont l’oeil s’alluma, sous ses lunettes, d’une lueur.
De saint Pierre ? se demanda Durtal. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce une rosserie ? Cela veut-il dire qu’avant d’être un saint, Dom Felletin fut un traître ?
Mais l’oeil étant éteint et lorsque Durtal le scruta, il n’y vit que du bleu mort. Le zélateur était d’ailleurs aussitôt passé à un autre sujet d’entretien.
Il discutait maintenant avec le cellerier sur certains ornements d’église que le nouveau curé réclamait, comme appartenant non à l’abbaye mais à la cure, et c’était une interminable énumération d’étoles, de chasubles, de chapes. Ce défilé n’intéressait guère Durtal ; aussi ne fut-il pas fâché, quand le train fit halte au Val des Saints, de prendre congé des deux religieux et de rentrer chez lui.