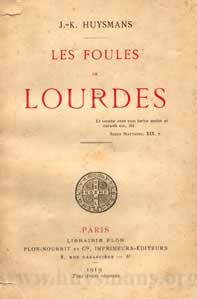ON s’attache à certains malades que l’on ne connaît pas, plus qu’à d’autres que l’on ne connaît pas davantage, d’ailleurs ; je me répète cette réflexion en allant faire, ce matin, ma visite à l’hôpital. Ces préférences ont des causes multiples, quasi inconscientes, pour la plupart. Certainement, la pitié s’émeut, plus forte, pour ceux que l’on voit le plus souffrir ou qui sont férus d’affections plus rebutantes ; le souvenir de ceux-là vous hante, en effet, alors que tant d’autres infirmes, aux aspects moins imprévus, passent, sans qu’on y prête attention, en cet étonnant kaléidoscope de maux qui ne cesse de tourner dans cet hôpital où constamment des moribonds en remplacent d’autres. Il est bien évident aussi que l’on se sent, qu’on le veuille ou non, plus attiré vers une jeune fille impotente et jolie que vers une vieille, plus touché également par les tortures d’un enfant que par celles d’un homme. Tout le monde, je crois, se mesure à ce même étalon de sensibilité. Ajoutons encore que des sympathies que ne déterminent point, cette fois, l’avenance plus ou moins accentuée des traits, la différence des sexes, le degré plus ou moins pitoyable des douleurs subies, naissent pour les uns et pas pour les autres. L’on cause avec ces alités-là, alors que l’on n’éprouve aucun désir d’interroger leurs voisins et dès lors une sorte de lien s’établit avec eux et l’intérêt plus spécial qu’on leur porte s’explique ; mais la raison même de cette sympathie reste, dans ce cas, obscure ; elle dérive d’une impulsion que l’on serait bien en peine d’analyser. Enfin il y a parfois aussi, dans cette préférence, la présence d’un tiers qui vous tient plus à coeur que le malade même, mais qui vous le fait, par ricochet, aimer.
Tel est, je pense, le cas de cette petite, aux pieds gangrenés, que je vais revoir ; certes, je ne suis pas indifférent au sort de cette enfant qui a enduré le plus épouvantable des martyres, mais je suis plus requis, je le confesse, par l’héroïque dévouement de cette bonne vieille dame qui la soigne et qui est si contente que l’on vienne prendre des nouvelles de sa protégée. La petite va de mieux en mieux ; évidemment, ses pieds ne sont pas ce qu’on pourrait appeler de très jolis petons ; l’ontils jamais été d’ailleurs ? — mais ils ont maintenant la forme de pieds ; ils s’éclaircissent, leur rouge sombre commence à se muer en rose. Malheureusement, elle va partir avec le pèlerinage qui l’amena et je ne saurai que l’année prochaine, en admettant qu’on la conduise encore à Lourdes, si elle est décisivement guérie. Quant à l’homme à la langue fluctueuse de Coutances, il a quitté l’hôpital dans le même état qu’il y était venu ; de même aussi pour la mauviette nichée dans sa minuscule voiture ; elle ne s’est pas dénouée dans les piscines et la charitable demoiselle l’a remportée, heureuse tout de même de lui avoir procuré ce voyage au grand air et cette diversion.
Parmi les malades qui ont remplacé, dans les salles du rez-de-chaussée, ceux que l’on a réembarqués dans les trains, il y a, dans la salle des femmes, deux cas affreux. L’un est celui d’une malheureuse, étendue dans un cadre, dont on n’aperçoit qu’un bout de visage livide dans le creux, aux ailes rabattues, d’un oreiller ; elle est atteinte d’une tuberculisation générale et aiguë du système osseux et des poumons, le terrible mal de Pott, qui lui a déjeté la colonne vertébrale et couvert les hanches de fistules suppurantes et d’abcès ; elle trempe dans un lac de pus. L’autre est celui d’une jeune moniale d’un couvent de Saint-Brieuc, qui gît dans un panier d’osier ; elle est jolie et semble morte ; les joues sont d’une pâleur extraordinaire, les paupières sont closes, les lèvres ont le ton de la pierre ponce. Un prêtre brancardier cause avec une religieuse qui la garde ; il me mêle à la conversation et m’apprend que soeur Justinien a vingt-six ans, qu’après avoir été atteinte d’une pleurésie suivie, d’hémoptysies, elle est, depuis un an, immobilisée par une coxalgie avec raideur articulaire et déformation du membre inférieur. Elle a la jambe enfermée dans un appareil plâtré et son état d’épuisement est tel qu’on s’étonne qu’elle puisse encore vivre.
Dans la salle des hommes, que je parcours, il y a des cancéreux au teint de paille, des poitrinaires aux yeux moirés, un vieillard dont le visage peint en bronze décèle le mal d’Addison, des paralytiques, des gens qui se traînent sur des béquilles ; peu d’ulcères, visibles du moins, mais une sorte de lèpre qui boursoufle la face d’un homme dont la peau semble travaillée au repoussoir, dans un cuir grenu, couleur lie de vin.
Et je monte au premier ; dans une des salles occupées par le pèlerinage de Belley qui vient d’arriver et qui s’installe, les soeurs du Saint-Esprit s’empressent ; elles portent le magnifique costume des religieuses de l’hôpital de Beaune, — elles appartiennent, en effet, au même Ordre, — la robe bleue à vastes manches serrées au poignet et le hennin de toile blanche, le costume resté intact des moniales du quinzième siècle. L’une d’elles console un enfant qui pleure, la jambe emprisonnée dans une gouttière de bois ; celui-là est, comme la petite moniale du bas, tuberculeux et coxalgique ; il a sur la jambe et sur les reins des éruptions d’abcès. La soeur me dit que le voyage fut pénible, non à cause de cet enfant, mais à cause de l’une de leurs poitrinaires qui a failli mourir en wagon, dans un crachement de sang ; et elle ajoute que tout cela est oublié, qu’il va falloir maintenant ramener ses malades guéris ; et ce qu’elle l’espère, cette charmante vieille soeur, avec son regard candide et son à peine de sourire, très doux !
Je la quitte et me croise dans un couloir avec deux aveugles dont l’un a des yeux en laitance de poisson cuit et l’autre en croûte de bondon gras et ils sont conduits par un ophtalmique qui voit assez clair pour se guider, mais dont les paupières retournées exsudent sans arrêt, le long des joues, de leurs lisérés de jambon saignant, des traînées de larmes ; et, en les contemplant, le souvenir me hante du tableau du vieux Breughel où les gestes tâtonnants et les apparences des diverses cécités sont si bien rendus. Je pénètre maintenant dans une autre salle ; là, parmi les alités amenés par les Hollandais, figure un vrai gnome, un petit garçon enfoui, tout habillé, sous une couverture, coiffé d’un chapeau tyrolien de feutre vert.
Il a une tête de bossu, blanche, comme échaudée, sans une expression, sans un pli ; il ressemble, étendu sur le dos, avec la gibbosité de sa poitrine qui bombe sous la couverture et ses membres grêles, à une grenouille. Il paraît insensible, plongé dans une sorte de coma. On me répond simplement, quand je demande quel mal a pu le réduire à un état pareil « il a la colonne vertébrale pourrie. »
Quant aux autres invalides du même pèlerinage, entassés dans cette chambre, ce sont des incurables, mais dont l’existence peut se prolonger, ce sont surtout des scrofuleux et des infirmes.
Ça sent le pouacre, ça sent le fade ; j’éprouve le besoin de changer d’air et, en sortant de l’hôpital, je me heurte sur un pèlerinage qui chante avec des voix poussiéreuses et traînantes :
Chez nous, dans la Vienne,
Nous vous aimons tous.
O Marie, soyez Reine,
Chez nous, chez nous !
Je n’ai pas de peine à reconnaître, en considérant la dégaîne lourde et musarde de ces hommes et de ces femmes et en écoutant l’air bébête et gnan-gnan de ce cantique, que ces pèlerins appartiennent à la race subalterne du Poitou.
Je fuis, pour les éviter, par une autre route, et, chemin faisant, je me répète ce que chacun doit se dire, après qu’il a vu à l’hôpital le défilé de tant de misères et de tant de maux : Seigneur, que vous êtes bon de ne pas m’avoir infligé des maladies semblables ! Il est bien certain qu’il faut venir à Lourdes, si l’on veut se rendre compte ce que peut devenir la loque décomposée de notre pauvre corps. Il n’est point de clinique qui présente un éventaire aussi varié de monstres. L’on se remémore les bêtes fabuleuses du Moyen Age, mais que sont-elles en comparaison de la tête de mort du lupus qui saigne et de la langue tuméfiée qui précède le paysan de Coutances ?
Je vais au bureau des constatations. Y verrai-je, après le désolant spectacle de l’hôpital, la joyeuse scène du miraculé jailli, régénéré, de la piscine ? Ce bureau occupe, sous les arches de la rampe qui monte de l’esplanade à la basilique, un petit bâtiment éclairé par des fenêtres à vitres de couleur, solidement protégées contre la foule par des barreaux de fer et surmonté d’une statue en marbre de saint Luc.
L’intérieur, plutôt obscur, tapissé du haut en bas de ses murs et sur son plafond en voûte d’un cloisonnage de faux pitchpin, évoque l’idée d’une cabine de navire. Entre les deux fenêtres, du côté de l’esplanade, une grande table et une autre formant avec elle un angle ; et, cloué sur le panneau entre ces croisées, un crucifix ; en face, une cheminée sur la tablette de laquelle est posée une statue de la Notre-Dame de Lourdes ; à gauche, une porte donnant sur une autre petite salle qui sert aux examens médicaux ; à droite, des photographies de miraculés, dans un cadre, et en vis-à-vis à la porte d’entrée, une autre qui s’ouvre, derrière la rampe, sur l’allée longeant le Gave ; des banquettes, quelques fauteuils, des chaises, des armoires qui renferment des dossiers et des registres et c’est, je crois bien, tout.
Devant la grande table, le docteur Boissarie est assis et, à sa gauche, devant l’autre table, se tient son adjoint, le docteur Cox. La première impression que l’on éprouve, alors qu’on assiste à l’interrogatoire des malades, est que le docteur Boissarie est un juge d’instruction, mais un juge brusque et bon enfant, et qui retourne, en souriant, ses accusés sur le gril, et l’aimable docteur Cox fait alors l’effet du greffier qui, tout en écrivant, jette de temps en temps un coup d’oeil sur les inculpés dont il inscrit, s’il y a lieu, la réponse.
La vérité est, n’en déplaise aux gens qui ne connaissent que par ouï-dire la clinique de Lourdes, que ces deux praticiens sont fort défiants et qu’ils ne retiennent, pour leurs annales, que bien peu des cas extraordinaires dont le défilé s’opère devant eux.
Alors que j’arrive, le docteur Boissarie me fait signe de m’asseoir auprès de lui et il continue de causer placidement avec une jeune fille d’allure un peu bizarre, une paralytique qui déclare avoir été guérie, miraculeusement, ce matin, après un premier bain. Elle ne fait pas partie d’un pèlerinage, ne possède aucun certificat de médecin, rien qui renseigne sur ses antécédents ; elle est d’ailleurs pleine de réticences et se tait sur l’origine de son mal ; mais elle a affaire à un homme patient qui l’incite à se contredire, qui lui dit : « Voyons, vous avez dû suivre tel traitement, éprouver tel et tel symptôme. » Et peu à peu, il finit par lui extirper la vérité, par lui faire avouer qu’elle est sujette à des attaques et qu’il faut alors quatre hommes pour la tenir, et le docteur sourit, la congédie avec de bonnes paroles, et me dit : « C’est de la fausse monnaie. »
Et d’autres passent, des améliorés, mais non des guéris. « Voyons, marchez un peu sans vos béquilles. » — Et l’homme essaie quelques pas dans la pièce et s’arrête, épuisé, alors qu’on lui tend une chaise. On lui demande alors combien de temps il doit rester à Lourdes et on l’invite à revenir, avant son départ, pour un dernier examen.
Et ainsi de suite ; l’on peut vraiment attester que le bureau des constatations ne pousse pas aux miracles, car toute affection qui peut provenir d’un détraquement du système nerveux est, de prime abord, écartée ; et quant aux autres, l’on ne se prononce réellement que quelques années après, alors que l’on a pu s’assurer que la guérison s’était maintenue. Malheureusement, ces habitudes de prudence ne sont pas celles de la presse ; elle prend justement le contre-pied de la clinique et, à propos de guérisons surnaturelles qui n’en sont pas, donne raison à la critique obligée de ne se baser que sur des comptes rendus forcément inexacts.
A en croire les correspondants des journaux catholiques venus pour assister aux pèlerinages, les miracles foisonnent ; c’est à qui en aura vu le plus. S’il en était ainsi, les inguéris seraient l’exception, et le vrai miraculé serait celui qui ne le serait pas !
— Connaissez-vous Mme Rouchel ? me demande le docteur Boissarie.
— Non.
— Eh bien, je vais vous la montrer tout à l’heure, car elle est présentement à Lourdes et je l’attends, ce matin.
Et il me rappelle, en feuilletant un dossier qu’on lui apporte, le miracle avéré, certain, celui-là, d’un lupus guéri instantanément et qui n’a jamais reparu depuis l’année 1903, pendant laquelle eut lieu la guérison.
Je regarde le dossier avec lui ; il est bourré de rap. ports, de certificats médicaux ; cette femme, avant de venir ici, avait été examinée par tous les docteurs de la Lorraine, traitée par tous les spécialistes des maladies de la peau ; tous les certificats concordent et concluent à l’impossibilité de guérir un lupus arrivé à un état d’acuité pareille.
Ce que l’on a tenté, pour entraver la marche de cet ulcère, est incroyable ; on a saccagé la mâchoire de la malheureuse, en lui arrachant les dents ; on l’a cautérisée sans mesure et le lupus n’en a pas moins continué de la dévorer vive et de répandre une odeur si nauséabonde que person ne n’osait plus la panser. La figure était devenue quelque chose d’effrayant. Le nez et la bouche confondus s’ouvraient en un rouge cratère d’où coulaient des filets de lave couleur de soufre ; les joues étaient percées de deux trous de l’épaisseur d’un petit doigt et qu’il fallait boucher avec des tampons de ouate lorsque la pauvre femme s’apprêtait à manger ou à boire, de peur que les aliments et la boisson ne sortissent par ces ouvertures. Sa situation était devenue si atroce qu’elle avait résolu de se jeter dans la rivière. Un vicaire de l’église de Saint-Maximin, à Metz, où elle résidait, l’abbé Hamann, l’en empêcha et la fit admettre parmi les malades que le pèlerinage de cette ville expédiait à Lourdes.
Arrivée devant la grotte, elle prie, puis baigne ce qui lui sert de visage, à la piscine. Le lendemain, elle recommence à s’imbiber la face avec une éponge et sans plus de succès ; ce même jour, honteuse, se sentant un objet de dégoût pour tout le monde, à quatre heures, au moment de la procession du saint Sacrement sur l’esplanade, elle ne veut pas se mettre sur les rangs des malades et elle se cache dans le Rosaire, vide, à ce moment-là, derrière le grand autel. Elle lisait, agenouillée, ses prières dans un livre de messe quand, la procession étant terminée, monseigneur de Saint-Dié, qui avait tenu l’ostensoir, rentre pour le déposer dans le Rosaire. A ce moment, le bandeau qui lui voilait la figure se défait et tombe sur son livre qu’il macule de sang et de pus. Elle le rattache solidement, à l’aide d’un double noeud, et, intimidée par la foule qui rentre à la suite de l’évêque, dans l’église, elle s’échappe et s’en va à la fontaine pour y prendre un peu d’eau. Elle était penchée sur le robinet, lorsque le bandeau se détache encore ; un peu surprise, car elle était certaine de l’avoir très fermement noué, elle le rajuste et retourne à l’hôpital où elle se plaint qu’il ne tienne pas et demande qu’on le lui applique avec plus de soin. On l’enlève et les deux personnes qui l’ont ôté poussent un cri : « Vous êtes guérie ! » — Elle n’y croyait pas ; il fallut qu’elle se vît dans une glace pour se convaincre qu’en effet le lupus avait disparu, comme par un coup de baguette, en une seconde. Le visage s’était réparé, le nez s’était restauré tant bien que mal, les trous des joues et du palais ouverts étaient bouchés ; les chairs s’étaient reconstituées d’elles-mêmes, spontanément.
Et, tandis que nous nous entretenons de ce phénomène inouï, la bonne femme arrive et salue, en riant, le docteur ; elle peut avoir cinquante-quatre ans ; elle est grosse, marche pesamment, a l’air tout à la fois d’une paysanne et d’une loueuse de chaises, dans une église. Je regarde la figure, elle est celle de quelqu’un qui se serait autrefois brûlé ; elle est machurée de rose et veinée de blanc ; les traces des cicatrices sont apparentes. Cette femme est évidemment laide, mais d’une laideur qui ne répugne pas.
Et pendant que les médecins qui se trouvent dans le bureau l’examinent, je cause avec le docteur Boissarie de cet autre cas de lupus dont Zola a vu la guérison, à Lourdes, celui de Mlle Marie Lemarchand, de Caen, devenue, sous le nom d’Élise Rouquet, l’un des personnages de son livre. La guérison qui eut lieu, le 20 août 1882, fut ainsi que celle de Mme Rouchel, qu’elle précéda, instantanée.
Mais, elle, se sentit guérir. A peine se fut-elle lotionnnée dans la piscine qu’elle éprouva d’atroces douleurs, puis eut l’immédiate certitude qu’elle était guérie ; et elle l’était, en effet ; un médecin, le docteur d’Hombres, qui se tenait là et qui l’avait remarquée tandis qu’elle lavait l’horrible bouillie de sa face, et qui l’examina aussitôt après sa sortie de la piscine, a très nettement déclaré ceci : « Au lieu de la plaie hideuse, je vis une surface sèche, comme recouverte d’un épiderme de nouvelle formation. »
Zola n’a pas voulu avouer cette spontanéité qu’il avait constatée pourtant ; il a préféré raconter que l’aspect du visage s’améliorait peu à peu, que la cure s’opérait indolemment ; il a inventé des étapes et des gradations pour ne pas être obligé de confesser que cette renaissance soudaine d’une figure détruite était en dehors des lois de la nature humaine ; ç’eut été l’aveu du miracle.
La question est, en effet, là. Que le lupus, si rebelle à tous les genres de médications, puisse néanmoins disparaître à la longue, c’est très possible ; mais ni les anciennes méthodes, ni la nouvelle thérapeutique des rayons invisibles ou des rayons lumineux n’ont fait et ne feront qu’il s’envole, qu’il s’évapore, par enchantement, en un clin d’oeil. La nature ne peut fermer une plaie en une seconde, les chairs ne peuvent se restaurer en une minute. Ce qui constitue l’élément du miracle, en pareil cas, c’est moins la guérison que sa promptitude, que son instantanéité.
L’histoire de Marie Lemarchand, telle que l’a relatée Zola, est donc résolument inexacte ; préoccupé de fournir des arguments aux adversaires du surnaturel, il insinua, dans son volume, en sus de la lenteur mensongère de la cure, que ce lupus pouvait bien être un faux lupus, d’origine nerveuse. Et après ? en l’admettant, en quoi la question serait-elle changée ? Il n’en resterait pas moins le point principal, la réfection subite des cellules et des tissus. Un ébranlement nerveux n’a pas, je présume, le pouvoir de faire repousser sur-le-champ des chairs ; alors ? — mais la vérité est autre — l’origine du lupus de Marie Lemarchand est parfaitement connue ; elle a été certifiée par les médecins, garantie par l’état même de la malade qui était atteinte de la phtisie lorsqu’elle vint à Lourdes. Son lupus était, ainsi que la plupart des lupus, d’origine tuberculeuse. Ajoutons que les tubercules des poumons sont partis en même temps que les ulcères de la face ; la Vierge a fait d’une pierre deux coups. Douze ans se sont écoulés, et ni l’une ni l’autre de ces affections ne sont revenues ; l’on peut donc affirmer que Mlle Marie Lemarchand est une miraculée vraiment guérie.
Et je songe maintenant aux cas semblables et cependant différents de ces deux femmes. Mme Rouchel n’a éprouvé aucune commotion, n’a senti aucun de ces souffles chauds ou froids qui sont si souvent les signes avant-coureurs des guérisons, à Lourdes ; elle a été guérie, sans souffrir, sans s’en apercevoir, hors des suppliques des foules et des piscines, seule, dans un coin. Mlle Lemarchand, elle, a souffert atrocement dans la piscine et s’est très bien sentie guérir ; et elle n’a pas gardé, comme Mme Rouchel, trace des cicatrices de ses plaies ; ni coutures blanches, ni plaques roses ; sa figure est redevenue ainsi qu’elle était auparavant.
Je suis tiré de mes réflexions par le bruit des conversations qui se croisent dans la salle ; elle s’est, peu à peu, remplie ; des médecins, des prêtres, des curieux se pressent ; le secrétaire de l’Évêque de Tarbes, l’affable P. Eckert, entre, en quête de renseignements pour le Journal de la Grotte qu’il dirige et il s’installe près du docteur Cox ; et la porte s’ouvre encore et une jeune fille, accompagnée de deux dames, demande à être examinée.
On s’enquiert de son nom. Virginie Durand, âgée de dix-neuf ans, demeurant à Saint-Michel-Chef-Chef, dans la Loire-Inférieure ; elle raconte qu’elle était poitrinaire et qu’elle a été guérie, l’année dernière. Le docteur Cox se lève, va chercher les dossiers et les registres, découvre, en effet, le nom, et donne, à haute voix, lecture des pièces.
Il en résulte que Virginie Durand est venue, avec le pèlerinage nantais, l’an dernier ; elle a présenté un certificat médical constatant qu’elle était atteinte de tuberculose des poumons ; les crachats avaient été analysés, la nature du mal ne pouvait faire de doute. Elle avait eu de nombreuses hémoptysies et elle était tombée dans un tel état d’affaiblissement qu’elle était incapable de se tenir debout. Dans le bain où elle fut plongée, elle endura des douleurs épouvantables et faillit passer dans une crise de suffocation ; puis avant même que d’être retirée de l’eau, elle sentit un bienêtre îndicible qui succédait à ses tortures ; et elle put s’habiller, seule, aller sans aide à la grotte, manger de bon appétit et dormir. On l’a auscultée, le jour même, et l’on n’a plus trouvé trace des lésions.
— Avez-vous un nouveau certificat de votre médecin ? demande le docteur Boissarie.
Elle en tend un, relatant qu’elle n’a jamais été souffrante depuis son retour dans son pays et qu’elle a engraissé de vingt-quatre livres.
— Voulez-vous examiner Mademoiselle ? propose le docteur à plusieurs médecins qui tournent autour de l’ancienne malade ; deux acceptent, qui l’auscultent dans la salle voisine et déclarent, en rentrant, que les poumons ne présentent rien d’anormal.
Le docteur Cox rajoute au dossier le nouveau certificat, prend note de la consultation et, l’an prochain, quand cette jeune fille sera de nouveau de séjour à Lourdes, on l’examinera, afin de s’assurer si sa guérison s’est encore maintenue.
Il y en a qui, depuis quinze ans, viennent ainsi, en action de grâces, à la grotte et se rendent à la clinique, si bien que l’on suit, année par année, l’état de leur santé ; ce sont de vraies archives de familles, que ces archives de Lourdes !
— Ah ! Messieurs, s’exclame tout à coup le docteur Boissarie, voici un cas intéressant et que nous avons étudié de près, il y a quelques jours ; entrez, mon enfant, entrez, asseyez-vous là.
Et debout, dans le silence subit de la pièce, il dit, en désignant une jeune fille, installée dans un fauteuil :
— Mlle Rosalie Monnier, que voici, fait partie du pèlerinage diocésain de Belley ; elle habite le village de Cuet où est né le Bienheureux Chanel, un père mariste, qui fut, vous le savez, martyrisé en 1840, dans l’Océanie. Sa mémoire est l’objet d’un culte fervent dans ce village ; ces détails ne sont pas, vous le verrez tout à l’heure, inutiles.
Mlle Monnier appartient à une famille de cultivateurs qui eurent six enfants dont deux sont morts de la poitrine ; elle, a été prise, dès l’âge de quinze ans, d’une maladie de langueur, sans cause bien définie et qui a arrêté son développement et s’est compliquée, il y a déjà près de dix-neuf années, d’un état de dyspepsie tel qu’elle fut obligée de ne prendre que du lait, et, à doses insuffisantes pour s’alimenter ; encore devait-elle, pour ne pas le vomir, l’absorber à l’aide d’un tube de caoutchouc.
Les médecins dont nous avons ici les certificats ont renoncé à la traiter ; elle gardait la chambre, ne pouvait supporter ni lumière ni bruit, et il y a quelque temps elle est devenue, par suite d’inanition, tellement faible que l’on a cru qu’elle allait mourir et qu’on l’a administrée.
Mais elle avait la dévotion de son pays, la dévotion du Bienheureux Chanel ; abandonnée par la science qui se déclarait inapte même à la soulager, elle se remit entre ses mains et, après l’avoir ardemment invoqué, elle eut l’intuition subite qu’il obtiendrait sa guérison de la Vierge, si elle se rendait à Lourdes. Elle partit le 6 septembre, et ce long voyage de vingt-six heures fut des plus pénibles ; elle vomit jusqu’à Lyon, arriva à jeun le lendemain soir à Lourdes où elle fut placée à l’hôpital de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Le 8, dès le matin, elle se traina jusqu’à la chapelle de cet établissement, pria le Bienheureux et fut portée à la grotte où elle reçut la sainte communion. Aussitôt, il lui sembla qu’on lui écartelait l’estomac, — qu’on le lui ouvrait, selon son expression, comme un livre — et depuis ce moment, elle ne souffre plus, mange avec appétit ce qu’on lui sert. Elle est encore un peu pâlotte, mais la reprise se fait depuis quelques jours, chez elle, à vue d’oeil.
J’ai cru devoir signaler à MM. les ecclésiastiques, ici présents, parce qu’elle peut intéresser la canonisation du Bienheureux qui est actuellement soumise à la Congrégation des Rites, à Rome, l’intervention de ce martyr, auprès de la Vierge, pour cette guérison.
J’ajoute, du reste, que deux fois déjà nous avons pu constater son rôle de médiateur auprès de l’Immaculée Conception de Lourdes ; une fois, à propos de l’un de ses compatriotes, Vion-Dury, un aveugle incurable qui, après lui avoir fait une neuvaine, se bassina les yeux avec de l’eau de la source et recouvra immédiatement la vue ; une autre fois, à propos d’une femme du pèlerinage de Belley qui l’implora dans la chapelle de l’hôpital de Notre-Dame et fut guérie, le même jour, après avoir communié à la grotte.
En ce qui concerne la maladie même de Mlle Monnier, j’appelle l’attention de mes confrères sur les conditions dans lesquelles cette cure s’est opérée. Cette jeune fille, malade depuis dix-neuf ans, pouvait-elle guérir par les seuls efforts de la nature ? oui, évidemment ; au point de vue théorique, il est permis de le soutenir, mais pas cependant dans l’espace d’une minute, pendant le temps d’une communion ; car, de même que la nature ne peut cicatriser une plaie en une seconde, de même elle ne peut refaire soudainement une économie minée par dix-neuf années d’inanition. Cette instantanéité dans les résultats doit surtout vous arrêter, car il n’est pas, vous le savez, en notre pouvoir de supprimer la convalescence et de passer sans transition de la maladie grave à la santé.
Je pense, à part moi, que cette guérison — si tant est qu’elle persiste — s’est effectuée sans bain, sans verre d’eau, sans foule, sans cris, sans bénédiction du Saint-Sacrement, après une simple communion, ce qui prouve combien toutes les hypothèses qui attribuent les cures de Lourdes au saisissement causé par l’eau froide et à la suggestion des bruyantes multitudes sont fausses. Ce qu’en tout cas l’on guérit, si l’on doit guérir, d’une façon variée à Lourdes !
VI
LA laideur de tout ce que l’on voit, ici, finit par n’être pas naturelle, car elle est en dehors des étiages connus ; l’homme seul, sans une suggestion issue des gémonies de l’au-delà, ne parviendrait pas à déshonorer Dieu de la sorte ; c’est, à Lourdes, une telle pléthore de bassesse, une telle hémorragie de mauvais goût, que, forcément, l’idée d’une intervention du Très-Bas s’impose.
Je laisse de côté la basilique qui grelotte, maigre comme une perche, sous son chapeau de pierrot, dans son mince vêtement de pierre, sur le plat humide de son roc, mais que dire du Rosaire, de ce cirque hydropique dont le ventre rebondi bombe sous ses pieds ? Comment définir cette bàtisse dont la forme intérieure rappellerait vaguement celle d’un as de trèfle, avec cinq autels disposés dans la circonférence de chacune de ses feuilles ? On voudrait savoir de quel style cela procède, car il y a de tout là dedans, du byzantin et du roman, du style d’hippodrome et de casino ; mais il y a surtout, à bien regarder de près, du dépôt de machines, de la rotonde de locomotives ; il ne manque que les rails et la plaque tournante au milieu, à la place du grand autel, pour permettre aux machines de sortir des coulisses et d’évoluer sur les voies de l’esplanade, en sifflant au disque.
Et cette rotonde qui devrait être enfumée par la vapeur des charbons, encrassée par la poix des suies, elle est d’un blanc de plâtre neuf ; on a commencé par la parer comme une salle de théâtre, mais le décor est inachevé ; partout cependant des ornements de faux or, des torchères électriques, lourdes et tortillées, d’une insolence de luxe atroce ; des colonnes qui ne sont que des pans de murs nains et carrés, revêtus à mi-corps de plaques de marbre, couleur de rillettes et dont les inscriptions des ex-voto, creusées en lettres d’or se voient heureusement, à peine ; en fait de chapiteaux, au-dessus de ces piliers trapus, les versets des litanies courent, sculptés dans des feuillages, et, montent pour atteindre, en s’incurvant, un dôme badigeonné au lait de chaux, troué d’oeillères garnies de Dieu sait quelles vitres ! des colonnettes s’effilent et, au bout de leurs tiges, fleurissent des plumeaux ou plus exactement des diadèmes de sauvages en plumes ; ça, c’est de l’exotique d’opéra, de l’alhambra de province. Dans l’incohérence de cet ensemble, imaginez maintenant le boniment électrique de centaines d’ampoules, allumées, le soir, et dont les lueurs fracassantes se répercutent dans les ors et les marbres des murs et vous pourrez vous croire partout où vous voudrez, sauf dans une église.
Cette nef ou cette crypte — on hésite à qualifier d’un nom ces salles biscornues — sont évidemment le produit de l’imagination d’un brelandier en veine de gain et d’un bedeau en délire ; mais il y a pis, ce constructeur de casino religieux a du génie, si on le compare aux peintres.
L’on a cru devoir, en effet, commander pour les niches à autels d’immenses peintures, traduites, pour que ce fût plus somptueux et que cela coutât plus cher, en des mosaïques que façonnèrent des fabricants de pâtes de couleur, en Italie.
Et cela dépasse tout ce que l’on pourrait rêver. L’art, même dans ses plus basses déchéances, n’a plus rien à voir ici ; ce n’est même pas mauvais, car enfin, en art, le mauvais existe ; on peut l’expliquer, le définir ; la discussion qu’il suscite implique la reconnaissance peut-être d’un effort, d’une impuissance, en tout cas, ou d’une erreur ; mais ces murs cimentés de cailloux tassés dans un fond crevassé d’or et qui reproduisent de vagues fresques que signèrent de pauvres inconscients, ne peuvent susciter que l’idée d’une impéritie sans égale et d’un néant ; ce n’est même pas cocasse ; ce n’est même pas fou, c’est puéril et c’est ganache ; ça vacarme et ça radote. Devant cette Nativité, cette Annonciation, ce Jardin des Olives, cette Flagellation ; les bras vous tombent ; le dernier élève de l’École des Beaux-Arts ferait mieux. Il ne s’agit pas, en effet, de talent, mais d’abécédaire et de rudiments et ici, c’est l’ignorance du métier, aggravée par le sentimentalisme bébête de l’ouvrier de cercle catholique qui a bu un coup !
Aussi, va-t-on se réfugier devant le seul panneau qui ait été confié, par distraction, sans doute, à un peintre, médiocre, je le veux bien, mais enfin à un peintre. Celui-là sait au moins et dessiner et peindre ; l’on peut distinguer l’art d’affiche et de chromo de M. Maxence, juger que son Ascension réduite deviendrait une parfaite étiquette pour les boîtes à dragées d’un confiseur, mais enfin son art paraît réel si en le rapproche des vétustés enfantines des trois autres.
Et la même réflexion vous vient devant une Vierge de Maniglier, sculptée dans le tympan, au-dessus de la porte, tenant un enfant qui remet à saint Dominique, agenouillé, un rosaire dont les grains étaient jadis simulés par de petites ampoules électriques qu’on allumait le soir ! on la jugerait, dans une exposition de Paris, courte et savonneuse, sans aucun caractère religieux, mais ici, elle fulgure, admirable, en face des infernales fantaisies de la maison Raffl.
Quel évêque atteint d’ablepsie, quels églisiers, agités par des forces mauvaises, ont commandé et accepté de telles choses ?
Et ils ont commandé et ils ont accepté pis encore. Sans parler de la Vierge en fonte peinte de l’esplanade, auréolée d’un cercle d’amandes électriques et dont la tête de raie, aux yeux laiteux et aux joues livides, est celle d’une démente évadée d’un asile, il faut, si l’on veut voir jusqu’où peut atteindre l’acuité du laid, grimper les lacets du coteau des Espélugues où l’on a commencé à planter un chemin de croix. Une station y est posée sur un tertre, entouré d’arbres.
Ici, les invectives défaillent. Imaginez des statues détachées d’un chemin de croix de la rue Bonaparte ou de la rue Saint-Sulpice, devenues deux fois plus grandes que nature, et campées en plein air et se découpant sur le ciel, en plein jour.
Au centre est assis un bonhomme dont la face glabre serait celle d’un fond de culotte si elle n’avait deux yeux et, autour de cette poupée de taille démesurée, des comparses aux traits fades et secs, aux gestes pétrifiés, cernent une statue, debout, vêtue d’une robe blanche, avançant le visage régulier de la sydonie masculine, de l’une de ces sydonies à teintures, représentée dans des tableaux d’annonces, avec une barbe blanche d’un côté et noire de l’autre. — Cela représente Notre-Seigneur devant Pilate ! — Figurez-vous encore, pour animer le champ immobile de ces fantoches morts, des paysannes vivantes et ahuries qui, ne voyant tout d’abord que le Pilate assis, bien en évidence, hors des groupes, le prennent de bonne foi pour le Christ, vont à lui, l’embrassent et lui font toucher leurs chapelets. Et vous aurez un vague aperçu de cette odieuse mascarade des Écritures !
Cette station du Calvaire est la seule qui, actuelle. ment, existe. Un brave curé me racontait que l’argent manquait pour édifier les autres et il paraissait croire que l’on réunirait difficilement la somme nécessaire pour commander la suite de ces stupres divins à Raffl. Qu’il se rassure ! Je ne connaîtrais pas mes catholiques si je doutais, une seconde, qu’ils ne fussent prêts à se laisser héroïquement dépouiller pour la joie de parfaire une telle oeuvre !
Évidemment, en aucun endroit, en aucun pays, en aucun temps, l’on n’a osé exhiber d’aussi sacrilèges horreurs et si l’on songe qu’elles ont été façonnées exprès pour Lourdes, fabriquées exprès pour Notre-Dame, l’on en vient à tirer d’un pareil spectacle un enseignement.
A n’en pas douter, de tels attentats ne peuvent être attribués qu’à des facéties vindicatives du démon. C’est sa vengeance contre Celle qu’il abhorre et on l’entend très bien lui dire :
Je vous suis à la piste et partout où vous vous arrêterez, moi je m’établirai vous ne serez jamais débarrassée de ma présence vous pourrez avoir à Lourdes toutes les prières qui vous plairont, vous pourrez vous croire revenue aux beaux temps du Moyen Age ; les foules afflueront auprès de vous ; les hourras des miracles, les Magnificat des guérisons, les roulements ininterrompus des rosaires, vous encenseront comme nulle part ailleurs, c’est possible ; en un siècle que je malaxe et pervertis à ma guise, vous découvrirez peut-être même de la sainteté dans les âmes éparses à vos pieds, c’est encore possible ; mais l’art, qui est la seule chose propre sur la terre après la sainteté, non seulement vous ne l’aurez pas, mais encore je m’y prendrai de telle sorte que je vous ferai insulter sans répit par le blasphème continu de la Laideur ; et j’obnubilerai à un tel point l’entendement de vos évêques, de vos prêtres et de vos fidèles, qu’ils n’auront même pas la pensée d’écarter de vos lèvres le calice permanent de mes injures ! Tout ce qui vous représentera, Vous et votre Fils, sera grotesque ; tout ce qui figurera vos anges et vos saints sera bas. Vous constaterez aussi que je n’ai rien omis ; j’ai même songé aux objets du culte, à ceux qui touchent surtout à la chair même du Christ ; je me suis spécialement occupé des monstrances et des ciboires et j’ai voulu qu’ils fussent d’un goût somp. tueux, atroce. L’abomination singulière pourtant de la bijouterie religieuse de l’Europe ne m’a pas suffi ; vous y étiez habituée peut-être ; j’ai trouvé mieux ; j’ai requis les rastas de l’Amérique du Sud et ils m’ont compris. Je suis vraiment satisfait des articles effrayants qu’ils vous offrirent. Ah ! les pièces de votre trésor de Lourdes, ce que je les ai, moi-même, une à une, choisies !
Et ces paroles s’attestent d’une déconcertante vérité, quand on considère l’esthétique de Lourdes !
L’art est, en effet, un don particulier que l’homme emploie à sa guise, bien ou mal, mais qui n’en garde pas moins, si profane qu’il soit, le caractère divin d’un don. Il est, sous des apparences variées qui atteignent l’âme et affectent les sens, la reproduction du Beau unique et multiforme comme la divinité même qu’il représente un peu, dans son faible miroir, car le Beau infini, inaccessible à l’être déchu, est identique à Dieu même.
Et Lamennais qui se sert de termes à peu près semblables pour définir l’art conclut : « Le Beau, tel que l’homme peut le reproduire dans son oeuvre, a une nécessaire relation avec Dieu. »
Or, s’il en est ainsi, le contraire est également exact, et le Laid est, lui aussi, en une nécessaire relation avec le démon ; il en est le reflet, comme le Beau est le reflet de Dieu.
Il est donc évident que l’on attribue à Satan ce qui est dû au Christ, lorsque l’on portraiture Jésus et la Vierge en d’immondes images ; l’on fait, dans tous les cas, son jeu ; l’on pratique, en quelque sorte, un acte de magie noire, en rendant hommage au Maudit, lorsque, renversant les rôles, transformant en effigies infernales les effigies divines, l’on dispose, pour sa joie, les ridicules personnages usités dans nos chemins de croix.
La laideur, l’atechnie, l’inart, dès qu’ils s’appliquent à Jésus, deviennent fatalement, pour l’homme qui les commet, un sacrilège.
La plupart des catholiques, heureusement pour eux, ne savent ce qu’ils font, car l’Esprit du mal use de prémotion et ne révèle pas à ceux qu’il incite ses desseins. Il se borne à utiliser la vilenie de la nature humaine et son peu de foi ; il agit, par l’intermédiaire des curés des campagnes et des villes qu’il aveugle et dont il accroît la vulgarité native du goût ; il s’installe à demeure, pour les servir, dans les officines du quartier Saint-Sulpice et là, il inspire ses tenanciers de la prostitution divine et organise, avec leur concours, le carnaval de la Jérusalem céleste, la chienlit du ciel.
Ah ! si l’on exorcisait ces ateliers de bondieusarderies, ce qu’il en sortirait des larves !
Le résultat le plus clair de cet état de choses est que tout individu qui fabrique, que tout individu qui vend, que tout individu qui achète des produits de ce genre est un possédé inconscient.
Les prêtres devraient y réfléchir et songer aussi combien l’élément juif domine maintenant parmi les débitants d’objets de piété. Convertis ou non, il semble bien qu’en sus de la passion du gain, ces négociants éprouvent l’involontaire besoin de retrahir le Messie, en le vendant sous des aspects soufflés par le démon.
L’argument qu’invoquent certains catholiques plus compréhensifs que les autres, pour excuser cette outrance de la laideur qui sévit à Lourdes, est vraiment débile. Ils feignent de croire qu’elle est indispensable pour plaire au peuple et attirer les foules. D’abord, il n’a jamais été démontré que le peuple aimât le laid de préférence au beau ; il ignore ce qu’est l’un et ce qu’est l’autre et voilà tout ; il s’enthousiasmerait aussi bien pour une belle oeuvre, si on la lui montrait, que pour une laide ; mais en fait de nutriment et de breuvage artistiques, on ne lui sert, sous couvert de religion, que de la ratatouille de cantine et de la ripopée !
Et puis, est-ce qu’au Moyen Age les cathédrales n’ont pas été construites pour lui ; est-ce que les statues, les tapisseries, les retables, toutes les oeuvres magnifiques qui parent maintenant nos musées, n’ont pas été créées pour rehausser, à ses yeux, le prestige de l’Église et l’aider à prier ?
Il les admirait de bonne foi et il comprenait très bien que cette splendeur était, par elle-même, un hommage rendu à Dieu et une supplique. Sans doute, son niveau a baissé depuis... il ne sait plus... mais à qui la faute, sinon au clergé qui avait charge de l’instruire et qui l’a, par son ignorance et son dédain de toute esthétique, ramené à son état primitif d’indifférence.
Lourdes est donc le parangon de la turpitude ecclésiale de l’art et il est, dans son genre, unique ; et pour que rien ne manque à l’oeuvre scélérate que le Malin y joue, les soirs de grande fête, on illumine la façade et le clocher de la basilique, avec des ampoules électriques tricolores et l’on dessine en traits de feu la tourte du Rosaire qui ressemble alors à une rotonde en pain d’épices, anisée de grains roses.
Il ne resterait, en fait de divertissements pour voyous, qu’à tirer un feu d’artifice sur la montagne du chemin de croix et peu s’en est fallu que cette dernière avanie ne fût commise. Un soutanier, venu de je ne sais quelle province, y avait si bien songé que l’on eut toutes les peines du monde à l’empêcher d’en allumer un.
Il n’en est pas moins vrai que, même sans fusées et sans bombes, les fêtes liturgiques de Lourdes res semblent aux fêtes civiques du 14 juillet ; n’y ai-je pas entendu des fanfares de cuivre et des Ave Maria soufflés dans des pistons et des trombones ? Je crois avoir, ce soir-là, souffert.
Ce pays où triomphe l’odieux spectacle de cette bravade de la beauté divine est d’ailleurs devenu, depuis que la Vierge s’y fixa, une sorte de camp, sillonné par les grand’ gardes du démon.
A vrai dire, cette grotte de Massabieille lui appartenait, car c’était un lieu désert et mal famé où personne ne s’aventurait. Ses seuls hôtes étaient deux espèces d’animaux qui faisaient, l’un et l’autre, partie du bestiaire infernal au Moyen Age : les serpents qui gîtaient dans ses crevasses et les pourceaux qui s’y abritaient, alors que Paul Leyrisse, le porcher du village, les menait paître sur les rives du Gave.
Marie balaya cette fange vivante en se montrant ; mais pour salir de nouveau cette grotte, Satan la fit, pendant la période même des apparitions, souiller la nuit par des ébats de couples ; « on a fait des sottises à la grotte », disaient les paysans qui n’ignoraient pas ces scandales ; puis il s’attaqua à Bernadette même, en extase, qui entendit derrière elle, sortant du Gave, des hurlements sauvages et des cris furieux lui ordonnant de se sauver ; enfin, il tenta d’amoindrir les révélations de l’enfant en suscitant des visions plus ou moins bizarres à un groupe de possédées dont les divagations essayèrent de troubler la confiance des habitants.
Mais bientôt le bon sens revint et Bernadette fut écoutée ; alors il changea de tactique et il attisa la passion du gain chez ces carriers qui se transformèrent en hôteliers, en marchands de chapelets et de cierges et dévalisèrent à qui mieux mieux, les pèlerins.
Et, après l’argent, ce fut la chair. Bientôt les moeurs de ces montagnards qui étaient honnêtes, lorsqu’ils étaient pauvres, se dévergondèrent ; puis ce fut l’indécent appoint des étrangers ; des liaisons impossibles dans des petites villes où chacun s’observe purent s’épanouir dans la promiscuité de ces immenses foules où l’on passe inaperçu ; ce fut, dans le hourvari des grands pèlerinages, la facilité des rencontres, l’impunité absolue des rendez-vous...
Satan put se réjouir — mais il n’obtenait, en somme, que des péchés communs, que des fautes inhérentes à la misère humaine ; il ne produisait que des oublis momentanés, que des offenses passagères que la pénitence efface.
Il voulut davantage, rêva de forfaits plus profonds et plus tenaces et c’est alors qu’il manoeuvra, sous le manteau de la piété, et qu’il instaura le blasphème permanent, en implantant la laideur sacrilège à Lourdes.
Et c’est par cet atroce moyen — qu’il faut divulguer à la fin, pourtant — que le vieux serpent nargue Celle qui lui écrase la tête et la mord quand même au talon !