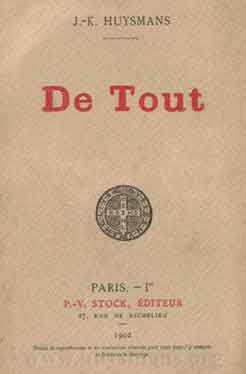��������������������������������������������������������������������A LA GLACIÈRE
J’Al voulu. savoir ce qu’était devenu le petit couvent de Franciscaines dont j’ai parlé dans En Route et j’ai refait, après bien des années, le long chemin que je suivais jadis pour atteindre la rue de l’Ebre. J’ai retrouvé cette mélancolique rue de la Santé si particulière avec ses bâtisses d’inégale hauteur qui cachent et laissent voir, tour à tour, des pans de ciel, ses longs espaces de murs qui séparent sea maisons, ses têtes d’arbres qui remuent au-dessus des toits ; elle n’a pas changee : d’un côté, la prison de la Santé et, au bout, l’asile des aliénés de Sainte-Anne ; de l’autre, des cloîtres. D’abord, en partant du boulevard de Port-Royal, un hôpital desservi par des religieuses de Saint-François et, attenant à cet hôpital, le couvent des Capucins, une bicoque grise, éclairée par des fenêtres de voitures cellulaires, un couvent d’un aspect funèbre, tenant, à la fois, de l’usine et de la geôle, dominé par une chapelle blanche et froide que précède une énorme croix couleur de pain d’épice, plantée dans une cour ; à quelques pas, ensuite, le domaine à l’allure grave et joyeuse des Augustines. Mais, il faut bien le dire, ici les physionomies des maisons mentent. Il semble, en effet, que les âmes conventuelles soient passées d’un corps dans l’autre, car la gaieté qui est l’essence même de la vie intérieure des Franciscains s’épanouit dans le lieu le plus morose et le plus triste, tandis que cette avenante façade des Augustines, cet extéricur de bon vieil hôtel, égayé par les arbres d’un ancien parc, cèle, derrière son sourire, les plus effrayants des maux. Ce monastère est un établissement Saint-Jean-de-Dieu pour femmes, un asile pour gens riches, où se pratiquent les opérations de la grande chirurgie et, constamment, les chambres de souffrances sont pleines !
Plus loin, en longeant toujours le même trottoir, juste en vis-à-vis de la prison, l’on arrive devant une sorte de cabane ou de resserre, dans laquelle les Franciscaines de l’Immaculée-Conception de Lons-le-Saunier ont installé, tant bien que mal, quelques soeurs et recueilli une quarantaine de gosses oubliés par leurs familles dans des coins de portes ; et la rue continue, solitaire comme un chemin de province, s’arrête, un instant, coupée par une autre voie, au coin de laquelle se dresse une bâtisse surmontée d’un belvédère peint en blanc et d’une croix ; — c’est là que gîte la congrégation enseignante des Fidèles Compagnes de Jésus, — et la rue de la Santé débouche au point de suture du boulevard Saint— Jacques et du boulevard d’Italie.
Alors l’aspect du quartier diffère.Il était triste et pénitentiel, pieux et discret, et il se fait sinistre et il devient canaille. En face de nous s’ouvre la grille, pavoisée du drapeau national, de la clinique des fous, puis, en obliquant un peu sur la gauche, la rue de la Santé reprend, interminable, bordée, à droite, par les murs de Sainte-Anne, à gauche, par des haies de maisons, des hangars crasseux, des vacheries en chambre, des métairies borgnes, des marchands de vins.
L’allure misérable des bouges s’accentue, la tristesse des plâtres s’aggrave; une population de femmes informes, d’enfants avec des joues barbouillées et des boules de pissenlits écloses au-dessous du nez grouillent sur les trottoirs, braillent dans des fonds de cours. J’arrive enfin à la rue de l’Ebre : elle est toujours la même ; quelques rides, quelques lézardes de plus dans la pâte sale de ses murs et c’est tout. J’aperçois ma petite chapelle dont le clocher est resté nain, car il ne dépasse toujours pas la hauteur d’un premier étage, mais les portes sont fermées ; je secoue la sonnette du petit cloître qui l’avoisine et rien ne répond ; une femme qui m’inspecte, d’un air défiant, sur le seuil d’un mannezingue, finit par m’apprendre que l’église est désaffeetée et que les Franciscaines logent maintenant dans l’impasse Reille.
Je repars, et, chemin faisant, je repense à ce quartier de la Glacière qu’autrefois j’explorai dans tous les sens. Il est bien demeuré ce qu’il fut, le purgatoire de notre ville ; l’image de l’expiation s’y montre à chaque pas : ici, les hideuses constructions d’une maison de force, les cachots d’un asile d’aliénés et les salles de torture des tanneries et des usines ; là, les couvents qui tentent d’alléger la vie de l’indigent et prennent à leur compte ses fautes. Ils s’échelonnent le long des voies, dessinent un cordon sanitaire dans cette paroisse où plus de 39.000 habitants gagnent leur mort en travaillant. A deux minutes de la prison, rue Méchain, ce sont les soeurs de Saint-Joseph de Cluny ; pas bien loin encore, ce sont les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, les soeurs servantes des pauvres d’Angers, l’oeuvre de Sainte-Rosalie, des patronages ; enfin, l’hôpitat Saint-François, tenu par des Franciscaines de Calais, un petit hôpital de 40 lits, dû à la charité d’un Tertiaire. Le nom du Père Séraphique revient constamment lorsqu’on veut s’occuper de ce quartier ; ses enfants y campent, en effet, sur tous les points, et cela se conçoit, car leur place est dans ces districts immenses que personne n’assiste, là, en plein peuple, dans le plus misérable des faubourgs.
Les Franciscaines missionnaires de Marie, que je vais revoir, forment l’avant-garde de la petite armée ; elles bivaquent sur un sol perdu, en un pays à peine civilisé, dans un cul-de-sac bâti d’un seul côté. Au fond, le remblai du chernin de fer ; à droite, des terrains vagues derrière lesquels apparaissent les derniers pavillons de Sainte-Anne ; à gauche, des buttes neuves, d’un éclat cru, et une boîte rectiligne, une sorte de caserne utilitaire, dont les croisées ont des vitres dépolies jusqu’à mi-corps. C’est dans ce lieu qu’elles résident. J’entre, je traverse un jardinet enfoui sous la neige et la tourière m’introduit dans l’auditoire, l’étemelle pièce officielle des collèges pieux, avec des cloisons blanches et des tableaux de sainteté, des chaises de paille et une table ronde dont un tapis éteint cache le bois. Ce parloir présente cependant cette particularité qu’au lieu du tableau d’honneur une immense vitrine monte du plancher jusqu’au plafond et contient des bannières de velours à franges d’or, des ouvrages d’aiguille, des broderies d’étoles, des fleurs d’église, l’exposition des produits fabriqués par l’école professionnelle que les nonnes dirigent.
La supérieure, assistée d’une religieuse, entre et me souhaite la bienvenue ; elles ont toujours ce costume un peu théâtral mais charmant, qui fait de la femme une statue animée de neige ; la coiffe, l’habit, la ceinture, le voile, le chapelet, les souliers, tout, jusqu’aux visages émaciés des mères, est blanc. Je m’assieds et nous évoquons les souvenirs de la rue de l’Ebre, l’effrayante détresse dans laquelle elles vécurent, le réfectoire qui était une ancienne étable et avait conservé sur ses murs fleuris de salpêtre ses vieilles auges, le dortoir où l’on ouvrait des parapluies, parce que l’eau coulait du toit sur les couches. Elles étaient alors plus miséreuses que ceux qu’elles voulaient secourir ; et, comme je les félicite de leur nouvelle installation, elles se mettent à rire, me racontent qu’en même temps que l’on fermait la chapelle de secours de la Glacière, elles avaient dû abandonner, par crainte d’accidents, leur refuge qui tombait en ruines, s’installer, n’importe comment, dans des bâtisses inachevées, faute d’argent, instaurer dans une salle quelconque un sanctuaire pour y continuer l’adoration du Saint-Sacrement, établir un dispensaire pour les malades du dehors, organiser la visite des pauvres à domicile, monter une école primaire et professionnelle, préparer l’oeuvre des baptêmes, des catéchismes, des premières communions, fonder un patronage pour les jeunes filles, remplir enfin l’office d’une crèche qui manque dans le quartier, en gardant, en nourrissant, en instruisant pour rien tous les enfants dont les mères travaillent dans les usines. Et la Mère supérieure ajoute en soupirant : « Tout cela fonctionne, mais petitement ; dans cette paroisse déshéritée, les besoins sont énormes et nos ressources sont nulles. »
— Et vous avez, à l’heure actuelle, combien d’enfants, à nourrir et à éIever ?
— Deux cents, tant petits garçons que petites filles. Voulez-vous les voir ?
Et me voici parti, à la suite des deux soeurs, pour visiter les classes. Nous franchissons des corridors blancs, percés de portes chocolat, et derrière elles je vois des ribambelles de gosses, assis devant de minuscules pupitres, qui me regardent, ébahis, tandis que les nonnes, dont j’interromps le cours, s’inclinent ; et, à mesure que les portes s’ouvrent, les bambins et les bambines grandissent et les pupitres poussent. Quand nous arrivons aux cours professionnels de jeunes filles, la croissance des objets et des êtres pour lesquels ils furent fabriqués cesse. Nous revoici dans le dédale des couloirs et nous aboutissons à une vaste salle dont tout le fond est occupé par des gradins. Une porte est à gauche et une autre, à droite ; et là où je suis, tournant le dos aux fenêtres, en face de cet escalier qui ne mène à rien, des chaises sont alignées près d’un piano. Une jeune religieuse plaque quelques accords, entame une marche très rythmée, les deux portes s’ouvrent et, aux sons des castagnettes, martelant le rythme, une procession de gamins s’avance d’un côté et une procession de gamines, de l’autre. Tous marquent le pas, montent, se déroulent en lacets, sur les gradins. Le piano se tait et tout s’arrête. Alors commencent les exercices de la classe ; la musique reprend ; les enfants font des mouvements, d’assouplissement de corps, en même temps qu’ils récitent des devoirs ou chantent des prières, se servent de balles, de différents jouets, selon la nature de la leçon que la maîtresse explique. C’est la méthode Froebel, un système d’éducation très usité en Angleterre et en Allemagne, en Belgique et en Suisse, un système qui développe en même temps l’esprit et le corps, qui tire d’une série de joujoux des points de comparaison, des remarques, des enseignements utiles, qui change les classes en des récréations, qui intéresse l’enfant, tout en tenant compte de son besoin de remuer, qui l’instruit, en un mot, en l’amusant.
Il y a tout un côté de bonne grâce, de douceur vraiment maternelle dans cette façon dont les Franciscaines traitent ces pauvres mômes qui, apès s’être divertis, pendant le jour, sen iront retrouver, le soir, l’abominable taudis où un père aviné cogne ! Je songe a cela, en scrutant le visage pointillé de ces mioches. Les garçons sont mastoques, ils ont des airs têtus, des mines basses de petits bouchers et d’aides marchands de vin. On lit dans les yeux, dans les coins des bouches, des intelligences rétives, des instincts de brutalité qui doivent infliger à la patience des soeurs de longs tourments ; mais les filles paraissent plus malleables, sont, en tout cas, plus curieuses. Engendrées dans les plus misérables des bouges, elles sont vieilles à dix ans ; elles ont déjà la physionomie de leur trentième année et leur face de femme mûre est prête ; et cependant, si elles sont mal toumées, mal fagotées, bâties à la grosse, elles sont quand même gentilles, avec leurs frimousses bien propres, leurs tabliers repassés, leur mine contente. On se doute bien que, chaque matin, les Franciscaines nettoient cette marmaille que les parents n’ont pas le temps de soigner, car c’est ici la note dominante de la maison, la propreté ; on l’aperçoit, on la suit, des vitres jusqu’aux planchers, des cheveux lissés des enfants jusqu’au bas rapiécé des robes.
Il ne me reste plus qu’à pénétrer dans la chapelle et c’est une veritable joie que j’éprouve en y entrant, car je suis dans le petit oratoire de la rue de l’Ebre. On dirait, en effet, que les religieuses ont emporté avec elles l’ancienne église et l’ont réinstallée dans leur pauvre salle ; c’est la même indigence, la même décoration de village, la même allure de campagne et aussi le même côté de sanctuaire nalf et pieux !
Devant l’autel, comme jadis, deux soeurs à genoux, enfouies sous des voiles, adorent le Saint-Sacrement. Notre-Seigneur a suivi ses filles en leurs étapes et s’est installé avec elles dans leur nouveau logis. Dans ce coin abandonné de ville, en cette ingrate paroisse privée d’églises. Il est là à demeure, choyé par ces nonnes qui font prier ces enfants pour leurs parents et qui prient elles-mêmes pour tous ceux qui ne le font point. Et je me dis que vraiment ces ordres religieux sont étonnants ! Un couvent apprend qu’il existe, dans certaines rues, des enfants qui traînent, délaissés, des ouvriers sans le sou qui sont malades, et il prend aussitôt une poignée de ses vierges et les essaime dans les parages de ces rues. Seulement, c’est à elles à lever et à fleurir, car la maison-mère ne subvient qu’avec peine à ses propres besoins ; mais il y a des terres plus ou moins friables, et le sol de la Glacière est dur. Les belles dames qui s’occupent dans leurs salons d’oeuvres, qui organisent des pouponnières pour discours, de l’Institut, des couveuses et des nurseries pour la frime, les belles dames qui s’occupent de bazars charitables et de loteries connaissent surtout le pauvre, de très loin, et par ouï-dire. Elles devraient bien aller s’assurer, par elles-mêmes, de la détresse de ce quartier ; peut-être auraient-elles alors l’idée d’aider ces braves religieuses à parfaire leur accablante tâche !
Et je songe, rentré chez moi, à ces Franciscaines que j’ai revues après tant d’années, aussi dévouées aux petiots et aussi pauvres, et des détails que j’ai naguère lus sur elles dans un très intéressant livre du P. Norbert me reviennent.
Leur début dans la vie fut déroutant. Elles forment une congrégation pour les missions étrangères et se distinguent des autres par cette singularité qu’au lieu d’avoir été créées en Europe pour aller évangéliser les Indes, elles sont nées dans les Indes et sont revenues de l’Asie pour évangéliser l’Europe. Elles ont été fondées en 1877, à Ootacamund, ville située dans la présidence de Madras, et leur communauté compte actuellement 35 maisons ainsi réparties : 10 en Asie, 2 en Amérique, 4 en Afrique et 19 en Europe ; 4 noviciats, l’un aux Châtelets, près de Saint-Brieuc, le second à Grottaferrata, près de Rome, un troisième au Portugal et un quatrième au Canada, suffisent à assurer le recrutement. En France, elles ont 8 maisons, dont 2 dans le département de la Seine, une à Vanves et une autre dans cette impasse Reille où elles sont au nombre de soixante-dix. Quant à leur vie, elle s’ordonne ainsi, en dehors des heures de classe, des visites aux pauvres et des offices : elles se Ièvent à cinq heures et se couchent à neuf heures et demie, dorment sur une simple paillasse, mangent ce qu’on leur apporte, vivent, en somme, de la charité pour la faire, à leur tour, aux autres.