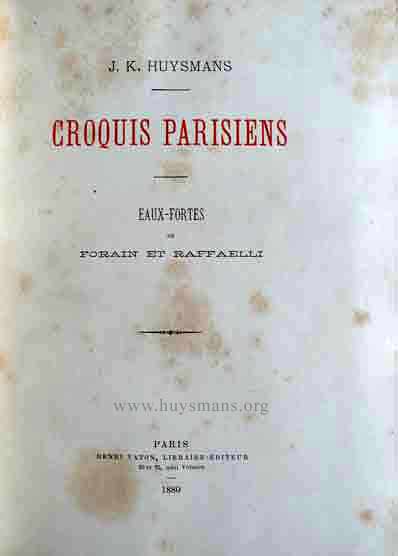Près d’une gare de chemin de fer, à l’angle d’un square, se trouve un musée d’histoire naturelle où l’on joue et où l’on boit.
L’endroit est somnolent et placide. C’est le café d’abonnés, sans clients de passage, le café dont la porte ne s’ouvre que sur des visages connus qui provoquent, dès leur entrée, des hourras et des rires ; c’est le café où dix rentiers réunis tous les soirs autour d’une table échangent, en battant les cartes, de médiocres aperçus sur la politique et s’intéressent longuement aux grossesses de la patronne et de la chatte ; c’est l’estaminet où chacun possède une pipe avec son nom émaillé, une pipe de jour de l’an offerte par le garçon qui dormasse, d’invariable mémoire, le nez sur un journal et jette un piteux et traînant « voilà » quand on lui commande un nouveau bock.
L’aspect de la salle est étrange ; au-dessus de divans à boutons, capitonnés de cuir chocolat, deux vitrines aux boiseries grises, rechampies de filets bleu pâle, se dressent le long des murs, bondées du haut en bas d’oiseaux empaillés et repeints.
L’une d’elles, située en face de la porte d’entrée, contient dans son rayon du bas des cygnes au bec de bois jaune, aux ventres crevant de foin, aux cous rétrécis, inégalement bourrés, dessinant des S blanches et des ibis sacrés, aux pattes ciragées à tour de brosses, aux têtes de ce rouge sale qu’a la confiture de groseille bue par le pain.
Puis, sur les planches échelonnées jusqu’en haut, s’étage une tiolée d’oiseaux, des grands, des moyens, des petits, des tortus, des bancroches, des droits, des volatiles aux airs de bons enfants ou de mauvais bougres tendant des becs courbés en fer de pioches, allongés en pointes de clous, des becs simulant des canules et des pinces à sucre, et tous ont le même oeil en cocarde, orange et noir, le même regard idiot et fixe, tous ont des habits couleur de muscade et de poivre, des plumages atrocement fanés, des dégaines bêtement satisfaites d’acteurs.
Vue de près, la large et lugubre tache que jette dans les armoires vitrées cet assemblage de teintes mornes montre, en se décomposant, rangés sans distinction d’amitié et de caste, dans une promiscuité de misère et de vermine, des combattants aux nez en becs de seringues, regardant avec des mines hargneuses et chipies de petites cailles, l’oeil au ciel, implorantes et douces, égarées dans des dynasties de barges rousses et de bihoreaux, dans des familles entières de hérons attendant on ne sait quoi, fichés sur une patte, rêvant peut-être à d’invraisemblables poissons empaillés comme elles.
Trois oiseaux essaient pourtant de rompre la pleurarde harmonie de ce tableau avec leurs plumes qui vibrèrent jadis de tons vifs : un oisillon d’un soufre sali qui a perdu son étiquette, un rollier figé tout gambadant dans son costume d’un affreux vert passé et un faisan sentimental et lyrique, l’or et le feu de ses plumes éteints.
En dépit de la triste et burlesque allure de ses hôtes, uniformément campés en rang d’oignons, au port d’armes, les pattes trop vernies, collées sur des plateaux de bois noir ou perchées sur des branches ornées de fausse mousse, cette vitrine contraste magnifiquement avec l’autre qui semble le décrochez-moi-ça d’une oisellerie de mélodrame.
Là, en effet, s’accumule sur une série de planchettes tout un ramas de bêtes sinistres et laides, des groupes de hiboux, ensevelis sous des couches de poussière, courbant des becs en sécateur, fronçant des ailes couleur d’amadou et de cendre, des chouettes nébuleuses, prétentieusement étiquetées sous le vocable latin « Strix nebulosa », des chouettes de l’Oural, avec des airs réfléchis d’aveugles, des grands ducs aux faces narquoises et féroces, des corbeaux mélancoliques et abêtis, des gentlemen râpés, grelottant sous leurs minces habits de plumes noires.
Un peu plus haut, ce cimetière de volatiles se complète encore d’un lot de bêtes qui ont dû traîner à la salle des ventes, d’un paquet acheté dans une faillite, de choucas et de corneilles, plus aimables et plus mondains, regardant dégoûtés leur voisinage, une société de vieux milans, désossés et bougons, se prélassant dans leurs loques mangées aux mites, un clan de faucons aux allures de chenapans et de matamores, de busards aux grimaces de grincheux et de pète-sec.
Et le patron de cet établissement, l’inventeur de ce café-museum, semble avoir été poursuivi par une îdée fixe ; non content d’avoir bourré ses armoires de carcasses d’oiseaux conservés dans des aromates et dans du camphre, il a encore décoré ses fenêtres de stores jaunes pareils à du sparadrap dégommé, arborant, par hasard sans doute, les armes de la ville de La Haye : une cigogne tenant un serpent dans le bec ; il a enroulé autour des colonnes de son estaminet des pythons vernissés et gonflés d’étoupe, tapissé son plafond de vagues esturgeons fixés à des crochets, de grands poissons plats, semblables à d’énormes peignes et enfin, comme oeuvre de choix, d’un vieux crocodile, les pattes écartées, la gueule ouverte, retapée avec du cuir de bottes, sans bouts de chicots ni dents, envahie par une armée de mouches qui manoeuvrent et fientent, cavalcadant entre les semelles de cette mâchoire.
L’étonnement du garçon que des curieux consultent sur la provenance et sur la raison d’être de ce café est extrême. Croyant qu’on se moque de lui, il garde le silence d’abord, puis se rendant compte de l’innocence des gens qui-l’interrogent, il répond, apitoyé et méprisant : oh ! il y en a un bien plus beau à Bar-le-Duc !
Et, satisfait de cette réponse, l’on embrasse d’un dernier coup d’oeil, en achevant de vider son verre, la laideur de toutes ces livrées d’oiseaux, n’éprouvant aucun désir d’aller visiter Bar-le-Duc, songeant simplement devant ces tables de vieux rentiers, figés le nez sur leurs cartes, immobiles et comme conservés dans ce milieu funèbre, à un Versailles de pacotille, à une Égypte de camelote, à une nécropole de volailles et d’hommes.