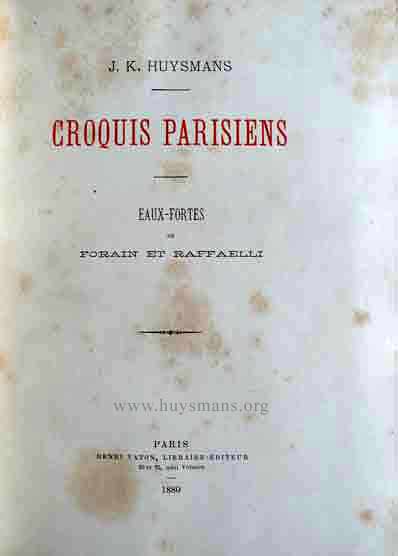A JULES BOBIN
Pour les gens qui haïssent les bruyantes joies retenues toute la semaine et lâchées dans Paris, le dimanche ; pour les gens qui veulent échapper aux fastidieuses opulences des quartiers riches, Ménilmontant sera toujours une terre promise, un Chanaan de douceurs tristes.
C’est dans l’un des coins de ce quartier que s’étend la si extraordinaire et si charmante rue de la Chine. Encore qu’elle ait été tronquée et mutilée par la construction d’un hôpital qui ajoute le douloureux spectacle des souffrances humaines errant au-dessus de la route sur des préaux sans arbres et sans fleurs, à l’aspect discret et recueilli de ses maisonnettes encloses de palis et de haies, cette rue a néanmoins conservé la joyeuse allure d’une ruelle de campagne tout enluminée par des jardinets et par des bicoques.
Telle qu’elle existe encore, cette rue est la négation de l’ennuyeuse symétrie, l’opposé du banal alignement des grandes voies neuves. Tout va de guingois chez elle ; ni moellons, ni briques, ni pierres, mais de chaque côté, bordant le chemin sans pavé creusé d’une rigole au centre, des bois de bateaux, marbrés de vert par la mousse et plaqués d’or bruni par le goudron, allongent une palissade qui se renverse, entraînant toute une grappe de lierres, emmenant presque avec elle la porte visiblement achetée dans un lot de démolitions et ornée de moulures dont le gris encore tendre perce sous la couche de hâle déposée par des attouchements de mains sucessivement sales.
C’est à peine si la maisonnette à un étage perce sous sa cannetille de vigne vierge dans un fouillis de valérianes, de roses trémières et de grands soleils dont les têtes d’or se dépouillent et montrent de noires calvities, pareilles aux ronds des cibles.
Puis, c’est invariablement derrière la haie des planches un réservoir en zinc, deux poiriers reliés par des ficelles, pour le linge et un bout de potager avec des courges aux fleurs d’un jaune clair, des carrés d’oseille et de choux que dentellent et quadrillent avec leurs ombres des vernis du Japon et des peupliers.
Et la rue va ainsi, laissant à peine entrevoir par de vertes éclaircies des bouts de toits violets et rouges ; elle va plus resserrée à mesure, se démanchant, se tortillant, grimpant, plantée, çà et là, de vieux réverbères à huile, jusqu’à la navrante et interminable rue de Ménilmontant.
Dans cet immense quartier dont les maigres salaires vouent à d’éternelles privations les enfants et les femmes, la rue de la Chine et celles qui la rejoignent et la coupent, telles que la rue des Partants et cette étonnante rue Orfila, si fantasque avec ses circuits et ses brusques détours, avec ses clôtures de bois mal équarri, ses gloriettes inhabitées, ses jardins déserts revenus à la pleine nature, poussant des arbustes sauvages et des herbes folles, donnent une note d’àpaisement et de calme unique.
Ce n’est plus comme dans la plaine des Gobelins une chétivité de nature en rapport avec l’impitoyable détresse de ceux qui la peuplent ; c’est, sous un grand ciel, un sentier de campagne où la plupart des gens qui passent semblent avoir mangé et avoir bu, c’est le coin souhaité par les artistes en quête de solitude ; c’est le havre imploré par les âmes endolories qui ne demandent plus qu’un bienfaisant repos loin de la foule ; c’est pour les déshérités du sort et pour les écrasés de la vie, une consolation, un soulagement qui naît de l’inévitable vue de l’hôpital Tenon dont les hautes prises d’air crèvent le ciel et dont toutes les croisées s’emplissent de figures pâles, penchées sur la plaine qu’elles contemplent avec les yeux profonds et avides des convalescents.
Ah ! cette rue est clémente pour les affligés et charitable pour les aigris, car à la pensée que de pauvres gens sont couchés dans ce gigantesque hôpital aux longues salles pleines de lits blancs, l’on trouve bien enfantines et bien vides ses souffrances et ses plaintes, puis l’on rêve aussi devant ces cottages cachés dans la ruelle à un délicieux refuge, à une petite aisance qui permettrait de ne travailler qu’à ses heures et de ne pas hâter par besoin la confection d’une oeuvre.
Il est vrai qu’une fois rentré dans le coeur de la ville, l’on se répète avec raison peut-être qu’un accablant ennui vous opprimerait dans l’isolement de la maisonnette, dans le silence et dans l’abandon du chemin ; et pourtant, chaque fois que l’on vient se retremper dans la douce et triste rue, l’impression reste la même ; il semble que l’oubli et que la paix cherchés au loin dans la contemplation de monotones plages se trouveraient là, réunis au bout d’une ligne d’omnibus, dans ce sentier de village perdu à Paris, au milieu du joyeux et du douloureux tumulte de ses grandes rues pauvres.