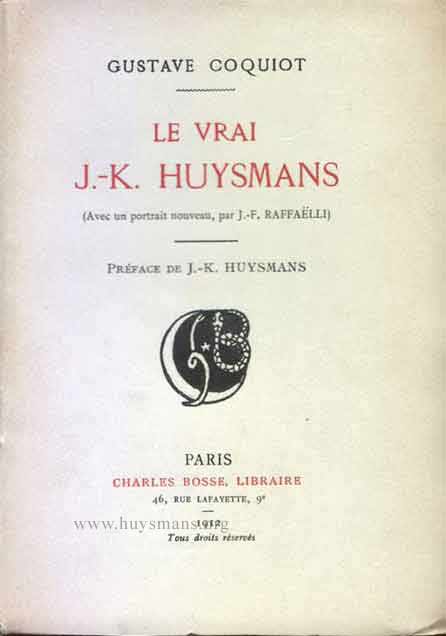QUELQUES MOTS
La lettre de J.-K. Hüysmans ci-après photographié constitue une véritable préface à ce livre que je crois avoir écrit avec sincérité. On voudra bien voir tout au long des pages que j’ai seulement développé les opinions catégoriques énoncées dans cette lettre par le grand écrivain qui nous donna Là-Bas et En Route. Peut-être même ceux qui l’approchèrent trouveront que je suis resté souvent en deçà de la vérité ; mais il était bien impossible tout de même d’en dire davantage, sous peine de rouvrir de trop anciennes et de trop cruelles blessures !
Pour la même raison, je n’ai pas voulu farcir d’anecdotes cet essai biographique. Cela m’eût obligé à nommer bien des gens qu’il convient de laisser dans un définitif oubli. Et aussi il m’a semblé qu’un tel essai devait être simple comme la vie même de Huysmans, qui, plus que quiconque, avait horreur des « confidences » et des « souvenirs ». (On sait que, par un paragraphe de son testament, il a interdit de réunir en volume ses lettres ou ses notes inédites).
Je remercie de tout mon coeur M. J.-F. Raffaëlli, que tant de liens d’amitié unissaient à Hüysmans, d’avoir paré ce livre d’un admirable portrait.
J’adresse également mes plus vifs remerciements à M. Lucien Descaves, exécuteur testamentaire de Huysmans, qui a bien voulu, par une exception dont je lui suis infiniment reconnaissant, m’autoriser à reproduire la lettre d’ordre général qu’on va lire maintenant avec un certain intérêt, je crois.
G. C.
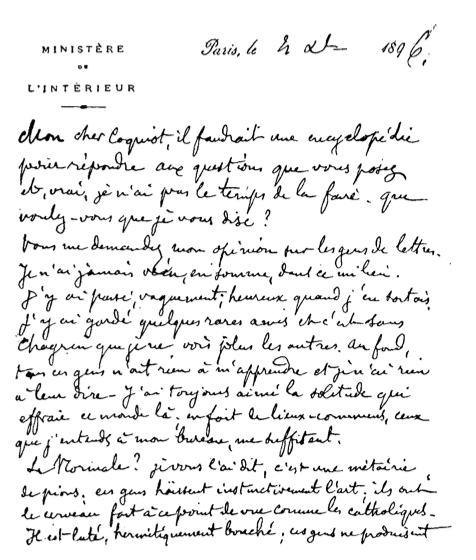
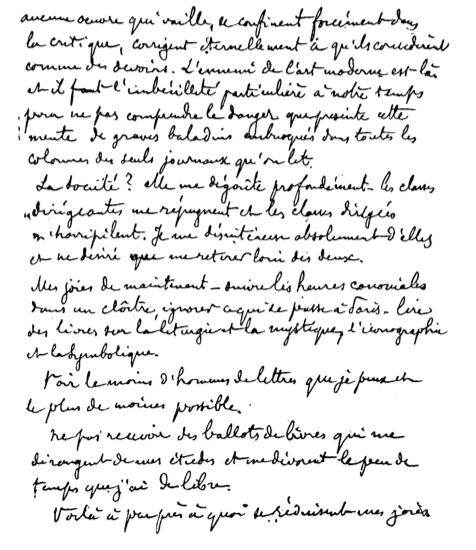
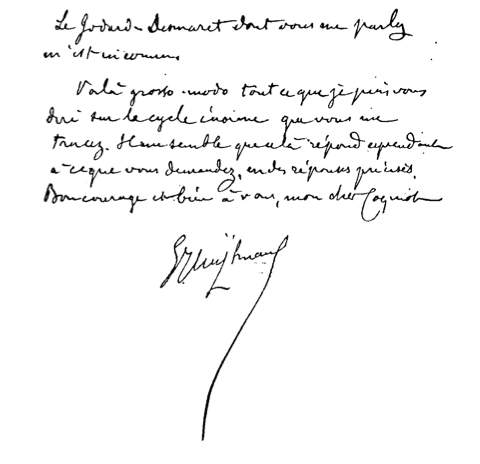
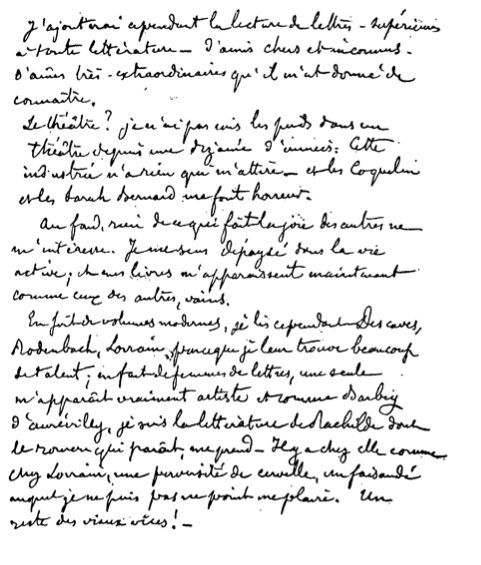
Premiers contacts
ON m’avait dit : « Il n’est pas commode, vous savez, le bougre ! Ne vous laissez pas trop impressionner, car l’accueil, même préparé par quelques mots chaleureux, ne sera pas engageant ! »
Parbleu! je ne m’attendais pas à autre chose. Et avec cela que c’est si plaisant d’être dérangé à tout moment par des gens même bien intentionnés qui vous viennent voir avec une curiosité ambiguë que, d’ailleurs, ils laissent trop bien paraître ! Hüysmans, était, me répétait-on, grincheux, de peu courtoise physionomie ; eh bien ! tant mieux, pour une fois je me trouverais en présence d’un homme de lettres tout à fait conforme à son style, qui n’est pas, lui non plus, très amène et très « ouvert »,
Mais quand irais-je chez l’auteur de cet incomparable et démoniaque Là-Bas qui venait d’affoler des foules entières au point qu’on le pourchassait pour qu’il se fit cicerone de messes noires !
Le soir, ou le matin, avant son départ pour son bureau ?
Cette question-là, je la débattis longtemps.
Le soir, Hüysmans devait écrire ; ou même prendre simplement des notes ; et alors quel accueil, bon Dieu ! serait celui qu’il me réserverait !
Le matin, autre chanson. L’ennui de reprendre tout à l’heure le chemin du Ministère de l’Intérieur ferait peut-être qu’il me recevrait tout à fait mal.
En vérité, j’hésitais, interminablement ; et je crois bien que je ne serais jamais allé à ce No 11 de la rue de Sèvres, où il habitait, si, un soir, passant par la Croix-Rouge, je n’avais pris tout d’un coup la résolution de monter chez lui.
Dès l’entrée, j’eus un émoi en mettant le pied dans cet ancien couvent de Prémontrés, qu’il a si complètement décrit dans son livre intitulé De Tout.
Cet immeuble était, en effet, véritablement noir et silencieux. De places en places, guidant les pas, des lumignons essayaient vainement de percer d’épaisses ombres. J’avais mal choisi, pour m’y reconnaître, cette soirée d’avril de l’année 1892 ; cette soirée si opaque que je ne voyais rien devant moi.
Enfin, voici l’escalier indiqué. Au bas, je m’étonne. Il y a une plaque avec ce libellé : Circulation interdite aux chiens dans l’escalier ; — et s’entre-croisent des treillis de bois vert comme dans les « beuglants » de quartier et dans les « guinches ». C’est amusant ! Mais je me demande : où est-il donc le large escalier dont on m’a parlé, et dans lequel, dira plus tard Hüysmans, « un régiment défilerait à l’aise » ? Ce n’est pas à coup sûr celui où je suis engagé ; et, pourtant, je viens de tout considérer, c’est bien celui-ci qui conduit à l’appartement de l’écrivain. Allons ! montons.
Ah ! oui, l’escalier est étroit, et, comme il est sans tapis, il est rude, avec son bois fortement ciré ! Quels petits paliers aussi ! On a de la peine à s’y retourner. Je pense tout de suite que Monsieur Paul Bourget est sûrement bien mieux logé ! Ce n’est pas tout, du reste : quelles étroites portes également ! Mais il est vrai qu’elles s’ornent toutes d’un guichet de cuivre et d’une boîte à lait accrochée après la poignée !
Ce décor-là, ma foi, m’enhardit un peu. Hüysmans est, peut-être, âpre, me dis-je, en tous cas, il n’est pas présomptueux. Et me voilà arrivé; — et tout doucement j’ai sonné.
J’écoute. J’entends des pas feutrés qui glissent ; et l’on ouvre la porte.
C’est Hüysmans lui-même. Mon courage est très chancelant. Je dis cependant le nom de l’ami qui m’adresse à lui ; et il m’engage à passer dans son cabinet.
C’est très intime, très émouvant, oui, d’un coup ; et, comme l’écrivain ne s’étonne point trop de ma visite, et que je bafouille des excuses saugrenues, je le regarde beaucoup, et je me fais, heureusement pour moi, l’idée à son sujet d’une « personne revenue de bien des choses, pas bavarde, mais aimable et point fâchée, au fond, je crois, de recevoir, de temps en temps, dans sa solitude, un visiteur ».
Hüysmans a écrit cela quelque part ; et il me semble que c’est pour lui, pour se bien désigner.
Ah ! quelle soirée, celle de mon premier contact, quand j’y songe !
Ce que j’étais dans mes petits souliers ! Je connaissais à peu près certes le chapitre des haines de Hüysmans, et celui de ses admirations ; mais, entre ces deux choses-là, à propos d’une réflexion sur rien, je pouvais tout à coup et brutalement chopper, et l’écoeurer sans retour ! Et si encore j’étais tombé sur un causeur ; mais non, Hüysmans paraissait chercher ses mots ; et il y avait des silences qui pesaient étrangement sur moi.
J’allais prendre congé de lui quand le hasard d’un mot le fit « partir ».
C’était à propos des extraordinaires exhibitions d’alors du Sâr Péladan ; j’avais dit innocemment que ce mage était un homme de talent, malgré ses fumisteries !
— Lui, du talent, furibonda Hüysmans, mais il est dénué de tout : c’est un indigent de lettres et d’art, qui s’est raccroché au Vinci comme après une béquille, et qui affole avec sa Rose-Croix des sociétés de toquées ! Quel bon tour, on lui jouerait à celui-là, si on pouvait le prendre, puis lui raser la barbe et les cheveux, car ça, c’est tout son prestige ! Ah ! non, tout de même, en voilà assez, à la fin! » — et Hüysmans rallumait sa cigarette.
Moi, je crus que j’étais perdu auprès de lui après ma malencontreuse opinion ; et je battais, penaud, en retraite, quand il me dit :
— Tenez, voici quelque chose qui dégote son Vinci ! Et il me montrait une photographie du Crucifiement, de Mathaeus Grünewald :
« Hein ! est-ce assez éloquent ? Ça surpasse carrément toutes les peintures du Léonard. C’est autrement vivant et neuf ! On est las de ces Jésus peints comme des petits vieux et de ces Vierges sébacées, plus molles que des vessies de porc. Il faudra cependant que je dise ça tout au long un jour ; car c’est agaçant et épuisant, en somme, d’entendre toujours rabâcher, en fait d’art, les plus dénués lieux-communs et les plus imbéciles opinions. Ah ! si elle connaissait seulement ce Grünewald, toute la clique des critiques d’art ! mais non, ils sont trop crétins, ces gens-là !
Dans la rue, je me dis : Voilà, tu as cherché bien des sujets de conversation, tu n’en as guère trouvé de favorable, tu n’as pas su placer un seul tremplin, et, à ta portée, il y avait celui-ci : le Sâr Péladan et le Vinci ! Mais comment penser que Hüysmans pouvait s’émouvoir d’un tel cliché ! Et j’en restais surpris.
Depuis, je suis revenu souvent rue de Sèvres.
Je n’y suis jamais allé toutefois que sur un mot de Hüysmans. Je ne me flatte pas d’avoir été pour lui un ami indispensable ; mais il me témoignait de la sympathie. Quelquefois, je ne demeurais avec lui qu’un bref moment ; cela suffisait à m’enchanter ! Et pourtant que d’écoeurements j’ai pris là ! Quel mauvais « professeur d’énergie » était cet unique écrivain ! En sortant de chez lui, je n’avais guère envie de travailler ; et encore moins de visiter des gens.
Comme Mallarmé et Hüysmans étaient deux amis qui se rencontraient avec plaisir, j’établissais souvent une comparaison touchant les entretiens que le poète accordait si volontiers.
Quelle différence il y avait entre eux deux ! Autant Hüysmans était âpre et rétif ; autant Mallarmé demeurait courtois et ouvert. Et comme il vous fouettait, celui-ci ! On le quittait avec des envies désordonnées d’écrire et une abondance de pensées qui, malheureusement, disparaissaient vite ; mais comme on avait l’esprit orné ! quelle joie on ressentait !
Cette naturelle verve, Hüysmans s’amusait à la combattre chez son ami ; et rien n’était curieux comme une discussion devant des auditeurs entre ces deux parfaits artistes : l’un, Hüysmans, retors, embusqué, revêche, ayant même provision de mots, mais ciselant des mots féroces, aigus, corrosifs ; et l’autre jetant sur nos têtes toute une manne d’images et de symboles ardemment pittoresques et imprévus !
Et cela était d’un vif intérêt, et d’un enseignement utile. Car cette discussion prouvait que la musique des mots, si chantante et si harmonieuse qu’elle soit, est fréquemment arrêtée net par un mot, par une repartie. Et c’était toujours Hüysmans qui disait ce mot-là, cette repartie.
J’appris bientôt, après plusieurs contacts, que Hüysmans parlait tout de même avec plaisir ; mais voilà, il fallait pour cela bien des choses ; il convenait d’abord que le décor où il se trouvait lui plût, et qu’ensuite les assistants, et surtout son interlocuteur fussent à son gré ! Je vis cela nettement un soir chez un peintre lithographe dont il établit la renommée. Hüysmans parlait avec un vif humour, blaguant ce qu’il appelait les essais constipés de Brunetière ; et il nous affirmait que le cabinet de ce critique était « tapissé vert-aigre », quand on annonça Monsieur Marcel Prévost.
Cet aimable auteur pour dames, arrivant à l’improviste, glaça net Hüysmans.
Ah ! cette année 1892 dans sa vie ! Ce qu’elle compta, presque malgré lui ! car, dans un autre chapitre, je dirai comment, avec la bonne humeur « d’un chien qu’on fouette », il partit pour la petite Trappe de Notre-Dame-d’Igny, située près de Fismes, sur les confins de l’Aisne et de la Marne. Oui, ce fut la fameuse année soi-disant de la grâce. Ce fut plutôt l’année des doutes, que Hüysmans sut si bien transposer en phrases littéraires et artistes. Et, en faisant une retraite à Igny, en se confessant, en communiant, il ne nourrissait surtout en lui que le violent désir d’aller chercher des sensations vécues, qu’un besoin désormais inapaisable de documents neufs et vrais !
Car, combien de fois devant moi n’avait-il pas plaisanté Zola et sa documentation superficielle, faite en courant, et augmentée le plus souvent de notes prises par d’anciens disciples, tels que Henry Céard et Paul Alexis !
Quand Hüysmans revint à Paris, pour écrire En Route, la vérité m’oblige à dire ici — et j’aurai d’autres occasions de le constater — qu’il se retrouva avec joie dans son appartement tout encombré de livres, de gravures et de tableaux. Oui, quoi qu’il en dît, rien ne l’enchantait mieux que ses petites pièces tendues d’andrinople, où il écrivait, où il errait en pantoufles en la compagnie de son chat Barre-de-Rouille. Là, seulement, sous sa lampe, et tout en fumant de nombreuses cigarettes, il travaillait avec plaisir.
Patiemment et sans cupidité aucune, lui qui fit tant pour les peintres, qui en inventa tant ! — ainsi qu’un autre chapitre le montrera — il avait accroché aux murs des aquarelles de Forain, de curieuses oeuvres de Raffaëlli, de Bartholomé, de Seurat, de Cézanne, de Bresdin et de Constantin Guys. Quelques estampes de Peter Breughel, d’Israël de Meiken, de Dürer, de Téniers, d’Hogarth, de Lucas de Leyde, de Daniel Hopfer et de Piranèse complétaient ce décor mural ; et c’était à peu près tout. Je dirai même que c’était tout, si je mentionne encore quelques bois, quelques faïences, une monstrance et des cierges de Bohême, de vieilles cires curieusement historiées.
Cette fois, c’est tout ! Oui, voilà qui va égayer nos actuels critiques d’art, qui se font de copieuses rentes en envoyant sans vergogne à la salle des ventes les tableaux et les sculptures qu’ils ont l’impudence d’exiger.
Pour Hüysmans, ce cadre modeste était d’ailleurs bien le seul qui lui convînt. Au cours de sa vie, il changea quelquefois de logis — par force ; il voyagea même, le musée du Louvre ne le contentant point absolument ; mais toujours il pensa à ce couvent des Prémontrés où il fut en partie élevé et où il vécut une grande partie de sa vie.
Je l’y connus s’occupant encore d’un atelier de brochure qui lui venait de sa mère : le fameux atelier qu’il mit en scène dans les Soeurs Vatard, et qui était installé au rez-de-chaussée, dans la cour. A dire vrai, l’écrivain se reposait plutôt sur son associé Leroux du soin d’exploiter cet atelier. Il avait bien assez, comme tâche rebutante, d’aller au Ministère de l’Intérieur, où il devait rester trente-deux épuisantes années.
Ce couvent des Prémontrés !
Dans son amour pour lui, il en supportait même les locataires. Ainsi, il me racontait que sa joie fut extrême au matin du premier quatorze juillet commémoré, quand il vit un de ses voisins, M. Boileau père, l’architecte de l’église Saint-Augustin, arborer une écharpe tricolore et présider à l’ornementation farouchement républicaine de la grande porte d’entrée du No 11, sur la rue.
C’est que, — si vous vous rappelez l’extraordinaire et si cocasse invasion du concierge aux premières pages de Là-Bas — c’est que Hüysmans lui aussi, parfois, fut une manière d’humoriste, ayant plus que quiconque par exemple le sens du caricatural, étant absolument tel qu’un littéraire et hargneux Gillray.
Oui, ainsi que le caricaturiste anglais, Hüysmans était, en effet, tout à fait mordant, quand il parlait de son prochain. En cela. au moins déjà, il n’était pas un saint. Ce n’est, certes, pas l’amoindrir que de dire qu’il était plutôt une gale. Il n’épargnait personne, juste son interlocuteur, au cours d’une conversation. Il avait une façon de laisser tomber ses mots, assez lentement et rageusement, pour que la blessure fùt sensible. Et elle l’était, durement. Il fallait lui pardonner beaucoup de choses pour revenir avec plaisir auprès de lui. S’il recevait néanmoins, et assez régulièrement, chez lui, quelques amis, c’est que chacun d’eux se croyait — et bien à tort ! — à l’abri de ses coups de boutoir.
Sortait-il ? Assurément. Même ce solitaire qui n’a jamais cessé de vilipender la femme, supportait cependant sa société chez les autres. Il allait comme cela, aimable an moins en apparence, chez certaines gens, presque toujours les mêmes ; — et il s’y attardait souvent, quitte à en grogner le lendemain si quelqu’un l’interrogeait sur sa soirée de la veille.
Et ces détails que j’effleure, que l’on ne m’en ait pas rancune, car ils expliquent bien toute l’unité littéraire de Hüysmans, tout son art résolument pareil, que les années de maturité ont seulement paré d’orfèvreries de mots de plus en plus merveilleuses.
Oui, cet art grognon, rêche, violent, vibrant, fait de coups de poing, de coups de dent, de coups de tête, cet art qui fonce, heurté, bousculé, et bouclant tout, et étranglant tout, c’est tout l’art de Hüysmans, dès son premier petit volume, qu’avait si drôlement condamné le père Hetzel ; — et c’est aussi toute sa vie, en dépit des ménagements qu’il fut bien contraint d’avoir, sous peine de périr, lui aussi, avec la camisole de force, dans un cabanon du Bicêtre des Lettres.
Et c’est dans cette attitude qu’il était curieux à considérer. Sans le faire exprès, on le mettait souvent, à huit jours d’intervalle, en pleine contradiction avec lui-même. C’est qu’il ne se souvenait plus de la concession qu’il avait faite, et de la forme qu’elle avait prise.
Toutefois, appuyons bien sur ceci: ses concessions ne visaient toujours que des gens de talent et des choses louables. Car, jamais je ne l’ai entendu, par exemple, vanter un homme de lettres auquel il refusait tout intérêt.
Et je ne sache pas non plus que la Politique, ait, avec son amas d’infamies, jamais trouvé gràce devant lui. Non, je le répète, il redoutait ce que les aliénistes appellent d’un doux euphémisme : le maillot de sûreté ; et, partant donc, il était parfois conciliant et, ce qui peut surprendre, indulgent.
Du moins, si je me trompe, je puis avancer que c’est ainsi qu’il me parut avant son départ pour la Trappe d’Igny et après son retour à Paris.
Et je le vis souvent en ces mois-là et au cours des mois suivants.
Que de soirées j’ai passées avec lui, appelé par des mots brefs tracés d’une fine écriture sur des cartes de papier gris ou sur des lettres à en-tête de son Ministère !
J’arrivais, et c’était toujours pour moi le même contentement à gravir le petit escalier roide, me semblant de jours en jours plus étroit.
Les boîtes à lait étaient encore accrochées aux boutons des mêmes portes, et tous les judas, que la concierge devait frénétiquement astiquer, brillaient à en éblouir. Cela, somme toute, restait un immeuble honnête; et, maintenant, je comprenais que Hüysmans ne pouvait guère en habiter un autre, plus opulent et plus compliqué!
C’est qu’il était si simple, si modeste en ses désirs. Une femme de ménage ravaudait son logis, cirait ses bottes, préparait, l’hiver, son feu, et c’était tout. Pour tout le reste, l’écrivain y parait lui-même. Combien de fois, ainsi, l’ai-je vu compter ses notes de blanchissage, vérifier son linge et le pointer sur un carnet !
Sans doute, ces détails surprendront nos actuels « gendelettres » ; mais sont-ils tant que cela inutiles pour présenter ce merveilleux artiste, qui, au moment où tant d’auteurs mondains s’enrichissaient, restait obstinément, lui, dans sa condition médiocre !
Un de ses rares plaisirs d’alors, c’était la flânerie sur les quais. Certain de ne rien trouver dans les boites des bouquinistes, il y furetait quand même, par besoin de remuer des livres, des paperasses, ou de lire en courant quelque sottise.
Quand j’avais la joie de l’y accompagner, nous commencions toujours invariablement notre promenade par le Pont-Neuf ; et, après un coup d’oeil jeté sous le pont, dont le pittoresque le captivait toujours, nous allions sans hâte, jusqu’au Pont-Royal. Mais il en avait touché des livres avant d’arriver là. Et que de mots personnels il disait ! que de réflexions sur leurs auteurs encaissaient les bouquins, si mornes quand ils sont livrés au vent et à la pluie, si solennellement bêtes dans leur reliure rouge dès qu’on les met, à l’instar des pierreries, dans une vitrine.
Au Pont-Royal, la Seine, toujours, était si jolie, si avenante que nous ne manquions pas alors de la suivre jusqu’à la Concorde. Et les bateaux, les débardeurs, les chiens qu’on baigne, tout cela nous amusait, jusqu’au moment où je sentais que je devais le laisser seul ; — jusqu’au moment où je le regardais s’en aller, très droit et très maigre, sans gestes, sous son éternel chapeau haut-de-forme à bords plats.
Quelquefois, il me donnait rendez-vous chez lui, le matin, avant que d’aller à son Ministère.
Je le trouvais presque prêt, n’ayant plus qu’à prendre son chapeau et ses souliers. Il me lançait une boutade résignée sur la nécessité d’aller dans un bureau, donnait un dernier coup d’oeil à Barre-de-Rouille ; et il descendait lentement son escalier.
Je l’accompagnais jusqu’au cabaret bardé d’une grille, dit de la Petite Chaise, rue de Grenelle, au No 36 ; et là, il « chipotait » un menu repas, qu’il me vantait — avec force réticences ; — puis, pour toute une journée, il disparaissait sous une porte de la rue des Saussaies.
Hüysmans devenait un employé.
Son Bureau
SON bureau ! Depuis combien de temps était-il dans ce ministère ?
Il me dit un jour qu’il y était entré exactement le 1er avril 1866. Ça avait été une idée de son grand-père maternel, caissier à l’Intérieur. On avait bien pensé un moment, lorsqu’il eut pris son diplôme de bachelier, à lui faire étudier son droit, à le diriger même vers l’Ecole Normale, car il était d’une très réelle force en latin ; mais Hüysmans ne pouvait plus supporter davantage les professeurs, et tout ce qu’il appelait la cuistrerie de l’enseignement.
« — Entre deux dégoûts, me disait-il un jour, j’ai choisi le moindre : le Ministère ; c’est tout de même moins abêtissant ! »
Pourtant ceux-là qui ont figuré dans les humbles emplois d’un Ministère ou d’une Préfecture savent quel odieux régime l’on y subit. Directeurs présomptueux et sots, qui ne daignent se montrer que dans les circonstances solennelles ; chefs de bureau ignares et sournoisement hostiles, ayant la haine de tout subordonné qui pense, qui les juge ; collègues aussi le plus généralement envieux et bêtes, c’est là le triste milieu qui attend un esprit libre. Cette vie-là. Hüysmans la vécut ; et il n’en déchut pas. Il y a de tels miracles !
Il parvint, après je ne sais combien d’années, à un emploi de sous-chef. Il y gagna un bureau plus spacieux, et où enfin il se trouva seul. Ses amis et moi, nous le visitâmes souvent dans ce local.
Il nous en faisait les honneurs avec un mot féroce chaque fois à l’adresse de l’Administration ; mais il s’égaya tout à fait en revanche quand le ministre Dupuy le décora au titre d’employé « exact et zélé »,
M. Folantin décoré ! Ce fut un hourvari de ses collègues et un soulagement pour les gendelettres. Les feuilletonnistes et les vaudevillistes, qui dépendent de l’Instruction publique, n’ont jamais, en effet, trop de croix ; et qu’était Hüysmans ? Le public des boulevards, allons ! ne le connaissait même pas ! A l’opposé, au Ministère, je veux dire chez les chefs de bureau, cette croix suscita un scandale ; c’est que ces séniles bonshommes bâillent continuellement après ce ruban promis à leurs années de patiente inactivité.
A la suite de cela, on connut un peu Hüysmans à l’Intérieur.
Jusqu’à ce moment, en effet, il n’y avait pas eu grandes palabres au sujet de cet employé peu bavard, très froid d’allures, qu’on aurait pu voir arriver tous les matins et partir tous les soirs avec le même sourire sarcastique et figé. Ecrivait-il dans les journaux à " grand tirage " ? Non ! Eh bien, alors, pourquoi s’en occuper ?
Certains collègues se disaient bien qu’il avait été autrefois un des disciples de Médan ; qu’il entretenait de « hautes » relations littéraires ; qu’il publiait de temps en temps des livres ; mais tout cela s’effaçait devant ce fait : c’est que Hüysmans restait employé, prouvant ainsi qu’il n’avait point de talent et qu’on ne le lisait point. Il n’y avait rien à ergoter, ce semble, sur cela !
La vérité était autre. Ne détenant pas une conservation de palais, de bibliothèque, de musée ; car où caserait-on alors les requins d’antichambre ? ne songeant même point à solliciter une quelconque de ces prébendes, Hüysmans avait trop horreur d’une besogne courante de lettres pour s’évader de son bureau. Là, s’il s’y ennuyait, ce n’était pas du moins l’affreux désastre d’âme qui l’eût, répétait-il, étreint ailleurs.
Son gîte lui semblait, du reste, maintenant, possible ; et, tout de suite, il y avait disposé méthodiquement ses livres, ses notes.
Il y travailla, en somme, avec assiduité, pour son propre compte ; car il avouait qu’il y avait écrit entièrement quelques-uns de ses romans.
Quand il était fatigué, il regardait sous sa fenêtre un jardinet tapissé de lierre, et, au centre d’une corbeille, une statue de marbre, une femme dont la physionomie allègre et sotte, l’inspirait, disait-il.
« — L’Administration vous inflige bien des pensums ? lui demandai-je, un jour.
— Sans doute, me répondit-il, tous les trois mois, je sors cette fiche — il la prit dans un tiroir de sa table — et ce qu’il y a là-dessus : la date de ma naissance, la date de mon entrée dans l’Administration, etc., etc., je le reporte scrupuleusement sur une feuille spéciale, dite signalétique, qui, de chefs en chefs, estimera mon intelligence, mon zèle et ma bonne conduite !
— Ce n’est pas possible ! dis-je. Il y a des chefs de bureau et des directeurs qui portent un jugement sur votre intelligence ?
— Pourquoi pas ? Ah ! si vous saviez ce qu’ils sont tous de solides cuistres ! Quel livre à faire sur eux! Et je ne sais pas ce qui l’emporte encore, de leur malhonnêteté ou de leur sottise ! Mais laissons cela ! je suis ici, il faut que j’y reste au moins jusqu’à ma retraite ! Je sais bien qu’il me serait possible déjà de m’en aller ; oui, je pourrais me faire réformer comme gâteux, par exemple ; bah ! une année de plus ou de moins ! »,
C’était surtout à la fin des jours d’hiver que nous allions voir Hüysmans dans sa geôle. Alors le garçon entrait, apportant une lampe à huile dont le modèle réglementaire ne plaisait guère avec son immuable carton vert et sa boîte cylindrique passée au chocolat. Puis elle éclairait mal tout d’abord, et le garçon multipliait les tentatives pour obtenir une lumière acceptable.
Hüysmans y tâchait lui aussi avec un sérieux imperturbable ; et il souriait à peine quand la lampe, exténuée d’être ainsi manipulée, gémissait. De ses lèvres pincées tombait seulement ce mot : Enfin ! et cela contenait tout un monde de rancoeurs. Puis, tout de suite, cela apparaissait si drôlatique que l’on ne pouvait s’empêcher d’en rire.
Si redoutables que soient certaines unions ou associations, on n’a pas cru toujours à la détresse du célibat. Or, Hüysmans était un célibataire effroyablement triste. Cette lampe, au bureau, qui fonctionnait presque toujours mal, c’était une des petites et nombreuses causes de son universel ennui. Tout à l’heure, il sortirait ; et ce serait la même chose, tout en étant autre chose.
— Ils en ont de bonnes, me disait-il, ceux qui me conseillent de me marier ; comme si le mariage n’était pas encore cent fois plus affligeant que tout le reste. Et puis quelle femme se contenterait d’un sort semblable au mien ! Et quel déluge de contraintes et d’implacables maux ! Enfin il me faudrait subir toute une famille, toute une trôlée de parents que d’avance j’exécrerais, ah ! non, je me satisfais encore mieux des soins de ma concierge et de la bibine des gargotes !
Et il y allait sans cesse dans ces gargotes, avec un vague espoir de trouver le mieux, un jour. Or, continuellement, il était déçu.
On a raillé sans esprit sa manie de toujours parler cuisine. Ses inquiétudes d’estomac ont fait sourire. Pourquoi ?
Un repas qui le laissait ensuite tranquille lui était autrement agréable — il le confessait ! — qu’à un autre, une soirée au théâtre, par exemple.
C’est que, à peine libéré du restaurant, il rentrait vite chez lui pour y reprendre son manuscrit, pour y retrouver ses notes. Eh, dame ! il devait ne point souffrir pour couvrir de sa petite écriture toutes les pages qui constituaient depuis longtemps sa seule raison de vivre. Quand il était par hasard « désoeuvré » ; quand, ayant fini un livre, il attendait — en méditant — le moment favorable d’en commencer un autre, il était certes encore plus inquiet, agacé, et tout hors de son assiette. Il était bien l’employé « ponctuel et zélé » qui s’attriste pour de bon de n’avoir point de lettres à écrire et qui se demande, au bout de sa triste journée, s’il ne va pas se pendre parce qu’il a, croit-il, « volé » l’Administration !
Du reste, vous l’avez vu en scène dans A Vau-l’eau, ce Hüysmans désuni.
Il a exagéré sans doute la détresse de ce pauvre hère qui va, de gîtes en gîtes, pour pêcher une joie sûre ; je me souviens, certains soirs, pourtant, d’un Hüysmans, qui, toujours pourvu d’argent, — car il était prudent — ne savait où aller, malgré toutes mes propositions concernant tel ou tel restaurant.
— Vous croyez ? Bah ! à quoi bon changer ? me disait-il. Les mets y sont peut-être d’aspect plus engageant, mais les sauces en seront plus scélérates. Croyez-moi ! Nous sommes bien dans un temps de composts, et il y a de la gadoue partout. Voilà notre sort éternel. Ce qui me stupéfie, c’est qu’on trouve encore le courage d’entrer dans une seule de ces officines !
Et voilà avec quel entrain, il abordait le restaurant qu’on lui avait choisi !
Il est vrai qu’on n’y perdait pas son temps ; car, si l’on avait, soi, un appétit féroce défiant toutes les « ratatouilles ». on en entendait de ces mots amusants qui muaient toute l’ordonnance des mets, tout l’apprêté du service, en une effroyable bouillabaisse de bran et d’ordures qui réellement fumait avec une saveur incomparable.
Le terrible, c’est que Hüysmans parlait de cette mixture à des dîners d’amis, devant des invitées même. Et alors, ça jetait un froid ! Ce n’est pas une légende ! Une maîtresse de maison me disait : « Je l’invite avec plaisir, M. Hüysmans, mais si je pense à lui, au moment de faire servir, mes sauces tournent ! »
Encore me pardonnera-t-on d’insister, après l’écrivain lui-même toutefois, (car son oeuvre fourmille de ses plaintes culinaires), sur ces autres petites choses de sa vie ? Elles s’expliquent si naturellement, d’ailleurs, quand on songe à ses malaises d’estomac d’abord, et ensuite’ à la nécessité où il se trouvait de dîner la plupart du temps au restaurant.
Là, songez, il n’avait point fixé un seul détail du menu ; c’était une implacable carte qu’il subissait ; et de relire toujours les pareils noms à choisir, cela l’affolait. Nous n’y pouvions rien ! sans doute ; mais lui aussi n’y pouvait rien. Il continuait à se lamenter à ce sujet parce qu’il n’arrivait point à se dire que tout devait être, le plus souvent par nécessité économique, falsifié et truqué. Par hasard, un plat lui semblait-il bon une fois ; quelques jours après, ce plat, chez le même traiteur, était inacceptable. Pourquoi ? C’est cette question qu’il se posa toute sa vie ; car, étant, en somme, dépourvu d’imagination, il aimait les redites.
En cela, il fut bien toujours un employé. Un employé de génie, c’est entendu ; mais c’est bien une nature de commis, celle qui rabâche la même chose, quelquefois dans des situations inattendues et compliquées : quand il fut à la Trappe, par exemple.
Du reste, au Ministère, Hüysmans fut, durant toute sa carrière, " régulier " — ce qui est la caractéristique du véritable employé. C’est peut-être un étonnement. Mais il était cela, je dois le dire, par calcul, afin d’éviter les « histoires ».
Une après-midi que, malade, il gardait la chambre, je me souviens qu’étant venu le voir, j’avais à peine pris de ses nouvelles qu’un de ses collègues entra. Inquiétudes, souhaits de prompte guérison, etc., rien ne manqua dans la bouche du bon camarade, qui, satisfait, s’en alla. J’en félicitai Hüysmans : on s’inquiétait de lui, à la bonne heure !
— Ah ! me répondit-il ; il est venu simplement de la part du chef pour voir si j’étais sorti !
Et cela, au fond, ne l’indignait pas. C’était dans les habitudes du bureau : il y était fait depuis longtemps.
Et alors nous nous expliquons comment il put demeurer trente-deux ans dans une telle situation. D’ailleurs, quelle paisible hérédité fut la sienne !
Voyons, en effet. Du côté de sa mère, c’est une famille de petits bourgeois, au milieu de laquelle un artiste était tombé à la façon d’un bolide; mais ce ne fut, il est vrai, qu’un statuaire prix de Rome, et qui commit d’innocentes ciselures sur le piédestal de la colonne Vendôme et aux arcs de triomphe du Carrousel et des Champs-Élysées.
Du côté paternel, même accalmie. Son père, Godfried Hüysmans, est venu à Paris pour y peindre des missels et des enluminures. Il vit très à l’écart rue Suger, au No 11, où Joris-Karl naît le 5 février 1848 ; puis de là, Godfried Hüysmans va rue Saint-Sulpice, où il devait mourir le 26 juin 1856, à l’ombre de la funèbre église. Depuis longtemps des tantes de l’écrivain sont entrées dans des béguinages. Quand il les visitera, il en notera l’accueil morne et froid.
On le voit, rien ne le prédispose à chercher des aventures. Il est de sang rassis, comme on dit, et, toute sa vie, il restera ainsi. Le père qui vécut difficilement revivra dans son fils, mécontent de tout ; employé ponctuel, je le répète, mais emmagasinant une trôlée de récriminations ; et, comme le livre est le seul porte-paroles durable qu’affectionne Hüysmans, c’est dans les livres qu’il rejettera sa bile, et cela, interminablement.
Il arrivera même un jour ceci ; c’est que, forcé d’admirer, quelquefois, des oeuvres, il s’en défendra après coup, trouvant de subtiles raisons pour justifier ses enthousiasmes, mettant tout, sans vergogne, sur le compte du beau style neuf, pittoresque, coloré, qui, dit-il, le requiert par-dessus tout.
Ah ! quand il quittera son bureau, définitivement, il sera bien mûr pour cette discipline du temps qui avait été si longtemps la sienne ; et il ne s’effrayera point d’avoir à arranger sa vie en conséquence, jour par jour, et heure par heure encore !
Il voyagera davantage ; il ira enfin, sans autorisation cette fois, voir des musées, des églises, des monastères, des villes même ; mais tout cela, il le sait bien, se fera sans heurts, sans bousculade, comme au temps de l’ancien congé annuel, octroyé par l’Administration ; et il ne changera rien à sa manière de vivre, sinon qu’il écrira désormais ses livres chez lui, à condition toutefois que les voisins veuillent bien, par un relatif silence, lui en accorder le moyen.
Hommages
COMME tout le monde, Hüysmans eut pendant longtemps le culte de certains maîtres ; et, aussi adroit que n’importe quel débutant, il sut se glisser dans les cénacles et dans les étroites chapelles où les réputations s’établissent à grand renfort d’admiration mutuelle.
Fils d’un véritable déraciné — car son père, tombé dans Paris, y resta volontairement casematé, — Hüysmans suivit heureusement des cours à l’institution Hortus et au lycée Saint-Louis. Cela le parisiennisa, lui acquit des relations utiles ; et, par la suite, on le vit s’en souvenir et les mettre en oeuvre, quelquefois avec une obstination têtue.
Car il faut bien affirmer que Hüysmans eut presque toutes les faiblesses des débutants.
C’est ainsi qu’il trouva bon, lors de ses premiers livres, d’aller partout ; je veux dire chez tous les incontestables maîtres du moment ; quitte ensuite à les juger avec une amusante et ardente sévérité, souvent très injuste.
Plus tard, il restera chez lui, c’est entendu ; à ce moment-là, sa place sera faite, et il n’aura guère de mérite à nous vanter son indépendance et son amour de la solitude.
Il m’a conté ses premières relations littéraires :
— C’est chez Léon Cladel, me dit-il, que j’ai connu Edmond de Goncourt et Villiers de l’Isle-Adam.
« Ah ! quel brave homme c’était, ce Cladel ! Il était très serviable, bien que vraiment bizarre d’allures. Ses yeux de lion luisaient dans une invraisemblable crinière. Il affolait Goncourt qui était de mise recherchée et précieuse ; mais il chérissait tellement les Lettres, ce bougre-là, que l’on avait un réel plaisir à l’aller voir ! Ah ! oui, c’était un brave homme!
Et c’est très exact. Par le cher poète Henri Degron, aujourd’hui casé sans doute dans le ciel des bons petits hôtes de Yokohama, je connus moi aussi Cladel sous cet aspect.
Il logeait en banlieue, et, entouré de chiens qui le suivaient partout, il adorait, c’est vrai, la Littérature d’une telle passion que ça devenait de l’épopée à propos de la plus menue épithète. Il était né trop tard, ce grand bonhomme. Les éditeurs le considéraient comme un peu fou, et alors, gaillardement, ils l’exploitaient.
Quant à Villiers de l’Isle-Adam, Hüysmans le trouvait « désorbité » ; mais il admirait sans réserve son indépendance intransigeante, sa pauvreté redressée héroïquement et fièrement, comme un panache.
Un jour, quelqu’un osa lui dire que Villiers, « après tout, n’était qu’un influencé d’Edgar Poë et de d’Aurevilly ! » Ah ! en réponse, ce fut une des rares apologies que je lui aie entendu débiter, mais ce qu’elle le fut d’un ton sec et rageur !
Edmond de Goncourt avait des rentes et un incommensurable orgueil. Grâce à cela, Hüysmans put sans gêne être un des assidus du notoire grenier d’Auteuil. Il s’en fatigua vite pourtant ; et il fut le premier qui se refusa à célébrer, chaque dimanche, la gloire d’un incontestable mais exigeant artiste.
Et puis Hüysmans n’aimait guère qu’on l’accusât de plagiat. Or, une après-midi, chez Goncourt, alors que toute la cour habituelle recueillait dévotieusement les mots du mattre, un ami de Hüysmans — celui-ci n’était point présent — émit l’imprudente opinion que rien n’était beau comme l’érotique hallucination de Gilles de Rais, dans la forêt de Tiffauges. Edmond de Goncourt se redressa aussitôt, et répliqua qu’en effet c’était très beau, car c’était le simple plagiat de sa Germinie Lacerteux, hallucinée, elle aussi, de même manière, dans sa cuisine !
Cela jeta malgré tout un froid, — et l’on parla d’autre chose.
Ce fut seulement après le Drageoir à épices et Marthe que Hüysmans connut Zola, Flaubert et Barbey d’Aurevilly.
L’équipe de Zola dans laquelle il s’enrôla ne lui donna aucune joie.
Il y supportait cependant Maupassant et Henry Céard, qui était son collègue au Ministère.
Quant au maître, il était trop autoritaire pour que l’accord fût durable. Et, à écouter Hüysmans, Zola n’entendait rien à l’Art. Il l’avait prouvé, répétait-il, en tambourinant de niaises opinions sur les peintres ; en bafouillant à propos des oeuvres de Manet ; en installant enfin dans l’escalier de son hôtel de la rue de Bruxelles, un vitrail ! un Coupeau taillant à même une miche de quatre livres !
Et puis enfin, c’était un fait : dès que les marchands de bric-à-brac avaient une camelote à vendre, dare-dare ils la portaient chez Zola !
Moi, j’écoutais avec angoisse. Alors que fallait-il croire ?
Mais Flaubert ? disais-je.
— Celui-là, et Hüysmans leva les bras, il ne cherchait qu’à nous interloquer. Il faisait le commis-voyageur et il jouait les Homais ! Jamais je n’ai rencontré un tel Gaudissart ! A table même, ses plaisanteries conservaient leur goût douteux. Ce grand écrivain cultivait l’intolérable manie du calembour et de l’à peu près !
— Et Tourgueneff, l’ami dont Flaubert parle sans cesse ? demandai-je encore.
— Le Russe ! ah ! quel robinet d’eau tiède, c’était le plus niais des hommes ! Je ne sais vraiment pas pourquoi l’on chante toujours ses louanges !
Tout cela me laissait absolument interdit.
Restait Barbey d’Aurevilly.
Celui-là allait peut-être trouver grâce devant la mauvaise humeur de Hüysmans. Oui, cette fois, il jeta son éloge d’une voix allègre :
— Hélas ! Je l’ai connu trop tard, ce merveilleux artiste ! Ah ! quels goûts romantiques, quelle passion de toilettes saugrenues, quel besoin de gongorisme et d’hyperboles ! Il piaffait en parlant, cet unique causeur. Il avait des mots qui faisaient feu, des rencontres inattendues d’idées, des phrases qui picrataient ! Lui aussi, il aimait à raconter, à table, certaines anecdotes qui relèvent du répertoire du baron de Crac, mais quels rugissements pendant tout son discours ! Ah ! ce n’étaient pas les faciles plaisanteries de Flaubert, ah ! non !
« Il y avait pourtant un ennui chez lui, et il comptait ! C’était sa clientèle. Car il avait toute une séquelle à ses trousses ; et il était impossible de le voir, de lui causer cinq minutes, sans qu’aussitôt un Bourget sortît de la cheminée ou d’une armoire. Et cependant Dieu sait si le Psychologue l’agaçait fortement, le fracassant Connétable, qu’il s’obstinait à nommer toujours Monsieur Barbey !
« C’est dans ce petit tourne-bride que je connus Charles Buet. Ah ! il était curieux celui-là, au moins ! Il tenait de l’homme d’église et de l’huissier de province ; d’ailleurs, il se révélait très retors et très fin. »
Toutes ses autres opinions sur les maîtres dont l’admiration nous est, pour plus de garantie, imposée de bonne heure, Hüysmans les a exprimées succinctement dans A Rebours. Il n’y a donc pas à y revenir. Mais quand on le visitait, il avait des mots autrement brefs et énergiques, pour qualifier ces écrivains qui sont appelés avec emphase : les grands classiques.
Il me disait n’avoir même jamais goûté Corneille, Racine, ainsi que Molière. Ces illustres ombres ne l’avaient, à aucun moment, attiré ; il les tenait, Corneille et Racine, surtout, pour d’étonnants « raseurs ! » ; et il mettait dans le même sac et Dante et Schiller et Goethe, par exemple.
— Je les ai tous lus avec attention cependant, ces solennels pontifes, disait-il ; et je me suis toujours demandé en quoi ils pouvaient intéresser. Ils sont d’un pompier qui accable, et il est vraiment odieux qu’on nous ressasse tous les jours l’apologie de ces séniles badernes qui ne devraient contaminer que les lycées où d’imbéciles barbacoles opèrent !
Propos hors de toute mesure, certes. Mais Hüysmans en tenait d’autres !
Ainsi, il déclarait ne point se plaire à l’extrême en la compagnie de Balzac. Ce prodigieux romancier le laissait indifférent. Sans doute, il appréciait le formidable amas d’oeuvres exhaussé par cet acharné producteur ; — mais où y a-t-il dans tout cela une épithète artiste ? me demandait-il. Ah ! ce Balzac, il est peu aisé à relire, mais ça, on n’ose pas l’avouer !
Théophile Gautier, de même, ne l’attirait pas. Il n’aimait pas ce parfait artiste ; il le jugeait froid et dilué. Il lui en voulait d’avoir publié tant de pages « pour ne rien dire, en somme »
Seul, Baudelaire était véritablement l’idole. Et c’était une admiration sans limite, un enthousiasme sans cesse renaissant :
— Ah ! ce que cet homme a écrit ! s’écriait-il. Ce qu’il l’a explorée, l’âme ! Tout ce que nous aimons maintenant vient de lui, uniquement de lui ! Et il a tout réussi avec le même bonheur surnaturel ! Tenez, il y a des gens qui, avant que de s’endormir, relisent le Candide, de Monsieur Voltaire, moi, je leur donne et ce médiocre matassin et toute sa bande, pour une simple page des Curiosités esthétiques ! Ah ! ce que c’est charnu, artiste et neuf !
Et des soirs d’hiver, près d’un feu de bois qu’il tisonnait, j’écoutais ainsi Hüysmans me dire ses haines et ses joies.
Une fois, après l’avoir entendu encenser les grands Mystiques : Ruysbroeck l’Admirable, Catherine Emmerich et quelques autres, poussé par je ne sais quoi, je profitai d’un silence pour lui citer les Augier, les Feuillet et les Dumas fils dont le répertoire reste, au bout du compte, celui de la Comédie-Française et des grands galas dramatiques.
J’excitai alors une verve pareille à celle que je connus à un moment lors de notre première rencontre ; mais rien ne fut divertissant comme d’entendre Hüysmans invectiver ces encombrants apôtres de l’art théâtral ; et je pensai :
— Quel dommage qu’un impresario, un marchand de conférences, un négociant de lettres ne songe pas à prier Hüysmans de parler sur ces auteurs-là ! Il est vrai qu’il faudrait être bien malin pour l’amener à cette tâche ; car, lui et un conférencier, ce n’est pas du tout la même chose ; cependant, après un début peut-être pénible, et qui ferait sourire les « enfileurs » de phrases, je crois que l’on collectionnerait à plaisir des arguments contre le sans-gêne étonnant avec lequel Dumas, Augier et Feuillet continuent à s’étaler sur les affiches et dans les bibliothèques pour le triomphe de l’art bourgeois !
Ses opinions sur d’autres hommes de lettres de son temps ? Il les exprimait souvent d’une façon extrêmement concise. En voici quelques-unes que j’ai pu noter fidèlement, au sortir de nos entretiens :
VICTOR HUGO. — Epique garde-national ; mais ce qu’il les a bien chantés, celui-là, les Eléments !
LECONTE DE LISLE. — Le quincaillier sonore ; tout de même d’autres vers que ceux d’Hugo !
P AUL BOURGET. — Ah ! celui-là, les duchesses l’ont toujours stupéfié !
JULES LAFORGUE. — Quelle joie !
FLEURIOT-KÉRINOU. — J’ai goûté de ce poète un volume : « La genèse de l’Eucharistie ».
RÉMY DE GOURMONT. — J’ai écrit une préface pour un de ses livres ; c’est tout dire !
VERLAINE. — Ah ! si on avait pu le retenir tout le temps en prison ou à l’hôpital !
D’ESPARBÈS. — Un clairon ivre !
HENRI DE RÉGNIER. — Le pompier Renaissance.
MARCEL PRÉVOST. — Le jeune premier des romans de Georges Ohnet !
LES HUMORISTES. — Je m’en f... !
MAURICE BEAUBOURG. — Un régal, sa Saison au Bois de Boulogne.
LES ROSNY. — Les deux lapins de la Science ! quel vocabulaire !
JEAN RICHEPIN. — Ponchon d’abord !
HENRY HOUSSAYE. — La vivandière de la Grande Armée !
ANATOLE FRANCE. — Il s’y connaît, le gaillard ; mais ce qu’il se défile !
ELÉMIR BOURGES. — L’homme qui a reçu cette dédicace : « L’auteur de l’« Ensorcelée » à l’auteur de « Sous la hache ! »
JULES RENARD. — L’aigre constipé !
MAURICE BARRÈS. — Lord Beaconsfield ! A pris la parole une fois à la Chambre contre le monopole Hachette ; naturellement, un échec !
Et Hüysmans me disait encore :
— Du reste, quel sinistre moment vivons-nous ! Si l’on excepte quelques probes artistes qui depuis longtemps oeuvrent à l’écart, regardez l’amas des gens de lettres, des peintres, des sculpteurs et des architectes. Tous, sans honte, multiplient les occasions de s’exhiber, de révéler leurs turpitudes. Les Salons ? ils sont inabordables par le vomissement qu’ils provoquent. Et les architectes, eux, ne sont pas moins surprenants d’imbécillité avec leur incompréhension totale de tout art raisonnable et logique. Les hommes de lettres, enfin ! Mais c’est une cohue de niais icoglans et de vieux birbes ! et puis songez qu’avec cela les femmes maintenant s’en mêlent, comme s’il n’était pas mille fois avéré que la « petite oie » est radicalement inapte à perpétrer une oeuvre louable, au point que les rares femmes dont l’intelligence n’est pas tout à fait inexistante, refusent systématiquement de lire les élucubrations de leurs pareilles ! Ça, n’est-ce pas, c’est un signe ? Ah ! ce qu’il a raison, Degas, pour n’en citer qu’un parmi les peintres, de se foutre de son temps et de rester chez lui ; comme Mallarmé, de vouloir qu’on ne tire qu’à quelques exemplaires les oeuvres qu’il parachève dans le silence ! Aussi ce qu’ils me dégoûtent, mes livres, à moi, quand ils paraissent ! si je pouvais alors les reprendre et les pilonner !
Propos d’après chose faite, sans doute ! Cependant Hüysmans a tenu de moins en moins à sa vie d’homme de lettres; et c’est ainsi qu’il espaça bientôt, de jours en jours, ses visites chez les maîtres qu’il admirait.
Il se rendait bien compte que le mieux eût été de n’y plus aller du tout ; mais pouvait-il, du jour au lendemain, y renoncer ? C’est bien improbable.
Quoi qu’il en dît, il y trouvait parfois un plaisir ; et ce plaisir là, il l’éprouvait surtout quand il se rencontrait avec Gustave Guiches, dont la compagnie le récréait, qui allait aussi au grenier Goncourt.
Mais voilà, quand il avait fait encore une de ces visites, il était comme honteux de cet acte, et il s’en vengeait tout de suite par des propos aigres à l’adresse de celui qu’il venait de quitter. Souvent même, il s’en vengeait d’avance ; et c’est ainsi qu’un dimanche, alors qu’il se préparait à partir pour Auteuil, il me dit :
— Je vais aujourd’hui faire monter le vieux à l’échelle !
Le vieux, c’était Edmond de Goncourt.
Devons-nous en blâmer Hüysmans ? Non. Et puis, cela ne nous regarde pas. Je constate seulement qu’il était moins bien intentionné qu’un autre fidèle, Gustave Toudouze, qui, lui, tous les dimanches sans en manquer un seul, accomplit le pèlerinage d’Auteuil, pendant une vingtaine d’années peut-être, et qui voulut, en hommage, couronner le tout en publiant chez Colin un volume des « PAGES CHOISIES » d’Edmond de Goncourt !
Imprudence suprême que l’orgueil du Maître ne lui pardonna point !
Certes, j’ai un dernier scrupule en racontant cela, car on m’accusera peut-être de ne pas dresser une apologie de Hüysmans, mais il s’agit ici d’un artiste considérable, et je persiste à croire qu’il convient de le montrer humainement, tel qu’il était. Ainsi, il continuera à nous intéresser mieux par ses propres faiblesses qui le rapprochent de nous.
Et puis, si j’écrivais cette apologie, à la façon d’un croyant qui épure une vie de saint, comme Hüysmans a écrit, par exemple, la vie de Sainte-Lydwine de Schiedam, je ne manquerais pas, c’est certain, de susciter bien des sourires et bien des railleries chez tous ceux qui l’ont connu.
L’on admettra aussi que je fais tout de même la part des choses. Car il faut se convaincre que l’homme qui a dit de la Société : « Elle me dégoûte profondément. Les classes dirigeantes me répugnent et les classes dirigées m’horripilent. Je me désintéresse absolument d’elles et ne désire que me retirer loin des deux »; n’était peut-être pas, au point de vue altruiste, ou simplement social, un modèle. Enfin. je ne fais après tout que suivre son propre exemple ; car, bravement, et même avec une certaine forfanterie, il ne s’est guère ménagé dans ses propres livres.
Ceci dit, sa vie littéraire, au surplus, est tellement belle et probe, que tout le reste ne vaut guère que comme des notules, je le répète, qui nous attachent encore davantage à elle. Ai-je eu tort, pour tout dire, d’aimer Hüysmans, « avec toutes ses verrues », ainsi que Montaigne aimait Paris ? S’il y en a qui me blâment, ce seront certainement ceux qui, de son vivant, l’accaparèrent ; mais de ceux-là, comme il le dit plus haut lui-même, je me désintéresse absolument.
Il faut remarquer que Hüysmans fut hostile aux maîtres qu’il avait choisis du jour surtout que la Mystique l’absorba tout à fait ; et, humainement aussi, il avait, à ce moment, changé ; car, alors qu’il habitait rue de Babylone, après son retour de Ligugé, je l’ai vu refuser son aide à un ami, qui venait lui demander de dire un simple mot dans un procès ; et, pourtant, cet ami ne lui avait jamais ménagé ses enthousiastes et vibrants articles.
Les catholiques me diront que c’est dans la règle, cela. C’est possible.
Cependant les candidats à la canonisation viennent bien en aide, eux, quelquefois, à leur prochain ; pourquoi les simples croyants sont-ils alors si résolument indifférents. Ah ! « les voies de Dieu » — comme disent les prêtres — sont décidément peu encourageantes !
Critique d’Art
ROGER MARX, dans une rarissime plaquette publiée chez Kleinmann, termine ainsi une magnifique et rapide étude de l’oeuvre de Hüysmans : « Certes, l’heure présente ne manque ni d’historiens érudits, ni de reporters à l’affût de l’actualité, ni de chroniqueurs séduisants et diserts, mais la suprématie de J.-K. Hüysmans demeure inattaquée. Qu’elle le veuille ou non confesser, la critique de maintenant descend de lui, à bien peu près, toute. Voyez la faveur qu’ont obtenue ses opinions, la hâte apportée à emprunter ses modes de parallèle et de contraste, ses coupes de phrases, jusqu’à ses vocables. Nulle action ne fut plus décisive et, à la vérité, s’en doit-on étonner ? Il n’était pas arrivé de rencontrer depuis Thoré un diagnostic aussi peu faillible, depuis Baudelaire le double don de la divination et de l’expression, qui fait des écrits esthétiques de J.-K. Hüysmans des pages définitives, et de leur auteur, en ce temps, non point un juge parmi les juges, mais une personnalité unique : le critique de l’art moderne. »
Ah ! rien n’est plus juste que tout ceci ! et ce n’est pas sous un autre jour qu’il convient de voir cet incomparable descriptif, qui fut une sorte de « fou furieux » de peinture, comme il le disait lui-même, et qui aima l’Art avant tout, par-dessus tout.
Lui demandait-on lequel de tous ses livres il préférait ? il répondait sans hésiter : Certains.
Et, en effet, il a bien prodigué dans ce livre de critique toutes les plus étranges et les plus inouïes pierreries de ses mots, je dis ses mots ; car il en inventa beaucoup, quand la disette des rares vocables l’agaçait.
Pendant des semaines il lui arriva de chercher des épithètes neuves ; et il était étonnamment joyeux quand il avait réussi enfin à en trouver, à les ciseler et à les parer de magiques éblouissements.
Son premier livre : le Drageoir aux Epices, Théodore de Banville le comparait déjà à « un joyau de savant orfèvre ».
Le talent descriptif de Hüysmans tout de suite, en effet, s’accusa. Il écrira plus tard des romans qui s’efforceront de raconter des tracas de vies humbles ou paysannes, des tristesses de collège ; mais, vraiment, il n’exultera que lorsqu’il sera face à face avec une peinture, même insane, même venue avant terme ; car, dans ce cas encore, il trouvera une énorme joie à projeter à coups de mots son dégoût, en songeant, par contraste, à de parfaites oeuvres dont il parlera ensuite pour se récréer.
Aussi, autant il était débonnaire parfois pour des romans que la foule vantait, pour des volumes de vers qui radotaient d’anciens lyrismes, autant il était exalté et prolixe quand il s’agissait de peintures et de critiques d’art.
Il estimait certes les opinions de Roger Marx, de Gustave Geffroy, d’Octave Mirbeau, d’Armand Dayot, de Georges Lecomte, de Louis Vauxcelles et de Gabriel Mourey ; mais tout le reste du lot des Aristarques débridait ses colères ou son ironie.
Je me souviens ainsi de son contentement quand il lut la préface que Mirbeau avait consacrée à des « Vues de la Tamise », exposées par Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel. La façon d’y traiter en passant M. Charles Morice l’enchanta. « Ce génie, dont le Monde haletant espère toujours une oeuvre, disait Hüysmans, n’avait-il pas fulminé autrefois, d’impudente façon, contre ce qu’il appelait : Le désert du naturalisme ? Et c’était risible, ajoutait Hüysmans, de si peu s’apprécier soi-même ; car rien, allons, n’est plus vain et plus stérile que toutes les oeuvres de M. Charles Morice, puisqu’elles n’existent même pas !...»
Dès qu’il l’avait pu, Hüysmans s’était. dans son grand amour de l’Art, jeté sur tous les peintres, indistinctement. Il se réservait de faire plus tard son choix, de l’appuyer d’arguments passionnés ; et tant mieux, s’il arrivait un jour à imposer des artistes inconnus, des oeuvres qu’on n’avait point encore vues.
C’est dans le Voltaire, dans la Réforme, dans la Revue littéraire et artistique, qu’il débuta comme critique d’art par de longs articles consacrés au Salon de 1879, à l’Exposition des Indépendants, au Salon de 1880, à celui de 1881 et encore à la nouvelle Exposition des Indépendants de cette même année.
C’était le temps où il était possible de dire toute sa pensée, d’exposer toutes ses opinions. Aujourd’hui, on résume en quelques lignes les plus valeureux efforts ; il est vrai qu’il y en a tant !
Rien n’est intéressant comme de relire ces lointaines critiques. On assiste à des inhumations cette fois sans appel, et aussi à des résurrections. D’autres artistes enfin n’ont jamais cessé de vivre et de produire, de mieux en mieux, d’excellentes oeuvres. On les revoit tous, et l’on se figure qu’il vous est réservé de rendre les définitifs jugements qui deviendront des « clichés » pour les âges suivants.
Déjà Hüysmans se révèle ici très aigre et très hostile. La banalité l’écoeure et la médiocrité l’enrage. Il y a en germe dans ces premiers articles toutes les magnifiques colères et toutes les cuisantes ironies dont déborde Certains ; et si les mots et les épithètes crient moins les enthousiasmes et les dégoûts, je me demande, tout de même, comment les peintres mis en cause et les lecteurs des feuilles hospitalisant de telles diatribes se retrouvaient, quand ils s’étaient secoués des fureurs de ce terrible homme.
Et il avait le toupet de célébrer de jeunes artistes, dont personne ne parlait, de les porter même aux nues ! Vraiment, c’était excessif. Puis il daubait sur les officiels, sur les grands Magnats de l’Art, sur les solennels bonshommes accablés de commandes et d’honneurs ! Ah ! le père Hetzel avait eu bien raison de dire à Hüysmans qu’il « faisait la Commune de la Littérature ! » Voilà maintenant qu’il se montrait encore tel qu’un impitoyable massacreur d’écoles et d’enseignement officiel ! Où voulait-il donc conduire les pacifiques bourgeois, les robustes « esquimaux porte-écailles », ce nouveau venu ?
Il les contraignit à admirer Degas, Raffaëlli et Forain, les trois maîtres qu’il préférait ; il les mata, — sans souci de leurs plaintes et de leurs rires ! — devant ces oeuvres qui apportaient en elles d’inouïs caractères de beauté. A l’opposé, il fit tant aussi, il projeta de telles invectives contre les médiocres et les indigents qu’il arriva peu à peu à empêcher les visiteurs de Salons de louer les Cabanel, les Bonnat, les Flameng et les patriotes de Neuville et Detaille.
Quand vous parcourez aujourd’hui ces pages, vous êtes émerveillé de ce clairvoyant critique à qui il plut, comme le dit encore M. Roger Marx : « de promener sur l’art ambiant le regard d’un voyant, d’opérer au premier coup d’oeil, dans le fatras des expositions, le tri de la postérité. »
Comme il restait aussi lui-même ! Et ce fut là son incontestable force.
Il ne s’en rapporta qu’à lui pendant toute sa vie. Quitte à se tromper lourdement, il exprimait brutalement sa pensée, toute sa pensée. Il ne dériva d’aucune école de critique. Dire ce qu’il voyait, et rien que cela ; et il répétait volontiers que « toute vérité est toujours bonne à dire ». S’il fut injuste, ce fut en toute sincérité.
Pour lui, le critique d’art devait être un sauvage, plus verrouillé que retiré dans la tour d’ivoire. Ainsi seulement il peut résister à tous les caprices, à toutes les sollicitations individuelles, à tous les élans irréfléchis, aux emballements trop vite débridés, aux craintes d’aller trop loin, d’en dire trop ou pas assez. Il ne doit pas être enfin un arbitre mondain ou même social retenu par toutes sortes de contingences, dans lesquelles l’Art d’abord ne trouve jamais son compte !
La vérité, il la formulait donc, telle quelle. Ses mots, quelquefois, faisaient sursauter ; peu importe, on les avait enregistrés ; par leur étrangeté, par leur violence, ils s’étaient tout de suite imposés.
Aussi, il arrive ceci : c’est qu’il est impossible présentement de parler de Degas, de Raffaëlli ou de Forain sans songer aussitôt à Hüysmans.
Soyons toutefois précis : il n’a pas tait, bien entendu, ces peintres ; il ne les a même pas aiguillés ; mais, dans notre admiration actuelle, il entre beaucoup de choses dites par Hüysmans, et ce, malgré nous. Oui, quand nous voulons encore essayer d’expliquer pourquoi ces maîtres ont toujours du talent, nous sommes forcés de répéter à peu près identiquement tout ce qu’avait écrit Hüysmans, il y a une trentaine d’années.
On le voit : pour ces maîtres, la critique n’a plus beaucoup raison d’être !
Néanmoins, Félix Fénéon remarque avec justice dans un numéro d’Art et Critique, qu’avant Hüysmans, Théodore Duret avait fêté l’impressionnisme naissant ; « mais son style incolore, ajoute-t-il, n’avait pas fait une grande trouée. »
Il est incontestable que, mieux aussi que Duranty, cet autre promoteur de l’Impressionnisme, Hüysmans fixa tous les regards vers les maîtres qui sont aujourd’hui classiques ; cela, Félix Fénéon, dans la Libre Revue, et Gustave Geffroy, dans la Justice, le dirent expressément par de lumineux articles.
Ça n’allait point sans horions, inefficaces, d’ailleurs.
Des feuilles, depuis longtemps mortes, fulminèrent contre « ce Hüysmans sans grand talent », contre « ce pauvre jeune homme ! » (sic). L’Illustration même, toute vouée à Lefebvre, Bonnat et consorts s’inquiéta ! Une gazette enfin s’indigna parce que des journaux italiens, américains et anglais avaient parlé longuement de « ce critique », qu’elle déclarait, elle, renvoyer dans « sa brumeuse Hollande ! ».
Mais la Hollande n’eût peut-être pas voulu, elle non plus, accepter ce critique révolutionnaire et enragé.
Et dire qu’il était (on en conviendra !) le peu banal aboutissant d’une longue lignée de peintres s’imaginant que l’on ne pouvait pas marcher sans la noble béquille d’invariables maîtres ! croyant fermement qu’il y avait d’immuables recettes pour peindre les ciels, l’eau, les arbres ; redoutant enfin toute manière différente de peindre comme une embûche, comme une trahison !
Aussi bien, Hüysmans resta à Paris.
Il y demeura plus exaspéré, plus « fou furieux » d’art que jamais ; et, un beau matin, il publia Certains.
Alors, il fut de nouveau très attaqué et très soutenu. Le livre méritait, certes, toutes les louanges et toutes les haines.
Dans l’amas des articles qui lui furent consacrés, j’ai glané pour cette oeuvre préférée de Hüysmans quelques opinions caractéristiques. On aura ainsi une idée d’ensemble des propos qu’elle suscita.
D’abord, tandis que la Revue des Deux-Mondes laisse tomber dix lignes indigentes, M. Henry Bauer, lui, y va carrément dans l’Echo de Paris, et il loue, et il recopie des phrases du livre, après avoir commencé par remarquer que Hüysmans « vit à l’écart, qu’il plane au-dessus de son temps ! » Le Voltaire se glorifie d’un pénétrant commentaire de M. Roger Marx ; et Jean Lorrain, dans l’Evénement, écrit enfin le plus incisif et le plus vibrant article qui soit.
Alors l’Echo de Paris revient à la charge ; et, cette fois, sous la signature de M. Lepelletier, déclare que « ces Certains portraits d’art sont très curieusement fouillés ! » M. Retté affirme que : « M. J.-K. Hüysmans est un des princes de l’épithète, un instaurateur, en de magiques synthèses, des mille façades d’un Moi nostalgique ! » Mais les Rosny, eux, ne sauraient se contenter d’une telle phrase lapidaire ! Ils publient dans la Revue Indépendante un long article dans lequel ils parlent « d’une langue forgée, martelée, avec toutefois certains adjectifs pénibles, sortant imparfaits de la forge ! » Ils continuent en disant que « les opinions banales se magnifient en passant par l’écrivain » ; et ils terminent en faisant la guerre aux « éreinteurs du temps présent ! »
Cela, c’est parce que Hüysmans a le tort de ne point aimer assez, au gré des Rosny, son prochain.
En Belgique, M. Eugène Demolder qualifie d’étroit le pessimisme de Hüysmans. « C’est, dit-il, un pessimisme fermé d’aristocrate, que le détail choque, à qui une fausse note en une symphonie procure des migraines, et qui se plaint que les bahuts du Musée de Cluny puissent être copiés par les ébénistes de la camelote. Son néant est fait d’un manque de livres vraiment artistes, et ses blessures sont des picotements. Sybarite de l’esprit, une feuille de rose mal peinte gâterait son repos. »
Plus loin, M. Demolder note plus justement, à mon avis, que Hüysmans « écrit simplement pour le plaisir du verbe, de la couleur et de la vie rendue. »
Et un autre écrivain belge, M. Jules Destrée, formule, dans l’Artiste, la même opinion : à savoir que Hüysmans est « dans le bon sens du mot, un rhéteur ».
Cela me semble tout à fait exact. Oui, toute la merveilleuse force de Hüysmans est là : écrire avant tout de prestigieuses phrases !
Un jour que je lui demandais s’il tenait tant que cela à Félicien Rops (auquel il a consacré dans Certains le plus long chapitre), en lui disant que ce graveur m’apparaissait comme un artiste bourgeois, foncièrement imbu de traditions académiques, et, au surplus, d’une imagination érotique vraiment étroite, il me répondit :
— Rops! Mais c’est toute une mine de phrases ! Quant au reste, le seul fait que les magistrats et les notaires se jettent sur ses planches indique assez quel piètre artiste il fut ! Convenez qu’il m’a largement permis de me divertir, avec toute sa luxure de promenoir ! Ah! non, croyez-le, je n’ai pas songé un seul instant que le plus débile des Japonais ne lui était pas cent fois supérieur ! Ces gaillards-là, à la bonne heure, ils ont fait, eux, des estampes terriblement libertines. Rops, c’est toujours comme un Benoîton qui serait dévoré de luxure. Ses femmes sont de pesantes harengères qui ne raccrochent guère, même quand il les pare de bas noirs et de chapeaux fous. Son art, c’est de la brocante de sexes, du laissé-pour-compte de maisons closes !
Alors comme je disais que Théophile Gautier et Paul de Saint-Victor avaient aussi enguirlandé quelquefois de médiocres peintres, Hüysmans me jeta ;
— De même pour Odilon Redon ! Je ne suis pas tombé dans ce panneau-là ; mais c’était si amusant de parler d’un homme qui déforme comme s’il avait une boule de verre pleine d’eau dans l’oeil !
« Ah ! les monstres de Goya sont autrement vivants et impressionnants que ceux qu’a fabriqués ce lithographe ! Je ne nie pas, certes, sa virtuosité dans son métier de graveur ; ses pastels aussi ont quelque éclat ; mais tout cela, en résumé, est déséquilibré et absurdement loufoque ! Oui, c’est bien la nature vue, comme je vous le disais tout à l’heure, à travers un aquarium !
Des formes cocasses, des monstres anatomiquement impossibles, cela tenta Hüysmans. Il y avait encore ici matière à des phrases et cela lui suffisait. M. Odilon Redon en a profité !
Quel double jeu agaçant, néanmoins ! Au premier abord, Hüysmans a l’air d’attacher de l’importance aux oeuvres de M. Redon — ainsi qu’à celles de Félicien Rops ; — puis si on le pousse à bout, à propos de ces deux graveurs, ses opinions alors apparaissent chancelantes.
Un critique d’art poète, voilà donc au fond ce qu’il était ! et il était cela absolument, entièrement ! Il sacrifiait tout à sa joie d’écrire.
C’est dans le même esprit qu’il consacra au peintre mystique Charles-Marie Dulac des pages dans la Cathédrale et un long chapitre dans De Tout.
Je veux bien croire que ce franciscain « hors les murs de tout monastère » l’intéressait en faisant de la peinture religieuse. Il lui consacra même des phrases très tendres, s’extasiant sur sa série des églises, sur cette autre des sites de France, sur ses lithographies, qu’il appelait des « gloses de prières et des stades d’âmes ! » Des vues d’Assise, de Subiaco, de Fiesole, de Ravenne et de Rome l’avaient aussi charmé : mais quand toutes ces oeuvres surtout de piété furent exposées chez Vollard, rue Laffitte, elles ne déclanchèrent point l’approbation des peintres ; — et je ne vise ici que des maîtres, à commencer par Pissarro qui s’étonna que Hüysmans eût exalté cet artiste, inspiré sans doute, mais dont le métier était à peu près inexistant.
Hüysmans, lui, était dans sa règle : il avait trouvé un peintre pieux, il l’encensait, en se donnant le luxe, cette fois, d’écrire avec une plume détachée de l’aile d’une colombe. D’excellents professionnels seraient surpris ; bah ! cela ne comptait guère.
De même, il s’était enthousiasmé pour l’art patient, minutieux et d’orpailleur de Gustave Moreau.
C’est que là il avait trouvé tout un inventaire de pierreries serties sur des corps d’hippogriffes, sur d’étranges fleurs, sur des nudités de femmes, sur des Salomés dansant en offrant du bout des doigts un rigide lys. Et, comme il l’avouait, cet « onanisme oculaire » l’avait transporté. Il avait été extrêmement joyeux d’avoir à décrire toutes ces flores, ces nénuphars, ces pyxides, ces calices et ces algues qui brillaient sans mesure dans le bleu fou d’un fleuve.
Pourtant, aujourd’hui, le souvenir de Gustave Moreau revit à peine dans l’esprit de ses disciples. Ses aquarelles sont devenues ternes et grises, et ses peintures sont mornes.
Je veux bien que la « salauderie des marchands de couleurs » comme dit Hüysmans, en soit un peu la cause; tout de même, en établissant le compte, le dessin, la composition au moins restent ; et tous les tableaux de Moreau, ce ne sont que des décors pour un grand ballet de music-hall.
Mais Hüysmans a débusqué aussi, on l’a vu, d’authentiques artistes que le temps n’a pas blessés ; et il a eu raison dans Certains de leur consacrer les pages définitives qui demeurent pour nous, au surplus, de parfaits modèles de critique d’art.
Nul n’a aussi bien que lui parlé de Degas. Le grand peintre de la vie moderne, qui a bien touché à peu près à tout, ce qu’il est présenté, expliqué, choyé !
Etudes de nus, danseuses, ah ! le déterminé misogyne qu’était Hüysmans se détend ici à son aise 1 Comme il se délecte à fouiller les tares physiques de la femme, à la montrer batracienne et simiesque ! Ah ! ce qu’il insiste sur les tubs et sur les pansages auxquels elle doit se soumettre chaque jour pour retaper le « fripement » de sa chair !
Raffaëlli, maintenant. Il en commente l’admirable « Belle matinée », que l’on a laissé partir pour l’Amérique, comme si nous étions tellement riches d’incontestables chefs-d’oeuvre ! Puis voici d’extraordinaires scènes de café-concert, un hilarant et formidable quadrille aux Ambassadeurs, du temps de ce Valentin le désossé qui fut une des convulsions de Paris ; mais Hüysmans n’oublie pas pourcelales paysages suburbains que Raffaëlli a imprégnés de tant de douloureuse poésie ; et où des êtres étiques, souffreteux, n’implorent plus le ciel, d’où retombent sans cesse d’épaisses fumées et des nuages de suie !
Le critique ne serait plus lui-même s’il ne se faisait pas la main, à présent, en écorchant toutes vives de trop notoires renommées ; et, dans le tas, il choisit Stevens et James Tissot,
Le premier mérite cependant une louange mitigée ; mais comment défendre le second, celui qui ne craignit pas de saboter pour la maison Marne, à Tours, les légendes des Evangiles! Toutefois Hüysmans ne vise pas ici les honteux méfaits de ce bondieusard, et nous y perdons beaucoup ! Il eut été agréable de voir cet « illustrateur » subir la torture à laquelle sa médiocrité avérée lui donnait incontestablement droit.
Une page seulement est consacrée à Cézanne ; mais c’est une page très juste, très complète. Constatons, d’ailleurs, que les critiques, depuis, ont largement — et sans profit, — accablé de leurs proses cet original peintre, d’abord très naïf, et qui étonna tout le monde en se révélant, dit-on, sur la fin de sa vie, tel qu’un rusé négociant, très entendu aux affaires.
Quant à Forain, il sait bien le premier qu’il doit tout à Hüysmans, Une réelle et ancienne amitié liait les deux hommes. Et Forain « marcha » très vite. Il fut bientôt populaire. L’écrivain conserva longtemps chez lui d’hennissantes aquarelles de son ami. Comme elles représentaient des étals de filles nues, elles disparurent un jour pour faire place à des estampes pieuses. Non par « bégueulerie » de l’auteur d’En Route ; mais il avait déjà assez à faire pour « se pouiller l’âme ! », comme il disait et ces aquarelles raccrochaient véritablement trop !
Le chapitre consacré à Chéret mit aussi en pleine vedette ce charmant tenorino de la Rue. Hüysmans se grisa de toutes ces trouvailles de gestes et de couleurs ; et il épingla sur cet art léger, primesautier, spirituel, ce qualificatif : une « dînette d’art, exquise ».
Enfin, après un hommage rendu à M. Théodore Duret, « l’auteur des vigilantes et sagaces critiques d’avant-garde », Hüysmans fait sa révérence à James Mac Neil Whistler.
C’est que le visionnaire des fameux « Nocturnes », des féeriques et fantomatiques vues de la Tamise, était pour l’enchanter ; et il lui plut étrangement par son art que le peintre avait appelé lui-même: « une divinité d’essence délicate, tout en retrait ».
J’ai dit ce que Hüysmans pensait de Félicien Rops, qui prend, dans Certains, la plus grande part. Et il la prend, parce que l’écrivain a pu se vautrer sur un sujet qui lui fut particulièrement cher : la Luxure.
Avec quelle ivresse non contenue, il s’attarde, après avoir rejeté les innocents badinages des Fragonard, des Boucher, des Baudoin, des Gavarni et des Devéria — auprès d’abord des Rowlandson et des Japonais !
Quel ragoût de gestes érotiques lui fait flairer le caricaturiste anglais ! Alors, il n’en finit pas, lui non plus, de retrousser — avec des phrases — les filles que des hussards vrillent sur des tonneaux, sur des coins de table. Cette gaillardise éperdue le met en liesse. Un à un, il retient tous les gestes, tous les sursauts amoureux. Et c’est toujours très amusant et très gai, pas du tout obscène !
Mais avec les Japonais, c’est une toute autre rage ! Ils sont effroyables quand ils salopent des poses ; et il écume une de leurs terribles estampes : La Pieuvre, qui appartenait à Edmond de Goncourt. C’est d’une souffrance et d’une angoisse atroces.
J’ai gardé longtemps trois albums japonais que Hüysmans m’avait donnés. Il les collectionnait volontiers. Ceux-ci contenaient de frénétiques images où l’imagination la plus furieusement bestiale avait déliré. Dans des palais, en bateau, dans des intérieurs, devant des boutiques, au beau milieu de la rue, où bâillaient des foules, d’exceptionnels sex.es mis en branle se noyaient dans des marais. Et ce qui surtout empoignait, c’était la couleur violemment prodiguée, éclairant comme de lampions neufs tous les détails de la scène !
Avec Félicien Rops, Hüysmans fut à l’aise. Et comme je comprends sa prédilection pour ces pages-là, si singulières et si magnifiques ! Il ne les dépassera jamais par la suite ; et personne sans doute ne les égalera, d’ici à longtemps. Quel lot d’épithètes rares, quelles phrases bondissantes, vives, passionnées, quelles images hardies, étonnantes, exactes ! Voilà le plus grand artiste, incontestablement, des Lettres françaises ! Qui fut plus peintre que celui- là ? Qui déploya jamais une plus souveraine pompe de mots ?
Je ne résiste pas au désir de reproduire ici les descriptions dont il flambe certaines planches de la série des Sataniques :
« L’une, « le Sacrifice », atteint, écrit-il, à l’épouvante. Sur un autel, une femme nue est étendue, les jambes écartées ; au-dessus d’elle, un être ineffable dont le dos est fait par le squelette d’une tête de cheval, trouée de deux yeux vides, avec, au bout du museau descendu à la place des reins, deux longues dents, est surmonté d’une tête obscure qui se détache dans un ciel bouleversé, sur un croissant de lune. Les bras maigres forment des anses de chaque côté de ce corps terminé, sans croupe, par une sorte de thyrse, par une double vrille qui plonge dans le bas-ventre de la femme, la cloue sur la pierre tandis qu’elle clame, éperdue d’horreur et de joie !
« Ce qui est unique, c’est l’impression que dégage cette effrayante page. Ce démon si étrangement figuré, est là, immobile, impitoyable, campé en quelque sorte dans sa victime dont il n’entend même pas les râles. Sa tête, traversée par la corne lunaire et dont on ne voit que la nuageuse nuque, songe, loin de la terre, alors que le pieu festonné de ses génitoires baigne dans des flots de sang. C’est affreux et grandiose, d’un symbolisme aigu de Luxure échouée dans la mort, de Possession désespérément voulue, et, comme tout souhait qui se réalise, aussitôt expiée.
« Dans une autre, « l’Idole », la femme acquiert, elle aussi, son Dieu, un Satan, effroyable encore, une sorte d’Hermès, à gaîne de pierre, une tête souriante et lascive, ignoble avec son front bas, son nez cassé, sa barbe de bouc, sa lippe velue qui suinte. Il est là, droit, dans un hémicycle de marbre, planté de phallus dont le bas s’hermaphrodise, entre deux pieds de chèvres ; à droite, un éléphant se stimule avec sa trompe.
« Et la femme a bondi sur le monstre, elle l’étreint d’un mouvement passionné, féroce, reste suspendue à ce ventre qui la perfore, regarde l’abominable Amant, avec des yeux stridents dont l’allégresse effraie.
« Cette figure est vraiment magnifique ; jamais la violence de la chair n’était ainsi sortie d’une œuvre; jamais expression d’infini, d’extase, n’avait ainsi décomposé, en la sublimant, une face. Il y a d’une Thérèse diabolique, d’une sainte satanisée, en prière, dans cette créature accouplée, attendant la minute suprême qui se changera en une inoubliable déception, car tous les documents l’affirment, la femme qui fait paction avec le Diable, éprouve, au moment final, l’indicible horreur d’un jet de glace et tombe, aussitôt, dans une inexprimable fatigue, dans un épuisement intense.
« La dernière planche enfin, s’intitule : « le Calvaire, » et c’est le Maudit qui se dresse à la place du Christ sur le gibet infâme, le Maudit, ricanant avec une tête où il y a du paysan vicieux, du Yankee et surtout du Faune, un Satan bestial, vineux, immonde, avec sa gueule en tire-lire et ses dents de morse. Et il sourit, la mentule en l’air, et, de ses pieds décloués qu’il écarte, il atteint et tire la crinière d’une femme, nue, debout devant lui, et lentement il l’étrangle avec le lacis de ses cheveux, alors que, terrifiée, les bras étendus, elle agonise, dans un spasme nerveux, d’une jouissance atroce.
« La fiction dérisoire de cette scène, le sacrilège de cette croix devenue un instrument de joie, le stupre de cette Madeleine en extase devant la nudité de ce Christ, à la verge dure, toute cette Passion utérine qu’éclaire une rangée de cierges dont les flammes dardent dans les ténèbres comme des lancettes blanches, sont véritablement démoniaques, véritablement issus de ces anciens sabbats qui, s’ils n’existent plus maintenant à l’état complet et réel, n’en sont pas moins célébrés, à certains instants encore, dans l’âme putréfiée de chacun de nous. »
Reprenez aussi les pages consacrées à l’énigmatique Jan Luyken, — au Monstre : c’est là qu’il chevauche au-dessus des fantaisies de M. Odilon Redon ; relisez également ces chapitres : le Musée des Arts décoratifs et l’architecture cuite ; le Fer; la salle des Etats au Louvre ; et les pages accordées à Millet, à Goya, à Turner et à Bianchi ; et vous vous direz qu’il est tout à fait juste de considérer avant tout Hüysmans comme un peintre en prose, amoureux des territoires neufs, des peintres honnis des bourgeois, et recherchant même ceux-là, nous l’avons vu, parmi les médiocres, quand il y a pour lui matière toute trouvée pour d’étranges prouesses de style.
Un tel artiste peut-il donc, un jour, être un converti docile, ne voyant plus, ne jugeant plus, ne décrivant plus ? Certainement non ; ce serait contraire à toute pensée saine, et aussi bien l’on sait que ses livres qui vont suivre sont encore tout imprégnés d’art et de critique.
Seulement, naturellement, il évoluera. Quand il sera en plein dans la Mystique, il condamnera beaucoup d’œuvres, qu’il continuera à admirer en dessous. Ainsi, lui qui a goûté beaucoup à un moment les Primitifs italiens, ne l’entendra-t-on pas répondre à quelqu’un qui lui demandait son opinion précise touchant ces peintres :
« — Ce qu’il y a dans presque tous ces Primitifs là, sauf l’Angelico ? Il y a de la sodomie. On n’y voit qu’éphèbes aux longs cheveux d’or, au teint mat, aux yeux alanguis, qu’androgynes-énigmatiques, qu’êtres mièvres et insexués ! Certes, j’aime les Primitifs italiens. Mais, pour moi, les grands mystiques, en peinture, ce sont les Flamands. Ceux-là, voyez-vous, sont les Maîtres. Mais c’étaient des mystiques d’un réalisme intense. On parle de l’Ecole de Cologne, dont les peintres étaient, disait-on, « des fils de harpe, des anges blancs ! » L’école de Cologne n’a valu quelque chose qu’après le passage des Flamands, après avoir subi leur influence. Oh ! je sais bien que les néo-chrétiens dont les chefs sont les Desjardins, les Vogüé, préfèrent les Italiens. Mais ça, c’est le mysticisme des pions, n’en parlons pas, c’est trop bête ! Il n’y a qu’un seul mysticisme, c’est celui de Saint Jean de la Croix et de Sainte Térèse ! »
Et il revient à ses flamands. Dans Là-Bas, il a déjà clamé toute sa ferveur pour le farouche Mathaeus Grünewald, dont une Crucifixion découverte dans une petite salle du Musée de Cassel l’a rempli d’horreur et de joie. Dans Trois Eglises et Trois Primitifs, il rejoint ce Mathias Grünewald d’Aschaffembourg, et il décrit encore prolixement son Crucifiement et sa Résurrection qu’il a contemplés cette fois au musée de Colmar.
L’on constate toujours que cela lui convient bien mieux que les descriptions de ses états d’âme, alors qu’il s’alarme dans une Trappe.
Aussi, avec son autre livre préféré: La Cathédrale, va-t-il redevenir très heureusement tout-à-fait lui-même ; car il aura l’occasion de faire montre derechef de ses éblouissantes qualités de critique d’art.
M. Camille de Sainte-Croix a remarqué très justement que c’est par les sens que le mysticisme a conquis Hüysmans :
« Lisez La Cathédrale, dit-il, vous y trouverez non point une prédication apostolique, mais une éclatante et furieuse interprétation des styles de toute architecture gothique, romane, byzantine ou jésuite. Il a médité devant la pierre, le marbre, les vitraux, les boiseries, les dorures, les fers forgés, les ciselures et les fresques. Et les yeux pleins de visions, il en a écrit la flamboyante interprétation, selon le rythme de son rêve, ne songeant à revêtir toutes ces formes de significations et de sous-entendus métaphysiques que pour obéir à son impérieuse et supérieure vocation de grand artiste : traduire des colorations, donner une âme aux choses et créer des images. »
Au lendemain de la publication de La Cathédrale, au-dessus du flot des comptes-rendus, M. Roger Marx eut la plus ingénieuse idée d’illustrer le sien par des photographies de divers aspects de la basilique et de placer au-dessous de ces images les phrases correspondantes du livre.
On vit alors nettement avec quelle conscience, avec quelle sûre virtuosité de mots exacts, avec quelle surprenante clairvoyance, Hüysmans avait étudié, scruté toutes les physionomies de Notre-Dame de Chartres, toute son anatomie même, depuis le jet de la nef jusqu’aux contreforts, armés comme des roues.
« Hüysmans, dit au surplus M. Roger Marx, atteint à une pénétration intense, à des équivalences littéraires vraiment spéciales dans ses descriptions de tableaux, de portails, de verrières, de sculptures, et des pages moins fières ont assuré l’immortalité d’un livre. Les anthologies ne guettent-elles pas sa version du Couronnement de la Vierge par Fra-Angelico, puis cette tumultueuse évocation de la rangée de grotesques qui courent au-dessus du porche à Notre-Dame de Dijon ? »
Et, vous voyez, j’ai écrit cette dernière phrase, parce que je tiens à vous donner le plaisir de relire tout de suite ce pittoresque tableau :
« Ils étaient là (écrit, avec quel entrain ! Hüysmans), grimaçant en des lignes serrées, jaillissant de la pierre en un pêle-mêle de religieuses démentes et de moines fous, de terriens ahuris et de villageoises cocasses, de coquebins tordus par un rire nerveux et de diables hilares ; et, au milieu de cette horde de réprouvés hurlant hors des murs, surgissait, entre deux démons qui la tourmentaient, une figure réelle de femme, s’élançant de la frise, tentant de se ruer sur vous, des yeux dilatés, hagards. les mains jointes, elle vous supplie, terrifiée, désigne le lieu saint et vous crie d’entrer ; et l’on s’arrête, interdit, devant ce visage décomposé par la peur, crispé par l’angoisse, qui se débat dans cette meute de monstres, dans ces visions irritées de larves. Farouche et charitable à la fois, elle menace et elle implore, et cette image d’une éternelle excommuniée, chassée du temple et reléguée à jamais sur son seuil, vous hante comme un souvenir de douleur, comme un cauchemar d’effroi. »
Mais si Hüysmans admire passionnément les aspects de sa cathédrale, la préférée d’entre toutes les autres Notre-Dame de France, il ne ménage point, en passant, ses railleries pour quelque détail de son ornementation que lui ont infligée les prêtres ; pour cette odieuse « cohue de déicoles, par exemple, appartenant à cette catégorie dite article de Munich, dans les magasins de la rue Madame ! »
— Ah ! ces Marie peintes avec le vert glacé des angéliques ! répétait-il. Et ces Madones considérant d’un oeil béat leurs pieds ! et ces Saints Antoine de Padoue, frais et léchés ! et ces Saintes Madeleine pleurant des pilules d’argent !
Mais cela compte peu si l’on met en parallèle tous les cris d’admiration que la prodigieuse basilique lui fait jeter.
Comme il l’aima ! Que de dimanches, que d’après-midi même prises sur le temps de son bureau, il consacra à des voyages à Chartres !
Au Ministère, — et il était par surcroît, on le sait, à l’Intérieur ! — on voyait de mauvaise manière ce qu’on appelait ses « tendances cléricales »!
On ne l’avait pas décoré, répétaient ses chefs, pour qu’il « se moquât ainsi du Gouvernement ! » La situation, pour tout dire, s’était bientôt tendue. Aussi, écoeuré, las de tous ces cuistres, leur jeta-t-il bientôt à la tête son départ. cette fois, enfin, définitif.
« — Je prépare un livre complètement illisible, me dit-il, un jour, en parlant de sa « monographie » de Notre-Dame de Chartres. Il rebutera mes meilleurs amis et il écartera tout à fait les autres. Mais, en attendant, ce qu’il est dur à raboter ! Je passe des nuits à prendre des notes dans un tas de bouquins. Heureusement qu’un ami me les apporte de la Bibliothèque, sans quoi je ne vois pas comment je m’en sortirais ! »,
Quand le livre fut terminé, il y avait, avec les notes prises, de quoi remplir cinq gros volumes ! Et l’on accusait Hüysmans de lenteur !
Ce fut du moins et exactement le propos tenu devant moi par un éditeur notoire, maquillé d’un ruban rouge.
Notre Cafe
C’ÉTAIT un petit café paisible et fané.
De vieilles dorures achevaient de se noircir là-haut dans les corniches et tout autour de scènes mythologiques que l’on avait brossées avec une délicatesse inusitée de tons.
Jamais un homme bruyant n’entrait là. On y eût entendu voler une mouche ; puis, soudain, comme une espèce de cyclone, des dominos que l’on remuait, fracassaient.
La caissière était une personne très effacée par le temps ; une veuve, sans doute, revenue depuis bien des années des orages de la vie. Elle plaisait au regard ; elle avait un menu sourire chaque fois qu’un de ses clients entrait ; puis elle se remettait à écrire des comptes qui n’en finissaient pas ; et c’était inexplicable pour ce petit café si désuet.
Deux garçons apportaient les mazagrans et les bocks ! Combien de ces tabliers blancs avaient passé ici avant qu’on retînt ceux-là ! Nul ne le savait ! Enfin le choix était cette fois parfait. Ah ! ces deux garçons discrets et pacifiques, souvent je pense à eux, quand il m’arrive de subir — entré par force dans un café — la grossièreté et le vacarme d’autres « louffiats » qui ne viennent qu’après des appels réitérés, vous servent en rechignant et ne vous remercient aucunement, bien entendu, en empochant votre pourboire !
Pour eux, pour la caissière si humble, pour le petit café si paisible, nous y fûmes quelquefois, Hüysmans et moi.
Ah ! certes, bien que pour les Types de Paris, de son ami Raffaëlli, il eût écrit le poème en prose des Habitués de Café, il n’était guère, lui, un de ces habitués ; mais il me disait, certains soirs d’accablante chaleur : « Ah ! j’ai toujours le temps de rentrer dans mon chauffoir ; allons prendre un bock ! »
Et l’on y allait, et nous causions.
Conversations à bâtons rompus que j’ai notées au fur et à mesure, sans penser qu’un jour je me plairais à les transcrire.
Mais — je m’en rends compte, maintenant — combien de mots j’ai oubliés ! Combien d’autres aussi que je ne veux point dire ici pour ne pas désabuser beaucoup de gens qui croient encore qu’ils étaient, eux, ménagés par le peu commode écrivain.
Il me parlait volontiers des quelques voyages qu’il avait pu réaliser ; et, comme je devais partir à ce moment-là pour l’Allemagne, il me dit, un soir :
— Ah ! surtout, n’oubliez pas d’y visiter Hambourg. Quelle ville ! et ce qu’elle est remplie de juifs et de filles ! Ah ! il y a tout ce qu’il faut là-bas pour drainer votre bourse ! Suivez n’importe quel juif d’aspect sordide, et il vous conduira dans un immonde locatis où il recèle les plus mirifiques diamants du monde et les plus fabuleuses pierreries ! Quant aux filles qui y pullulent et y purulent, ce qu’elles sont — en outre de leur savoir-faire spécial, — joyeusement patriotes, avec leur manie de saluer toutes, avant l’effusion des sens, l’image de leur Empereur qu’elles gardent au-dessus de leur lit ! Ça dégote un peu nos rapetasseuses d’ici, hein ?
— Oh ! répliquai-je, il y a à Paris des maisons qui affichent, au salon, les mémorables batailles de Napoléon !
— Oui, mais à Hambourg, me répondit-il, les filles ne vivent pas sur le passé ; le présent seul les passionne ; et c’est mieux : elles montrent ainsi un esprit nouveau qui doit prendre davantage les goujats d’aujourd’hui. Tenez, je vous montrerai chez moi une saisissante photographie du maréchal de Moltke ! C’est une de ces cataux qui me l’a donnée ; et vous lirez ce qu’elle a écrit au bas de cette face de monstre, aux oreilles en escalope, qui tient de la vieille sorcière et de la hyène !
— Qu’a-t-elle écrit ?
— « A ma chère petite fleur » !
— C’est gentil !
— N’est-ce pas ? Pour apprécier cela, il faut connaître les formidables assauts que ces limonières subissent ! Sans doute, il y a partout de solides et rudes putassières mais dans ce fantastique Hambourg, c’est le dessus du panier assurément qui besogne sans trêve. Et avec quels gens ! Toute la vermine du négoce, pompée sur toute la terre, est déversée là ! C’est un ramassis de crapules qui est, ça, je l’avoue, d’un vif attrait ! On ne voit nulle part comme ici l’indéniable malpropreté des affaires, que, de part et d’autre, riches et pauvres, on ne trame qu’à coups de goinfreries et de saouleries ! Alors, quand les guenipes excédées de fatigue vantent « la petite fleur », vous conviendrez que c’est plutôt drôle !
— Mais, dis-je, les voyageurs racontent assez volontiers que les femmes allemandes n’attribuent aucune importance au rapprochement des sexes ; ce qui ainsi ferait croire que « la petite fleur » se développe, et vit, là-bas, tout naturellement, au-dessus des lits.
— Certes, l’Allemande se laisse facilement assaillir et sans y chercher midi à quatorze heures. Elle est benoîte et de bonne composition. Ça repose des simagrées des Parisiennes, qui, sans attribuer plus d’importance au coucher, le retardent, par gredinerie sournoise, de quelques heures. Tout de même, elle pourrait être, la Gretchen, un peu moins sans-gêne dans ses rapports. Ainsi, très carrément, elle viendra pour vous embrasser aussitôt après avoir mangé des rôties chaudes qu’elle a beurrées de fromage ; ça, peut-être, c’est aller un peu loin !
— Oui, dis-je, il n’est guère possible, avec la meilleure volonté du monde, de célébrer cette femme-là ! Par contre, on a beaucoup vanté les brasseries allemandes. Est-il exact qu’elles soient aussi bien que cela ?
— Oui, c’est ce qu’ils ont de mieux, les AIboches. Ce sont des salles hautes comme des cathédrales ; et il y règne un silence relatif qui ne ferait guère l’affaire de nos braillards d’estaminet. On y fume et l’on y boit, pour ces deux plaisirs-là uniquement. Ils ont, c’est certain, d’étonnantes faces qui ne vous reviennent pas trop ; mais, ce que c’est bon de ne pas entendre des gens s’abreuver d’injures à propos d’un voyou de la Politique ou d’un discours ministériel ! Et, parfois, il y a de la musique qui vous change aussi des rigodons ou des airs tronqués qu’on rabiboche à Paris, dans les tavernes.
Et notre causerie se prolongeait.
Autour de nous, il y avait quelques allées et venues ; mais, combien elles étaient calmes ! Sans se faire appeler, un des garçons venait, prenait la commande ou rendait la monnaie, sans bruit.
Ce petit café était trop insolite ; il ne durerait plus longtemps, maintenant !
J’en fis un soir la remarque à Hüysmans.
— Ah ! oui, nous en verrons bien la fin ! dit-il. Du reste, le patron est sur ses boulets. Il doit envier, cet homme, quoiqu’il soit chenu, les tavernes du jour, où l’on tapage sans répit et où de la musique de bastringue flonflonne. Sans compter que s’il ne pense pas à s’en aller, lui, à l’expiration de son bail, c’est le propriétaire qui l’expulsera, pour édifier sur ce pacifiant refuge un palace rempli de glaces et de quincaillerie, qu’il louera ensuite autrement cher. Le règne des mufles est bien venu, avec cette invasion de sud-américains et de troubadours qui a décidé de tout !
— Mais, dis-je, vous savez que c’est vous que M. Charles Maurras traite d’étranger et de barbare.
— Ah ! oui, l’homme de race latine, dont il se vante ! Il n’y a pas de quoi pourtant ! Prenez les hurleurs de la Chambre, et dites-moi s’ils ne sont pas tous de ce Midi odieux ! J’ai déjà écrit qu’elles empoisonnaient le pays, ces faces d’ébène et de pain trop cuit ! Il doit être aussi de leur Midi, ce Grosclaude qui, à propos d’un de mes livres, salopa un article sur les esprits frappeurs ! Si vous comprenez quelque chose à cela !
— Bah! fis-je, M. Grosclaude est un fantaisiste, et il cherche par cela même toutes les occasions d’être spirituel.
— Alors qu’il me fiche la paix, s’écria Hüysmans. Est-ce que je m’occupe des balivernes de tous ces plaisantins ! Nous n’avons rien de commun entre nous, il me semble ! Je suis peut-être le seul qui ne s’esclaffe pas à propos de leurs élucubrations, mais je suis celui-là ! Ils me dégoûtent autant que les illustrateurs de livres, ce n’est pas peu dire !
— Cependant ! ...
— Non ! Si mauvais que soit un bouquin, dites-vous bien que les gravures sont pires. On est toujours volé dans ce mic-mac là !
— Mais vous avez laissé Lepère illustrer A Rebours ?
— Oui, et je ne m’en félicite pas outre mesure. Et encore Lepère est-il un homme de goût et un artiste sûr ! Aussi il a plus dessiné, dans ce livre, des ornements délicats que des portraits de des Esseintes !
— Le fait est que c’était impossible de s’en tirer autrement ! dis-je.
— Peut-être ! Et, certes, je préfère son illustration de la Bièvre, des Gobelins et de Saint-Séverin. Là, il s’est bien montré tel qu’il est : un pittoresque et ingénieux metteur en scène de croquetons. C’est fin et rusé comme tout, cet art-là, et d’une couleur qui, assurément, plaît !
— Vous n’oubliez pas non plus le Raffaëlli et le Forain des Croquis parisiens ?
— Fichtre non ! Mais ces deux gaillards-là ne s’attellent pas souvent sur un livre ; en toute justice, il faut les mettre à part, ne pas les compter parmi les graveurs professionnels. Ils ont fait pour moi de savoureuses eaux-fortes que je n’oublierai jamais ; encore une fois, ils sont tout à fait en dehors, ces deux parfaits peintres !
— Et votre Quartier Notre-Dame ?
— Vous m’en direz tant ! L’artiste choisi m’a, je crois, fort bien interprété. Ce Jouas est un aquafortiste avisé et subtil. Il a eu la chance de tomber sur Romagnol, un éditeur éclairé qui l’a, c’est visible, doctement conseillé. Tandis que la plupart des autres libraires, vous voyez ce qu’ils produisent en fait de livres d’art ! et dire que des sociétés dites de bibliophiles, il s’en fonde tous les jours ! Quel amas de goûts médiocres !
Un acteur entra : c’était une vedette du Théâtre de l’Odéon. Il commanda un café ; et, à petites gorgées, il le sirota.
Au bout d’un moment, cette présence m’incitant, je demandai à Hüysmans :
— Vous n’allez plus au théâtre, n’est-ce pas ?
— Je n’y ai pas remis les pieds depuis je ne sais combien d’années. Le public qu’on y subit me répugne et toutes les pièces qu’on y joue m’indiffèrent. Je ne comprends guère que la féerie avec la lumière électrique, de séduisantes étoffes et des femmes. De la musique intéressante, si c’était possible — et d’extraordinaires mimes. Une sorte de.... d’onanisme oculaire. Hors de là, je ne vois pas bien l’art du théâtre ; cela me semble une honnête industrie, et Sardou le seul homme fort dans cette partie, car il pollue doucement les digestions du public et ne trouble pas les attentes, avec ses lettres qui amènent les dénouements et autres ficelles que le bourgeois aime à voir.
— Il y a cependant, dis-je, les efforts d’Antoine, avec les pièces d’Ibsen, de François de Curel, etc. !
— Bien ! Alors la simple lecture de ces pièces m’écoeure moins, cent fois. Car j’ai horreur des cabots et des actrices. Dire qu’on les supporte tous et toutes jusqu’à l’extrême vieillesse ! Et puis, il faut vraiment être dénué de tout pour consentir à monter sur une scène afin d’y rabâcher des niaiseries que d’autres ont écrites. Et je n’excepte pas les gens du Français, car là ils sont encore plus vains avec leur amas de traditions stupides, leur orgueil fou et leur manie de jouer toujours à côté de la vie. Ils me font rire avec leur Maison de Molière ! Il n’y en a pas un là-dedans qui sache interpréter les farces de cet auteur comme elles devraient l’être ! Ils ignorent tout et ils dindonnent sans répit. Je m’explique mieux les théâtres de quartier ; là, si l’on ne montre pas plus d’intelligence, on joue au moins sans pose, à la bonne franquette !
— Mais, dis-je, l’on prétend que vous collaborez à une mise à la scène de Gilles de Rais, votre héros de Là-Bas ?
— C’est de tous points ridicule, cette assertion. D’abord, Papus affirme que mon érudition en occultisme est tout à fait insuffisante. Si je l’en crois, le moment n’est donc pas encore venu pour moi, d’affronter, comme on dit. les feux de la rampe !
— Et, pourtant, vous vous êtes bien documenté ?
— Je comprends ! J’ai même été jusqu’à passer près d’un mois, à Lyon, chez l’abbé Boullan, qui était, j’en suis sûr, un autre lapin que Papus ! Du reste, on lui a fait payer tout aussitôt à ce bon abbé — et dans quels termes ! — l’hospitalité qu’il avait bien voulu m’accorder !
— Oui, selon les feuilles, l’abbé Boullan figurerait sous les traits du chanoine Docre.
— Comme s’ils le savaient mieux que moi, les reporters. Je me suis longuement expliqué là-dessus, et, Dieu merci, je n’y reviendrai plus. A les entendre tous, l’abbé Boullan était une fripouille et moi un jobard. Comme c’est simple !
Dans le café, un à un, les rares clients s’en étaient allés. C’était le moment où la caissière, lasse sans doute d’aligner des chiffres, somnolait. Le chat du café, fatigué lui aussi de sa station sur une banquette, s’était réfugié sur la pile des Bottins de je ne sais quelle ancienne année ; car ici l’on n’avait point coutume de consulter ces amas de noms. On gardait vraisemblablement ces pesants volumes, parce qu’ils faisaient pendant, de l’autre côté de la caisse, à des cubes de sucre méthodiquement rangés.
— Si nous partions, nous aussi ? Et Hüysmans se levait. Le patron n’aspire qu’après cela. Pauvre homme ! ce qu’il doit maudire notre clientèle !
J’accompagnais Hüysmans jusqu’à sa porte ; et nous passions chaque fois par la place Saint-Germain des Prés.
— La minable église ! me dit-il ce soir-là, ce qu’on a tapé dessus à tour de bras ! On lui a infligé un portail affreux, et qui, naturellement, en cache un second plus supportable. Et, au dedans, vous avez vu les peintures de ce Flandrin ! Quel salmigondis de sujets pieux ! Ah ! ce n’est pas facile à Paris de prier devant des choses propres ! sans compter qu’il se débite ici des fredons encore plus frelatés qu’ailleurs ; et pourtant ce quartier mériterait un autre sort, car il garde, malgré tout, un aspect possible.
— Oh ! dis-je, les raffineries de saints !....
— Ça, ils y abondent, répondit Hüysmans, les margouillats de la sculpture ! Mais cette rue Férou, cette rue Cassette, cette rue de l’Abbaye, même la chaude rue de l’Échaudé, ont une physionomie ancienne et partant plaisante ; et ça fait un contraste avec cette interminable rue de Rennes, qui file d’un seul jet jusqu’à la Gare ! Ce qu’il devait être enviable ce quartier autrefois, quand l’abbaye s’étendait au loin, étirait ses jardins et dressait ses deux tours latérales. Et ce qu’il y avait alors une jolie chapelle de la Vierge ! Quand on pense que l’on osa ensuite tasser dans ce sanctuaire une poudrière ! Ah ! les goujats d’au-jourd’hui doivent se réjouir davantage d’avoir étranglé l’abbaye dans ses dernières limites.
Nous étions arrivés. La porte était grande ouverte. Sur le seuil des gens attendaient le dernier moment de regagner des chambres que la cuisante journée avait transformées en étuves.
Et l’on entendait une voix de rogomme qui larmoyait les plaintes de Mignon.
«Je veux bien retîter du Journalisme »
HUYSMANS n’avait plus, au moment où j’eus la fierté de le connaître, aucun goût pour le journalisme.
Sans doute, il n’en avait pas toujours été de même, puisqu’on retrouve son nom dans divers journaux et revues. Néanmoins, sa part de collaboration se bornait à des sortes de tableaux parisiens et de fantaisies d’un caractère spécial, le plus souvent ne relevant que de la critique d’art.
C’est ainsi qu’on l’avait vu passer dans la République des Lettres, fondée par Catulle Mendès, dans le Musée illustré des Deux-Mondes, dans la Cravache, dans l’Artiste, etc., etc.
Le Voltaire, la Réforme, et la Revue littéraire et artistique publièrent ses Salons. Mais sa copie était trop abondante, et elle déconcertait les secrétaires de rédaction ! Puis, déjà, il témoignait d’opinions trop durement imposées, et il suscita à ces feuilles et revues tant d’ennuis de la part des peintres qu’il étrillait qu’elles n’eurent pas longtemps le courage de l’hospitaliser.
Et pourtant, c’était l’âge d’or du journalisme.
Chose presque inconcevable, on nommait des quotidiens qui n’étaient pas exclusivement des officines d’affaires, alimentées par le chantage. Bien plus : un beau livre était-il publié, on n’en pouvait rendre compte sans qu’un cuistre intervînt, le tarif de publicité à la main. Une peinture était intéressante, on la célébrait sans un marché préalable.
Et les vrais hommes de lettres recevaient de convenables « honoraires ». Il y en avait même qui signaient pour de royales sommes. On accueillait largement la Littérature ; on ne la subissait point.
Des directeurs de journaux étaient déjà ignares, c’est certain ; mais ils entendaient tous bourdonner à leurs oreilles le plus menu des noms, la plus légère des oeuvres ; et, quand l’occasion s’en présentait, ils se montraient renseignés.
Ce fut vers ce moment que la « nouvelle » commença à sévir.
li faut dire cependant que si Guy de Maupassant lui réservait un enviable sort, d’autres professionnels, malheureusement, — et dans le même temps, — s’efforcaient déjà d’en dégoûter le public.
Les scatologiques sottises d’un Armand Silvestre s’étalaient sur la même feuille, là, précisément, où, la veille, une nouvelle parfaite avait enchanté. Toutefois, dès le lendemain, il y avait compensation ; car le tour revenait d’un Anatole France ou d’un Théodore de Banville.
Son original Sac au dos l’ayant rendu notoire, Hüysmans devait fatalement essayer, lui aussi, du conte pour quotidiens.
Il pressentit donc diverses feuilles, mais toutes, aussitôt, regimbèrent. Ah ! non, il n’inspirait aucune confiance, ce « tire-au-flanc » qui avait si peu vanté la guerre et ses tragiques émois ! Il avait une liberté de mots que Zola mème ne prônait point !
Et enfin, la « grande » presse s’était montrée généralement hostile à ces Soirées de Médan ; et c’est quelque chose, cela !
La Liberté, le Globe, le Figaro et l’Evénement avaient stigmatisé, comme il convenait, ce mauvais livre : « On insulte l’armée ; on essaye de démoraliser la France ! Où allons-nous ? »
— « Oui, où allons-nous ? » répétait Albert Wolff ; — et ce journaliste de cercle, osait avouer « qu’il n’en avait lu que la préface ! »
Théodore de Banville avait bien écrit : « Très individuelles, très diverses, très librement conçues et écrites, ces nouvelles, qui toutes se rapportent à la guerre de 1870, ressemblent ainsi à des perles de forme et de grosseur différentes, attachées ensemble par un même fil écarlate. » Mais que vaut une opinion de poète ?
Les montagnards de la presse s’étaient tous dressés pour défendre les Lettres et la France outragées !
Il y eut même ce cri de la fin, dans l’Evénement : « M. Octave Feuillet quittera bientôt, espérons-le, sa solitude et réapparaîtra avec un beau livre que le public, vomissant enfin la littérature naturaliste, dévorera avec des yeux désormais dessillés et pleins de saine joie ! »
Camille Lemonnier vainement exalta, dans l’Artiste, la verve et la couleur de Sac au dos ; ce ne fut point encore une décisive compensation.
Car l’on n’ignore pas que les directeurs de journaux ont un tel souci du lecteur qu’ils ne veulent ni l’offusquer, ni même effleurer sa susceptibilité.
Pour cela, ils ont estimé que le conte à lire doit être moral !
Ils pensent que les faits-divers et la rubrique des tribunaux suffisent largement pour la description détaillée des turpitudes dont un grand journal ne saurait se passer.
Hüysmans ayant promis sans doute de s’amender, entra enfin au Gaulois. Dans quelles conditions ? Il répéta souvent à ses amis qu’elles n’étaient pas à envier.
Toutes les réflexions imbéciles, toutes les remarques saugrenues que peut susciter un artiste personnel, de la première à la dernière de ces sottises, on ne lui en épargna pas une. — Quelle chance que je sois dans un bureau ! disait-il, en allant « livrer » sa copie. Ce qu’on va un de ces jours me balancer, bien sûr ! »
Il n’attendit pas ce moment. Au bout de quatre nouvelles, exactement, il partit de lui-même, écoeuré.
Et un long temps ensuite se passa, pendant lequel, définitivement las des quotidiens, semblait-il, il se plut à écrire seulement, en se reposant de ses livres, pour des revues françaises et étrangères.
C’est dans ces organes qu’il fit paraître quelques-uns de ses poëmes en prose et des articles de critique d’art.
Mais, tandis qu’il était à peu près partout injurié en France, on l’accueillait avec une unanime ferveur en Hollande et en Belgique. Quand il envoya sa Bièvre à la revue De Nieuwe Gids, on l’en remercia avec enthousiasme. Cette même revue, d’ailleurs, lui avait, dès le mois de juin 1886, consacré un numéro spécial.
Les artistes belges furent les plus empressés à le louer. Camille Lemonnier écrivit à maintes reprises en sa faveur de hautains et frémissants articles.
Emile Verhaeren témoigna de sa belle intelligence en prônant le style si curieusement singulier de Hüysmans ; et M. Mario Varvara, dans la Wallonie, bien qu’en termes un peu tortueux, expliqua longuement pourquoi « ce merveilleux écrivain devait rester incompris de la foule et de la critique officielle. »
M. Hubert Krains, dans la Société Nouvelle, M. Jean Delville, dans la Revue Libre, M. Arnold Goffin, dans la Jeune-Belgique, et M. Nizet, dans le Salut, présentèrent encore à Hüysmans l’hommage de la Belgique.
Puis M. Jules Destrée, dans la Revue artistique d’Anvers, vint à la rescousse : « Le style raffiné et pittoresque de Hüysmans encadre, dit-il, superbement les raffinements excessifs de ses livres et de ses plus courts articles ; dérivant de Goncourt, il est déjà d’une époque plus avancée, plus décadente, d’une décomposition plus marquée ; il a la saveur faisandée des gibiers rares ; les néologismes y fourmillent ; l’insaisissable y veut être saisi ; la moindre nuance est notée et rendue avec une vibrante netteté ; c’est du Goncourt exaspéré. »
Dès l’année 1877, du reste, à mon cher ami disparu, Maurice du Seigneur, Théodore Hannon le rédacteur en chef de l’Artiste, avait offert son courrier hebdomadaire, artistique, littéraire et musical de Belgique. Maurice du Seigneur put écrire : « Cet auteur (Hüysmans venait de faire paraître le Drageoir aux Epices et Marthe, le premier roman en date sur les filles de maison) est déjà d’une jolie force et tombe assez gaillardement sur les pâles écrivains des chloroses et des anémies. C’est un coloriste de premier ordre, aimant avec passion les descriptions poussées en tons, les situations étrangement osées ; il fait opérer à ses phrases de merveilleux tours de force pour corser l’expression, il groupe ses mots comme un habile mosaïste groupe ses petits dés de pierres de couleur ; et tout cela produit un harmonieux chatoiement qui vous surprend et vous charme, pour peu que vous ayez un sentiment quelconque de l’Art. »
En parallèle, je me réserve de dire plus spécialement dans le chapitre suivant. comment, en France, vers la même époque (de 1880 à 1890 environ), on jugeait cet écrivain aujourd’hui si considérable.
Car j’ai tenu à noter tout de suite le bon accueil que réservèrent à Hüysmans ces pays dont, en somme, il venait, et qu’il chérira si dévotieusement plus tard, au travers de leurs grands peintres religieux.
Déjà je puis certifier que, dans l’ensemble, les journaux français ne s’étaient guère montrés très tendres pour Hüysmans ; et il est à présumer que, tout à ses livres à présent, il ne songeait plus aux gazettes quand, inopinément, il poussa à M. Henry Bauër l’idée de demander le manuscrit de Là-Bas pour le publier dans l’Echo de Paris.
L’entreprise était osée.
Certes, ce quotidien offrait bien des garanties à l’écrivain. Il n’était pas populaire, une certaine classe de la société seulement le parcourait, et ses articles étaient déjà d’un gris à ne rien effaroucher. C’était en un mot une maison à peine fréquentée qui pouvait, par seul caprice, hospitaliser occasionnellement un véritable écrivain.
Mais comment s’aboucher utilement avec Hüysmans ? Comment sans en être trop malmené le décider à revenir dans un journal, après toutes les catégoriques résolutions de n’y plus jamais écrire, qu’il avait maintes fois répétées ? M. Henry Bauër chercha, et, à un dîner où assistaient Hüysmans et un de ses amis, la chose, bien plus aisément qu’on ne s’y attendait, aboutit.
Là-Bas commença donc de paraître dans l’Echo de Paris.
Alors, comme à un signal, les désabonnements arrivèrent en foule. Valentin Simond, le directeur, tint bon ; et le prodigieux roman fut publié en entier.
En reconnaissance, Hüysmans, de lui-même, donna ensuite des chroniques pour la première page de ce journal.
Il avait bien spécifié par exemple qu’elles ne concerneraient toutes que la Mystique et l’art religieux. C’était à prendre ou à laisser !
On accepta ; et les chroniques parurent telles que les voulait Hüysmans.
Mais quels moments d’effroi dont l’Echo se souvient encore !
Quand le secrétaire de la rédaction voyait arriver cette copie qui célébrait sans se lasser les splendeurs de la cathédrale de Chartres, le sens biblique des pierres, les exceptionnelles vertus d’une carmélite, la botanique d’église. l’osmologie mystique ou bien encore la Mystique des foules, il prenait tout aussitôt le ciel à témoin de son infortune : — Quelle copie, mon Dieu, m’envoyez-vous là ! répétait-il, sur le ton de la plus amère désolation. Et dire qu’il faut imprimer ça ! Ah ! il est bien coupable celui qui a introduit dans la maison un tel exact « raseur » !
Les lecteurs habituels aussi continuaient de s’affoler. La banale prose, généralement localisée à la première page, ils ne la retrouvaient plus, les jours réservés à cet écrivain nouveau. Et ce qu’il était, par-dessus le marché, incompréhensible avec toutes ses histoires archéologiques et autres ! et combien elles n’intéressaient pas !
Où sont, se lamentaient-ils, les savoureuses anecdotes qu’on nous raconte si aimablement les autres jours ?
Et des lettres comminatoires arrivaient encore à l’adresse du Directeur de l’Echo de Paris ; le mettaient en demeure d’avoir à renvoyer « ce barbare, cet étranger qui répondait si mal au goût français, amoureux de clarté et de saines lectures. »
Aussi ce qui devait arriver arriva.
Hüysmans bientôt cessa de perturber cette gazette et son ordinaire clientèle. Il ne fut pas besoin de l’en avertir : il comprit de lui-même que ce public resterait obstinément fermé à toutes ses chroniques — et il s’en alla.
On respira. Ce fut sa dernière collaboration régulière à un journal.
Il ajouta définitivement cette fois un vif dégoût à tous ceux qu’il avait déjà.
Il ne les comptait plus lui-même !
Corbeille de Critiques
DEUX rares artistes J.-K. Hüysmans et M. Octave Mirbeau, ont donné leur opinion sur le critique d’art professionnel — et partant sur le critique littéraire.
Le premier, au chapitre : Du dilettantisme, de Certains, a écrit textuellement ceci : « Lâcheté, ce mot s’applique à la critique d’art. De même que le critique littéraire qui en fait métier, le critique d’art est généralement un homme de lettres qui n’a pu produire de son propre cru une véritable oeuvre. Parmi eux, quelques-uns ont la vacuité de cervelle des gens du monde qu’ils envient et singent ; leurs opinions sont dès lors connues. Mais, il en est d’autres, plus ouverts, plus rusés, qui professent, sous le nom de dilettantisme, la nécessité de ne pas se lier, le besoin de ne rien affirmer, la lâcheté, pour tout dire, de la pensée, et l’hypocrisie de la forme.
« Pour les critiques, c’est un terrain de rapport que ce fluctueux terrain sur lequel ils se meuvent. Vanter ou dénigrer les artistes morts ; éviter de se compromettre, en parlant de ceux qui vivent ; encenser en de sportulaires phrases les vaches à lait académiques des vieux prix ; baladiner avec des thèses soumises et des idées en carte ; débiter, sous prétexte d’analyse, les lieux communs les plus fétides, dans une langue limoneuse, simulant sous l’obscurité des incidentes la profondeur ; tel est le truc. Le critique hésitant et satisfait, amorti et veule, qui manie cette pratique, est aussitôt réputé homme de goût, homme bien élevé, compréhensif et charmant, délicat et fin — ah ! surtout, délicat et fin ! C’est pour lui tout honneur et profit et j’imagine du reste que c’est là tout ce qu’il cherche. »
M. Octave Mirbeau, dans sa préface à une exposition de Claude Monet, a, de son côté, bafoué ainsi :
« J’en’ai jamais si bien compris qu’aujourd’hui, devant cette extraordinaire exposition de M. Claude Monet, le ridicule souverain, la complète inutilité d’être de ce personnage, improbable d’ailleurs, et si étrangement falot, et pourtant si malfaisant, que nous appelons, en zoologie, an critique d’art.
« Cependant, les critiques d’art sont une espèce nombreuse et qui, au premier abord, paraissent inoffensifs. Mais, dès qu’on les étudie, c’est une autre histoire. Oh ! les sottises, le plus souvent comiques, mais parfois douloureuses, qu’inspirent les oeuvres d’art à ces braves gens qui, dans le train-train de la vie ordinaire et les conversations courantes, ne se montrent pas plus bêtes que les autres hommes, qui le sont autant, voilà tout, ce qui, déjà, n’est pas peu dire. Et qu’on me croie sur parole, car, moi aussi, j’ai été critique d’art, et je sais, par expérience, ce qu’il en est. Je ne m’en vante pas, certes, mais je l’avoue humblement.
« L’oeuvre d’art — et je parle ici de la peinture — a ce mystère, d’une ironie supérieure, savoureuse et vengeresse, qu’elle fait monter, tout d’un coup, avec force, à la surface, ce qui grouille et fermente de bêtises vaseuses au fond de l’esprit de celui qui s’est institué, par métier, son exégète et son juge. Il n’est pas de meilleur critérium de la mentalité d’un individu que le degré de « critique d’art » qu’il accuse à son thermomètre spirituel. »
Après ces deux caustiques déclarations, me voilà assurément fort à mon aise pour exposer quelques-unes. des nombreuses critiques que Hüysmans appelait en bloc : un recueil de sottises ! et qui, soit en mal, soit en bien, assaillirent en France, de 1880 à 1890, son oeuvre.
Cette période de temps est, je crois, la seule qui compte.
Par la suite, en effet, on voit les louanges l’emporter tellement sur les railleries qu’il n’y a plus aucun intérêt à signaler les unes et les autres.
Remontons donc à cette périlleuse année 1880. Je dis : périlleuse, parce que les coups tombent alors sur les « Médanistes » en général, et sur Hüysmans en particulier.
C’est ainsi que, dans le Gaulois, M. Montjoyeux reproche carrément à « Messieurs Zola » (sic), c’est-à-dire à Maupassant, à Hüysmans, à Paul Alexis, à MM. Céard et Hennique, « de ne pas assez produire ! »
— « Et, dit le journal le Citoyen, il faut d’ailleurs les jeter tous à la porte, ainsi que M. Ranc a fait pour Zola, en le chassant du Voltaire ! »
— « Bravo ! » crie à son tour le spirituel Scholl ; et il surnomme J.-K. Hüysmans et M. Céard : Chouya et Boulou !
La province, pendant ce temps, ne reste pas inactive. Elle déverse aussi ses bons mots sur le naturalisme.
— « Assez d’ordures, messieurs ! s’écrie la Presse illustrée. Ayez pitié des oreilles délicates ! »
Et les journaux : régionaux partent en guerre, somment Paris de « se purger de ces immondices dites littéraires »,
Charles Monselet, dans l’Evénement, entend ce cri d’alarme ; et, broche en main, il court sus au naturalisme : « Plus dé descriptions ! Assez de descriptions ! C’est d’un art trop facile, Messieurs de Médan ! »
Mais François Coppée veille, et il défend doucement « ce Hüysmans, si attaqué ! » C’est qu’il songe avec attendrissement qu’il « a essayé, lui aussi, de rendre les débiles paysages de la banlieue de Paris ! ».
On s’étonne davantage de voir M. Jean Richepin en cette aventure et déclarer, dans le Gil Blas, que « Ceux de Médan se sont mis derrière Zola pour arriver ! » M. Jean Richepin n’avait-il déjà, en ce sens, rien à se reprocher ? Bon prophète, cependant, il prévoit que Maupassant, Hüysmans et M. Léon Hennique ne pourront plus vivre longtemps avec Zola. « Seul, Paul Alexis doit, dit-il, lui demeurer fidèle. »
Comme Edouard Rod, lui, fut plus simplement probe en expliquant pourquoi l’union des « Médanistes » se réalisa ! Une association momentanée d’artistes ayant alors une même tournure d’esprit, — et rien de plus. « Mais M. Jean Richepin, concluait-il, est si ambitieux ! »
Les autres critiques ne désarmaient pas, pendant ce temps.
Le Siècle demandait à Hüysmans « qu’il fît des romans pouvant être lus par tout le monde! »
Pierre Véron, dans le Charivari, hurlait contre « toutes les préciosités baroques et les néologismes prétentieux de M. Hüysmans ! »
La Gazette de France s’indignait et le Gil Blas éclaboussait l’auteur de En Ménage d’un article intitulé : La Vie bête ! Simplement !
Robert Caze se fâchait contre tant de bêtises ; et il décidait Coppée à batailler nettement en faveur de Hüysmans.
Somme toute, « on s’amusait », ricanait la galerie.
Il y avait de quoi! Lisez cette fin d’un article paru dans l’Evénement : « Il est temps de penser à des choses plus sérieuses que le naturalisme ! Il est temps que des pensers plus virils, plus sains et plus forts occupent nos esprits trop longtemps amusés de tours de dislocations et d’exhibitions névrosiques ! ».
Je n’invente rien. Je copie textuellement toutes les citations.
Il y avait, certes, des opinions favorables à Hüysmans ; mais ce qu’elles pesaient peu !
Je cite toutefois l’article de M. Albert Pinard, dans le Radical ; celui de M. Francis Enne, dans le Réveil ; un autre encore de M. Paul Ginisty, dans le Gil BIas.
Au Figaro, Philippe Gille fétidait ; et ce critique-là, c’était sans conteste un merveilleux comique. Il rafistolait de vieilles plaisanteries, se livrait à d’innocents jeux de mots ; en un mot, il apparaissait tel qu’un stupéfiant phénomène, tant il était borné !
Ses chroniques s’intitulaient... devinez comment ?... La bataille littéraire !
Hüysmans jugé par lui ! le journalisme seul pouvait inventer cette chose énorme. Je vous réponds qu’avec le Gille, on ne s’ennuyait pas !
Imprudemment, la Revue catholique blaguait aussi. Ce qu’elle dut s’en repentir plus tard !
Quel joyeux temps, tout de même !
Les uns accusent Hüysmans d’ « injurier la vie » ; les autres plaisantent ce qu’ils appellent ses « vocables saugrenus ». La Revue illustrée « regrette d’avoir à parler de cet écrivain à ses lecteurs » ; et une autre feuille annonce, gravement, que « les romans de M. Hüysmans lui donnent la nausée ».
M. Teodor de Wyzewa, généralement mieux inspiré, déclare que « cet écrivain est véritablement trop terre à terre! »
Mais il y a mieux encore : les feuilles de province s’en mêlent et déversent sur « le perpétuel auteur des Soeurs Vatard, qui ne saura plus faire maintenant un autre livre ! » (sic), des potées d’injures.
La Presse illustrée « prend pitié des oreilles délicates » ; et l’Evénement reproche à M. Léon Bloy de « défendre M. Hüysmans, après avoir osé cingler Ohnet, Halévy et Paul Bourget, ce dernier si honteusement surnommé le Chérubin des Comtesses Almaviva de la haute muflerie! »
Théodore de Banville, heureusement, consacre, dans le Gil Blas, sous le titre général : Lettres à Pierrot, ayant pour sous-titre : Raffinement, un long article à des Esseintes. A dire vrai, c’est plutôt — et ce n’est même que cela : « un commentaire des formes du plaisir dans la vie. » Les poètes ont de ces ruses !
M. Gustave Geffroy est plus brave, dans la Nation ; ainsi que M. Paul Margueritte, dans la Libre Revue. Leurs articles sont brillants et enthousiastes.
Maupassant, bien entendu, loue également très fidèlement son ami ; et je note encore les articles éloquents de Léo Trézenik et Emile Goudeau.
Philippe Gille, ce vieux nageur, revient sur l’eau, cette fois à propos de A Rebours. Il déclare que le livre est « stupéfiant ! » Un point, c’est tout !
Combien Ernest d’Hervilly nous causa plus de peine, — car il avait parfois un esprit délicat, celui-là ! — en « regrettant Paul de Kock, ce naturaliste avant la lettre ! » et en disant de Hüysmans : « C’est Melpomène dans les lieux ! C’est ennuyeux comme la pluie d’hiver, froid comme elle, et ça pue d’un bout à l’autre ! »
Il y eut une compensation : celle qu’apporta M. Edouard Drumont avec son persuasif article, publié dans le Livre.
Un autre article, de cette nature, très long, plus substantiel même celui-là, — et dont Hüysmans me parla avec un plaisir qu’il ne cherchait pas à dissimuler — il le dut à l’admirable Emile Hennequin, mort si prématurément. Il convient, certes, de rechercher ce meilleur commentaire de l’oeuvre à ce jour de Hüysmans dans la Revue indépendante du mois de juillet 1884, et que je ne veux pas affaiblir ici en le tronquant. Jamais il n’y eut davantage de pensées contenues dans un style pénétrant et d’une éloquence quasi miraculeuse !
Et, ensuite, après ce jugement philosophique, vous goûterez peut-être cette vibrante page de M. Léon Bloy — qui ne se lassait pas — parue dans le Chat noir, sous ce titre : Les Représailles du Sphinx :
« La forme littéraire de M. Hüysmans rappelle ces invraisemblables orchidées de l’Inde qui font si profondément rêver son des Esseintes, plantes monstrueuses aux exfoliations inattendues, aux inconcevables floraisons, ayant une manière de vie organique quasi-animale, des attitudes obscènes ou des couleurs menaçantes, quelque chose comme des appétits, des instincts, presque une volonté.
« C’est effrayant de force contenue, de violence refoulée, de vitalité mystérieuse. M. Hüysmans tasse des idées dans un seul mot et commande à un infini de sensations de tenir dans la pelure étriquée d’une langue despotiquement pliée par lui aux dernières exigences de la plus irréductible concision. Son Expression toujours armée et jetant le défi ne supporte jamais de contrainte, pas même celle de sa mère l’Image, qu’elle outrage à la moindre velléité de tyrannie et qu’elle traîne continuellement par les cheveux ou par les pieds dans l’escalier vermoulu de la Syntaxe épouvantée. »
Ensuite, on peut s’égayer, il me semble, de M. Ed. Deschaumes qui, dans la Chronique parisienne, « trouve très drôle l’idée du bain de mer en Seine ! et n’a vu vraiment que ça dans A Rebours ! »
Heureusement je retrouve votre chère et profitable compagnie, Emile Verhaeren, et c’est vous, le grand poète, qui avez encore raison quand vous rappelez que Hüysmans disait de lui-même : « Il me reste le vieil Hollandais sous l’hystérique Parisien », et quand vous nous le montrez aimant les meubles rares, les brimborions lisses et propres, l’ingénieux et le compliqué, comme les Amstellodamois.
Mais j’arrive maintenant à un Pontife, à un Lama et à un Bouddha du Temple sacrosaint.
Il n’y a plus qu’à se prosterner religieusement.
Tant de clairvoyance entre-t-elle dans l’âme d’un Critique ! M. Jules Lemaitre, — car c’est de Lui qu’il s’agit — laisse tomber cette réflexion profonde :
« Des Esseintes, c’est une figure dont la peinture a trop souvent l’air d’un jeu d’esprit un peu lourd, d’une gageure laborieuse. »
Et il note avec une gaîté non dissimulée la puérilité des apprêts artificiels de des Esseintes. Et les classiques latins éreintés ! Quel dam ! « D’ailleurs, demande-t-il, M. Hüysmans a-t-il lu seulement, comme il le prétend, et Prudence, et Sidoine, et Marius Victor et Paulin de Pella ? S’il y a des crétins, ce sont justement ceux-là! »
« Et la tortue, et l’armoire à liqueurs, quelles plaisanteries ! Et les orchidées, et le voyage à la Bodega !
« Baudelaire est un Dieu, s’écrie M. Jules Lemaître. Eh bien, que fait-il, M. Hüysmans, de Rabelais, de Molière, de Voltaire et de Rousseau ? »
« Et le théâtre ? Oh ! le sacrilège qui le conspue ! »
« Cependant mon collègue M. Brunetière a déclaré que Hüysmans était un vaudevilliste et que A Rebours procédait du Voyage à Dieppe des sieurs Waflard et Fulgence !
« Je reviendrai, conclut M. Lemaître, sur ce cas-là ! »
Et il cède la place au splendide article de Barbey d’Aurevilly, paru dans le Constitutionnel, le 18 juillet 1884, et dans le Pays, le jour suivant.
Il conviendrait par déférence de citer cet article-là en entier ; car il est net et ne flatte pas.
Lui aussi, l’illustre écrivain catholique, il raille des Esseintes à propos de ses inventions pour pacifier son ennui : la tortue, encore, les fleurs de papier, son alchimie des parfums, etc. Mais il crie son plaisir de compter désormais un nouvel et grand écrivain catholique ; et il s’extasie sur la fin de A Rebours, qui lui rappelle un des plus vifs souvenirs des Fleurs du Mal.
Il dit : « Est-ce assez humble et assez soumis ? C’est plus que la prière de Baudelaire :
Ah ! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût !
« Baudelaire, le satanique Baudelaire, qui mourut chrétien, doit être, continue-t-il, une des admirations de M. Hüysmans. On sent sa présence, comme une chaleur, derrière les plus belles pages que M. Hüysmans ait écrites. Eh bien! un jour, je défiai l’originalité de Baudelaire de recommencer les Fleurs du Mal et de faire un pas de plus dans le sens épuisé du blasphème. Aujourd’hui, je serais bien capable de porter à l’auteur d’A Rebours le même défi. Après les Fleurs du Mal, dis-je à Baudelaire, il ne vous reste plus logiquement que la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix ; Baudelaire choisit les pieds de la croix ; mais l’auteur d’A Rebours les choisira-t-il ? »
Derechef, au tour de M. Jules Lemaître, maintenant.
Car ce critique revient sans tarder sur le « cas Hüysmans »; et il 1’« étudie » tout au long dans la Revue contemporaine.
Il remonte jusqu’à Marthe et il déclare que ce livre, pas plus que les Soeurs Vatard « ne donnent l’idée d’un drame. Ce n’est pas construit en vue d’un effet d’ensemble, et il n’y a pas de dénouement logique ! » — « Cela, ajoute-t-il, rappelle l’Education sentimentale, ce prodigieux roman où il n’arrive rien, où tout est quelconque, événements et personnages ! »
Il trouve ensuite que le mépris de Hüysmans contre « les étudiants qui braillent » et contre cette « trôlée de nigauds qui s’ébattent dans des habits neufs, de la place de la Concorde au Cirque d’Été », « n’a rien de bien original, ni de bien philosophique non plus ! »
Quant au pittoresque A vau-l’eau, « c’est, dit-il, d’une bassesse volontaire de conception, inédite jusque-là ! »
« En Ménage n’est point tout à fait méprisable, continue-t-il. Mais moi, au collège, j’avais l’heureuse gaieté absurde et irrésistible de cet âge ; et je redemandais des haricots ! » (sic)
Et M. Lemaître conclut : « L’histoire d’un monsieur qui a la diarrhée ; l’histoire d’un monsieur qui ne veut pas coucher seul et celle d’un autre monsieur qui veut de la viande propre : voilà en résumé l’oeuvre romanesque de M. Hüysmans ! »
Influencé sans doute par cette haute critique, M. Henri de Régnier, dans Lutèce, ne brilla point. Erreur de poète qui « allait prendre bientôt sa revanche »,
Jean Lorrain, dans l’Evénement, fut autrement éblouissant et précis. Il gardait à Hüysmans une affection certaine.
Dans ma glane, je note un nouvel article favorable de M. Léon Bloy, dans l’Art Moderne ; et une excellente chronique de M. Lucien Descaves, dans la Revue rose.
Puis, voici maintenant deux opinions risibles : « En Rade ne vaut pas Marthe, et M. Hüysmans est un soleil couché ! » (Edmond Lepelletier, l’Echo de Paris).
« M. Hüysmans ne nous intéresse nullement. C’est un pauvre sire ! » (Paul Perret, la Liberté).
Mais M. Henri de Régnier, dans Ecrits pour l’art, fait heureusement oublier tout de suite son article de Lutèce. Il écrit : « En ces étranges pages (En Rade), M. Hüysmans est maître d’un style excessif et personnel où, dans la phrase d’harmonie et de carrure un peu négligée à dessein, les mots prennent d’inouïes valeurs et des précisions inusitées, renforcées par d’incisives et perforantes épithètes.
« Le palais d’Assuérus est une des plus éblouissantes visions qui soient. Ce n’est pas la restauration antique et savante de Flaubert, qu’on sent stable, définitive, exhumée à jamais, c’est une évocation momentanée, chancelante, qui vacille en un lointain de rêve, mais à la fois nette et éclatante. »
A son tour, dans le Voltaire, M. Auguste Germain présenta sous ce titre : Les Raffinés littéraires, trois hommes de lettres : J.-K. Hüysmans d’abord, puis MM. Edmond Haraucourt et Gustave Kahn.
Il affirma que, selon lui, Hüysmans était un autre artiste que M. Haraucourt. « Où M. Haraucourt donne un coup de crayon, dit-il, M. Hüysmans burine ». Et il ajoute : « Et ce, dans une langue très savante, mais torturée, contorsionnée en des phrases qui serrent les mots, comme des brodequins de fer ! »
M. Gustave Kahn était alors, selon la déclaration d’un autre critique : « un des jeunes coryphées de l’école symboliste, qui avait encore pour chefs Moréas et M. Paul Adam. »
« Leur art (sic), ajoutait-il, ne dépend en rien du métier (sic) de M. Hüysmans ! Ils me l’ont nettement déclaré ! »
Un exact portrait fut celui que M. Marcel Fouquier dessina dans l’Echo de Paris. Il fut tout de suite suivi dans l’Art Moderne, d’un disert commentaire de M. Emile Verhaeren.
En terminant dans la Justice sa chronique littéraire, M. Gustave Geffroy écrivit, à propos d’Un dilemme : « Ce roman court, d’événements condensés, expliqués en phrases essentielles, est un précieux procès-verbal de l’état d’esprit et des laides pratiques des bonshommes qui se qualifient volontiers « d’honnêtes gens » en leurs dialogues. »
Il faut retenir aussi un autre pénétrant portrait que donna de Hüysmans M. Lucien Descaves, dans le Figaro, sous ce titre : Ceux de Médan.
C’est dans le même temps que M. Rémy de Gourmont consacre à Hüysmans, dans le Mercure, une attachante notule.
Et elle est autrement curieuse, certes, que le tiède charabia que réédite, sur la Bièvre, le flasque Coppée. Sa prose, c’est de la berquinade d’orgue de Barbarie. Ah ! il n’a guère compris ces désolants paysages que vous avez si bien interprétés, ô vous, J.-F. Raffaëlli !
Mais d’autres serins le suivent, même des pudibonds que je sais aujourd’hui casés dans les profitables cavernes des cercles ! Ça, c’est un couronnement !
Un courageux article de Bernard Lazare, dans la Nation, constitue, il est vrai, un parfait dédommagement. Et cet écrivain en profite pour reprocher à M. Anatole France de se désintéresser, par calcul, des oeuvres de talent et de ne louer que des « niaiseries »,
Dans le Temps, en effet, M. Anatole France avait délibérément « expédié » en dix lignes, pas une de plus, son opinion sur Là-Bas, — et il s’était donné comme prétexte prudent « que le journal ne pouvait pas tout dire ! ».
Sutter-Laumann, dans l’Intransigeant, M. Georges Frappier, dans le Constitutionnel, M. Paul d’Armon, dans le Voltaire, n’eurent point, heureusement, le même souci ; et ils témoignèrent hardiment et éloquemment en faveur de Hüysmans.
Georges Rodenbach, dans la Revue bleue, et M Léopold Lacour, dans le Figaro, remarquèrent, de leur côté, que Verlaine fut, avec Mallarmé, révélé par Hüysmans.
Et j’ajoute, moi, en passant, que l’illustre auteur de Sagesse fut maintes fois aidé — dans le sens matériel du mot — par Hüysmans, et avec un peu plus de discrétion que lorsque des poètes mondains et des femmes en mal de publicité s’en mêlèrent.
Mais voici d’autres attaques contre Hüysmans très intéressantes.
Dans le Figaro, Henry Fouquier l’appelle « un des dilettantes du catholicisme », en le plaçant, du reste, dans l’enviable société de Baudelaire, de d’Aurevilly, de de Maistre et de Veuillot. « Oui, conclut-il, satisfait, M. Hüysmans n’est pas non plus absolument un pieux saint ! »
Et qui l’eût cru ? C’est à M. Léon Bloy, l’ex-enthousiaste admirateur de l’oeuvre de Hüysmans, que nous devons maintenant une opinion presque semblable ! M. Léon Bloy, dans la Plume, écrit, en effet : « M. Hüysmans est un dilettante religieux, un inconscient, un écolier barbare ! Là-Bas, c’est un amas de petites notes. M. Hüysmans est un impuissant pervers, un compilateur sans idée personnelle, etc., etc. »
Et, plus loin : « A Rebours, ce n’était pas du tout fracassant de génie ! dit-il. Ça ne crevait pas les yeux à force d’éclat, ce haillon d’idée emprunté à la pouilleuse métaphysique de Schopenhauer : « Seul, le pire arrive ! »
Et voilà !... O revirement de pamphlétaire !
A la suite, comme si c’était un mot d’ordre, les feuilles se mettent à accuser Hüysmans d’avoir « perturbé des foules, fait naître des esprits frappeurs, revivre l’occultisme » ; elles le croient capable d’engendrer mille maux ; « il est un sorcier, un envoûteur, un spirite ! » et c’est ce coup de la fin : « M. Hüysmans va sûrement déchaîner des perversités ! »
Un vent de folie et de bêtise souffle alors sur presque toutes les gazettes. Les plus graves pondent une chronique sur ce « satanisme remis en lumière )) ; et le lecteur me remerciera certainement si je le renvoie aux gais commentaires que détaillèrent l’Echo de Paris et le Petit Parisien.
Pour rire ensuite tout à son aise, il faudra qu’il lise également l’inénarrable bouffonnerie de Philippe Gille, qui était encore en fonctions au Figaro en cette année 1891 :
« Ce qui m’a épaté, terminait-il, c’est la Messe noire ! »
Et les articles continuent à paraître, touffus toujours.
— Pour qu’on parle d’un livre, il faut qu’il donne prétexte à des chroniques ! me disait Hüysmans, Les journalistes, croyez-le, sont sans cesse aux abois ; il faut leur jeter de la curée !
Or, Là-Bas fut bien, certes, une véritable curée.
Tous les journaux, toutes les revues de France et de l’étranger, commentèrent ce livre ; et, sans tarder, mille absurdes légendes enveloppèrent, comme une vermine, son auteur.
Ce qu’on débita alors d’inepties fut inouï !
Aussi, quand on voulait passer une soirée divertissante, chez Hüysmans, il n’y avait qu’à le pousser à parler de ce temps-là ! Lui, qui détestait les « potins », il se révélait tel qu’un féroce pince-sans-rire en racontant les « coupures » de journaux et de revues qu’il lut, les visites qu’il subit, les extraordinaires lettres qu’il reçut.
— Mais les journaux étaient encore les plus bêtes ! répétait-il. On sentait là de telles besognes bâclées par des reporters en délire que ça voisinait avec l’excrément ! Et puis toutes ces conférences, toutes ces proses des Jules Bois et de quelques chatouilleurs de vieilles dames me firent passer, je vous prie de le croire, des moments inattendus ! Ah ! tout de même, je ne demandais pas tant de sottises à la fois pour lancer mon livre !
De quelle bouche serrée tombaient alors ces mots peu reconnaissants !
Les Bienfaits d’une conversion
JE suis arrivé au chapitre principal de cet essai consacré à une vie littéraire à coup sûr extrêmement curieuse et attachante.
A mon tour, je vais avoir à dire ce que je pense d’une conversion au sujet de laquelle, eu égard à cette sensationnelle occasion, l’Eglise n’a point manqué de mener grand tapage.
Voyons d’abord toutefois comment Hüysmans définit lui-même son cas, au moment où il est revenu de la petite Trappe de Notre-Dame d’Igny.
Il a pris soin de nous l’expliquer très nettement dans une préface à propos d’une nouvelle édition de A Rebours ; et, comme cette préface est assez peu répandue, il convient d’en reproduire ci-après les parties essentielles tout au moins :
« Je n’ai pas été élevé dans les écoles congréganistes, dit Hüysmans, mais bien dans un lycée ; je n’ai jamais été pieux dans ma jeunesse, et le côté de souvenir d’enfance, de première communion, d’éducation qui tient si souvent une grande place dans la conversion, n’en a tenu aucune dans la mienne. Et ce qui complique encore la difficulté et déroute toute analyse, c’est que lorsque j’écrivis A Rebours, je ne mettais pas les pieds dans une église, je ne connaissais aucun catholique pratiquant, aucun prêtre ; je n’éprouvais aucune touche divine m’incitant à me diriger vers l’Eglise ; je vivais dans mon auge, tranquille; il me semblait tout naturel de satisfaire les foucades de mes sens, et la pensée ne me venait même pas que ce genre de tournoi fût défendu.
« A Rebours a paru en r884 et je suis parti pour me convertir dans une Trappe en 1892 ; près de huit années se sont écoulées avant que les semailles de ce livre aient levé ; mettons deux années, trois même, d’un travail de la Grâce, sourd, têtu, parfois sensible ; il n’en resterait pas moins cinq ans pendant lesquels je ne me souviens d’avoir éprouvé aucune velléité catholique, aucun regret de la vie que je menais, aucun désir de la renverser. Pourquoi, comment, ai-je été aiguillé sur une voie perdue alors pour moi dans la nuit ? Je suis absolument incapable de le dire ; rien, sinon des ascendances de béguinages et de cloîtres, des prières de famille hollandaise très fervente et que j’ai d’ailleurs à peine connue, n’expliquera la parfaite inconscience du dernier cri, l’appel religieux de la dernière page de A Rebours.
« Oui, je sais bien, il y a des gens très forts qui tracent des plans, organisent d’avance des itinéraires d’existence et les suivent ; il est même entendu, si je ne me trompe, qu’avec de la volonté on arrive à tout ; je veux bien le croire, mais, moi, je le confesse, je n’ai jamais été ni un homme tenace, ni un auteur madré. Ma vie et ma littérature ont une. part de passivité, d’insu, de direction hors de moi très certaine.
« La Providence me fut miséricordieuse et la Vierge me fut bonne. Je me suis borné à ne pas les contrecarrer lorsqu’elles attestaient leurs intentions ; j’ai simplement obéi ; j’ai été mené par ce qu’on appelle « les voies extraordinaires »; si quelqu’un peut avoir la certitude du néant qu’il serait, sans l’aide de Dieu, c’est moi. »
Ainsi donc, Hüysmans déclare qu’il ne sait pas du tout comment et par quoi il a été poussé à devenir un écrivain catholique.
Pourtant son ascendance — du côté paternel, tout au moins — peut y être pour quelque chose. Son père, pieusement, n’oubliait point celles qui étaient toujours là-bas dans des béguinages. Il dut souvent être question d’elles durant les longues soirées qui s’écoulèrent rue Suger et rue Saint-Sulpice, après le minutieux et pénible travail d’enluminure du jour ; et l’on peut croire que Godfried Hüysmans, en songeant à ses sœurs, regretta quelquefois d’avoir quitté son pays pour venir dans ce Paris, qui ne lui fut pas autrement secourable et qui n’avait point su attirer l’ancêtre représenté au Musée du Louvre, le paysagiste Cornélis Hüysmans dit de Malines. Et ses regrets évoquaient alors les âmes plus sages qui étaient restées là-bas, devaient vanter la pacifiante tranquillité des cloîtres, le haut bonheur spirituel de la Foi.
Sans doute, Hüysmans vient de nous dire que sa jeunesse fut très secouée, à coup sûr pas pieuse ; mais, malgré lui, à certaines heures, il rêvait et sa pensée se reportait à cette Hollande tant de fois décrite par son père.
Bien qu’il fùt très jeune, alors qu’il écoutait les propos paternels, il lui était resté néanmoins le vif souvenir d’une ville brillant entre toutes les autres comme une étoile de charité ; car il avait entendu parler souvent de ce fervent foyer de catholicisme, brûlant à toutes flammes au-dessus de la masse des luthériens.
Cette ville de Bréda, il la visitera d’ailleurs une des premières, même la première, au temps de ses vacances, non point tant parce que son père est né là, que simplement parce qu’il a la tête lourde surtout des légendes dorées que sa mère, également, ne cesse pas de lui raconter.
Si Hüysmans ne hante, au temps du collège, l’Eglise, du moins il ne l’insulte pas. Il n’a aucun goût pour les imbéciles farces qu’affectionnent les laïques. Un prêtre même qu’il rencontre dans la rue ne lui fait point pousser de grotesques croassements. Quant aux moines, il méprise les cuistres qui s’égayent à les peindre attablés et suants de gourmandise.
Il n’est point religieux pour la forme tout au moins ; il est jeune et il entend goûter, Parisien, à tous les plaisirs de Paris.
Plus tard, quand il cherchera à s’évader intellectuellement de sa vie d’employé, c’est d’abord vers l’Art qu’il se tournera ; et s’il ne doit pas devenir un peintre, proprement dit, comme le furent ses ancêtres et son père lui-même, il écrira dès le premier jour avec l’entrain pittoresque des « naturalistes » de la Hollande, en transposant presque directement la verdeur d’expression des Brauwer et des Jean Steen.
Justement le « naturalisme littéraire » est en pleine moisson. Honoré de Balzac, Flaubert, les Goncourt, puis Zola, ont ardemment fécondé cette contrée. Hüysmans y pénétrera à son tour avec un goût très vif.
Et tous ses premiers livres en apportent ce réel témoignage : Le Drageoir aux Epices, Marthe, Les Soeurs Vatard, Croquis Parisiens, En ménage, A Vau-l’eau.
Mais quand il publiera A Rebours, en 1884, il y a déjà longtemps, par contre, qu’il a offert toute sa nouvelle admiration à Baudelaire et à Barbey d’Aurevilly ; et voici, naturellement, comment la chose s’est faite.
Ces deux grands seigneurs de lettres, un moment délaissés, sont revenus à leur tour régenter toute une génération littéraire et artiste ; et, tout de suite, ils s’imposent formidablement et frénétiquement.
Soudainement, on ne jure plus seulement par Zola, maintenant. Le naturalisme subit un temps d’arrêt. Le robuste et légitime entêtement du maître de Médan seul ne voudra point s’en apercevoir.
Lui, Hüysmans, le « grand espoir » avec Maupassant, de tous côtés on l’a sommé de s’émanciper, de s’échapper. Et toutes les antiennes se sont donné cours. Même des critiques qui lui furent singulièrement hostiles, viennent de proclamer qu’il n’est point sans talent, et que « s’il veut rompre avec son chef Zola, il est capable de faire de grandes choses ! »
Et cette campagne dure des mois, nourrit les délices de tous les suppléments littéraires des grands journaux. Quant aux revues, c’est pour elles une manne d’articles si nombreux que, plus tard, la question résolue, il en paraît encore, du fait de la force acquise.
On peut donc affirmer, je crois, que Hüysmans ne resta point insensible à toutes les pressantes sollicitations des critiques qui « rêvaient de vouloir faire de lui un écrivain personnel ! »
De son dernier livre naturaliste, Hüysmans tombe alors sans mesure dans A Rebours.
Oui, il eut tellement peur de « récidiver » que, cette fois, il multiplia à plaisir l’artificiel et le baroque. Son évasion du naturalisme le conduisit tout droit, par désir du contraste, à la tortue, par exemple, pavée de pierreries, raillée par M. Jules Lemaître et, ce qui fut plus grave, par Barbey d’Aurevilly. Mais ces chapitres, Hüysmans les qualifia plus tard de chapitres de transition ; et, aussi bien, seule la lyrique fin du livre, d’où l’on a voulu faire partir — résolument — l’échappée de Hüysmans vers la Grâce, doit nous retenir.
Il a écrit, je le répète, qu’il ne sait pas pourquoi et comment il a poussé ce cri.
Oh ! ignorait-il tant que cela d’où venait ce cri littéraire, pareil de tous points à ceux qu’il avait tant admirés dans l’oeuvre de Baudelaire ?
Déjà, il affirme qu’il lui est venu un goût nouveau des grands tableaux mystiques ; et il raconte que ses visites au musée du Louvre se cantonnent à peu près dans les coins des Primitifs.
Ce qui est tout à fait exact, c’est que l’appel de d’Aurevilly l’avait frappé : ses souvenirs d’enfance, son ascendance aidant, il va préparer sa conversion. Mais, pour mieux donner le change, — et faire attendre ! — il écrit En Rade et Là-Bas. S’il y a encore quelques chapitres naturalistes dans ces deux oeuvres, Hüysmans est bien décidé à abandonner les aventures usées du roman moderne.
Il le dit expressément aux premières pages de Là-Bas.
Avec quelle joie il va aller vers les livres que l’on n’hésitera pas à qualifier de religieux ! Et pourquoi ? simplement parce que là, il y a un domaine d’art inexploré, toute une littérature nouvelle à imposer, tout un monde, en somme, ignoré des hommes de lettres ; et dont lui, Hüysmans, il saura tirer d’étonnants romans, à coup sûr neufs.
Et quel orgueil littéraire serait désormais le sien !
Ce domaine mystique, tout le monde, en effet, pense-t-il, est d’accord pour le trouver ardu et rebelle. Il ne se prête guère aux explorations aisées, aux documentations entassées de bric et de broc en une journée. Sur ce territoire-là, impossible d’être renseigné, d’en noter tous les aspects, à moins d’y vivre peut-être, absolument.
Or, les romanciers, en général, ne sont point si consciencieux et si patients. Et puis, quel amas de volumes à consulter ! Mais tout est à connaître dès qu’on a mis un pied là-dedans ! Et ce qu’il faut déchiffrer de textes pour découvrir un détail utile, un mot intéressant ! Au moins là, on est sûr d’être seul à galoper au travers de tout, sans crainte de rencontrer un confrère.
En effet, en dehors du « mystérieux et pénétrant chapitre des Misérables, sur le couvent du Petit-Picpus », il n’y a dans toute la littérature d’aujourd’hui aucun livre religieux qui soit véritablement à prôner. J’aurai tout à dire, se répète-t-il encore ; et, quant à ne point égayer les foules avec ces futurs bouquins-là, ça, je ne m’en soucie guère !
Bien plus : du côté des prêtres, c’est la même certitude d’isolement. Employés dans une église, des vicaires au curé, ils ne se préoccupent que de leurs heures de présence obligatoire ; c’est en un mot la routine d’un bureau.
Sans doute, il y a, dans toute l’Eglise de France, quelques prêtres doctes ; mais ceux-là, ils ne songent point à écrire des romans même d’apparence mystique ; et, en dehors de quelques monographies d’églises, où ils se satisfont des plus banales redites, éculées en plus par la sottise bien connue des archéologues, ils ne produisent rien.
Ils ignorent d’ailleurs tout, pour bien dire.
Donc, de toutes parts, assurance d’être le seul écrivain en cette matière.
E t ce qu’elle est large !
Avec la Liturgie, la Mystique, la Symbolique, l’art religieux infini en ses manifestations, et quelque curieuse vie de sainte, j’ai, continuait-il, de quoi composer, en me mettant encore en scène, comme je l’ai fait jusqu’à ce jour.
Et mes nouveaux états d’âme à expliquer, c’est quelque chose, cela ! Car je ne me plierai pas bien sûr, sans grogner, à toutes les exigences de cette vie qu’il va falloir que désormais je vive !
Et prudemment, Hüysmans entretient ses amis des effluves saints qui dès maintenant l’assaillent. C’est qu’il sait bien qu’on n’acceptera pas aisément autour de lui cette conversion préparée uniquement, affirme-t-il, par de « mystérieuses voies divines. »
M. Lucien Descaves lui-même, qui a vécu dans l’intimité de Hüysmans, ne croit pas trop, du moins à ce moment-là (voir l’Evênement du 25 avril 1891), aux tendances mystiques de son illustre ami. Et tous ceux qui l’approchent, il faut bien le dire, ont alors les mêmes hésitations, presque les mêmes craintes d’une sorte de « mystification », mise au compte de la Littérature.
Quand, en février 1895, En Route parut, personne ne crut certainement à la conversion de l’auteur.
Je ne craignis pas moi-même de lui dire que telle était mon opinion.
— Eh bien ! vous avez tort, voilà tout ! me répondit Hüysmans. Vous savez si j’ai malmené Monseigneur d’Hulst dans ce livre, il n’a pas hésité, lui, cependant, à affirmer que certaines pages ne pouvaient être écrites par un auteur non touché de la Grâce !
J’avais osé lui dire cela parce que, quelques jours auparavant, accompagnant Hüysmans, nous étions entrés ensemble dans l’église Saint-Germain-des-Prés ; et, tout de suite, il m’avait jeté :
— Ce qu’ils l’ont gâtée cette chapelle, les trafiquants du culte. Tenez, regardez le long de ce mur un monument élevé à Flandrin ! Ça, c’est un comble ! Ça devient maintenant un dépotoir pour faux peintres ! Il est vrai que cette église-ci est particulièrement sordide avec ses saints de magasins et sa chaire pour une salle de correctionnelle ! Il faut en avoir du courage pour se ressaisir dans toute cette brocante ! Il est vrai que lorsqu’il reste de louables objets du culte, à la première occasion on les bazarde. Ah ! ils l’ont, les prêtres, le non-sens de l’Art !
Ces propos m’avaient encore cette fois-là surpris ; et cependant Hüysmans les avait déjà tenus souvent : toutes les fois qu’il avait été question entre nous du mobilier et de l’ornementation des églises actuelles.
Mais, à la rigueur, cela s’expliquait : en lui, le critique d’art véhément persistait, et, en y réfléchissant, sa conversion n’avait peut-être rien à voir là-dedans.
Ce qui était plus inattendu, c’étaient ses mots de pince-sans-rire, ses remarques fantaisistes, son humour impitoyable quelquefois à l’endroit de sa soudaine croyance.
Or, tout En Route est plein de ces choses-là.
Je sais bien qu’il a pris soin de nous avertir à l’avance que les saintes et les saints sont quelquefois bizarres et déconcertants.
Ainsi « Sainte Térèse, elle-même, avec toute sa grande intelligence et son prodigieux genie, était d’une simplicité admirable avec Dieu, dit Hüysmans (De Tout). Elle le considérait tel qu’un père auquel sa fille peut se permettre de lancer, sans qu’il se fâche, une boutade. Une réponse de ce genre qu’elle Lui fit est à citer en exemple : Un jour qu’accablée d’épreuves de toutes sortes, elle se plaignait et demandait une minute de grâce, Jésus lui dit : « Ne te plains pas, ma fille ; c’est ainsi que je traite mes amis », et, familièrement, elle répliqua : « Eh ! Seigneur, c’est pour cela que vous en avez si peu ! »
Oui ! mais c’était Sainte Térèse !...
Et Hüysmans se rend compte que ce modèle-là le dépasse ; car il revient ailleurs sur cette question des saints n’ayant pas toutes les vertus ; et il nous cite Benoît Labre « qui erra de villes en villes et fréquenta bien des Trappes sans jamais parvenir à s’y fixer. »
Ce Benoît Labre qui ne se trouvait bien nulle part, fut pour lui plaire, assurément ; car Hüysmans eut plus que quiconque l’esprit changeant ; toutefois il ne se contenta pas de la familiarité de Sainte Térèse et du goût d’indépendance de Benoît Labre ; il nous affirma qu’il y avait toutes les catégories parmi les saints, comme chez les magistrats, les hommes de lettres ou les négociants ; et il surenchérit en nous affirmant qu’on pouvait se montrer vif, raisonneur et même injuste, tout en étant un saint !
Ainsi tout s’expliquerait ; et il est possible d’admettre notamment tous les sacrifices relatifs au lever et à la nourriture que Hüysmans n’accomplit jamais régulièrement.
Bien plus : il relate avec plaisir que Célestin Godefroy Chicard, missionnaire, eut raison d’écrire cette phrase si sage, si profonde pour les gens qui sont au courant de la mystique : « Ne cherche pas à faire de l’extraordinaire, la Sainte Vierge n’en fit point. »
Ceci dit, on comprend mieux, c’est certain, ce que fut la conversion de J.-K. Hüysmans.
Encore faut-il avancer qu’elle dut s’appuyer toujours, pour être durable, sur ce qu’il appelait la « bonne nourriture » ; car, ainsi qu’il le dit (De Tout) : « C’est ridicule à déclarer, mais une tranche de gigot rassérène l’âme. »
Plus loin, il publie tout un chapitre intitulé : Le Luxe pour Dieu ; et il affirme qu’il est très juste que Solesmes contienne de nombreuses richesses ! Evidemment, à première vue, il semble très difficile de faire admettre cela à la majorité des ouailles ; mais Hüysmans en faveur de sa thèse n’en accumule pas moins des arguments nombreux sinon tout à fait décisifs.
Et il la renforce de cette opinion du P. Dom Besse, énoncée dans un livre, le Moine Bénédictin, paru à l’abbaye de Ligugé : « La construction et l’ornementation des églises monastiques et le caractère artistique des objets consacrés au culte n’importent pas moins à la régénération sociale d’un pays que l’érection des écoles ou des hôpitaux et que l’établissement de maisons de missionnaires. »
Et, ailleurs, on lit : « Le laid fait horreur aux Bénédictins. Ils y voient un désordre, un je ne sais quel péché dont la présence dans le temple ou à son ombre blesse le regard des anges, tandis que l’Art est comme le reflet de la beauté de l’ineffable Jésus. »
Tant pis, on le voit, pour les déshérités, pour les estropiés et les infirmes. L’huis des Bénédictins leur est clos ! Et si, cependant, ils expient pour d’autres, eux aussi, comme les saints, ces pauvres hères !
L’admirable morale !
Elle ne trouble pas Hüysmans.
Sa conversion comporte, en effet, déjà deux bienfaits principaux : d’abord, elle lui a procuré des « sujets » inédits, et ensuite elle lui permet d’échapper à ce qu’il appelle un « sale temps. »
Toutefois les catholiques ne viennent pas encore d’une seule poussée à lui. Il les gêne avec son style grincheux, discuteur, âpre. (Je connais des pratiquants qui lui refusent toute admiration.) Il fourrage trop, disent-ils, dans les jardins de l’Eglise et au travers des maximes les plus fortes de l’Evangile. Pour tout avouer, il est trop libre et trop entier, trop personnel. C’est au point — et certains s’en offusquent — qu’il prête à tous ses interlocuteurs, dans ses dialogues, toute sa phraséologie. C’est à croire que c’est lui qui parle tout le temps, soit qu’il fasse intervenir Mme Bavoil, l’abbé Plomb ou l’abbé Gévresin, — ou bien, ce qui est plus grave, une sainte !
— Et il est si peu charitable dans ses livres, Monsieur ! me disent quelquefois de bonnes âmes. Est-ce là la morale de Jésus ?
Le fait est, par exemple, qu’il ne manque jamais dans tous ses livres de malmener ses confrères. Telle cette courte et dure page si amusante à relire :
« Le monde des lettres! (La Cathédrale) non, Monsieur l’abbé, ce n’est pas lui que je pourrais regretter, car je l’avais quitté, bien des années avant de venir résider ici ; puis, voyez-vous, fréquenter ces trabans de l’écriture et rester propre, c’est impossible. Il faut choisir : eux ou de braves gens ; médire ou se taire, car leur spécialité, c’est de vous élaguer toute idée charitable, c’est de vous guérir surtout de l’amitié en un clin d’oeil.
— Bah !
— Oui, imitant la pharmacopée homéopathique qui se sert encore de substances infâmes, de jus de cloporte, de venin de serpent, de suc de hanneton, de sécrétion de putois et de pus de variole, le tout enrobé dans du sucre de lait pour en celer la saveur et l’aspect, le monde des lettres triture, lui aussi, dans le but de les faire absorber sans haut-le-coeur, les plus dégoûtantes des matières, c’est une incessante manipulation de jalousie de quartier et de potins de loges, le tout globulé dans une perfidie de bon ton, pour en masquer et l’odeur et le goût.
« Ingérés à des doses voulues, ces grains d’ordures agissent, tels que des détersifs, sur l’âme qu’ils débarrassent presque aussitôt de toute confiance ; j’avais assez de ce traitement qui ne me réussissait que trop et j’ai jugé utile de m’y soustraire. »
Pour les catholiques mêmes, M. l’abbé A. Mugnier a dû publier des pages expurgées ; et comme ils sont peu au courant des choses, il a écrit spécialement pour eux — en les ménageant ! — une substantielle biographie de Hüysmans et le résumé de ses oeuvres.
Sur l’apport de la considérable personnalité de l’auteur d’En Route, M. l’abbé A. Mugnier a, bien entendu, longuement insisté.
Ce n’est pas tous les jours, en effet, que l’Eglise peut se glorifier d’une telle acquisition. Après avoir fait état d’un Léo Taxil et célébré la médiocre besogne d’un Lasserre, elle doit recevoir à bras grands ouverts l’ « écrivain prodigue », qui supporte que l’on condamne — en paroles — ses fortes oeuvres antérieures. Aussi, après avoir excommunié hier Hüysmans, elle lui ouvre aujourd’hui l’accès des pieux éloges.
Les Etudes religieuses, la Revue Thomiste, l’Univers, la Vérité, en France ; le Magasin littéraire de Gand, la Jeune Belgique, la Revue Générale, la Durandal, en Belgique, célébrèrent à loisir les vertus du « nouvel et définitif écrivain catholique ».
Le R. P. Pacheu, de la Compagnie de Jésus, oubliant les principes d’une « saine » prudence, écrit : « Confondre (préface Pages catholiques) la droiture de Durtal avec les fumisteries d’un sauteur, ne mérite pas un brevet de perspicacité surnaturelle.
« S’acharner, deux ans après En Route, à mettre en doute la sincérité personnelle de l’auteur, c’est étrange et si j’osais dire en toute carrure de franchise, cela manque absolument de sens... n’est-il pas avéré, que, depuis six ans, il est un converti pratiquant, priant, édifiant — que ses amis bénédictins l’ont souvent reçu, — que la Trappe l’a vu de nouveau plus d’une fois raviver, dans la solitude, son âme et son talent ? Il a fait de mauvais livres ! Bien sûr, puisqu’il se convertit, on se doutait qu’il y eut quelques accrocs à quelques vertus. — Ces livres se vendent encore — mais, charitable et pudibond samaritain, ne les achetez pas, ne les lisez pas, ne les conseillez pas et de grâce, songez qu’avec les libraires comme avec d’autres contractants, il est des conventions synallagmatiques qu’on ne déchire pas à son gré... »
Puis M. le Marquis de Ségur, dans l’Univers, dit ce qu’il pense — aimablement — du nouveau converti.
Et, quand, au mois de février 1898, paraît la Cathédrale, les feuilles catholiques recouvrent de fleurs plus parfumées cet auteur qui a su écrire « une oeuvre artistique, archéologique et mystique », Même M. le Marquis de Ségur se porte garant « du retour progressif à Dieu de M. Hüysmans, de sa fidélité sans défaillances à la foi chrétienne, depuis sa conversion, de sa foi d’enfant, de son ardente dévotion à la Vierge Marie, de l’austérité pénitente et la borieuse de sa vie, cachée tantôt dans un cloître, tantôt dans sa cellule de la rue de Sèvres, à Paris. »
Cette cellule, c’était plutôt et toujours un confortable appartement. Seulement, quelques tableaux un peu libres avaient été remplacés par des images ; pieuses. Puis de nouveaux objets religieux encombraient les tablettes des cheminées.
Sur l’une d’elles, une petite cage de verre, surmontée d’un maigre Christ en cuivre, contenait ainsi des reliques avec leurs « authentiques. » Il y avait là des reliques de Sainte Térèse, du Bienheureux Grignon de Montfort (venant de la famille Veuillot), de Marie Alacoque (venant de Paray-le-Monial) et de Saint Martial, évêque de Cordoue.
Hüysmans me montra un jour à loisir toutes ces choses.
— Voici encore un doigt de Saint Victor, me dit-il ; et je vis, en effet, comme chimiquement blanchi, comme lessivé, à l’intérieur d’une autre petite cage de verre, surmontée d’une croix, un index.
Puis un Christ janséniste en buis, très curieux.
Au dos de la croix se trouvait effectivement une baguette que l’on retirait, comme une planchette de boîte de dominos, et l’on apercevait alors, attachés les uns aux autres par des rubans, des petits coussins contenant des reliques de Saint Théodore, de Sainte Aurélie, de Saint Lucien, de Saint Félix et de Sainte Vérécunde.
La chambre à coucher ne contenait que trois meubles : un lit de fer, une toilette et une petite table. Mais des tableaux ornaient encore les murs.
C’était d’abord la Parabole des Vierges folles et des Vierges sages de Saint Mathieu, par Peter Breughel ; puis, tout de suite, on était requis par un portrait de la soeur Emmerich, assise sur son séant, dans son lit, et, tandis qu’elle regardait le christ posé sur ses genoux, portant à son front ceint d’un bandeau ses longues mains trouées par les stigmates.
Ah ! ce qu’elle était froide comme une photographie de Morgue, cette estampe douloureuse !
De beauté plus reposante était en contraste cette image du musée de Cassel qui représentait le Christ et Madeleine, du primitif Jacob Cornélisz Van Oostzaanen.
Puis on était pris et secoué par le fameux crucifié de Mathaeus Grünewald, décrit dans Là-Bas. Quel Christ hurleur, sacripant et démoniaque ! Les bras de la croix ploient sous le faix du Supplicié ; sa tête roule sur ses épaules, et sa bouche s’ouvre pour vomir comme celle d’un reître ivrogne. Les mains se détendent, s’étirent de douleur, les pieds se recroquevillent, et tentent de remonter ; les genoux pointent et le thorax se creuse, tandis que la mort vient lentement, perpétrant l’agonie féroce, imaginant les dernières et plus frénétiques souffrances, espérant les hurlements, les suprêmes aboiements, dans un paysage au ciel d’encre, au sol rouge !
Oui, cellule si l’on veut; car il était plutôt attrayant, cet appartement tout tendu de rouge ; et une bibliothèque, presque exclusivement composée d’oeuvres mystiques, en complétait l’embellissement.
Hüysmans posséda principalement : La Légende dorée, de Jacques de Voragine, bel incunable avec lettres en couleur (venant des Jésuites) ; une petite Légende dorée, incunable également ; et la même en incunable français ;
Une Semaine Sainte aux armes de Marie Leczinska ; une Semaine sainte en latin, des presses de Plantin ;
Une sainte Bible de Ian de Tournes, avec des figures de Salomon dit le petit Bernard ;
Un Pontifical romain (Venise), imprimé en rouge et noir ;
La Bible de Louvain ; puis toute une série de livres sur la Mystique, parmi lesquels :
La seconde traduction des oeuvres de Saint Denis.
L’Aréopagite, par Jean de Saint-François.
La Cité mystique de Dieu, par Marie d’Agréda.
Les Tauler ; etc., etc.
Tout cela, c’était peu si l’on veut songer à l’abondante documentation des nouveaux livres de Hüysmans, ceux de cette période dite religieuse.
Pendant leur préparation, il peinait sur toute une besogne occulte que les plus avisés ne soupçonnent même pas.
Devenu « naturaliste mystique », il n’escamotait pas plus qu’autrefois le renseignement utile et il le voulait aussi précis. Il traduisait des textes latins entièrement pour dénicher deux mots importants ; il remuait d’arides tomes de botanique à propos de la flore liturgique. Et il ne s’arrêtait point de lire les livres condamnés, il fourrait son nez dans tout l’envers aussi de l’Eglise. Il restait hanté de vierges folles, de prêtres sataniques et de magie. Ergoteur et mauvaise tête, il ne demeurait pour le plus grand nombre, que comme un parfait artiste de lettres jeté, par goût littéraire, dans la Foi et ses « Curiosités ».
Aussi fût-ce un étonnement certain quand on apprit que, délaissant Paris et ses offices (il avait aimé Saint Sulpice et Saint Séverin), Hüysmans était parti pour de bon cette fois, afin de vivre à Ligugé, près d’un monastère.
Il fallut bien se rendre à l’évidence. Un beau jour, ses amis reçurent, en effet, une carte ainsi libellée :
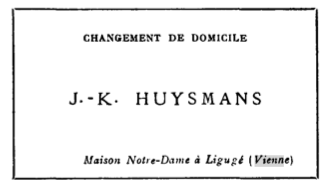
Comment allait-il vivre là-bas ? Il n’était guère possible de croire à son entrée dans un ascétère.
Il était lesté de trop de préoccupations de nourriture et de repos pour se plier aux exigences les plus anodines. Il regimbe, il se plaint tout le temps ; il raconte avec une familiarité excessive toutes ses « petites histoires »; certainement, on ne pourra point l’accueillir, se répétait-on, ainsi encombrant et peu commode !
On sut qu’il se « tâtait » d’abord, et que, doutant tout le premier de lui-même, il allait vivre, non point parmi les moines, mais à côté d’eux, dans une petite maison installée pour lui seul, et d’où il partirait, à des heures régulières, pour assister à certains offices (qui ne le dérangeraient pas trop), comme un retraité va à la pêche, quand la saison en est ouverte et le temps favorable.
Les ennemis de Hüysmans en ricanèrent.
— Si on appelle cela, dirent-ils, être converti, nous le sommes tous, nous aussi, qui recherchons avec la même conscience le document exact. Quand on le voudra, nous vivrons, nous, également, dans une confortable maison paysanne, bien alimentée de comestibles frais et bien à l’abri des vents, près d’une agréable forêt et non loin d’un chef-lieu à peu près pourvu de passe-temps divertissants !
Et la vie de Hüysmans à Ligugé pendant deux ans fut telle :
Il assista à certains offices et il travailla.
L’enviable vie !
Je sais toutefois qu’il n’eut point à se louer des paysans poitevins, puisqu’il a dit en parlant de la petite rivière du Clain : « Elle symbolise l’extraordinaire sournoiserie et l’incomparable fainéantise de cette race mesquine qu’est la race des Poitevins ». Mais il faut voir là une rancune contre ces paysans — qui, pareils aux autres paysans de France, d’ailleurs — n’aiment guère les moines, et le leur montrent bien à l’occasion par d’imbéciles inscriptions crayonnées sur les murs.
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que Hüysmans, à Ligugé, put travailler tout à son aise, puisqu’il y fit paraître une brochure consacrée à la Magie en Poitou, — et qu’il y écrivit eu partie l’Oblat et entièrement le touffu roman de la vie de la Bienheureuse Sainte Lydwine de Schiedam.
Ce qu’il consulta encore de volumes pour cet ouvrage-là, c’est inouï, vraiment ! Il en donne la liste, et elle inquiète.
Je crois — irrespectueusement — qu’il prit trop de notes, et qu’il alourdit ainsi, à les vouloir utiliser presque toutes, son récit.
Et puis trois biographies antérieures de la Sainte à suivre, c’était peut-être trop de sources.
Sa verve s’est diluée un peu au travers de cette monotonie de douleurs et de maux ; et, cependant, par instants, une simplicité de style tout à fait inhabituelle émeut !
Un regret — que j’ai déjà signalé — c’est qu’il prête trop souvent à la sainte ses propres mots ; et cela étonne, on en conviendra, d’entendre la Bienheureuse s’exprimer dans ce style de familiarité bourrue que Hüysmans affectionnait.
Autre chose: Hüysmans reproche à Flaubert de manquer d’ « accent » dans son admirable Légende de Saint Julien l’hospitalier ; et c’est peut-être exact ! mais, lui, Hüysmans, il en manque bien davantage. Certes, ce n’est pas en lisant un quelconque de ses livres d’après la conversion que l’on s’acheminera jamais vers la Grâce !
Non, cette vie de Sainte Lydwine est un nouveau prétexte à geindre, continuellement, quoiqu’elle soit résolument écrite avec foi, avec une force tranquille et une audace assurée.
Lisez ici ce qu’il dit des nations européennes. C’est un cruel et juste jugement :
« L’Autriche est rongée (Sainte Lydwine) jusqu’aux moelles par la vermine juive ; l’Italie est devenue un repaire maçonnique, une sentine démoniaque, au sens strict du mot ; l’Espagne et le Portugal sont, eux aussi, dépecés par les crocs des Loges ; seule, la petite Belgique paraît moins cariée, de foi moins rance, d’âme plus saine; quant à la nation privilégiée du Christ, la France, elle a été attaquée, à moitié étranglée, saboulée à coups de bottes, roulée dans le purin des fosses par une racaille payée de mécréants. La franc-maçonnerie a démuselé, pour cette infâme besogne, la meute avide des israëlites et des protestants. »
Et ce qu’il pense de nos ineffables gouvernants n’est pas plus tendre :
« Il y a dans tous les cas, un fait, indéniable, absolu, sûr, c’est qu’en dépit des dénégations intéressées, le culte Luciférien existe ; il gouverne la franc-maçonnerie et tire, silencieux, les ficelles des sinistres baladins qui nous régissent ; et ce qui leur sert d’âme à ceux-là est si pourri qu’ils ne s’imaginent même pas qu’ils ne sont, quand ils dirigent l’assaut contre le Christ et son Eglise, que les bas domestiques d’un maître à l’existence duquel ils ne croient pas ! Si habile à se faire nier, le Démon les mène. »
Mais ce sont surtout les pages dans lesquelles Hüysmans parle de la Souffrance que je tiens à faire relire, car elles sont autrement belles que celles écrites par Coppée ; et quand on songe à la longue agonie résignée de Hüysmans, elles apparaissent, assurément, d’une inégalable éloquence :
« Il n’y a jamais eu tant besoin de Lydwine qu’à présent, dit-il ; car, elles seules seraient à même d’apaiser la colère certaine du Juge et de nous servir de paratonnerre et d’abri contre les cataclysmes qui se préparent !
« Je ne me dissimule pas qu’en parlant de la sorte, dans un siècle où chacun ne poursuit qu’un but : voler son prochain et jouir en paix dans l’adultère ou le divorce de ses dols, j’ai peu de chances d’être compris. Je sais très bien aussi que devant ce catholicisme dont la base est la désaccoutumance de soi-même et la souffrance, les fidèles épris de dévotionnettes et abêtis par la lecture de pieuses fariboles, s’exclameront ; ce sera pour eux l’occasion de ressasser, une fois de plus, la complaisante théorie « que Dieu n’en demande pas tant, qu’il est si bon.
« Oui, je sais bien, mais le malheur, c’est qu’il en demande autant et qu’il est néanmoins infiniment bon. Mais il faut le répéter, une fois de plus, aussi, il dédommage, ici-bas même, par des joies intérieures, ceux qui le prient, de leurs afflictions et de leurs maux ; et chez les êtres privilégiés qu’il torture, l’outrance des liesses dépasse l’excès des peines; tous ont dans des corps broyés des âmes qui rayonnent, tous s’écrient comme Lydwine qu’ils ne souhaitent pas d’être guéris, qu’ils n’échangeraient pas les consolations qu’ils reçoivent pour tous les bonheurs du monde.
« D’ailleurs, les ouailles que l’existence exceptionnelle de ces protectrices effare, auraient tort de s’alarmer ; prenant en pitié leur ignorance et leur faiblesse, Dieu les épargnera plus sans doute qu’il n’a épargné son propre Fils ; il ne cherche pas parmi ceux qu’il n’a point nanti d’armes bien robustes les poids destinés à rétablir l’équilibre de la balance dont le plateau des fautes descend si bas... De même que personne n’est tenté au-dessus de ses forces, de même personne n’est chargé de douleurs qu’il ne puisse, d’une façon ou d’une autre, tolérer. Il les dose aux moyens de résistance de chacun ; seulement, ceux qui ne souffrent que modérément auraient tort de se trop réjouir, car cette abstinence de tourments n’est ni un signe de validité spirituelle ni d’amoureuse préférence.
« Mais ce livre n’est pas écrit, en somme, pour ceux-là. Il est, en effet, difficile, pour des gens qui vivent en bonne santé,de lebien comprendre ; ils le saisiront mieux, plus tard, lorsque séviront les mauvais jours; par contre, il s’adresse plus spécialement aux pauvres êtres atteints de maladies incurables et étendus, à jamais, surune couche. Ceux-là sont, pour la plupart, des victimes de choix ; mais combien, parmi eux, savent qu’ils réalisent l’oeuvre admirable de la réparation et pour eux-mêmes et pour les autres ? cependant, pour que cette oeuvre soit véritablement satisfactoire, il sied de l’accepter avec résignation et de la présenter humblement au Seigneur. Il ne s’agit pas de se dire : Je ne saurais m’exécuter de bon coeur, je ne suis pas un saint, moi, tel que Lydwine, car, elle non plus, ne pénétra pas les desseins de la Providence lorsqu’elle débuta dans les voies douloureuses de la Mystique ; elle aussi, se lamentait, comme son père Job, et maudissait sa destinée ; elle aussi se demandait quels péchés elle avait bien pu commettre pour étre traitée de la sorte et elle ne se sentait pas du tout incitée à offrir de son plein gré ses tourments à Dieu ; elle faillit sombrer dans le désespoir ; elle ne fut pas une sainte du premier coup; et néanmoins après tant d’efforts tentés pour méditer la Passion du Sauveur dont les tortures l’intéressaient beaucoup moins que les siennes, elle est parvenue à les aimer et elles l’ont enlevée dans un ouragan de délices jusqu’aux cimes de la vie parfaite ! La vérité est que Jésus commence par faire souffrir et qu’il s’explique après. L’important est donc de se soumettre d’abord, quitte à réclamer ensuite. Il est le plus grand Mendiant que le ciel et la terre aient jamais porté, le Mendiant terrible de l’Amour ! les plaies de ses mains sont des bourses toujours vides et il les tend pour que chacun les emplisse avec la menue monnaie de ses souffrances et de ses pleurs.
« Il n’y a donc qu’à Lui donner la consolation, la paix de l’âme, le moyen de s’utiliser et de transmuter à la longue ses tourments en joie, ne peuvent s’obtenir qu’à ce prix. Le récepte de cette divine alchimie qu’est la Douleur, c’est l’abnégation et le sacrifice. Après la période d’incubation nécessaire, le grand oeuvre s’accomplit ; il sort du brasier, de l’athanor de l’âme, l’or, c’est-à-dire l’Amour qui consume les abattements et les larmes ; la vraie pierre philosophale est celle-là. »
Avec l’Oblat, Hüysmans reprit sa besace de plaintes, et il nous distribua sans compter toutes ses raisons de vivre en dehors de tout monastère.
Dans ces conditions-là : ne pas revêtir la robe de l’oblature, ne pas se séquestrer dans un cloître, loger au dehors et suivre seulement les offices, on avouera qu’une conversion ne comporte pas des exigences variées et terribles.
Et l’on voit nettement le cas de l’écrivain qui veut prendre en toute liberté ses notes, étudier sans gêne, boire et manger selon ses appétits, allumer des cigarettes quand tel est son bon plaisir.
Dans le public, c’est certain, on se fait une toute autre idée de la conversion ; mais on a vraisemblablement tort.
L’imprudence de Hüysmans, c’est peut-être aussi d’aller trop loin dans ses souhaits, — il est vrai que c’est de la littérature encore ! — quand il s’écrie, ailleurs :
« Ah ! vivre, vivre à l’ombre des prières de l’humble Siméon, Seigneur ! »
En cela il ne peut vraiment, comme on dit, être cru sur parole !
N’importe ! ce nouveau roman l’Oblat est curieux, parce que Hüysmans est resté lui-même tout au long des pages.
La cuisine l’inquiète toujours. Il se débat contre sa bonne, la mère Vergognat, qui lui prépare des mets sans saveur ; aussi fait-il sans tarder venir auprès de lui Madame Bavoil, quand elle est libre. Alors ses repas sont excellents et il ne cache point sa satisfaction.
Puis, il voit les moines quand il le désire ; il allonge ou abrège ses promenades à son gré ; s’il ne veut pas assister à un office, il prétexte un malaise ; ah ! certes, combien elle est aimable, la vie dans la petite maison de Ligugé ! et, telle quelle, combien de laïques et même de francs-maçons, s’ils en avaient le moyen, la vivraient vite !
Enthousiasmé, Hüysmans va bientôt jusqu’à déclarer qu’il ne tient pas à revenir à Paris. Pour le moment, peut-être. Les moines exilés, il décampera cependant au plus vite ; et c’est le vrai Hüysmans qui parlera encore cette fois avec sa familiarité excessive qui n’a fait que s’aggraver dans son admiration pour Sainte Térèse, la plus prodigieuse peut-être, mais aussi la plus libre des saintes.
Toute cette fin de l’Oblat est à citer :
« L’expérience est close ; le Val des Saints est mort ; j’ai assisté à l’ensevelissement du monastère et j’ai été l’aide-fossoyeur de ses offices. C’est à cela que s’est borné mon rôle d’oblat ; il est fini maintenant car il n’a plus, aujourd’hui que je suis arraché de mon cloître, de raison d’être.
« Il sied d’avouer tout de même que la vie est singulière ! La Providence m’a fait passer deux ans, ici, pour me renvoyer ensuite Gros-Jean comme devant, à Paris. Pourquoi ? Je l’ignore, mais je le saurai sans doute, un jour. Je ne puis néanmoins m’empêcher de croire qu’il y a eu maldonne en cette affaire, que je suis descendu à une station intermédiaire, au lieu de ne m’arrêter qu’au point terminus, qu’à la tête de ligne.
« Je me suis peut-être trompé, moi-même, en présumant.
« En tous cas, mon Seigneur, ce n’est pas bien ce que je vais vous dire, mais je commence à me méfier un peu de vous. Il semblait que vous deviez me diriger sur un havre sûr. J’arrive — après quelles fatigues ! — je m’assieds enfin et la chaise se casse ! est-ce que l’improbité du travail terrestre se répercuterait dans les ateliers de l’au-delà ? est-ce que les ébénistes célestes fabriqueraient, eux aussi, des sièges bon marché qui s’effondrent dès qu’on se pose dessus ?
« Je ris et je n’en ai guère envie, car ces tunnels dont je ne vois pas le bout m’effarent. Que vous agissiez au mieux de mes intérêts, il ne m’est pas permis d’en douter et je suis très assuré aussi que vous m’aimez et que vous ne me délaisserez point ; mais, daignez, en excusant l’inconvenance de la proposition, vous mettre une toute petite minute à ma place, et avouez, mon cher Jésus, que je ne divague pas, en vous attestant que je ne sais plus du tout à quoi m’en tenir.
« Ai-je obéi à votre volonté ou ne lui ai-je pas obéi ? Je vous connus Grand Veneur d’âmes, les chassant et les rabattant ainsi que la mienne, dans une Trappe. Ah ! là, il n’y avait point d’erreur ; en me réfugiant dans un ascétère, j’étais certain de vous contenter, les indications étaient nettes et lès réponses précises. Aujourd’hui, vous ne me forlancez plus; je n’entends plus le frisson de vos ordres et je suis réduit à me conduire, de moi-même, selon les données de la raison humaine, ce que je m’en fiche de celle-là ! ce que je ne l’écoute, que faute de mieux !
« Songez aussi que je ne suis pas seul, que j’ai à remorquer la mère Bavoil et que nous ne savons ni l’un, ni l’autre, où nous allons ; c’est la parabole des aveugles ; le fossé est peut-être proche.
« Dans quelques jours, si les choses vous agréent de la sorte, nous serons réinstallés dans ce Paris que nous pensions bien ne plus réhabiter, Qu’est-ce qui va nous arriver là ? Les sièges y seront-ils plus solides qu’au Val des Saints, ou ne sera-ce encore qu’une étape ?
« C’est égal, reprit-il, après un silence de pensée, quel désastre de tranquillité, d’argent, de piété liturgique, d’amitiés, de tout, que ce départ ! je geins et ce n’est cependant pas moi qui suis le plus à plaindre. Songeons aux autres, à ceux qui restent, à la pauvre Mlle de Garambois isolée, sans offices ; à M. Lampre qui se débat dans des affaires de chicane pour sauver ses moines ; à ce malheureux père Paton surtout, abandonné, loin des siens, sans existence monastique possible, dans ce trou.
« Mais leur infortune n’allège pas la mienne ; elle ne fait, hélas ! que l’aggraver et je tremble à l’idée ile rentrer à Paris, dans la bagarre ; quelle tristesse !
« Au lieu d’une propriété paisible, je vais retrouver les boîtes à dominos d’une maison commune, avec menace, en dessus et en dessous, de femmes s’hystérisant sur des pianos et de mioches roulant avec fracas des chaises pendant l’après-midi et hurlant, sans qu’on se résolve à les étrangler, pendant la nuit ; l’été, ce sera la chambre de chauffe, l’étouffoir ; l’hiver, en place de mes belles flambées de pins, je considérerai par un guichet de mica du feu en prison qui pue. En fait d’horizons, j’aurai sans doute un paysage de cheminées. Bah ! je m’étais jadis habitué aux futaies des tuyaux de tôle poussées dans le zinc des toits sur le fond saumâtre des temps gris. Je m’y raccoutumerai ; c’est un courant à reprendre.
« Et puis...et puis on a bien des choses à expier. Si la schlague divine s’apprête, tendons le dos; montrons au moins un peu de bonne volonté. On ne peut pourtant pas toujours être dans la vie spirituelle ce qu’est, dans la vie matérielle, le mari de la blanchisseuse ou de la sage-femme, le monsieur qui regarde, en se tournant les pouces !
« Ah ! mon cher Seigneur, donnez-nous la grâce de ne pas nous marchander ainsi, de nous omettre une fois pour toutes, de vivre enfin, n’importe où, pourvu que ce soit loin de nous-mêmes et près de Vous ! »
Ce séjour à Ligugé ! Il reste cependant ceci, c’est que Hüysmans y vécut dans une heureuse période de travail.
C’est là encore qu’il rassembla et corrigea les épreuves de son nouveau livre : De Tout, si curieusement émaillé de chapitres variés et ardemment colorés. Notes de voyage, petits quartiers de Paris, portraits de quelques peintres, anciens « croquis parisiens » repris pour corser le volume, il relia tout cela par une prose plus libre, mais toujours pittoresque et combattive ; celle qu’on retrouve heureusement dans Trois Eglises et Trois primitifs et dans les Foules de Lourdes.
Le licenciement des moines fut la cause immédiate de son départ. Mais ces deux ans passés dans le Poitou l’accablaient et il n’eût guère pu, avec tout son bon vouloir, — je l’expliquerai plus loin — accorder une autre année de sa présence à ses amis les moines.
Le retour à Paris s’imposait.
Ah! que les quais de la Seine sont Jolis !
JE viens de dire que Hüysmans ne pouvait plus se plaire à Ligugé, mais je n’en ai pas donné les principales raisons. Les voici :
Les moines ne l’enchantaient plus ; il sentait autour de lui une légère hostilité, qui existait réellement. Il était trop personnel pour qu’il n’en fût point ainsi. Les moines, en général, ne comprirent point du tout Hüysmans. Il les choquait par ses allures, par ses propos demeurés très libres, par sa verve qui éclatait à tout moment ; ou bien il était pris d’une soudaine mélancolie qui effarait tout le monastère.
Cela, et aussi son horreur si connue de la campagne avaient peu à peu détaché Hüysmans de son nouveau rêve.
« Il n’est que temps de rentrer à Paris ! répétait-il, mais — pour la littérature encore ! — les dernières pages de l’Oblat étaient nécessaires. Ses amis surent tout de suite — malgré tout — à quoi s’en tenir.
D’ailleurs, comment était-il allé à Ligugé ? C’était aux derniers mois de son séjour rue de Sèvres, alors que, en retraite, il vivait, visité par quelques abbés, et en la compagnie de celui qui fut un véritable disciple, d’un dévouement sans mesure : M. Jean de Caldain.
Excepté le dimanche soir, où il recevait presque régulièrement à dîner ses amis Gustave Geffroy, Forain, Girard, Lucien Descaves, Landry et M. l’abbé Mugnier, tous les autres jours c’était la même routine remplie par les offices et le travail.
Autrefois, on n’avait jamais beaucoup aperçu Hüysmans dans quelque « attraction » que ce fût ; mais, depuis bien des mois, il ne s’acheminait plus que de chez lui à l’église et de l’église à la rue de Sèvres. Une révolution sacquebutant Paris n’eût modifié en rien cet itinéraire entêté.
Un soir alors, tout naturellement, M. Jean de Caldain en vint à se demander pourquoi Hüysmans n’allait pas carrément vivre à l’ombre d’un cloître.
Souvent, ensemble, ils avaient parlé d’une sorte de communauté d’artistes qui réunirait des gens ayant un sentiment religieux. Mais voilà, où les trouver ? s’interrogeait Hüysmans. Je connais bien un littérateur de ce genre, et je crois que c’est moi ! mais, à y réfléchir, c’est bien à peu près tout ! Un peintre seulement, un seul peintre, où le prendre ?
— Pardon ! il y a Dulac ! dit M. Jean de Caldain.
« Ah ! c’est trop fort ! sourit Hüysmans. Je serais curieux, vraiment, de voir les oeuvres de ce Dulac ! Ça, par exemple !
« Bien ! vous les verrez.
Et le surlendemain, le sculpteur Pierre Roche et M. de Caldain présentaient Charles-Marie Dulac à Hüysmans.
Ce fut un coup pour l’incrédule. Quand il vit ces lithographies mystiques (Dulac était surtout un lithographe), il ne cacha point son enthousiasme ; et, tout de suite, dans son esprit, il pensa que Dulac serait le Fra Angelico de la communauté qu’il rêvait.
Et il fut entendu que M. Jean de Caldain en ferait partie lui aussi, car il connaissait à merveille le tirage des épreuves lithographiques.
Alors Hüysmans précisa ses intentions :
« Je ne veux pas, dit-il, que l’on croie que je cherche à catéchiser les artistes et les littérateurs ! Ah ! non. Je me refuse à ouvrir une métairie d’âmes en déroute. Il faut qu’on vienne à nous avec une foi déjà certaine, ou, sinon, on boucle l’huis. Ce serait trop simple, s’il en était autrement. Nous aurions vite nombreuse compagnie de pseudo-artistes uniquement écrasés par le sort, et qui viendraient chercher près de nous un peu de fainéante tranquillité et beaucoup de profits !
Et, pendant bien des soirées, l’on discuta sur les points précis qu’il convenait de fixer.
Hüysmans, d’ailleurs, plus tard, devait les reprendre aux dernières pages de l’Oblat. Voici ce qu’il écrivit à ce propos :
« Une semblable institution ne serait guère possible qu’à Paris ou dans ses alentours, car les gens de lettres, les chartistes, les érudits, les gens spécialisés dans l’étude des diverses sciences, aussi bien que les peintres, les sculpteurs, les architectes, que les artisans de tous les métiers d’art que pourraient abriter des maisons d’oblats, auraient besoin d’entretenir des relations avec les éditeurs et les marchands et de fréquenter les bibliothèques et les musées. Il conviendrait aussi de distribuer la vie de telle sorte que chacun pût vaquer à ses affaires et travailler sans être continuellement dérangé par des offices. L’horaire serait facile à établir : — prière, et messe, le matin, de bonne heure : liberté complète pendant la journée — Vêpres vers les cinq ou six heures pour ceux qui seraient en mesure d’y assister — et Complies pour tout le monde, le soir.
« Je ne me dissimule pas cependant que, par cela même qu’elle serait rédemptrice et vraiment propre, cette oeuvre aurait des chances d’encourir toutes les haines, mais il me paraît impossible qu’en dépit de toutes les railleries, de toutes les mauvaises volontés, elle ne prenne pas corps un jour, car elle est, comme on dit, dans l’air ; il y a trop de gens qui l’attendent, qui la convoitent, trop de gens qui ne peuvent, à cause de leurs occupations, de leur état de santé, de leur genre de vie, s’interner dans les cloîtres, pour que Dieu n’instaure pas un havre de grâce, un port, où s’amarreraient ces âmes qu’obsèdent des appétences monastiques, des désirs de vivre hors du monde et de travailler près de Lui et pour Lui ! en paix. »
Peu à peu, l’idée donc « prenait corps ».
On ne cessait plus de l’examiner et de la retourner sur toutes ses faces. Aux visiteurs — amis et abbés — on posait des questions touchant une telle communauté ; on cherchait les moyens de la créer, de la faire vivre ensuite et de la développer.
Comme des bourgeois rêvent d’une installation à la campagne, supputent des dépenses, projettent des mobiliers, Hüysmans et les intéressés débattaient entre eux l’organisation future, passaient en revue les ascétères auprès desquels on pourrait s’installer.
Il restait à découvrir aussi une maison convenable où chacun, à l’aise, travaillerait en toute liberté, dans des coins séparés, pour ne se réunir qu’aux heures des offices et des repas.
Et cette demeure à édifier, c’était, somme toute, la grosse question. Oui, comment s’y prendre — et dans quel site ?
La réponse fut apportée par M. et Mme Léon Leclaire, que présentait à Hüysmans l’abbé Ferret, alors vicaire à Saint-Sulpice. Ces personnes pieuses connaissaient, à Ligugé, un vieux monastère ; et elles assuraient qu’il y avait devant le couvent la place largement suffisante pour une maison d’habitation ; — et, mieux encore : elles apportaient les fonds pour la bâtir.
Hüysmans regimba. C’était trop à la fois. Il n’aimait pas qu’on le liât ainsi d’un seul coup, sans crier gare. Il demanda à réfléchir, — et sans hâte.
Le ménage qui arrivait avec de telles offres était très recommandable, donnait toutes les références. Ce premier point acquis, Hüysmans s’enquit alors de Ligugé. Là encore, il obtint toute satisfaction. Le monastère se trouvait à 8 kilomètres au sud de Poitiers ; c’était parfait ; on était près d’une ville. Et il y avait des bois, des prairies arrosées par une capricieuse petite rivière, le Clain. Bah ! avec des livres à lire et à écrire, ce serait bien le diable si l’on ne s’accommodait pas une vie enfin propre !
Mais, sur la question des fonds, Hüysmans fut intraitable. Il acceptait, soit, la construction d’une maison, mais à condition d’y participer pour la moitié. Il fallut en passer par là.
Justement, un architecte avisé, ayant dessiné bien des édifices conventuels, se trouvait libre. On lui demanda de préparer un projet. Celui-ci fut agréé et l’habitation terminée, on la baptisa Maison Notre-Dame.
On avait pensé à tout. Comment vont nous accueillir les moines ? s’était, en effet, demandé Hüysmans. Si l’église est dans le couvent, ils vont peut-être nous balancer, et alors il nous faudra suivre les offices je ne sais où !
Il se trouva que l’église, quoique abbatiale, appartenait à la petite paroisse ; elle était donc libre. Tout, décidément, s’arrangeait ; et le départ collectif était fixé ; — enfin on allait mettre le cap sur un « havre de grâce », quand l’abbé Ferret (qui devait compter aussi dans la nouvelle communauté) et Charles-Marie Dulac trépassaient.
Le « pauvre petit frère » surtout, ainsi qu’il s’appelait lui-même, avait pourtant bien rêvé joyeusement de Ligugé.
Il comptait beaucoup travailler là-bas ; il se serait contenté de lait, de pommes de terre et d’un lit-cage, comme il disait. Sa mort, après celle de l’abbé Ferret, causa une véritable tristesse à Hüysmans. Il avait mis en lui « l’incontestable espoir de la peinture mystique de notre temps ». A quoi bon partir maintenant ? se répétait-il. Mais la maison là-bas l’attendait ; il partit ; et il laissait à Paris M. Jean de Caldain qui n’acceptait plus le voyage, Charles-Marie Dulac n’étant plus là.
Hüysmans resta deux ans, à Ligugé. Il occupa seul le premier étage de la maison ; le ménage ami s’était installé au rez-de-chaussée.
Sa vie là-bas, ce fut sa vie de Paris, à peu de chose près : assister aux offices, prendre des notes, écrire, — et les flânes le long des quais de la Seine remplacées par des promenades dans les bois ou au bord du Clain. Il alla quelquefois à Poitiers ; mais Notre-Dame la Grande ne sut point l’attirer, comme la souveraine de Chartres ; la petite cathédrale romane, fouillée comme un meuble, lui tenait un langage trop continu de vieille bavarde, qui mêle tout.
Il fut à Schiedam pour tâcher d’y trouver l’atmosphère valable à la vie de Sainte Lydwine ; et il a raconté combien ce voyage éveilla en lui de vifs et mélancoliques souvenirs.
Puis il revint à Ligugé ; et il finit d’y travailler avec un entrain qu’il n’avait guère connu. Les deux ans passés là-bas s’expliquent seulement par ce gros labeur entêté, que ne coupèrent plus à la fin que quelques rares promenades affreusement tristes dans la campagne poitevine.
Il rentra à Paris, très abattu, mais avec cependant la certitude désormais bien établie qu’il ne pouvait vivre, malgré tout, que là.
Informé de son retour, François Coppée s’entremit pour lui proposer un appartement, dans la maison qu’il habitait lui-même au No 12 de la rue Oudinot.
Le logis était convenable, tranquille, et l’on avait jouissance d’un jardin. Hüysmans allait accepter ; le prix de location en était raisonnable. Mais Coppée avait compté sans le propriétaire qui, apprenant que Hüysmans allait devenir son locataire, s’empressa de majorer sans mesure le montant du loyer.
La mère abbesse des Bénédictines du Saint-Sacrement offrit alors un appartement, dans une annexe de sa communauté, au No 19 de la rue Monsieur.
Hüysmans la visita, sans joie. Pourtant, sur les instances de M. Jean de Caldain qui lui représenta qu’il n’avait que quelques pas à faire pour aller à la chapelle, il se décida à débarquer là ses livres.
Quand il y fut à peu près installé, il eut à corriger les épreuves de l’Oblat.
« Il vécut, malgré tout, très attristé dans ce logis, m’a dit un de ses familiers. Quelquefois, il jetait une exclamation joyeuse, c’était quand il avait déniché un document intéressant ou pris en défaut un bonze ! Alors il redevenait pour un instant bavard, s’égayait à l’idée de désarçonner, comme il disait, des opinions admises, — et tout cela, il le proférait avec cette liberté de propos que vous connaissez et qu’il ne changea jamais contre un langage si peu policé qu’il fût.
Il ne réussit point à s’habituer à son nouveau logement. Ses repas, qu’il prenait dans le réfectoire des hôtes des Bénédictines, l’anéantissaient. Par surcroît, un jour, un commencement d’incendie éclata dans une de ses cheminées. Il s’en inquiéta. Tout pouvait, ici, brûler en un clin d’oeil. L’appartement était assurément trop délabré. Mais l’ennui d’un déménagement était si excédant qu’il se résignait. Alors on chercha pour lui un autre gîte.
Il laissait faire. Il avait dit son goût ; et c’était tout.
Sur la rive droite, il ne fallait point songer à s’y aventurer, par exemple. Ah ! non. Il abhorrait ces quartiers où l’on se bouscule sans politesse, où toute une horde de voyous s’abreuve, assis à des terrasses, l’été, ou parqués autour d’un orchestre, l’hiver. Il ne voulait plus passer, à jamais devant ces « palaces » où tous les forbans du Monde drainent leurs vols, et devant ces théâtres où, sous prétexte de littérature dramatique, on transvase l’ordure des alcôves et des Banques. Enfin, c’était un point acquis que toutes les églises de ces quartiers-là recélaient les pires ignominies du cuIte.
On arrêta enfin un appartement au No 60 de la rue de Babylone.
Cette rue est, en somme, paisible, et tout à fait même quiète par endroits. Et puis, on y aperçoit des aspects de jardins, des cours de maisons quasi-conventuelles.
Ce fut bientôt encore un logis attirant et un logis d’artiste. Tout y redevint méticuleusement rangé et propre, ordonné et harmonieux. Tableaux et livres s’y retrouvaient, familièrement amis. Hüysmans y donna l’illusion qu’il se reprenait à vivre. Et on le fêtait.
De tous côtés, on voulait de plus en plus illustrer ses livres. Les éditeurs et les bibliophiles s’y encourageaient, mutuellement.
M. Romagnol, néanmoins, avait toutes les préférences de Hüysmans. Il avait si bien réussi avec l’édition du Quartier Notre-Dame !
Aussi, l’écrivain ne voulut point tout d’abord entendre parler d’un autre éditeur pour illustrer sa Cathédrale ; mais M. Romagnol ayant justement fait remarquer que cette oeuvre serait pour lui une sorte de redite — évidemment développée — du Quartier Notre-Dame, Hüysmans le comprit si bien qu’il songea tout aussitôt à lui proposer un autre livre.
Que de visites à ce sujet M. Romagnol fit dans l’appartement de la rue de Babylone, que Huysmans enfin trouvait à son gré !
Aussi, cela ne devait pas durer !
Combien de fois il s’est plaint du tapage de ses co-locataires. Il redoutait comme pas un le sans-gêne de ces mufles qui assènent des coups de marteau sur les murs ou braillent sans répit des airs d’opéras. Il cherchait à échapper aussi autant que possible à ces soirées où des folles saccagent un clavier ; mais comment éviter cette menace ?
Un jour, deux femmes logées au-dessus de lui rendirent — naturellement — son logis inhabitable. Il ne dormit plus ; il passa des journées mornes. De nouveau, le découragement l’opprima.
Déménager encore, il n’osait plus y songer. Il considérait ses meubles, et il se demandait quelle était la nécessité de les transporter ailleurs, pour y retrouver sûrement le même vacarme.
Décidément, c’était bien arrêté : on ne le laisserait jamais en paix !
Il était rentré à patis, parce que la campagne lui était odieuse ; mais en quoi cela vouvait-il lui valoir un tel assaut d’ennuis ?
Ah ! ces quais de la Seine, les aimait-il assez, pour envisager une perspective pareille : ne pas pouvoir écrire, le jour, et ne point dormir, la nuit !
Il ne se pacifiait qu’aux offices qu’il suivait toujours chez les Bénédictines : messes et vêpres. Quant à son chapelet, il le disait tantôt à Saint-Séverin, tantôt à Saint-Sulpice, tantôt à Notre-Dame, au hasard de ses courses enfin dans Paris. Puis venait l’heure de l’apéritif, à laquelle il ne manqua jamais, tout en fumant de perpétuelles cigarettes ; et c’était l’heure aussi des anecdotes qu’il contait alors avec un véritable plaisir.
Puis il rentrait dîner chez lui, énervé à l’avance de son logis.
A Ligugé, au moins, il écrivait et il dormait ; mais il regrettait les bouquinistes, les bateaux, les flânes le nez au vent, les mains dans les poches, le long d’un quai mille fois suivi cependant, au point qu’il en savait par coeur tous les détails !
Paris l’avait envoûté, celui-là également.
Il n’aurait plus le courage de lui échapper.
A l’écart
CELUI, je le répète, qui fut pour Hüysmans le plus fidèle et le plus affectueusement dévoué des disciples, M. Jean de Caldain, voyant que la situation de Hüysmans devenait intenable rue de Babylone, jura que rien n’était plus simple que de déménager encore et de chercher un local garanti contre tout bruit.
On pouvait même, assurait-il, trouver un nouvel appartement qui, par sa disposition des pièces, rappellerait tout à fait l’ancien.
Hüysmans écoutait, résigné. Il se disait trop que tout cela, c’était un leurre. Enfin, essayez ! répétait-il.
Au No 31 de la rue Saint-Placide, il y avait un logis libre au cinquième étage. Des fenêtres de la salle à manger, on voyait les tours de l’église Saint-Sulpice, le clocher de Saint-Germain-des-Prés et la quiétude d’un ancien cloître.
Hüysmans s’y laissa traîner, et il n’objecta rien. Même, le décor lui plut. On dominait des toits ; c’était un charme réel.
Et, ses livres encore une fois rangés, il se remit à écrire, à prendre des notes, — travail qui, maintenant, le surmenait.
Il commençait à se mal porter. Il avait eu un jour une grosseur sur l’épaule, qui l’avait fait beaucoup souffrir. Il maigrissait, donnant à ses familiers l’idée saugrenue qu’il grandissait.
M. le docteur Crépel qui eut pour lui une vigilante et admirable sollicitude, le venait voir presque quotidiennement. M. Gravollet-Leblan, également, lui prodiguait de constants soins.
Hüysmans bavardait, se plaisantait lui-même ; mais, un jour, comme le docteur Crépel l’engageait à aller à la campagne, pour se reposer :
« Ah ! non, j’en ai assez ! répondit-il. Un ami, l’autre semaine, m’a emmené à Blois. En voilà pour toute ma vie, à présent !
— Cependant, il faut partir ! et le docteur insista tellement, pria, menaça si bien que Hüysmans lui promit de l’écouter.
Mais où aller ?
Il dit à M. Jean de Caldain :
— Nous allons partir pour Clamart !
En route, il s’égaya, disant que c’était en somme un voyage sérieux qu’ils entreprenaient, puisqu’il y avait dans leur train un wagon-bar et des grands couloirs.
Il ajouta :
— Je sais bien que Clamart, ce n’est guère la campagne ; mais, vraiment, c’est tout ce que l’on peut exiger de moi !
A Clamart, il dit nettement ce qu’il voulait :
— Je tiens surtout à un jardin de curé, avec une allée. La cambuse, je m’attends bien, parbleu ! à une rocambolade de style ! Car ce qu’ils sont nigauds encore, ces architectes pour locatis de banlieues ! Mais, je suis bien tranquille, nous ne trouverons rien : ni mon jardin de curé, ni des prix doux !
Une agence indiqua une villa confortable. On y fut. Le jardin s’y trouvait.
— Alors, ce sont les water-closets qui clochent ! dit Hüysmans.
— Les voilà, très convenables, dit le commis qui faisait visiter.
— Parfait ! et le prix ?
— 1200 francs ! pour la saison.
— Très bien! dit Hüysmans, je ne les ai pas ! et vous aussi non plus, n’est-ce pas, mon ami ?
Il s’adressait à M. de Caldain.
Et il souriait. Inutile de voir d’autres maisons.
Elles seraient, du reste, toutes inabordables.
— Allez ! ajouta-t-il. Fichons le camp. On dira à Crépel qu’on n’a trouvé que des boîtes à 1200 francs. Ce que ça m’arrange !
Mais le docteur ne s’en laissa point conter. Il dit à Hüysmans :
— Vous irez ailleurs, voilà tout ; mais vous ne resterez pas à Paris !
Second départ avec le même enthousiasme.
Au moment de prendre le train, on rencontre un ecclésiastique que Hüysmans connaissait.
— Où allez-vous, Monsieur l’abbé ?
— Je vais dans une agence pour donner à louer ma maison et mon jardin, à Issy-Ies-Moulineaux. Ça me procurerait 400 francs, dont j’ai besoin pour faire un voyage en Italie.
— Eh bien ! maître, dit à voix basse à Hüysmans son compagnon, voilà l’occasion toute trouvée ! Rendez service à votre ami, en louant sa villa !
Et, à voix haute : « Vous avez dit qu’il y a un jardin, Monsieur l’abbé ? »
— Et un potager par dessus le marché, messieurs ! Je possède aussi un excellent vin d’hospice que je mets à la disposition de qui louera ma petite maison.
— Eh bien ! nous vous la louons ! dit M. de Caldain.
— A la bonne heure ! et vous aurez de beaux ombrages ! Par cette rude chaleur d’août ! s’égaya, satisfait, le prêtre, ce n’est pas de trop !
La maison, contre son attente, plut à Hüysmans.
Elle était hospitalière et d’aspect avenant. Les chambres en étaient confortables, et la bibliothèque très garnie de livres.
Dans le jardin d’agrément, il y avait du buis, des tonnelles et des statues de plâtre qui s’écaillaient. D’une ruche voisine, des abeilles, échappées, rebondissaient sur toutes les fleurs. Dans une cage, un faisan doré paradait, tandis que des colombes roucoulaient sur le toit d’une petite remise à outils, que gardait un jardinier de plâtre colorié.
Et l’on avait la sensation d’être très loin de Paris. Il y avait même dans un poulailler des poules et aussi un unique canard, qui, depuis toujours privé d’eau, se mit à pousser des cris horribles un jour qu’on voulut le baigner !
Mais l’endimanchement des banlieusards fut une des joies de Hüysmans ; ils apparaissaient alors farauds et sournois. A la grand’messe, le curé, en chaire, ne craignait point de les invectiver personnellement, avec de durs propos, — et c’était un réjouissant spectacle.
Les indigènes s’en vengeaient en regardant de travers les deux hôtes inconnus de la maison de l’abbé. Quels étaient-ils ? On se le demandait.
S’enhardissant, des habitants vinrent — avec des prétextes — pour les questionner. Hüysmans s’amusa alors à les égarer, avec le même entrain qu’il mettait à repousser les avances des « curatons » du séminaire.
Au bout de six semaines, il fut impossible de décider Hüysmans à rester plus longtemps à la campagne. Il voulut rentrer, et l’on réintégra la rue Saint-Placide.
Sa maigreur s’accentua. Il vivait maintenant tout à fait à l’écart, ne voyant plus que quelques rares familiers, ses amis de toujours et le docteur René Dumésnil, que sa thèse sur la maladie originelle de Gustave Flaubert avait rendu notoire. Il consentit cependant, après bien des insistances prudentes de M. l’abbé Mugnier, à recevoir aussi M. Liouville, le beau-fils de Waldeck-Rousseau, qui désirait ardemment lui être présenté.
Par M. Liouville, Waldeck-Rousseau avait hâté l’existence légale de l’Académie des Goncourt. C’était un titre à la sympathie de Hüysmans. Il se souvenait qu’il avait fait partie de la délégation chargée de remercier l’homme d’Etat. Même ce mot de Waldeck-Rousseau l’avait bien diverti : « Messieurs, la pente de mon esprit va vers vous ! »
Il le citait un jour, quand, du tac au tac :
— Mais, Hüysmans, elle est de vous aussi cette phrase ! jeta quelqu’un.
— Ça, c’est trop fort !
— Parfaitement ! Vous l’avez écrite, et Waldeck-Rousseau, continua l’autre, sans pitié, a pu vous la resservir, la trouvant, lui aussi, très stupéfiante !
Cela amusa fort Hüysmans. Ah ! il ne se déridait plus guère !
Quel mauvais état physique était le sien !
Un jour, M. de Caldain fut obligé d’aller chercher sans retard le docteur Crépel. Depuis ce moment, le mal ne cessa plus alors de harceler Hüysmans ; et M. Liouville émit l’idée de le conduire chez le chirurgien Poirier.
Bien! mais comment le décider à cette visite, qu’il convenait, d’ailleurs, de soumettre d’abord à l’assentiment du docteur Crépel ?
On usa de réticences et de ménagements sans fin ; mais on arriva au but.
Le chirurgien reçut Hüysmans, avec, pour vêtement, un peignoir saumon, et il dit, le plus aimablement du monde :
— Monsieur, je n’ai pas voulu vous faire attendre. J’allais prendre mon bain. L’heure exacte de votre visite ne m’ayant pas été annoncée, je vous prie d’excuser mon incorrect costume !
Et il piaffait, tel qu’un « petit cheval arabe », ainsi que le baptisa aussitôt Hüysmans.
La consultation fut sérieuse. En sortant, Hüysmans était à peu près fixé. Le chirurgien ne lui avait, bien entendu, rien dit de grave ; mais l’inspection qu’il avait faite de sa bouche restait d’un bien fâcheux signe.
Et le mal, presque tout de suite, empira. Le docteur Crépel et le chirurgien Arrou alors se consultèrent, et ils conclurent qu’une opération s’imposait.
A cet avertissement, l’écrivain fut atterré. Cette fois, toutes ses craintes se réalisaient. Le cancer si redouté était installé. Rien ne le délogerait plus.
Il se résigna.
Il entra rue BIomet, dans une maison de santé.
Il considéra avec étonnement la chambre qu’on lui destinait, et il dit :
— Ah ! vous m’en faites voir, Seigneur ! Quand je pense que je vais être obligé de rester je ne sais combien de temps devant ces clefs de sol !
Il fixait les fleuri stylisées d’un papier de tenture.
— Enfin, on voit des arbres, ajouta-t-il, en appuyant son front contre la fenêtre.
Par une porte entr’ouverte, il aperçut aussi une table d’opération et un homme dont le tablier était pavoisé de sang.
Il dit alors, à l’ami qui l’accompagnait :
— En cas d’accident, vous n’aurez qu’à ouvrir la cassette, tout est prêt. Trois lettres contiennent toutes mes instructions !
Il n’avait pas oublié non plus son tabac et son papier Job ; car, un instant après son opération heureusement faite, la soeur le surprenait déjà en train de fumer.
Il rentra rue Saint-Placide.
Il était résigné maintenant, et tout à fait admirable.
— J’ai été autrefois un abominable « salaud » répétait-il. Il n’est que juste que je pâtisse !
On voulait — pour calmer ses atroces souffrances — le piquer à la morphine. Il refusa toujours ; et on fut obligé de lui en administrer autrement, à son insu.
Mieux que François Coppée, qui, souvent, le venait voir, il eût pu, lui, célébrer « la bonne souffrance » ; car il l’acceptait avec une joie véritable à présent, répétant à ses intimes que « les hôpitaux sont des choses nécessaires dans la vie », et qu’il faut se réjouir d’avoir la chance d’expier ainsi ses fautes.
Il avait reçu la lettre de faire-part des obsèques du chirurgien Poirier.
Le jour même, il pria M. de Caldain de rédiger, sous sa dictée, sa propre lettre de mort ; et comme M. de Caldain avait oublié l’M majuscule devant le nom, il lui dit :
— Je tiens beaucoup à ce que le libellé en soit très correct. Mettez bien cette lettre en évidence. — Là ! c’est parfait ! Voilà toujours une besogne faite !
Le 23 avril 1907, exactement, jour de sa fête (les coïncidences liturgiques abondent dans la vie de Hüysmans), il était monté sur l’échelle de sa bibliothèque quand M. de Caldain survint.
— Que faites-vous là, maître ?
— Je cherche le Pontifical, répondit Hüysmans. J’attends l’abbé pour qu’il me donne l’extrême-onction !
Et, comme M. de Caldain paraissait angoissé de cette réponse — Eh bien ! quoi, mon ami, qu’y a-t-il là d’effarant ? dit Hüysmans. Ne savez-vous pas que c’est le sacrement des malades et non celui des morts ?
Son confesseur d’alors, le dernier, c’était M. l’abbé Daniel Fontaine, missionnaire, — aujourd’hui installé curé de Notre-Dame auxiliatrice, à Clichy.
Je dois noter — ainsi que me l’a certifié un témoin digne de foi — l’état de ravissement de cet ecclésiastique quand il venait de quitter Hüysmans.
Il était aisé de se rendre compte que l’abbé Fontaine était édifié par la perfection de cette âme, maintenant absolument rédimée.
Ah ! comme elle l’appelait, la souffrance !
Hüysmans fit son testament, le jour des Saintes Reliques.
Il laissait des legs à partager entre ses amis des dernières années ; et, sa mère s’étant remariée, il réservait à ses deux demi-soeurs tous ses droits d’auteur.
On a dit qu’il avait quelques jours avant sa mort brûlé quelques manuscrits.
Rien n’est plus exact ; mais il s’agit d’anciennes productions et d’une oeuvre même de jeunesse.
Les unes avaient pour titre Notre-Dame de la Salette (celle-ci inspirée par l’abbé Boullan), — et la Comédie humaine, une sorte de roman naturaliste.
L’oeuvre de jeunesse s’intitulait : La Faim, et elle mettait en scène la guerre de 1870.
Ses derniers projets se résument en un roman qu’il aurait appelé Un Soir, et divisé en trois chapitres : le 1er et le 3e très courts, le second constituant à lui seul tout le corps du volume.
Et l’Exégèse aussi le tentait. Il rêvait de raser des opinions reçues de faux-savants mystiques. Plus que jamais, le document exact l’intéressait, le passionnait.
Il n’est pas mort, au soir du 12 mai 1907 « en lisant la prière des agonisants », comme on l’a raconté ; mais en s’endormant, dans son lit. C’était un dimanche. Dans la journée, des visites trop nombreuses l’avaient fatigué. Il avait fumé encore, comme à son habitude, malgré l’horrible plaie qui lui perforait le « plancher de la bouche », Il s’était couché, et on l’avait laissé reposer en paix.
Vers sept heures, en entrant dans sa chambre, M. de Caldain eut la brutale impression que la mort était venue, doucement. Et c’était l’angoissante réalité. Hüysmans dormait pour toujours, la figure très calme. La couverture du lit était seulement un peu rejetée, comme si le moribond avait voulu se lever.
On conduisit Hüysmans à l’église Notre-Dame des Champs, sa paroisse. Il était enseveli dans sa robe d’oblat, que lui avait envoyée le P. Dom Besse. La ceinture ayant été oubliée, Hüysmans l’avait fait acheter, voulant la robe complète.
On lui organisa un grave et beau cortège, dans lequel défila une délégation de littérateurs hollandais.
Toutefois, il n’y eut pas de discours. Hüysmans les avait formellement proscrits, lui qui, à l’enterrement de Villiers de l’Isle-Adam, avait emmené brusquement le fils du grand écrivain, en voyant des feuillets dans la main du poète Georges Rodenbach.
On l’a enterré au cimetière Montparnasse, dans un caveau de famille, où reposaient déjà son père Godfried Jean Hüysmans, décédé le 26 juin 1856, à l’âge de 41 ans ; son grand-père maternel Louis Jules Guillaume Badin ; sa mère Elisabeth Malvina Badin, veuve Og, décédée le 4 mai I876 ; et quelques autres membres de sa famille.
La tombe est simple. Sur la stèle, on a gravé à la française les prénoms du grand écrivain catholique : Charles-Marie-Georges.
Je suis allé revoir, cette année, à la Noël, cet humble caveau.
On ne le distingue guère dans la cohue pressée des autres tombes ; j’ai vu une pauvre chose toute verdie par les pluies ; et j’ai eu de la peine à lire les noms sur la pierre.
Une pluie fine s’éparpillait et de lointaines cloches tintaient, couvrant par instants des pépiements d’oiseaux. Une pie se laissa choir d’un cyprès et se mit à sauteler sur les croix.
Tout autour des sépultures, c’était la Ville. Là-bas se silhouettait la pointe de la Tour Eiffel : et des sifflets brefs et aigus de locomotives vrillaient l’air.
C’était une après-midi affreusement triste, avec de longs nuages de suie qui s’étiraient et couraient brusquement sous le vent. Mais, çà et là, il y avait cependant des couronnes qui ressemblaient, si roses et si jaunes, à des « parfaits » et à des sorbets ; et tout cela sentait la terre fraîchement remuée.
En repartant, j’ai suivi la rue de la Gaîté dont Hüysmans a fait un des décors de ses Soeurs Vatard.
Quelle apothéose ! la rue flambait de tous ses « assommoirs », et une foule, déjà ivre, grouillait et tapageait. On se disputait les huîtres et les bouteilles. Cela promettait pour la nuit !
Mais je pensais toujours, moi, au cimetière qui devait être maintenant si noir :
« Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs »,
Et je me disais : « Après Baudelaire, voici Hüysmans. Quel double pèlerinage pour les véritables amants des Lettres françaises ! »
Aujourd’hui, c’est chez l’éditeur Plon-Nourrit qu’il faut aller chercher les admirables livres de Hüysmans, Ils y sont sévèrement gardés.
Je tiens à noter, en effet, qu’un livre de Hüysmans (les autres, je les tiens de lui-même) me fut aigrement refusé, dans la boutique de la rue Garancière, par un vieux monsieur, à l’air important, sous prétexte que les « services de presse » étaient faits depuis longtemps !
Ah ! oui, ils sont bien gardés, ces admirables livres !
Chez un dépositaire, je n’ai trouvé qu’un exemplaire défraîchi de ces Pages Catholiques que je désirais, et comme j’en réclamais un autre, le marchand me dit :
— Je n’ai que ça par unité, Monsieur ! Ça ne se vend pas tous les jours ! (sic).