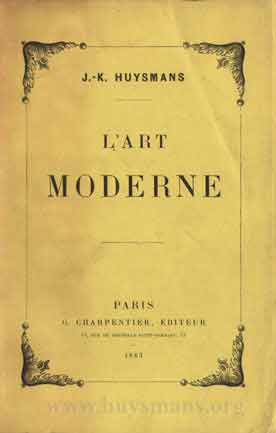LE SALON OFFICIEL DE 1881
Il exhale sa dernière pensée dans l’âme d’un canon poudré de neige. Les yeux au ciel, la bouche un peu rétractée, la main pressant sa tunique à l’endroit où bat faiblement son triste coeur, le pauvre soldat songe, avant que d’expirer, à la France dont la maternelle sollicitude l’a mené se faire égorger dans un abattoir.
Cette toile est l’oeuvre d’une belle nature qui saigne sur les malheurs éprouvés par son pays ; chaque année, M. Reverchon ravive son inapaisable plaie, en nous servant un tableau patriotique et vengeur. N’est-ce pas lui aussi qui a inventé la décoction du souvenir, un liquide qu’on aperçoit chez certains mastroquets, enfermé dans une fiole en forme d’obus sur laquelle se pavane une image représentant deux soldats, l’arme au pied, avec ces mots imprimés en rouge : « Souviens-toi ! »
Pour sa gloire, je le souhaite. — Maintenant, au caractère chevaleresque et à l’esprit si pompeusement chauvin de son oeuvre, il faut ajouter encore une inestimable perfection d’artiste sachant vaincre, comme pas un, les mystérieuses difficultés de l’art de peindre appliqué aux décors des devants de cheminées et des stores. M. Reverchon serait un artiste unique si son dangereux rival, M. Protais, consentait à ne plus peindre.
C’est que celui-là aussi a des entrailles de mère pour nos troupes. Dans la peinture militaire, qui, sous l’impulsion de Vernet, d’Yon et de Pils était devenue une série de tableaux à épisodes et à tiroirs auxquels on adjoignait une légende pour indiquer la binette de tel ou tel général, l’emplacement de telle ou telle division, M. Protais avait apporté cette innovation : la gnolle sentimentale. Il a joué pendant des années, sur son clairon, la larme des batailles, nous montrant, une fois, des officiers qui s’étreignent, des soldats qui regardent pathétiquement le ciel; une autre, un malheureux chasseur de Vincennes couché sur le flanc et roulant des yeux pleins d’eau rougie dans de l’herbe verte. Cette année, M. Protais a tari ses pleurs ; de viriles résolutions sont écloses dans cette âme sensible. — Plus de soupirs, du sang ! — Ah mais ! — Des fantassins de toutes armes sont rassemblés; derrière eux se massent des cavaliers triés dans tous les corps; des canons d’acier éteignent leurs lueurs, en un coin où se dressent les artilleurs ; au fond, des usines fument. Cela paraît agressif, car tous ces pioupious semblent crier : « Qu’on y vienne donc, et l’on va voir ! »
Telle est la première impression que produit ce groupe de militaires, puis quand on les observe plus longtemps, quand on scrute longuement l’expression figée dans la porcelaine de leurs faces, l’on s’aperçoit que ce peintre est beaucoup moins farouche qu’il n’en a l’air. Dominé par un ardent amour de l’humanité, repris par l’impérieuse habitude des élégies qu’il module depuis des ans, M. Protais s’est efforcé de peindre des soldats qui, tout en menaçant, ne menacent point. J’ajouterai, du reste, que le procédé employé pour obtenir ce résultat difficile est des plus simples. M. Protais s’est borné à donner aux vêtements des troupiers une apparence de vessies gonflées par des soufflets. On sent, derrière ces plastrons, le vent ; sous ces culottes de drap, le creux; sous ces shakos de carton, le vide. Ces gens sont des épouvantails à moineaux, des loques tendues sur des perches. Ils sont donc terribles, sans l’être. En somme, ils satisfont nos instincts de chauvinisme et ils ne sont pas sérieusement hostiles pour les puissances qui nous entourent.
Ainsi que M. Protais, nombre de peintres ont tenu à célébrer leurs espoirs ou leurs douleurs patriotiques. En tête, M. Jundt. Cet Alsacien appelle Retour une servante, versant, dans un cabaret des pays annexés, des moos de bière à des cuirassiers français. C’est de la peinture en avance sur l’histoire, la peinture de l’espérance.
Pour camper ces cavaliers sur leurs bottes, M. Jundt s’est servi de son procédé habituel, de son brouillis clapoté de couleurs, de ses incertitudes poétiques de lignes, de tout ce qui donne cet aspect de tapisserie fanée à ses personnages. C’est de la peinture vaporeuse, mais elle ne l’est pas assez, malheureusement, pour se volatiliser ou se résoudre.
Après l’Alsacien Jundt, le Messin Bettanier. Nous possédions déjà le soldat laboureur, nous avons maintenant le soldat faucheur. Sa toile, intitulée En Lorraine, montre un soldat devenu paysan, une paysanne, un enfant, un vieillard, tête nue, faux en main, chapeau bas devant une croix, dans un champ. C’est le tableau chanté dans les concerts par le baryton, au menton bleu, dont la bouche rasée dégueule de plaintifs hurlements sur la perte de nos provinces ; c’est le tableau versifié par M. Déroulède, qui a, du reste, inspiré un autre peintre M. Delance, un garçon de bien du talent. Le plus bel éloge que je puisse faire de son Retour du drapeau est celui-ci : sa peinture est tout à fait à la hauteur des chansons claironnées par notre grand poète.
Des myriades de tableaux de ce genre défilent encore le long des salles ; tous ont du génie, — ceux de M. De Neuville plus que les autres, par exemple. Le Cimetière de Saint-Privat a résolu cette difficulté de peindre, à l’état immobile, un grouillement. C’est une purée figée de combattants, remuée du haut d’un tertre, par trois anabaptistes, les trois inévitables soldats résignés et farouches, qui ornaient déjà la Dernière cartouche. Dans une autre toile, Un Espion arrêté par les Prussiens, M. de Neuville a prêté aux officiers de l’armée allemande les poses les plus outrées, les torsions de corps les plus baroques, les mines les plus satisfaites et les plus grotesques ; tandis que le Français est distingué et noble, puissant et beau. Je ne saurais blâmer M. de Neuville d’avoir, dans cette toile comme dans l’autre du reste, infligé à ses galonnés de Prusse une morgue ridicule, car l’épaulette influe souvent sur la cervelle et n’en laisse plus jaillir que des fleurs de férocité ou de sottise ; seulement il faut bien le dire, ces allures et ces mines de soudards ne sont pas spéciales aux Prussiens ; elles appartiennent, sans distinction, au militarisme de tous les peuples. Comme peinture, l’Espion est d’une noire médiocrité; mais, si j’en juge par les cris d’allégresse que poussent les dames, M. de Neuville est assuré d’un grand succès auprès de ce public féminin si débonnairement apprécié par l’indulgent Schopenhauer.
Quelque méritantes que puissent être, au point de vue du patriotisme, les oeuvres dont je viens de passer la revue, elles ne témoignent cependant d’aucun effort artistique sérieux ; il nous faut arriver au Detaille pour trouver enfin une tentative vraiment aventureuse. M. Detaille a renoncé à la peinture à l’huile et il a carrément abordé l’impression en couleur. Étant donné la prodigieuse grandeur de sa Distribution des drapeaux et le nombre de teintes qu’il emploie, mon admiration éclate, sans incertitudes, sans réticences. Quel tour de force réussi malgré les difficultés inhérentes à un tirage successif de si nombreuses planches ! Sa chromo est dure, sèche, aveuglante, parce que le moyen n’a pas encore été découvert, en France, d’éviter dans la lithographie en couleur, les lumières douloureuses, les fonds sans perspective et sans air ; — mais si l’artifice est grossier encore, il faut convenir pourtant que la bravoure de M. Detaille mérite au moins qu’on la salue et qu’on l’encourage !
Laissons maintenant les élégiaques et les mâles pilous et arrivons aux oeuvres purement démocrates ou patriotes. Longeons la Bastille de M. F. Flameng, qui continue à peindre les sujets recommandés par M. Turquet, et persiste aussi à tailler ses bonshommes dans du cristal et à peindre du même ton les chairs de ses figurines et le cuivre de ses tambours, et faisons halte devant le Souvenir de fête de M. Cazin.
Tâchons de comprendre, si faire se peut, cette bizarre énigme. Le Panthéon détache sa coupole délinéée par des jets de gaz, sur un firmament de bleu dur, orné de cette inscription : Concordia. Huchées sur un échafaudage, trois figures : l’une, avec un casque de carabinier sur la tête et un peignoir de baigneur sur un corps nu ; une autre, assise dans une robe blanche ; une troisième enfin, debout, offrant un rameau d’or au peignoir et au casque. Comprenez-vous ? — Non. — M. Cazin paraît du reste, s’être douté de l’incompréhensibilité de sa toile; aussi, en lettres d’or, au-dessous d’une fusée qui décrit sa parabole dans le ciel, a-t-il inscrit, au-dessus du carabinier : Virtus; de la femme au rameau : Labor; de la femme assise : Scientia. Comprenez-vous mieux ? Non n’est-ce pas ? Eh bien, moi non plus ! Voyons, c’est le travail qui remet un rameau à la vertu, sous le regard bienveillant de la science, et le tout s’appelle la concorde. — C’est le symbole de la France vertueuse et pacifique, — c’est la vertu résultant de l’accouplement de la concorde et du travail, c’est la personnification du siècle qui est, dit-on, un siècle de science ; c’est la paix obtenue par le travail et grâce au courage de l’armée qu’allégorise un casque, ou bien c’est quoi alors ? Puis, que vient faire dans cette obscure abstraction le symbole de cette bruyante et inutile fête ? De quelque côté que je retourne ce sujet, il me semble saugrenu et vague, mais ce qui est pis encore, c’est que l’homme de talent que fut M. Cazin a complètement sombré. Disons-le, c’est franchement mauvais ; les figures sont veules, hésitées dans les poses, d’un dessin pesant, la couleur est caduque, les tons obstrués, l’éclairage vient on ne sait d’où et semble emprunté à la chandelle de Schalken. Voilà pourtant où peut mener la peinture à sentiments et à idées, la peinture à sujets soi-disant profonds !
Dans sa Kermesse du Louvre, Rubens n’en faisait pas, de cette peinture-là, et Brauwer et Ostade n’en faisaient pas davantage. Dans leurs toiles on pisse, on dégobille, et dans celle du vieux Breughel à Haarlem, comme dans une eau-forte de Rembrandt, on va plus loin, on accomplit l’acte considéré comme le plus répugnant de tous par les gens du monde. Et c’est de la peinture admirable pourtant, de la peinture plus élevée, plus large que celle de M. Cazin ! Ces gens fument la terre de leur patrie, pipent et boivent, sans rouler des pensées subtiles ou profondes et cependant ils sont peints avec un style superbe que ni les Laurens, ni les Chavannes, ni les Cazin n’atteindront jamais, en dépit de toutes leurs recettes apprises pour fabriquer du grand art.
Une femme de Jordaens torchant son gosse, un cavalier de Terburg offrant de l’argent à une fille, la drouille ivrognée de Jean Steen se vautrant, au musée Van Der Hoop, sur la culotte d’un pochard, sont des oeuvres d’un grand style, parce que tout en étant une reproduction exacte, presque photographique de la nature, elles sont néanmoins empreintes d’un accent particulier déterminé par le tempérament personnel de chacun de ces peintres, tandis que la Mignon, le Faust, d’Ary Scheffer, tandis que les religiosités de M. Flandrin, sont écrites dans une langue pâteuse, sans aucun style, attendu qu’aucun de ces deux hommes n’avait une palette qui lui appartînt, un oeil qui fût à lui.
Il est donc bien inutile pour un peintre d’essayer des modes usités dans les écoles pour ennoblir la peinture ; il est donc bien inutile de choisir des sujets dits plus élevés les uns que les autres, car les sujets ne sont rien par eux-mêmes. Tout dépend de la façon dont ils sont traités; et il n’en est point d’ailleurs de si licencieux et de si sordides qui ne se purifient au feu de l’art.
Quant aux méditations et aux pensées qu’ils peuvent suggérer, ne pensez-vous pas, pour choisir un exemple dans le moderne, que les toiles de MM. Degas et Caillebotte soient plus fécondes en rêveries que toutes les machines de M. Cazin ? C’est la vie de toute une classe de la société contemporaine qui défile devant nous; nous sommes libres de reconstituer l’existence de chacune de ces figures, ses faits et ses gestes, au lit, dans la rue, à table; tandis que des incohérences d’imagination pourraient seules nous hanter devant les fantoches si marmiteusement agencés par M. Cazin. En quoi, je vous prie, peuvent nous intéresser ces poupées occupées à je ne sais quelle besogne ? En quoi peuvent nous toucher ces mythologiades appliquées à la vie moderne ? — Comme un virus qui ne s’éteint pas, l’originelle sottise des peintres a reparu et brutalement envahi le cerveau d’un homme qui avait été pourtant vacciné par M. Lecoq De Boisbaudran, le seul maître dont l’enseignement n’ait pas déprimé l’intelligence ou aggravé l’ineptie des élèves qui eurent la chance d’apprendre leur métier sous ses ordres.
Puisque nous avons tant fait que de regarder le rébus et les mythes de la peinture, voyons l’étrange panneau de M. de Chavannes : le Pauvre Pêcheur. — Une figure, taillée à la serpe, pêche dans une barque; sur le rivage, un enfant se roule dans des fleurs jaunes près d’une femme. Que signifie cet intitulé ? En quoi cet homme est-il un pauvre ou un heureux pêcheur ? Où, quand cette scène se passe-t-elle ! Je l’ignore. — C’est une peinture crépusculaire, une peinture de vieille fresque mangée par des lueurs de lune, noyée par des masses de pluie ; c’est peint avec du lilas tourné au blanc, du vert laitue trempé de lait, du gris pâle; c’est sec, dur, affectant comme d’habitude une raideur naïve.
Devant cette toile, je hausse les épaules, agacé par cette singerie de grandeur biblique, obtenue par le sacrifice de la couleur au gravé des contours dont les angles s’accusent avec une gaucherie affectée de primitif ; puis, je me sens quand même pris de pitié et d’indulgence, car c’est l’oeuvre d’un dévoyé, mais c’est l’oeuvre aussi d’un artiste convaincu qui méprise les engouements du public et qui, contrairement aux autres peintres, dédaigne de patauger dans le cloaque des modes. En dépit des révoltes que soulève en moi cette peinture quand je suis devant, je ne puis me défendre d’une certaine attirance quand je suis loin d’elle.
Je n’en dirai pas autant, par exemple, du Triomphe de Clovis, de M. Blanc. Cela nous représente, sur fond d’or, avec le chef ceint d’une auréole, MM. Gambetta, Clemenceau, Lockroy et, enfin, apparaissant en tenue de martyr, le profil de M. Coquelin. Cette fresque, puisqu’il paraît que cela s’appelle une fresque, est une oeuvre basse, tout au plus digne de figurer dans une exposition de tableaux suisses.
Rien ne nous sera, du reste, épargné cette fois. Une dernière monstruosité s’étale : la nature morte démocratique et patriote, le Bureau de Carnot. Il y a de cela deux ou trois ans, après une comique circulaire prêchant l’intrusion des idées républicaines dans la peinture, Duranty mit en circulation ce bruit que la nature morte allait devenir, elle aussi, démocrate, et, de son ton pincé, il prédit qu’un jour viendrait où l’on peindrait le bureau d’un notable républicain. Ce fut un hourra général, un éclat de rire. — Eh bien, c’est chose faite maintenant. Elle a été commise par M. Delanoy, achetée par M. Turquet.
A quand le thomas de Robespierre et le bidet de Marat ? à quand, à supposer qu’une nouvelle forme de gouvernement survienne, le parapluie de Louis-Philippe, la sonde de Napoléon, les pelotes herniaires de Chambord ?
Nous ne nous sommes que trop longtemps arrêtés devant les atroces misères de ces toiles; mais hélas ! Il le fallait bien, car si le salon de 1881 est peut-être plus comique encore que ceux des années précédentes, cela tient à l’invasion du militarisme et de la politique dans l’art.
Maintenant filons, et arrivons à la peinture des gens réputés « modernes » par le public.
MM. Bastien-Lepage et Gervex tiennent la corde. Le premier de ces peintres expose un mendiant, la main dans sa besace, devant une porte qu’on referme. M. Lepage a cessé de chatouiller l’agreste guitare de M. Breton ; il nous épargne, cette fois, son extatique modèle des pommes de terre et des foins, ce dont je lui suis gré. Contrairement à la plupart de ses confrères, il cherche à se renouveler ; il flotte de-ci, de-là, pastichant Holbein, dans son portrait du prince de Galles, voisinant avec les Van Der Werf et les Miéris, dans son portrait de M. Wolff. Maintenant, tout en s’agitant, trouve-t-il un accent qui lui appartient ; a-t-il perdu ses défauts coutumiers, sa mièvrerie de touche, ses manques d’air, ses simagrées de haillons empruntés aux vestiaires des théâtres ? Non, à coup sûr, mais il a du moins conservé son ancienne prestesse de doigté, gardé les connaissances techniques de son métier, ce qui manque, hélas ! maintenant à M. Gervex. C’est triste à dire, mais cet artiste ne sait même plus peindre. Son Mariage civil pourrait être signé par Santhonax, l’étonnant homme qui peinturlure les bâches-affiches des baraques de foire. Ni dessin, ni couleur, rien ; M. Gervex est fini-et je le regrette sincèrement, car après ses premières oeuvres, j’ai été de ceux qui le soutenaient et croyaient en lui.
L’année est décidément mauvaise, car voilà M. Manet qui s’effondre, à son tour. Comme un vin vert et un peu rêche, mais d’un goût singulier et franc, la peinture de cet artiste était engageante et capiteuse. La voilà sophistiquée, chargée de fuschine, dépouillée de tout tanin, de toute fleur. Son portrait de Rochefort, fabriqué d’après des pratiques semi-officielles, ne se tient pas. On dirait de ces chairs, du fromage à la pie, tiqueté de coups de bec, et de ces cheveux une fumée grise. Nul accent, nulle vie; la nerveuse finesse de cette originale physionomie n’a nullement été comprise par M. Manet. Quant à son Pertuiset à genoux, braquant son fusil dans la salle où il aperçoit sans doute des fauves, tandis que le jaunâtre mannequin d’un lion est étendu, derrière lui, sous des arbres, je ne sais vraiment pas quoi en dire. La pose de ce chasseur à favoris qui semble tuer du lapin, dans les bois de Cucufa, est enfantine et, comme exécution, cette toile n’est pas supérieure à celle des tristes rapins qui l’environnent. Pour se distinguer d’eux, M. Manet s’est complu à enduire sa terre de violet; c’est d’une nouveauté peu intéressante et par trop facile.
Je suis très sérieusement contrit d’être obligé de juger aussi durement M. Manet ; mais étant donné l’absolue sincérité dont j’ai jusqu’à ce jour fait preuve dans cette série de salons, je me devais à moi-même de ne pas mentir et de ne pas cacher, par esprit de parti, mon opinion sur l’oeuvre exposée de ce peintre.
J’ai hâte d’arriver aux quelques toiles plus nourries, plus riches en fer. Je vais donc précipiter la revue des portraits qui nous regardent. Il est bien inutile, je pense, de répéter ce que j’ai dit, depuis deux ans déjà, de certains peintres : de M. Bonnat dont les lourdes portraitures se détachent avec des égouttures de phosphore au nez et au front, sur un repoussoir brouillé de lie de vin et de brun sec qui vont, en s’atténuant, du haut en bas du cadre ; de M. Carolus Duran, le véloce et bruyant pianiste ; de M. Boldini, dont le jeu est plus nerveux, le virtuosisme plus expressif ; de M. Laurens, qui a emprunté à Ingres, ce vieux saint Antoine exorciste des teintes vives, le terne et mécontent aspect de son portrait de dame. Heureusement que, pour nous dédommager, les Fantin-Latour sont proches. Celui-là possède une rectitude de l’oeil appréciable par le temps qui court, une personnalité de coloriste bien tranchée, car avec du brun, du noir et du gris, M. Fantin-Latour est mille fois plus coloriste que tous les Boldini et les Duran, et, en effet, l’on n’est pas coloriste parce qu’on plaque de vigoureux accords d’orangé et de bleu, de vert et de rouge, de violet et de jaune, ou parce qu’on se plaît à juxtaposer du rouge sur du rouge et du bleu sur du bleu. Autant que Rubens qui emploie des rouges entiers, des bleus puissants, des blancs et des noirs presque purs, Vélasquez qui meut dans une gamme argentine des bruns sourds égayés parfois de tendres éveils de jaune soufre et de rose, est un grand coloriste. C’est que l’un et l’autre de ces maîtres a su combiner ses couleurs dans des relations habiles et justes, c’est que leur oeil les percevait, à l’état délicat ou fort, mais toujours rare. M. Fantin-Latour a ce don de la couleur, seulement ses tableaux de cet an sont ceux de l’année dernière; c’est toujours la même dame qui pose dans la même chambre. Il y a là, de la part de ce peintre, une immobilité par trop constante.
Je n’adresserai pas ce reproche à M. Renoir; depuis ses bals du moulin de la galette, ses paysages, ses coins de Paris, ses saltimbanques dans un cirque, il a produit de nombreux et différents portraits. Ceux exposés au présent salon sont charmants, surtout celui d’une petite fille assise de profil, qui est peinte avec une fleur de coloris telle qu’il faut remonter aux anciens peintres de l’école anglaise pour en trouver une qui l’approche. Curieusement épris des reflets du soleil sur le velouté de la peau, des jeux de rayons courant sur les cheveux et sur les étoffes, M. Renoir a baigné ses figures dans de la vraie lumière et il faut voir quelles adorables nuances, quelles fines irisations sont écloses sur sa toile ! Ses tableaux figurent, à coup sûr, parmi les plus savoureux que le salon renferme.
La plupart des artistes étrangers nous sont revenus avec leurs qualités de sincérité que je signalais l’année dernière. M. Artz nous apporte l’Hospice des vieillards à Katwyck, une toile vive et claire, toute émue et toute simple. Par contre, j’aime moins les deux toiles de son maître, M. Israels. C’est d’une exécution brouillée à la Jundt, d’une couleur lunaire, d’un sentiment trop peu contenu pour qu’il me poigne. Quant à M. Bischopp, un autre Hollandais, je préfère n’en point parler; cet artiste a peint une excellente toile, au salon dernier; espérons qu’il nous revaudra, en 1882, le déboire qu’il nous cause. Nous allons rester une minute encore dans les Pays-bas, mais, cette fois, c’est un Allemand, M. Max Liebermann, qui nous montrera le Jardin d’une maison de retraite à Amsterdam. Le faire en est un peu trop empâté et pianoteux, mais il y a des qualités; ses vieux invalides, assis au soleil sous des arbres, sont assez lestement pochés, sans gros comique; revenons en France, après un court arrêt en Belgique, juste le temps de jeter un coup d’oeil sur la Revue des écoles de M. Jean Verhaz, qu’il ne faut point confondre avec un certain Franz Verhas dont le talent m’apparaît comme des plus problématiques. Cette Revue des écoles est une gigantesque toile. Le roi se tient sur une estrade; des gens, en habit noir, sont disséminés, un peu partout, pour les besoins du peintre. En colonne serrée, toute une armée de petites filles, vêtues de blanc, défile. L’habileté du peintre est excessive; très adroitement, il a rompu cette énorme tache blanche par quelques écharpes soigneusement distancées, par des tons éclatants de fleurs, par des coups sombres d’habits. Les fillettes sont un peu effacées et minaudières, trop peu variées, car l’on sent que cinq ou six d’entre elles ont servi, seules, de modèles, mais c’est néanmoins une méritante et audacieuse toile. Il y a un bon effet de plein air ; tout le paysage de maisons est excellent, exécuté dans la claire tonalité de la nouvelle école. En somme, je souhaiterais à nos salons officiels beaucoup de tableaux d’une pareille valeur.
J’en souhaiterais beaucoup aussi comme celui de M. Bartholomé : Dans la Serre. Ce peintre va en progressant; ses qualités de simplicité et de franchise qui m’avaient attiré lors des expositions de 1879 et de 1880, sont demeurées intactes; mais sa peinture un peu froide s’est échauffée et est devenue plus lumineuse et plus claire; la scène qu’il a brossée est ainsi conçue : une nourrice montre un jouet à un enfant qui tend les mains, dans sa petite voiture. Une table, des livres, un chien au museau effilé et aux yeux vifs, de grandes plantes vertes complètent la scène. Il fallait être bien sûr de soi pour se risquer dans un sujet pareil ; mettez-le entre les mains d’un de nos peintres dits modernes, il y a quatre-vingt-dix-neuf chances à parier sur cent qu’il en fait une gravure de modes et qu’il tombe immédiatement dans la romance sentimentale et dans la mignardise niaise. M. Bartholomé a passé, tous feux allumés, entre ces écueils ; à force de bonne foi, il a peint une femme et un enfant dans une pose ni prétentieuse ni apprêtée, et leur sourire est charmant de vérité et de grâce.
C’est d’un dessin très décidé, mais d’une couleur un peu assoupie. M. Bartholomé est, en somme, un des seuls peintres qui comprennent la vie moderne; je n’étonnerai personne en ajoutant que son oeuvre a été soigneusement reléguée au cinquième étage, sur une terrasse, tandis que les suzerains du jury et que la foule de leurs vassaux et de leurs feudataires se prélassent commodément, dans les rez-de-chaussée, aux meilleures places.
A signaler maintenant un tableau d’un élève de Gérôme, M. Gueldry, Une Régate à Joinville : un tableau de plein air, très vivant, très gai. M. Gueldry est un des rares peintres qui aient tenté de s’affranchir de ses souvenirs d’école et d’aller droit à la nature ; il mérite vraiment qu’on l’applaudisse. À signaler encore la Seine à Bezons, de M. De L’Hay, une toile que signerait, dans certaines parties, un impressionniste ; un Ulysse Butin assez vigoureux ; une marine de Boudin où de jolies taches s’enlèvent dans une atmosphère un peu bleutée; puis, des efforts trahis par l’insuffisance du talent : un essai de fleurs, en plein air, de M. Quost, une toile brouillée et blanchâtre; Une Coulée d’acier à l’usine de Seraing, de M. Meunier, une toile cartonneuse et couleur de brique ; mais enfin si ces deux peintres ont trop présumé de la force de leurs jambes, ils ont du moins osé courir, ce dont il faut leur tenir compte.
Je laisserai sous silence le paysage; ce sont des tableaux identiques à ceux des salons précédents ; il est bien inutile que je me rabâche. La plupart des paysagistes sont de souples singes qui s’éternisent dans les mêmes redites exécutées sans qu’une impression quelconque leur affecte le cerveau et l’oeil. Je mentionnerai cependant M. Luigi Loir dont les Giboulées sont agréables, et le Vieux Villerville et la Plage de Saint-Vaast de M. Guillemet qui continue à brosser avec adresse ses ciels que tranchent des cimes de falaises. Une impression de jours pluvieux, de tristesse, se dégage de ses toiles plus expansives que celles de ses confrères officiels du paysage.
Est-il bien nécessaire aussi de parler des natures mortes, de dire de quelle hémiplégie est atteinte la peinture de M. Rousseau, de vanter l’inconcevable jonglerie de M. Martin. Son Intérieur oriental est tout aussi terriblement délibéré que son amas d’armes et que sa dame-jeanne de l’an dernier. Seulement la personnalité de ce peintre ne sourd pas ; c’est l’oeuvre d’un prestidigitateur consommé, mais d’un artiste véritable, pas. Je lui préfère de beaucoup la Desserte de Mme Ayrton, brossée à grands coups, avec une puissance qui étonne chez une femme.
Il ne nous reste plus, avant de quitter les salles de peinture, qu’à parler de M. Baudry et de M. Alma-Tadéma.
Un plafond pour l’une des salles de la cour de cassation a été commandé à M. Baudry ; cela s’appelle : Glorification de la Loi. Le concept du peintre n’est ni bien aventureux, ni bien neuf. C’est l’éternel plafond décoratif bâti, avec une figure assise, en haut des degrés d’un temple, des femmes volantes au-dessus, d’autres accroupies près d’un lion, le tout agrémenté d’un drapeau et d’un président au nez aquilin et à la robe rouge, saluant la loi de sa toque; mais puisqu’il est convenu que ces vastes machines sont fondues dans une matrice uniforme, il faut avouer que les personnages de M. Baudry, bien que conçus sur un type unique qui sert indifféremment à tous, sont élégants et bien campés. C’est une page harmonieuse et claire, pleine de pastiches des anciens maîtres de l’Italie ; mais c’est, malgré tout, supérieur aux autres plafonnades apprêtées par les artisans chargés d’accomplir de semblables tâches.
En route pour le temple de Cérès, de M. Alma-Tadéma, tient moins de place et est certainement plus intéressant et plus original.
Le cas de cet artiste abasourdit vraiment. Je n’ai pas besoin de rappeler les oeuvres qu’il exhiba, en 1878, au champ de mars : l’Audience chez Agrippa, la fête intime, Après la danse, des panneaux ouvrés avec un art délicat d’artiste et d’archéologue. Sans doute, M. Tadéma n’a point l’art mystérieux et exquis de Gustave Moreau, mais il a aussi une note singulière, une facture captieuse se jouant avec les blancs de lait, les jaunes de Naples, les vert-de-grisés, jetant dans la pâle et tendre assonance de ses teintes des carillons de magnifique rouge, comme dans ce champ de pivoines et de pavots qui s’épanouissait au soleil, dans son Jardin romain.
Malgré moi, devant ces toiles, je songe au Balthazar Charbonneau de L’Avatar de Gautier, à cet étrange thaumaturge qui envoie son esprit voyager, au loin, dans les siècles défunts, tandis que son corps reste vide, affaissé sur une natte. Par quelle bizarre faculté, par quel phénomène psychique, M. Tadéma peut-il s’abstraire ainsi de son époque, et vous représenter, comme s’il les avait eus sous les yeux, des sujets antiques ? J’avoue ne pas comprendre et admirer, inquiet, le talent de cet homme qui doit se trouver bien dépaysé dans les brumes de Londres.
En route pour le temple de Cérès est la répétition de ses toiles déjà connues, je ne m’y arrêterai donc pas ; mais puisque ce tableau a attiré le nom de ce peintre sous ma plume, j’en profiterai pour aborder les oeuvres de deux de ses élèves, deux dessinateurs anglais qui ont ciselé de petits joyaux pour les albums enfantins du jour de l’an. M. Walter Crane et Miss Kate Greenaway. Comme les albums anglais sont, avec les albums du Japon, les seules oeuvres d’art qu’il reste à contempler, en France, lorsque l’exposition des indépendants se ferme, la parenthèse que j’ouvre me semble avoir sa raison d’être.
Édité par George Routledge et fils, de Londres, M. Walter Crane a été importé en France par la librairie Hachette. L’on pourrait diviser ses albums enfantins du jour de l’an en trois séries. L’une fantastique, simplement adaptée à la traduction des contes de fées ; l’autre, purement humoristique, accompagnée seulement d’un bout de légende explicative; la dernière enfin, moderne, s’attachant à rendre certains coins de la vie intime.
Je ne suivrai pas l’artiste par toute la filière de ses dessins ; je me bornerai à choisir ses planches les plus typiques.
Dans les contes de fées, une unique conception de la beauté féminine. Un nez droit, semblant ne faire qu’un avec le front très bas, de grandes prunelles pareilles à celles des Junons, une bouche petite, un peu rentrée, un menton très court, une taille élevée, des hanches robustes, des bras très longs, emmanchés de fortes mains aux doigts effilés. C’est le type de la beauté grecque. Mais ce qui est bizarre, c’est que la femme ainsi conçue paraît, dans ces cahiers, vêtue de costumes les plus divers, appartenant à toutes les époques, empire grec dans certaines planches de la Biche au bois et de la Beauté endormie ; moyen âge, dans Valentine et Orson ; renaissance, dans le Liseron et dans d’autres ; Louis XVI, dans la deuxième planche de la Belle et la Bête. Avec un rien, une déviation à peine sensible du nez qui se trousse imperceptiblement, la figure sculpturale se chiffonne, et tout en conservant le caractère immuable de l’artiste, devient charmante, d’une grâce de soubrette de Marivaux qui jaserait avec un petit accent de Londres, ou bien alors, comme dans l’Ali-Baba, elle tourne au type romain, reste régulière, mais de rigide se fait souple et mêle dans l’amusant milieu d’une fantaisie persane une élégance Pompéi presque animée, presque sournoise.
Un autre fait curieux à observer est celui-ci :
Alors qu’en France, dans les tableaux contemporains, le peintre néglige toute composition et semble seulement dessiner une anecdote pour un journal à images, dans les albums qui nous occupent, Crane compose de véritables tableaux. Chacun de ses feuillets est un tableautin, et la princesse Formose, dans le prince Grenouille, assise, devant un bassin, et la princesse Belle-Étoile, dans l’album de ce nom, retrouvant ses frères enfouis sous la montagne enchantée, seraient des toiles très étudiées et de large allure, aux salons annuels. Et je pourrais citer maintes et maintes pages de ces « picture books » signées de ce monogramme, « une grue dans un grand C »,(1) qui mériteraient plus un cadre que les vastes coupons de toile perdus, dans du bois doré, à chaque mois de mai, le long de toutes les salles de l’Industrie.
Seulement dans cette série, il faut bien le dire, le souvenir d’Alma-Tadéma obsède. Qu’il vête ses personnages de robes de brocart, qu’il les déguise en Japonais comme dans Aladin ou qu’il leur conserve le costume style empire, Crane ne peut échapper à la hantise de son maître; s’il se sert d’une gamme plus étendue, plus variée de couleur, s’il va jusqu’aux tons les plus acerbes, aux orangés les plus féroces et aux verts presque noirs, tant ils sont intenses; s’il use peu, en revanche, de toute l’octave cendrée de Tadéma, son dessin ne peut se délivrer des imitations les plus flagrantes. C’est la même façon de camper le personnage, de le dessiner en vigueur, de faire les raccourcis, de le muscler sous l’habit par quelques traits, de détacher sa silhouette dans une pose antique. Il n’y a pas jusqu’à cette préoccupation archéologique lui faisant, dans Barbe-Bleue, assortir tout l’intérieur au costume choisi par ses figures, et, dans Aladin, décalquer les cigognes et les fleurs décoratives des Japonais, qui ne rappelle le soin pieux d’Alma-Tadéma, de mettre ses personnages dans les milieux où ils devraient évoluer et vivre.
Un curieux parallèle pourrait s’opérer maintenant, entre les manières si dissemblables de comprendre le fantastique, de M. Crane et de M. Doré,(2) et les rapprochements seraient d’autant plus aisés à établir que l’un et l’autre de ces artistes ont illustré certains contes de Perrault, tels que la Barbe-Bleue et le Petit Chaperon rouge. Doré, plus fantaisiste, plus dramatique, plus outré; Crane moins dissonant, plus simple, suivant la vérité pas à pas, introduisant toujours une atmosphère de réel même dans la féerie, puis, trouvant, comme dans la Barbe-Bleue, une soeur Anne, montée sur une tour et dominant un paysage, qui atteint une certaine grandeur d’allure inaccessible à M. Doré. Ajoutez encore l’intérêt ethnologique qui fait de ces albums pour enfants un régal pour les artistes et mettez en balance à l’acquit de M. Doré d’amusantes fantasmagories de campagne, des jeux de lumière comme au théâtre, une transposition de l’art du décor dans le dessin, et vous aurez les qualités les plus éloignées et l’interprétation la plus disparate des contes de Perrault.
Au fond l’un est bien Anglais et travaille bien pour les enfants de son pays aux cervelles déjà posées, aux besoins de réalité plus mûrs que les nôtres, et l’autre est bien Français et travaille bien pour nos enfants dont l’imagination est plus flottante et plus crédule, sans désir de raisonnement, sans attache au terre-à-terre quotidien de la famille. Toute une différence de race et d’éducation se dégage de ces contes ainsi traduits.
Mais l’influence incontestée de M. Tadéma va s’atténuer et disparaître. Dans son oeuvre purement humoristique et moderne, M. Crane est sorti de chez lui ; deux types de vieilles femmes, l’une monstrueuse, dans le Nain jaune, avec sa robe et son bonnet écarlates, sa tignasse vipérine de sorcière, son oeil énorme roulant au-dessus d’un nez que sépare d’un menton en galoche le fossé sans fond d’une horrible bouche, la Fée du désert qu’escortent deux gigantesques dindons faisant la roue et l’autre dans la princesse Belle-Étoile une vieille maugrabine se contorsionnant en de comiques grâces, décelaient déjà une note très particulière dans l’humour.
Cette note, il l’a développée dans trois albums surtout. L’un qui représente les Saisons et qui est un écrin de folle cocasserie : janvier personnifié par une sorte de général russe, revêtu de l’accoutrement de fourrures le plus baroque, saluant avec un formidable bicorne, marchant dans des raquettes, l’oeil biglant sous un monocle, tandis qu’un petit groom, trouvaille de solennelle componction, offre des paquets de friandises à d’adorables fillettes clouées tout interdites, osant à peine toucher à de si bonnes choses ; août incarné en la personne d’un matelot dont les poils de la tête flamboient comme des soleils ; septembre, en un joyeux sommelier, montrant, avec une indicible joie, de poudreuses bouteilles, suivi par deux messieurs, un gras et un maigre, d’une attitude de vie superbe; mais il est impossible de décrire et d’expliquer cet album, l’humour qu’il renferme est intraduisible ; je ne puis qu’y renvoyer le lecteur, bien qu’il n’ait pas été francisé, je crois, par la maison Hachette. En tous cas, il porte ce titre : King Luckieboy’s.
Un autre nous raconte la vie journalière d’une famille de porcs. Un père, le cou engoncé dans un col de prud’homme, les yeux abrités par les verres fumés de lunettes à branches, le corps bien pris dans un habit pistache, les fesses bombant sous une culotte jaune citron, barré de blanc, par l’ouverture de laquelle frétille une queue en tire-bouchon, les pattes moulées dans des bottes à revers, se livre à toutes les scènes intimes de la vie anglaise. Le chapeau cavalièrement campé sur la hure, la mine joviale et satisfaite, il va au marché, puis en revient, les paniers remplis, traînant après lui l’un de ses fils, un jeune verrat, habillé de rouge et coiffé d’une casquette pâtissière à gland ; dans cette planche, l’énorme derrière du papa emplit le ciel, abritant de sa rotonde l’enfant qui pleurniche, se tenant d’une main, à la basque de l’habit pistache et se frottant, de l’autre, les yeux avec ce mouvement grognon et rageur naturel aux gosses. Puis, une fois rentré dans sa maisonnette, le père donne à dîner à quatre petits cochons assis en flûte de pan autour de la table. Tandis qu’il découpe, un grand recueillement emplit la salle ; les gorets joignent les pattes et, très émus, regardent ; l’un est tellement affriolé qu’il en louche, les autres poussent leurs petits bedons, pointent les oreilles, et humectent sensuellement la bavette qu’ils ont par dessus leurs tabliers, autour du cou.
Ce qui est inestimable dans ces planches, c’est la mise dans l’air de ces personnages, le spirituel de ces figures, l’expert de ces regards, la réalité de ces postures; il y a là une senteur inconnue en France; cela exhale un goût franc de terroir et laisse loin des lourdes et insipides plaisanteries de Grandville, ce Paul de Kock du dessin, ce grossier traducteur des attitudes et des passions humaines sous des habillements et des mufles de bêtes !
Mais un troisième album, The fairy ship, est plus humoriste encore. Un vaisseau est le long d’un quai, dans un port; les gigantesques grues fonctionnent, les ballots encombrent les trottoirs qu’hérissent des bornes en fonte, enroulées de câbles ; les hommes sont sur le pont ; les armateurs et les négociants causent entre eux en alignant des chiffres, des contre-maîtres transmettent des ordres, la manoeuvre se précipite, tout le régulier tohu-bohu d’un port est devant nous ; puis le feuillet tourne, le navire a pris le large et alors apparaissent les perspectives les plus imprévues, les plus osées, le ciel fouetté par des mouettes aperçu, tout penché, du fond d’une cale; la mer vue du haut d’un mât, où des marins cramponnés carguent une voile que remplit un coup furieux de vent; le pont du bâtiment vu, à moitié, de biais, montant dans le ciel, sur une vague, pendant que les matelots grimpant dans les cordages, disparaissent, coupés au ras du ventre par le cadre. Or tout l’équipage est composé de rats et dirigé par un pingouin. C’est une petite merveille d’observation, un tour d’adresse de dessin, enlevant d’un coup de crayon les poses les plus effacées et les plus simples du corps, un tour d’adresse tel qu’il faut, pour en trouver un aussi expressif et aussi agile, recourir aux albums japonais d’Hokkei et d’Okou-saï.
La troisième catégorie, celle où M. Crane traite le moderne, contient les détails essentiels de la vie de Londres. Ici, c’est une marchande de pommes, tassée sur sa chaise, culottant sa pipe; là c’est un corridor de maison, un clair vestibule où, par une porte ouverte, l’on entrevoit tout le côté droit d’un soldat de la cavalerie, en petite tenue, courtisant une bonne, tandis que menaçantes, s’agitent en l’air, pendues à la queue-leu-leu, de prodigieuses sonnettes ; là encore c’est l’intérieur d’une cuisine et d’un office, avec des servantes essuyant, debout, des plats et des tasses, ou tirant, à genoux, de l’eau chaude, des fourneaux qu’illumine la flamme rouge et bleue du charbon de terre ; plus loin, c’est la salle à manger, avec sa large fenêtre au fond ouvrant sur des jardins et toute la famille assise, le père, la mère et les enfants, un gai tableau montrant les mille riens du confort de la table anglaise, notant les diverses façons lestes ou maladroites, des gamins, de tenir leur gobelet et leur cuiller.
Dans un autre, c’est la ville de Londres qui apparaît, vue d’abord au travers de la vitre d’un wagon ; puis, comme en un kaléidoscope, les tableaux changent. Nous entrons dans le musée Tussaud, dans le palais de cristal, nous assistons aux pantomimes des clowns, enfin à des exercices de patinages piqués vifs, avec leurs envolées, leurs brusques arrêts, leurs chutes ; il y a des poses de pieds de patineurs peu habiles, des marches mal équilibrées, des oscillations de têtes, des vacillements de bras d’une vérité extraordinaire. Dans un dernier album enfin, Ma mère, une planche représente une famille aux bains de mer, des enfants courant sur la plage et, à Londres, au milieu d’un jardin, une femme relevant son baby tombé qui est une ébahissante surprise de réalité et d’élégance.
C’est dans ces deux séries d’albums que la personnalité de M. Crane s’est affirmée. Comme je l’ai dit plus haut, dans sa suite de Contes de Fées, la filiation est trop évidente ; je pourrais même ajouter encore que le père d’Alma-Tadéma et que, par conséquent, le grand-père de M. Crane, le peintre belge Leys, se montre aussi, avec sa naïveté fabriquée, dans certains albums tels que le Liseron, mais les traces de cette hérédité se meurent dans le moderne. Ici c’est la nature directement consultée, avec une entière bonne foi. Du reste, ces qualités d’exacte notation et d’indiscutable véracité, communes à la plupart des dessinateurs de talent d’outre-manche, ont rendu le Graphic, le London News Illustrated, des journaux sans rivaux dans la presse illustrée des deux mondes. M. Crane n’a donc eu qu’à se laisser porter par le courant de l’art moderne anglais, dans ses scènes de la vie contemporaine, mais dans son King Luckieboy’s, dans son Vaisseau enchanté, dans plusieurs de ses alphabets et dans les dessins dont il a orné des cahiers de musique, il a su mettre une bonne humeur, une finesse d’esprit, une fantaisie de haute lice qui en font des oeuvres à part, des oeuvres uniques, en art.
Le seul album de Miss Greenaway, Under the Window (Sous la fenêtre), a été traduit en français sous le titre de : la Lanterne magique. Cette artiste a eu la chance de réussir du premier coup et son recueil est devenu à Paris maintenant presque célèbre dans un certain monde.
Miss Kate Greenaway a bu au même verre que M. Crane. D’invincibles réminiscences d’Alma-Tadéma reviennent encore dans nombre de ses planches ainsi que d’inchassables souvenirs des albums d’Okou-saï, mais, sur cette mixture habilement battue, surnage une affectueuse distinction, une souriante délicatesse, une préciosité spirituelle, qui marquent son oeuvre d’une empreinte féminine toute de dilection, toute de grâce. Puis, il faut bien le dire, le femme seule peut peindre l’enfance. M. Crane la saisit dans ses attitudes les plus tourmentées et les plus naïves, mais il manque à ses aquarelles ce que je trouve chez Miss Greenaway, une sorte d’amour attendri, de ferveur maternelle; vous pouvez feuilleter chacune de ces pages, au hasard, celle où des fillettes jouent au volant, celle où dans un paysage de Nuremberg, une délicieuse mioche se tient, interloquée, honteuse, devant un roi d’opérette, en bois articulé et peint; cette autre, où une grande fille tient un bambin dans ses bras, et cette dernière enfin où cinq jeunes miss vous regardent, les mains noyées dans leurs manchons, le corps enfoui dans leurs pelisses vertes, à fourrures, pour vous assurer du caractère et du sexe de leur auteur : aucun homme, en effet, n’habillerait ainsi l’enfant, n’arrangerait les cheveux, sous le grand bonnet, ne lui donnerait cette pétulante aisance, cette jolie tournure de tablier et de robe façonnés aux moindres mouvements du corps, les gardant presque, alors même qu’il demeure, pour quelques instants, à l’état immobile. Puis quel art de la décoration dans cet album, quel art de la mise en page, quelle incessante variété dans les motifs de l’ornement, empruntés aux fruits, aux fleurs, aux ustensiles du ménage, à la bande des bêtes domestiques ! Quelle diversité dans la ligne du cadre qui change à chacune des feuilles du livre ! Ici, des tiges de tournesols se dressent dans un coin; là, des lances de roseaux montent dans des fins de page dont le haut représente un pont et une rivière; là encore, des corbeilles de tulipes s’irradient en dessous d’une petite maison de rentier soigneux et propre ; puis l’harmonie convenue du feuillet se rompt et voilà que des courses de cerceaux se précipitent autour du texte, qu’en guise de cul-de-lampe, le peintre dispose les tasses à thé des personnes en scène et use comme de fleurons des volants qui passent au-dessus des vers imprimés, à la grande joie des enfants brandissant leurs raquettes, dans le bas de la page.
L’emblème du talent de Miss Greenaway qui nous a offert en sus de cet album quelques petits calepins à images, des livres distribués pour leur fête aux enfants anglais, des plaquettes émaillées de quelques chromos sans importance, me paraît gravé sur la première page de son Under the Window. Dans une sorte de cadre grec, un vase du Japon se dresse, plein de roses roses et de roses thé ; c’est du Tadéma, de l’Okou-saï, et, s’exhalant de ce mélange, un frais parfum de fleurs aux douces nuances.
Un troisième dessinateur, M. Caldecott, a, de son côté, peint pour les bambins des recueils en couleur. Celui-ci ne dérive plus d’Alma-Tadéma, mais bien du plus grand et du plus inconnu en France des caricaturistes anglais, Thomas Rowlandson. Le John Gilpin de M. Caldecott a cependant été inspiré par le John Gilpin de Cruikshank ; mais il est bon d’ajouter que cet artiste dérive en ligne droite, dans cette fantaisie du moins, de Rowlandson. L’histoire de ce bonhomme qu’un cheval emporte, qui file, ventre à terre, au travers des prairies et des villages, lâchant ses étriers, perdant sa cravache et sa perruque, dans la nuée des oies qui s’envolent, effarées, sous les pieds de son cheval poursuivi par toute une meute de chiens, rattrapé par toute une cohue d’amis qui parviennent, après de folles cavalcades, à le rejoindre et à le ramener chez lui, où il s’affaisse, exténué, dans les bras de sa femme, est interprétée avec une jovialité formidable, une gaieté féroce. Il y a là-dedans un vieux reste de sang flamand, comme un écho persisté du gros rire, secouant les vitres et battant les portes, de Jan Steen.
À ce rire débordant, Rowlandson joignit une froide goguenardise bien anglaise. Laissant à Hogarth ses idées morales et utilitaires que reprirent plus tard les Cruikshank ; abandonnant, après de nombreux essais, à James Gillray, ses sujets politiques, il s’attaqua aux moeurs et les peignit en d’incomparables satires, gravées à l’eau-forte et coloriées à la main. Toute la série du Docteur Syntaxe, des Misères de la vie humaine, de la Nouvelle Danse de la mort, prouve quel personnel artiste fut cet homme, dont les planches, jadis laissées au rebut, acquièrent aujourd’hui de fermes prix dans les ventes.(3) Les renseignements sur sa vie font malheureusement défaut ; on peut les résumer en six lignes. Il naquit, au mois de juillet 1756, dans le quartier d’Old Jewry, à Londres, perdit ses parents, vint à Paris, hérita d’une tante dont le saint-frusquin disparut, mangé par les femmes et le jeu, revint à Londres, continuant ses noces de bâtons de chaise, ne travaillant que par besoin, et mourut le 22 avril 1827, dans la pauvreté la plus noire, nous laissant, en sus de caricatures politiques, d’illustrations de livres et d’études de moeurs, une série de planches gaillardes qui sont de purs chefs-d’oeuvre d’invention obscène.
Personne ne s’est plus que Rowlandson réjoui devant les déformations de la graisse et de la maigreur. En quelques traits, il vous gonfle une bedaine, vous ballonne des joues, tend un fessier, indique les bourrelets de la peau, polit la boule d’un crâne, injecte le teint où éclate l’émail blanc des yeux, dégage le comique de l’adiposité ou détache la héronnière carcasse d’un homme étique. Personne n’a saisi, comme lui, le grotesque de ces gens à cheval, écrasant le bidet sous leur poids ou volant sur sa croupe comme des plumes. Personne enfin, dans ses premières oeuvres surtout, n’a dessiné d’aussi exquises figures de femmes un peu dodues. Une estampe politique est, à ce point de vue, caractéristique. Fox est assis dans les bras de deux femmes, deux merveilleuses trouvailles d’un adorable charme ! En revanche, personne aussi n’a ridiculisé plus cruellement la femme lorsque les ravages de l’âge sont venus. La gravure connue sous le titre de Trompette et Basson en fait foi. La trogne de la femme dormant près de son mari, dont le nez s’élève au-dessus d’une gueule édentée, ainsi qu’une pyramide trouée de deux portes, ferait reculer d’horreur les moins difficiles et les plus braves.
Comme Rowlandson, M. Caldecott s’adonne au burlesque de l’obésité et du rachitisme ; comme lui, dans son album des Trois joyeux Chasseurs, il fait galoper, par monts et par vaux, des gens pansus ; s’il n’a pas encore abordé les monstruosités de la vieillesse chez les femmes, il n’a jamais pu, en compensation, dérober à Rowlandson l’élégance de leurs délices juvéniles.
Malgré tout, M. Caldecott n’est pas seulement un direct reflet de Rowlandson ; dans quelques albums sur lesquels je vais m’arrêter, il a secoué l’influence de son maître et donné une note à lui; et alors, plus que M. Crane et que Miss Greenaway, il possède le don d’insuffler la vie à ses personnages. Tout semble compassé à côté de ses figures qui se démènent et braillent ; c’est la vie elle-même prise dans ses mouvements. Puis, quel paysagiste que ce peintre ! Voyez dans le livre intitulé la Maison que Jacques s’est fait construire, ces bâtisses s’enfonçant, sous un ciel pommelé, dans de grands arbres que limitent des prairies et des parterres, ce soleil se levant sur la campagne, tandis qu’un coq claironne et qu’un bonhomme ouvre, en souriant, sa fenêtre; voyez, dans un autre représentant des enfants abandonnés en une forêt, la tournure des grands et humides nuages, la puissance robuste des chênes, le délicat feuillé des fougères que l’automne rouille, et dans un autre encore; Chantez-nous une chanson pour douze sous, racontant l’histoire de toute une gazouillante couvée d’oiseaux, un paysage d’hiver où se dressent sous le plomb d’un firmament, des meules coiffées de neige, pendant que des galopins transis chassent au trébuchet.
Et l’animalier qu’est aussi M. Caldecott égale le paysagiste ! Il y a, dans ses recueils, un rat rongeant des sacs d’orge, poursuivi et mangé par un chat, traqué à son tour par un chien qu’éventre à la fin une vache, qui sont enlevés en quelques traits spirituels et décisifs ; il y a plus loin un petit chat noir tout penché, par un mouvement félin d’une justesse extrême, sur la main de l’homme qui le caresse; et dans l’Élégie d’un chien enragé, une planche entière consacrée aux chiens, où les allures des races diverses et l’air sérieux et défiant des conciliabules tenus entre bêtes qui ne se sont pas suffisamment flairées sous la queue, sont croqués avec une étourdissante alerte.
Mais où M. Caldecott s’élève au rang d’un grand artiste ne devant plus rien à ses devanciers, c’est dans The Babes in the wood (les Enfants dans les bois), où un mari et sa femme se meurent, tandis que les deux enfants jouent au polichinelle sur le rebord du lit. Si la figure des médecins n’avoisinait pas la charge, ce serait un simple chef-d’oeuvre. L’homme, debout sur son séant, émacié, blême, les mains bleues, tant les veines saillent sous la peau maigre et comme rentrée, tire péniblement la langue.
Il est bien malade, mais on sent qu’il a encore quelques jours à vivre. Quant à la femme, elle va mourir et sa face est terrible. La tête sur l’oreiller, ne pouvant plus soulever le bras qu’on lui tâte au pouls, elle a le visage blanc ainsi qu’un linge et comme mangé par deux grands yeux dont le regard fixe et souffrant fait mal. Je ne connais pas de tableau où le spectacle de la mort soit aussi cruel et aussi poignant; c’est qu’ici l’artiste a supprimé toutes les attitudes théâtrales adoptées par les peintres, tous les modes convenus des poses mortuaires, toutes les expressions apprises dans les écoles ; il a, telle quelle, et avec une grande pitié, suivi la nature et abordé la lamentable scène, et il nous la décrit en plusieurs feuilles, ne nous épargnant aucune horreur, aucune angoisse ; nous montrant la mère embrassant son petit garçon, au dernier moment, et, dans le geste de cette femme, dans le recueillement de cette figure dont les yeux se ferment, dans cette étreinte sanglotante, passe toute l’immense douleur de la mère qui laisse des enfants seuls au monde.
Ces planches sont malheureusement rares dans l’oeuvre de M. Caldecott ; dans ses autres albums, la joviale rondeur du caricaturiste est réjouissante, mais ce dessin roulant et goguenard n’est pas à lui ; et si certains croquis tels que celui d’un bambin qu’on lave dans un baquet ne sont plus du Rowlandson, ils semblent alors crayonnés par l’un des artistes de Yeddo.
Comme celles de la Lanterne magique, de Miss Greenaway, ces chromos sont magnifiques : d’aucunes donnent l’illusion d’aquarelles, tant elles sont fines et blondes. L’art de l’image en couleurs, si grossier en France qu’il devrait se confiner exclusivement dans l’industrie, a atteint chez les Anglais une perfection plénière. Regardant ces planches, M. Chéret qui, en sus de son original talent, est le plus expert de nos chromistes, soupirait me disant : « il n’y a pas ici un ouvrier capable de tirer ces planches. » celles dont je viens de parler sont, il est vrai, des merveilles de fondu et de moelleux, obtenues par l’imprimeur Evans, et elles sont bien supérieures à celles de Crane dont les tons sont encore discordants et bruts.
En somme, l’album du jour de l’an, si méprisé en France qu’il est confié par les fabricants des joies enfantines à je ne sais quels manoeuvres dont les papiers peints me font amèrement regretter les anciennes images d’épinal naïves et gaies parfois, avec leurs larges plaques de bleu de prusse, de vert-porreau, de sang de boeuf et de gomme-gutte, est devenu une véritable oeuvre d’art en Angleterre, grâce au talent de ces trois artistes, car je néglige nécessairement les pastiches plus ou moins réussis de la Lanterne magique, de Miss Greenaway, qui ont récemment paru à Londres.
Encore que les source où ils ont puisé nous soient connues, Crane, Greenaway et Caldecott ont chacun une saveur personnelle, une complexion différente, un tempérament nerveux commun, mais très équilibré chez Crane, dominé par le mélange sanguin chez Caldecott, un tantinet anémié chez Miss Greenaway.
Sans vouloir établir ici de comparaison entre leurs oeuvres, on peut affirmer cependant que, du jour où elles seront populaires à Paris comme elles le sont de l’autre côté de la Manche, les artistes iront de préférence à Crane,(4) dont le talent est plus varié, plus ample et plus souple; les femmes et les amateurs du joli et du tendre seront attirés par les délicats joyaux de Miss Greenaway, tandis que le public adoptera Caldecott, dont l’entrain bouffon et le rire sonore le séduiront davantage.
Mais c’est trop nous attarder, car il nous faut maintenant rentrer au salon de 1881, où il nous reste à voir encore les salles de dessin et d’aquarelles, la sculpture et l’architecture. Je serai bref, autant que possible.
Parmi les dessins, deux fusains hors ligne, le Quatuor et le Pot de vin, de M. Lhermitte, deux fusains sabrés à grands coups et vraiment modernes ; le Quatuor surtout, où des amateurs réunis pour faire de la musique de chambre s’étagent, tels quels, en groupes non préparés pour le photographe. J’avoue préférer de beaucoup ces faciles dessins à la peinture de cet artiste si contrainte et si tâtée. — Après lui, je puis signaler encore un Poste de secours, une cire-pastel de M. Cazin où je retrouve les qualités perdues dans son Souvenir de fête, puis une Tentation de M. Fantin-Latour assez plaisante, deux aquarelles de M. Heins, puis quoi ? ... rien, — si ce n’est cinq aquarelles d’un Japonais, élève de M. Bonnat. Imaginez des souvenirs du Japon, traduits dans la langue de nos écoles. M. Yochimathi-Gocéda est perdu ; son oeil est oblitéré, sa main inconsciente. Je n’ose le supplier de retourner dans son pays et d’étudier la nature et l’oeuvre de ses maîtres, car je sais combien est indélébile la pratique apprise dans nos classes. Ah ! le malheureux qui est venu en France pour perdre son talent, s’il en avait, et pour n’en acquérir aucun semblant s’il n’en avait point !
Les aquarelles exposées, cette année, sont donc à peu près nulles ; les pastels sont peu nombreux et d’une médiocrité qui décourage. Il faudrait, pour en découvrir d’intéressants, sortir encore une fois du salon et pousser jusqu’à la place Vendôme où sont réunis ceux de M. De Nittis. Le temps me manque pour en rendre compte. Disons seulement que ce peintre est en progrès, que ses afféteries coutumières et ses adultérations de perspective sont moins sensibles ; que parmi ses pastels des Courses d’Auteuil, l’un représentant une Femme debout sur une chaise, et un autre, un Coin de tribune, par un temps de pluie qui met, en bas, sur la piste, comme dans certaines planches japonaises, des nuées de parapluies ouverts, semblables à des plants de champignons, sont d’une amusante et jolie couleur.
Descendons maintenant dans les salles de la sculpture. Toujours la même assemblée de bustes, d’allégories, de nudités. Aucune tentative dans le moderne ; mieux vaudrait se taire que de ratiociner ainsi, tous les ans, le même discours de grand concours. — Passons, en jetant pourtant un regard à la bizarre fumisterie de M. Ringel, appelée Splendeur et Misère, un groupe de terre cuite peinte, grandeur nature, montrant un catin debout sous une ombrelle, et, assis à ses pieds, une sorte d’arsouille estropié, coiffé d’un yokohama de paille, le nez chaussé de véritables besicles d’aveugle, en verre bleu, qui hurle je ne sais quelle parade ! Il y a pourtant quelque chose dans ce Vireloque qui ressemble à un yankee, mais la fille est détestable ; c’est un mannequin, malgracieux, sans vie, attifé d’une manière ridicule.
Des épures : en voici, en voilà. Dans de solitaires salles, l’architecture exhibe ses lavis évoquant l’idée d’une considérable consommation de bols d’encre de Chine; ce sont, pour la plupart, des projets de restauration d’églises et de lycées, des aménagements d’hospices et d’écoles, des plans de chapelles funéraires : rien, en somme, qui puisse laisser croire que ces exposants aient même conscience du mouvement déterminé dans l’architecture.
Il est vrai que ce sont les pusillanimes qui fonctionnent ici ; tous rabibochent des bâtisses vermoulues ou recopient, mot à mot, les types déjà conçus des villas ou des casernes ; aucun n’essaie de marcher dans ses propres bottes ; je ne m’occuperai donc pas des châssis de ces ressemeleurs, je me bornerai simplement à appuyer et à compléter les affirmations que j’ai émises, dans mon salon de 1879, au sujet de l’architecture, en montrant la succession non interrompue des monuments élevés à Paris, d’après les données de l’école nouvelle, en indiquant ainsi la route déjà parcourue, celle qui reste à suivre.
Le second Empire, grand bâtisseur, comme chacun sait, mais d’une irrémédiable ineptie au point de vue du goût, avait rêvé de faire éclore un art architectonique qui portât son nom. Il encouragea, dans ce but, des amalgames disparates de tous les styles ; il poussa à cet abus des lourdes ornementations qui ont rendu le tribunal de commerce l’un des palais les plus affligeants du siècle. Ne voulant pas reconnaître, comme le dit justement M. Boileau, dans son très intéressant volume, le Fer, que « les combinaisons inhérentes à la pierre comme matière fondamentale des monuments étaient épuisées, il persista à vouloir en tirer des effets nouveaux, sans même s’apercevoir qu’on devait au contraire, pour atteindre le but proposé, étendre l’usage d’un nouvel élément matériel dont l’usage, employé d’une manière restreinte par l’architecture moderne, a pourtant donné d’heureux résultats : le fer.’ »
La routine des bureaux continua donc de plus belle ; les avis n’avaient pas manqué pourtant. Léonce Regnaud, Michel Chevalier, César Daly, Viollet-le-duc, déclarèrent à mainte reprise que le fer et la fonte pouvaient, seuls, commander de nouvelles formes. Hector Horeau, qui fut le plus audacieux architecte de notre temps, dressa de gigantesques plans de monuments sidérurgiques : rien n’y fit. Le mouvement s’annonçait bien, mais l’état disposant de toutes les commandes s’acharnait dans ses idées, soutenu par la vieille école, n’admettait qu’à de rares intervalles l’emploi combiné du fer et de la pierre, repoussait résolument le métal appliqué seul comme matière primordiale des édifices.
Peu à peu, cependant la fonte s’impose. Les travaux des ingénieurs aident à la divulguer; les constructions métallurgiques qu’ils effectuent secouent l’apathie routinière des architectes et du public, et les oeuvres architectoniques mixtes, c’est-à-dire celles où s’allient les deux éléments du moellon et du fer, s’élèvent à mesure, plus nombreuses.
Parmi ces oeuvres, on peut citer, mais seulement pour mémoire, la bibliothèque Sainte-Geneviève, édifiée par M. Labrouste. Cet artiste a, depuis, fait jouer un rôle plus grand au métal lorsqu’il a érigé la splendide salle de la bibliothèque nationale dont je parlerai plus loin. La ferronnerie artistique s’est affirmée dans son oeuvre avec une forme originale, impossible à trouver avec d’autres matières de construction. En 1854, le métal entra, pour la première fois, dans la structure des monuments voués au culte ; M. Boileau construisit Saint-Eugène. À cette époque et bien que les halles, bâties l’année précédente, eussent été une révélation complète du nouvel art, l’adoption du fer étiré et fondu comme élément principal d’une église stupéfia. Encore que le style fût comme toujours imposé à l’artiste et que son oeuvre ne pût être forcément qu’une oeuvre bâtarde, ce fut un nouvel appoint apporté aux théories des ferronniers. Une polémique s’engagea, mais le novateur eut gain de cause, et nous verrons plus tard, en 1860, l’état accepter la sidérurgie dans la construction de l’église Saint-Augustin et plus tard, dans un de ses palais, dans celui de l’école des beaux-arts, remanié à la fonte par M. Duban.
De leur côté, les grandes compagnies de chemin de fer contribuèrent, pour une large part, au mouvement. La gare d’Orléans, l’embarcadère du nord, bâti en 1863, par M. Hittorf, témoignent d’efforts nouveaux et je laisse de côté, dans cette nomenclature, le palais de l’industrie qui n’est qu’une réduction du palais de cristal de Londres, lequel n’était d’ailleurs qu’une amplification malheureuses des serres de notre Muséum. Cet essai malencontreux, avec ses affreuses toitures vitrées, ne saurait nous occuper au point de vue artistique, le seul dont il soit ici question.
Mais, après ces exemples encore limités de l’emploi du métal, nous voici non plus devant des oeuvres mixtes, mais devant des oeuvres entières.
Les halles, édifiées en 1853, ont été, comme je l’ai dit plus haut, un succès décisif pour la nouvelle école. Ici l’empire tâtonna encore, guidé par son architecte M. Baltard. Il voulut continuer les vieux errements et l’on dut démolir les fortins de pierre que cet architecte avait tout d’abord fait poser, en guise de halles. Ce fut sous la pression de l’opinion publique donnant raison aux projets de l’architecte Horeau(5) et de l’ingénieur Flachat, que M. Baltard, soudain converti, adora ce qu’il avait brûlé, fondit les projets proposés en un seul et, de concert avec son collègue M. Callet et avec le concours de Joly, maître de forges, éleva ce monument qui est une des gloires du Paris moderne.
Puis, c’est le marché aux bestiaux et l’abattoir de la Villette qui reprennent l’ossature ferronnière des halles que M. Janvier, sur les plans de M. Baltard, élargit encore. Ici, le métal atteint des proportions grandioses. D’énormes routes filent, rompues par de sveltes colonnes qui jaillissent du sol, supportant de légers plafonds, inondés de lumière et d’air. C’est l’énorme préau dans les flancs duquel s’engouffrent des milliers de bêtes, la vaste plaine dont le ciel couvert plane sur une activité fébrile de commerce, sur un incessant va-et-vient de bestiaux et d’hommes, c’est une série d’immenses pavillons dont la sombre couleur, l’aspect élancé et pourtant trapu, convient aux infatigables et sanglantes industries qui s’y exercent.
Ensuite, reconstruit sur les plans d’Ernest Legrand, voilà le marché du temple qui s’élève sur ses jets de fonte; un marché plus petit, plus coquet, plus chiffonné. Ici les allées s’amenuisent, les arcs s’élancent, moins hauts, la couleur devient moins sombre ; la coulée de vie qui le sillonne est moins lourde qu’à la Villette, moins brutale, plus tatillonne et plus caquetante. C’est un joyeux édifice, composé de six petits pavillons dont deux, réunis par une arcade, forment la façade flanquée de tourelles carrées et surmontées de clochetons; c’est une série de ruelles parant, avec leur ménagement de jour, la misère des défroques. Il y a presque un rire de volière dans ce leste bâtiment où le fer semble se gracieuser, pour s’assortir au pimpant tapage de couleur des rubans et des bijoux amoncelés, dans des boutiques, sous ses voûtes.
Ce sont maintenant les expositions universelles, enveloppant des mondes entiers dans leurs vaisseaux aériens et immenses, dans leurs gigantesques avenues montant à perte de vue au-dessus des machines en marche. Malgré ses dômes à verrières dont l’aspect affectait une forme de scaphandre, il y avait dans l’exposition de 1878, élevée par M. Hardy, une certaine ampleur d’allures, bien rare dans les oeuvres architectoniques de notre époque.
Enfin c’est le splendide intérieur de l’hippodrome bâti par les ingénieurs de Fives-Lille; là, dans une prodigieuse altitude de cathédrale, des colonnes de fonte fusent avec une hardiesse sans pareille. L’élancé de minces piliers de pierre si admirés dans certaines des vieilles basiliques semble timide et mastoc près du jet de ces légères tiges qui se dressent jusqu’aux arcs gigantesques de ce plafond tournant, reliés par d’extraordinaires lacis de fer, partant de tous les côtés, barrant, croisant, enchevêtrant leurs formidables poutres, inspirant un peu de ce sentiment d’admiration et de crainte que l’on ressent devant certaines machines à vapeur énormes.
Si l’extérieur de ce cirque était une originalité, d’une valeur artistique, égales à celles de l’intérieur, l’hippodrome serait certainement le chef-d’oeuvre de la nouvelle architecture.
À un autre point de vue, la salle métallique de lecture, contenue dans les bâtiments de pierre de la bibliothèque nationale, est une merveille d’agilité et de grâce; c’est une vaste salle surmontée de coupoles sphériques, percée de larges baies ; une salle posée comme sur des pédoncules effilés de fonte, une salle d’une incomparable distinction, rejetant l’uniforme gris-bleu dont est presque toujours affublé le métal, admettant sur les cintres soutenant ses lanternons les blancs et les ors, acceptant le concours décoratif des majoliques.
On pourrait presque dire qu’entre l’enceinte de l’hippodrome et l’enceinte de cette salle, il y a une différence analogue à celle qui existe entre ces oeuvres entières : le marché du temple et celui de la Villette, l’un élégant et souple, l’autre superbe et grandiose.
Dans tous ces monuments dont je viens de passer la revue, nul emprunt aux formules grecque, gothique ou renaissance ; c’est une forme originale neuve, inaccessible à la pierre, possible seulement avec les éléments métallurgiques de nos usines.
J’ai peur que M. Garnier ne se soit trompé lorsque, dans son volume À travers les arts, il a écrit des phrases de ce genre : « Le hangar, voilà la destination du métal...je le dis tout de suite, c’est une erreur et une grande erreur, le fer est un moyen et ne sera jamais un principe. Si de grands édifices, des salles, des gares, construits presque exclusivement en fer, ont un aspect différent des constructions en pierre (et cela surprend surtout par le caractère de la destination), ils ne constituent pas pour cela une architecture particulière. »
Mais qu’est-ce qui la constitue alors ? Est-ce donc la bâtardise des styles péniblement raccordés de l’opéra, ce dernier effort du romantisme, en architecture ? Est-ce ce bout-ci, bout-là du polychrome ? Est-ce cet assemblage de trente-trois espèces de granits et de marbres qui s’y coudoient et qui sont forcément destinés à s’altérer sous nos airs pluvieux ? Est-ce la forme du grand escalier qui ne lui appartient pas ? Est-ce donc enfin l’aspect de ces portes de cave, écrasées par le poids de cette bâtisse, massive et pompeuse, sans grandeur vraie ?
Rien de moins étonnant, du reste, que l’opinion de cet architecte, car le romantique forcené qui a décrit de la sorte le Paris qu’il rêve : « ...Des frises dorées courront le long des édifices; les monuments seront revêtus de marbres et d’émaux et les mosaïques feront aimer le mouvement de la couleur...les yeux auront exigé que nos costumes se modifient et se colorent, à leur tour, et la ville entière aura comme un reflet harmonieux de soie et d’or... » ne pouvait accepter la magnifique simplicité d’un art qui se préoccupe peu des bariolages et des dorures !
Non, l’art moderne ne peut admettre ce caractère rétrograde, ce retour à une beauté de colifichet prônée par M. Garnier. Le faste des costumes de Véronèse est loin et il ne reviendra jamais, car il n’a plus de raison d’être, dans un siècle affairé, bataillant pour la vie, comme le nôtre.
Un fait certain, c’est que la vieille architecture a donné tout ce qu’elle pouvait donner. Il est donc bien inutile de la surmener, de vouloir approprier des matériaux et des styles surannés aux besoins modernes. Il s’agit maintenant, comme l’a écrit M. Viollet-le-duc, de chercher les formes monumentales qui dérivent des propriétés du fer. Quelques-unes ont été déjà découvertes. Les efforts de l’école dite rationaliste se sont portés jusqu’à ce jour surtout sur les types des gares, des cirques et des halles; demain ils s’attaqueront aux types des théâtres, des mairies, des écoles, de tous les édifices de la vie publique, abandonnant ses serviles copies de dômes, de frontons, de flèches, délaissant les combinaisons à jamais appauvries de la pierre.
Comme la peinture qui, à la suite des impressionnistes, s’affranchit des désolants préceptes de l’école, comme la littérature qui, à la suite de Flaubert, de Goncourt et de Zola, se jette dans le mouvement du naturalisme, l’architecture est, elle aussi, sortie de l’ornière et, plus heureuse que la sculpture, elle a su créer avec des matières nouvelles un art nouveau.
Ainsi sont en partie déjà réalisées les prévisions de Claude Lantier dans le Ventre de Paris, montrant les halles et Saint-Eustache.
« C’est une curieuse rencontre, dit-il, que ce bout d’église encadré dans cette avenue de fonte ; ceci tuera cela, le fer tuera la pierre et les temps sont proches. Voyez, il y a là tout un manifeste ; c’est l’art moderne qui a grandi, en face de l’art ancien. Les halles sont une oeuvre crâne et qui n’est encore qu’une révélation timide du XXe siècle. »
Notes
1. « Grue » se dit en anglais « crane ».
2. Un autre artiste s’est récemment affirmé, en France, dans la peinture du fantastique : je veux parler de M. Odilon Redon. Ici, c’est le cauchemar transporté dans l’art. Mélez dans un milieu macarbre, de somnabulesques figures ayant une vague parenté avec celles de Gustave Moreau, tournées à l'effroi, et peut-être vous ferrez-vous une idée du bizarre talent de ce singulier artiste.
3. A signaler une bien bizarre rencontre ! — Une planche de Rowlandson ressemble, à s'y méprendre, comme composition, comme ordonnance du sujet, à un célèbre panneau de l'illustre M. Vibert, Le Repos du peintre, exposé en 1875. Cette planche porte ce titre : Le Repos après le bain. — Comforts of bath, publish 6 janvier 1798, by S.-B. Fores 50 Piccadilly, corner of Sackvill street. Rowlandson.
4. M. Crane ne s'est point confiné d'ailleurs dans l'illustration des albums et des livres. Il a, en outre, obtenu, comme peintre, de nombreux succès en Angleterre. Malheureusement ses oeuvres n'ont guère franchi le détroit et il ne nous a pas été possible de les étudier. Disons seulement qu'il a figuré parmi les préraphaélites, ce qui explique sa préoccupation de l'exactitude archéologique, son souci du détail juste.
5. La vie de Horeau a été celle de tous les gens qui ont voulu rompre avec la routine. Il en mort, méconnu, désespéré, sans avoir pu appliquer ses idées que d'autres se seront appropriées et ont mises en pratique.