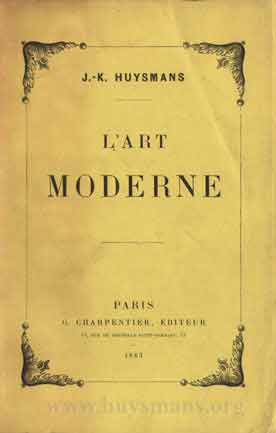L’EXPOSITION DES INDÉPENDANTS EN 1880
Depuis des milliers d’années, tous les gens qui se mêlent de peindre empruntent leurs procédés d’éclairage aux vieux maîtres.
Celui-ci éclaire une femme moderne, une parisienne, assise dans un salon de l’avenue de Messine avec le jour de Gérard Dow, sans comprendre que ce jour particulier aux pays du Nord, déterminé par le voisinage de l’océan et par les buées montant de l’eau qui baigne, comme à Amsterdam, à Utrecht et à Haarlem, le pied des maisons, tamisé en sus par des fenêtres spéciales à guillotine et à petits carreaux, est exact en Hollande, de même que certains ciels d’un bleu verdi de turquoise, floconnés de nuées rousses, mais qu’il est absolument ridicule à Paris, en l’an de grâce 1880, dans un salon donnant sur une rue dont le canal est un simple ruisseau, dans un salon troué de larges croisées, aux vitres blanches, sans bouillons ni mailles.
Celui-là imite les ténèbres des Espagnols et du Valentin. Cuisiniers, samaritains en détresse et portraits de paysans ou de dames, tous montrent des chairs de ce rouge qualifié rouge d’onglée par les Goncourt, marinant dans un bain de cirage délayé et d’encre. Quand Ribéra représentait des scènes dans de froides cellules, à peine transpercées par une flèche de lumière tombant d’un soupirail, le jour de cave qu’il adoptait pouvait être juste ; transporté dans le monde actuel, adapté aux moeurs contemporaines, il est absurde.
D’autres encore s’assimilent les procédés de l’école italienne, sans tenir compte, cela va sans dire, pas plus du reste que ceux qui imitent les Hollandais et les Espagnols, de l’altération des toiles, des fraîcheurs perdues, des nuances tournées, des modifications de couleurs infligées par le temps ; le reste, enfin, se contente des simples tricheries enseignées dans les classes des beaux-arts ; ils pratiquent, suivant les usages reçus, un petit jour commode, en manoeuvrant des rideaux sur des tringles, éclairant de la même façon les scènes d’intérieur, qu’elles se passent à un rez-de-chaussée, dans une cour, ou à un cinquième étage sur un boulevard, dans des pièces nues ou capitonnées d’étoffes, éclairées par une tabatière ou par un vitrail, les paysages, par n’importe quelle saison, qu’il soit midi ou cinq heures, que le ciel soit limpide ou couvert.
En résumé, chez les uns comme chez les autres, c’est la même absence d’observation, le même manque de scrupules, la même inconscience.
C’est au petit groupe des impressionnistes que revient l’honneur d’avoir balayé tous ces préjugés, culbuté toutes ces conventions. L’école nouvelle proclamait cette vérité scientifique : que la grande lumière décolore les tons, que la silhouette, que la couleur, par exemple, d’une maison ou d’un arbre, peints dans une chambre close, diffèrent absolument de la silhouette et de la couleur de la maison ou de l’arbre, peints sous le ciel même, dans le plein air. Cette vérité, qui ne pouvait frapper les gens habitués aux jours plus ou moins restreints des ateliers, devait forcément se manifester aux paysagistes qui, désertant les hautes baies, obscurcies par des serges, peignaient au dehors, simplement et sincèrement ! la nature qui les entourait.
Cette tentative de rendre le foisonnement des êtres et des choses dans la pulvérulence de la lumière ou de les détacher avec leurs tons crus, sans dégradations, sans demi-teintes, dans certains coups de soleil tombant droit, raccourcissant et supprimant presque les ombres, comme dans les images des Japonais, a-t-elle abouti, à l’époque où elle fut osée ? — Presque jamais, je dois le dire.
Partant d’un point de vue juste, observant avec ferveur, — contrairement aux us de Corot qu’on signale, je ne sais pourquoi, comme un précurseur, — l’aspect de la nature modifiée, suivant l’époque, suivant le climat, suivant l’heure de la journée, suivant l’ardeur plus ou moins violente du soleil ou les menaces plus ou moins accentuées des pluies, ils ont erré, hésité, voulant, comme Claude Monet, rendre les troubles de l’eau battue par les reflets mouvants des rives. Ç’a été, là où la nature avait une délicieuse finesse de fugitives nuances, une lourdeur écrasante, opaque. Ni le vitreux fluide de l’eau, jaspée par les taches changeantes du ciel, fouettée par les cimes réfléchies des feuillages, vrillée par la spirale du tronc d’arbre, paraissant tourner sur lui-même, en s’enfonçant ; ni, sur la terre ferme, le flottant de l’arbre dont les contours se brouillent, quand le soleil éclate derrière, n’ont été exprimés par l’un d’entre eux. Ces irisations, ces reflets, ces vapeurs, ces poudroiements, se changeaient, sur leurs toiles, en une boue de craie, hachée de bleu rude, de lilas criard, d’orange hargneux, de cruel rouge.
Il en a été de même des peintres d’intérieur et de genre. Observant que, dans un jardin, par exemple, l’été, la figure humaine, sous la lumière filtrant dans des feuilles vertes, se violace, et que, le soir surtout, aux flammes du gaz, les joues des femmes, qui usent de ce fard blanc connu sous le nom de blanc de perle, deviennent légèrement violettes, lorsque le sang y monte, ils ont badigeonné des visages avec des grumeaux de violet intense, appuyant pesamment là où la teinte était à l’état de soupçon, où la nuance perçait à peine.
Ajoutez maintenant à l’insuffisance du talent, à la maladroite brutalité du faire, la maladie rapidement amenée par la tension de l’oeil, par l’entêtement si humain de ramener à un certain ton aperçu et comme découvert, un beau jour, à un certain ton que l’oeil finit par revoir, sous la pression de la volonté, même quand il n’existe plus, par la perte de sang-froid venue dans la lutte et dans la constante âpreté des recherches, et vous aurez l’explication des touchantes folies qui s’étalèrent lors des premières expositions chez Nadar et chez Durand-Ruel. L’étude de ces oeuvres relevait surtout de la physiologie et de la médecine. Je ne veux pas citer ici des noms, il suffit de dire que l’oeil de la plupart d’entre eux s’était monomanisé; celui-ci voyait du bleu perruquier dans toute la nature et il faisait d’un fleuve un baquet à blanchisseuse ; celui-là voyait violet; terrains, ciels, eaux, chairs, tout avoisinait, dans son oeuvre, le lilas et l’aubergine, la plupart enfin pouvaient confirmer les expériences du Dr Charcot sur les altérations dans la perception des couleurs qu’il a notées chez beaucoup d’hystériques de la Salpêtrière et sur nombre de gens atteints de maladies du système nerveux. Leurs rétines étaient malades; les cas constatés par l’oculiste Galezowski et cités par M. Véron, dans son savant traité d’esthétique, sur l’atrophie de plusieurs fibres nerveuses de l’oeil, notamment sur la perte de la notion du vert qui est le prodrome de ce genre d’affection, étaient bien les leurs, à coup sûr, car le vert a presque disparu de leurs palettes, tandis que le bleu qui impressionne le plus largement, le plus vivement la rétine, qui persiste, en dernier lieu, dans ce désarroi de la vue, domine tout, noie tout, dans leurs toiles.
Le résultat de ces ophtalmies et de ces névroses ne s’est pas fait attendre. Les plus atteints, les plus faibles ont sombré; d’autres se sont peu à peu rétablis et n’ont plus eu que de rares rechutes ; mais si déplorable qu’ait été, au point de vue de l’art, le sort des incurables, il faut bien dire qu’ils ont déterminé le mouvement actuel. Dégagées de leurs applications maladives, leurs théories ont été reconnues justes par d’autres plus équilibrés, plus sains, plus savants, plus fermes.
Comme l’a excellemment fait remarquer Emile Zola, de sombre qu’elle était, la peinture est, grâce à eux, devenue claire. Lente est l’évolution, mais enfin, même dans ces panneaux sans valeur, dans tout ce rebut de faux moderne emmagasiné, à chaque mois de mai, dans les remises de l’état, la clarté perce déjà un peu. Aujourd’hui la difficulté de l’éclairage est résolue ou ramenée du moins aux seules proportions exactes qui soient possibles, enfin les ébauches jetées à la vanvole ont disparu, en grande partie, pour faire place à des oeuvres finies et pleines ; le système consistant à laisser une toile à peine commencée, sous prétexte que l’impression voulue y est, à se contenter ainsi de trop faciles rudiments, à esquiver de la sorte toutes les difficultés de la peinture, cette impuissance, pour écrire le mot, à élever sur ses pattes une oeuvre solide et complète, n’existe plus guère aujourd’hui, Mme Morizot exceptée, parmi les oeuvres exposées dans un appartement de la rue des Pyramides.
La première salle contient les Pissarro et les Caillebotte, deux artistes qui ont figuré aux premières exhibitions des révoltés de l’art.
Je laisserai de côté l’oeuvre de M. Pissarro, cernée par le violet de ses cadres entourant un papier jaune, de ce jaune des papiers à autographie, sur lequel sont piquées les pointes sèches et les eaux-fortes, et négligeant aussi certains panneaux où la manie du bleu s’affirme, je m’arrêterai devant une toile huchée sur un chevalet, un paysage d’été où le soleil pleut furieusement sur un champ de blé. C’est là le meilleur paysage que je connaisse de M. Pissarro. Il y a sur ce champ un poudroiement de soleil, un tremblement de nature chauffée à outrance, curieux. A signaler encore un autre tableau, un village plaquant le rouge de ses tuiles dans des feuillées d’arbres.
M. Pissarro possède un véritable tempérament d’artiste, cela est certain; le jour où elle se dégagera des langes qui la couvrent, sa peinture sera la véritable peinture du paysage moderne, vers laquelle marcheront les peintres de l’avenir, mais, malheureusement ces oeuvres si particulières sont des exceptions ; lui aussi a bariolé, sous prétexte d’impressions, d’obscures toiles; c’est un intermittent qui saute du pire au bon, comme Claude Monet qui expose maintenant avec les officiels, un paysagiste de talent parfois, un détraqué souvent, un homme qui se fourre le doigt dans l’oeil jusqu’au coude, ou bien qui brosse tranquillement une très belle oeuvre.
Ces hauts et ces bas sont, du reste, un des traits distinctifs des quelques paysagistes qui ont surnagé dans la débâcle de leurs confrères en impressionnisme. Pas de milieu ; folies ou audaces du vrai, selon l’état de leur vue qui ne passe jamais par l’état de la convalescence. Cette remarque peut s’adapter à M. Sisley, l’un des mieux doués et même au regretté Piette, qui était cependant le mieux portant, le moins éprouvé de tous.
L’indigomanie, qui a fait tant de ravages dans les rangs de ces peintres, semble avoir définitivement échoué sur un ancien élève de Bonnat, sur M. Caillebotte. Après en avoir été cruellement atteint, cet artiste s’est guéri et, sauf un ou deux retours, il semble être enfin parvenu à se débrouiller l’oeil qui est bien, à l’état normal, l’un des plus précis et des plus originaux que je connaisse.
Celui-là est un grand peintre, un peintre dont certains tableaux tiendront plus tard leur place à côté des meilleurs ; la série des oeuvres qu’il expose, cette année, le prouve. Il y a parmi elles un simple chef-d’oeuvre. Le sujet ? Oh mon Dieu ! Il est bien ordinaire. Une dame nous tourne le dos, debout à une fenêtre, et un monsieur, assis sur un crapaud, vu de profil, lit le journal auprès d’elle, — voilà tout; — mais ce qui est vraiment magnifique, c’est la franchise, c’est la vie de cette scène ! La femme qui regarde, désoeuvrée, la rue, palpite, bouge ; on voit ses reins remuer sous le merveilleux velours bleu sombre qui les couvre ; on va la toucher du doigt, elle va bâiller, se retourner, échanger un inutile propos avec son mari à peine distrait par la lecture d’un fait-divers. Cette qualité suprême de l’art, la vie, se dégage de cette toile avec une intensité vraiment incroyable; puis, j’ai parlé de la lumière, au commencement de cet article; c’est ici qu’il faut la voir, la lumière de Paris, dans un appartement situé sur la rue, la lumière amortie par les tentures des fenêtres, tamisée par la mousseline des petits rideaux. Au fond de la scène, par la croisée d’où s’épand le jour, l’oeil aperçoit la maison d’en face, les grandes lettres d’or que l’industrie fait ramper sur les balustres des balcons, sur l’appui des fenêtres, dans cette échappée sur la ville. L’air circule, il semble que le lourd roulement des voitures va monter avec le brouhaha des passants battant le pavé, en bas. C’est un coin de l’existence contemporaine, fixé tel quel. Le couple s’ennuie, comme cela arrive dans la vie, souvent ; une senteur de ménage dans une situation d’argent facile, s’échappe de cet intérieur. M. Caillebotte est le peintre de la bourgeoisie à l’aise, du commerce et de la finance, pourvoyant largement à leurs besoins, sans être pour cela très riches, habitant près de la rue Lafayette ou dans les environs du boulevard Haussmann.
Quant à l’exécution de cette toile, elle est simple, sobre, je dirai même presque classique. Ni taches trémoussantes, ni feux d’artifices, ni intentions seulement indiquées, ni indigences. Le tableau est achevé, témoignant d’un homme qui sait son métier sur le bout du doigt et qui tâche de n’en pas faire parade, de le cacher presque.
A rapprocher de cette oeuvre une autre qui exécute une nouvelle variation sur le même thème.
Au fond, par un bizarre et incompréhensible effet de perspective, un monsieur apparaît, microscopique, couché sur un divan, lisant un livre, la tête posée sur un coussin qui semble énorme; au premier plan, une femme vue de profil, lit un journal. Ici, l’ennui désoeuvré du premier intérieur que nous venons de voir n’est plus; ce couple n’a rien à se dire, mais il accepte, sans révolte, avec une douceur résignée, la situation qu’a faite la permanence du contact, l’habitude ; il tue le temps, placidement enfoncé dans une lecture qui l’intéresse; étant donné l’intelligence, au point de vue de l’art, du monde que représente M. Caillebotte, il y a même lieu de croire que la femme lit le Charivari ou l’Evénement et que le mari fait ses délices d’un Delpit quelconque. En tous cas, ils s’occupent, sans pose pour la galerie, sans cette attitude des gens dont on prépare le portrait. La main de la femme, à la chair potelée et souple, est une merveille, et je recommande aussi à tous les peintres qui n’ont jamais pu rendre le teint frelaté d’une Parisienne, le derme extraordinaire de celle-ci, un derme travaillé à la veloutine, mais sans fard. Et c’est encore là une très exacte observation. Il n’y a pas, dans ce ménage, le maquillage usité chez les actrices et chez les filles, mais le simple compromis de nombre de femmes de la bourgeoisie qui, sans se grimer comme elles, se nuent tout bonnement la peau de poudre au bismuth, teintée en rose pour les blondes, en nuance Rachel pour les brunes.
Il ne faudrait pas s’imaginer maintenant que, semblable à la grande majorité de ses confrères, M. Caillebotte s’éternise dans le même sujet ; nous allons le voir aborder de tous différents et les traiter avec la même bonne foi, la même souplesse.
Je rappellerai tout d’abord, pour mémoire, ses inoubliables racleurs de parquets, jadis exposés dans les galeries de Durand-Ruel, et, passant devant un petit panneau, Un enfant dans un jardin, où le péché du terrible bleu a été de nouveau commis, je ferai halte devant sa toile intitulée : Un Café.
Un monsieur, debout, nous regarde, appuyé au rebord d’une table où se dresse un bock d’une médiocre bière, qu’à sa trouble couleur et à sa petite mousse savonneuse nous reconnaissons immédiatement pour cet infâme pissat d’âne brassé, sous la rubrique de bière de Vienne, dans les caves de la route des Flandres. Derrière la table, une banquette en velours amarante, tournant au lie de vin par suite de l’usure opérée par le frottement continu des râbles; à droite, un joli coup de lumière tempéré par un store de coutil rayé de rose; au milieu de la toile, fichée au-dessus de la banquette, une grande glace au cadre d’or tiqueté par des points de mouches, réverbère les épaules du monsieur debout et répercute tout l’intérieur du café. Ici encore nulle précaution, nul arrangement. Les gens entrevus dans la glace, tripotant des dominos ou graissant des cartes, ne miment pas ces singeries d’attention si chères au piètre Meissonier; ce sont des gens attablés qui oublient l’embêtement des états qui les font vivre, ne roulent point de grandes pensées, et jouent tout bonnement pour se distraire des tristesses du célibat ou du ménage. La posture un peu renversée, l’oeil un peu plissé, la main un peu tremblante du joueur qui hésite, la tête penchée en avant, le geste haut et brusque de l’homme qui bat atout, tout cela est croqué, saisi, et ce pilier d’estaminet, avec son chapeau écrasé sur la nuque, ses mains plantées dans les poches, l’avons-nous assez vu dans toutes les brasseries, hélant les garçons par leurs prénoms, hâblant et blaguant sur les coups de jacquet et de billard, fumant et crachant, s’enfournant à crédit des chopes !
Deux portraits, un enfant dans un jardin, un paysage très juste de ton et une étonnante nature morte dans une salle à manger complètent l’exposition de ce peintre.
J’insisterai sur la nature morte ainsi conçue : des oranges, des pommes, dressées en pyramide, dans des compotiers, sur de la fausse mousse, des verres à tailles grossières, des carafes de vin, des bouteilles d’eau de Saint-Galmier, emplissent une table couverte d’une toile cirée qui reflète la couleur des objets posés sur elle et perd la sienne propre.
L’effet est encore bien observé; l’air emplit la pièce, les oranges, les bouteilles ne se détachent pas sur les glus sèches de gratins usités depuis des siècles. Ici, nul repoussoir, nul faux aloi, et l’éclat des fruits ne se concisant pas en des points lumineux distribués sans cause, ne s’exagère ni ne se diminue. Ici, comme dans ses autres oeuvres, la facture de M. Caillebotte est simple; sans tâtillonnage; c’est la formule moderne entrevue par Manet, appliquée et complétée par un peintre dont le métier est plus sûr et les reins plus forts.
En résumé, M. Caillebotte a rejeté le système des taches impressionnistes qui forcent l’oeil a cligner pour rétablir l’aplomb des êtres et des choses ; il s’est borné à suivre l’orthodoxe méthode des maîtres et il a modifié leur exécution, il l’a pliée aux exigences du modernisme, en quelque sorte rajeunie et faite sienne.
La même remarque peut s’appliquer à M. Raffaëlli. Celui-là n’a pas accepté non plus, sous prétexte d’impression, les pénuries du dessin et les vices de la couleur. Il est venu, apportant dans ces limbes de l’art où vagissaient les impuissants et les fous de l’oeil, une peinture correcte, terriblement savante sous son allure franche. Il est des rares indépendants que n’aient pas tout d’abord influencé le travers du bleu et la manie du lilas ; lui, au contraire, avait à se débarrasser des enténèbrements de l’école, des radotages ressassés par Gérôme, son ancien maître ; il est allé au plein jour et sa peinture, maintenant désassombrie, se clarifie, chaque année, davantage; après avoir sacrifié dans les resserres officielles où il était généralement relégué sous les diaphanes torchons des combles ou sur le haut des portes, comme en 1877, lorsqu’il apportait une grande toile, âpre et brusque, mais déjà très personnelle, une famille de paysans de Plougasnou, il a eu le courage de rompre avec tous les préjugés, de fuir les affligeantes assises de la bourgeoisie de l’art, de lâcher, en un mot, le salon pour aller se joindre aux réprouvés et aux parias.
M. Raffaëlli est un des plus puissants des paysagistes que nous possédions aujourd’hui ; la preuve en est cette admirable Vue de Gennevilliers qu’il expose.
Imaginez un de ces temps sombres où les nuées galopent et se bousculent dans le gris des profondeurs immenses. La terre s’étend, blême, sous le jour blafard; au loin, des peupliers étêtés se courbent sous le fouet de la bise et semblent cingler les nuages gonflés de pluie qui roulent au-dessus d’une maisonnette, tristement assise dans la morne plaine. A droite, des tuyaux d’usines vomissent des bouillons de fumée noire qui se déchirent et s’écartent, toutes, du même côté, ensemble.
Enfin l’artiste est donc venu, qui aura rendu la mélancolique grandeur des sites anémiques couchés sous l’infini des ciels; voici donc enfin exprimée cette note poignante du spleen des paysages, des plaintives délices de nos banlieues ! — nous sommes loin, comme vous voyez, des gaies opérettes des Vaux De Cernay, des repaires dramatiques de Fontainebleau, ce mélo de la nature accommodé par les Dennery de la palette, à toutes les sauces — Ah ! mais voilà, c’est que cette forêt-là, c’est de la grande nature, c’est de la nature réputée distinguée par les beaux-arts. Au fond, nous en sommes aujourd’hui encore au paysage composé; on y met un peu moins de nymphes et un peu moins de ruines, mais on la trie, on le pomponne, on l’édulcore, on l’assaisonne suivant une recette convenue, comme un plat de fèves. Il faut un site qui offre un premier plan, il faut des arbres d’une certaine forme, des firmaments prévus, de parcimonieux et modérés soleils, toute une rengaîne sans laquelle les plus adroits des manouvriers se déclarent incapables de peindre.
Tout cela est risible, car enfin il n’y a pas plus de grande qu’il n’y a de moyenne et de petite nature. Il existe une nature aussi intéressante à décrire quand elle se dénude et pèle que lorsqu’elle exubère et rutile, au plein soleil. Il n’y a pas de sites plus nobles les uns que les autres ; il n’y a pas de campagnes à mépriser, pas de fleurs à ne point cueillir, qu’elles soient écloses aux chaleurs factices des serres et alléchantes comme des lèvres fardées, ou qu’elles aient percé à grand’peine la croûte des gravats et s’épanouissent, chlorotiques, dans les jardins sans air de la capitale. Nous sommes gavés de sites redondants, de natures ventrues ; il serait peut-être bon de varier un peu, et cela me surprend que des peintres de talent n’aient pas tenté d’élargir, en entrant dans cette voie, la formule qu’ils ont acquise ; il y a là toute une mine à exploiter; les deux pôles contraires du paysage parisien, le square maquillé du Parc Monceau et les terrains vagues de Montmartre et des Gobelins sont délicieux, chacun dans son genre; les peindre eût été, à coup sûr, aussi intéressant que de beurrer des allées de chênes et de cabosser des rocs d’aquarium et des grès de feutre !
M. Raffaëlli, qui se soucie heureusement peu de la nature distinguée et noble, a compris quel personnel accent il pourrait donner avec les environs roturiers de Paris et, en sus de sa plaine de Gennevilliers, il a également commis une superbe vue de la route de la Révolte, par un temps de neige.
Un ciel immobile, d’un gris uniforme, un de ces ciels chargés de neiges qui semblent s’abaisser et peser lourdement sur nous, s’étend au-dessus de la route. Partout des tas de neige, blanche par places, par d’autres noire, tassée sous le poids des voitures, sous les pieds des chevaux. Des squelettes d’arbres, dans leur cercle de tuteurs peints en vert, se dressent, lignant le bord de la route dont la chaussée a disparu sous la couche accumulée des boues et des glaces : un charretier crie : hue ! en tirant sur sa bête, et essaye de faire démarrer le tombereau dont les roues patinent; devant nous, trois chevaux dételés baissent la tête, attendent, impassibles, sous le vent qui les mord, un chien aboie et saute, un homme, les mains dans ses poches grelotte, et au loin, à l’horizon, là-bas, la fumée d’un invisible chemin de fer monte, toute claire, dans le ciel sourd.
Toutes les horreurs de l’hiver sont là. Jamais l’impression du grand froid qui vous pénètre jusqu’aux moelles, jamais cette inquiétude et cette sorte de malaise qui saisissent la machine humaine, par ces temps où, comme l’on dit, la neige est dans l’air, n’ont été exprimées avec une telle intensité, une telle ampleur.
Puis, quelle observation, quelle fidélité dans cette lumière triste et livide, coulant d’un ciel de plomb, s’animant sur la blancheur de la neige, accentuant le ton des chevaux, des arbres, des hommes, les forçant jusques au noir !
Je ne connais pas de paysage plus juste que celui-ci, de même que je n’en connais pas non plus de plus douloureux, de plus lamentable, de plus grandiose que cette vue de Gennevilliers dont j’ai parlé plus haut.
Dans son exposition qui ne comprend pas moins d’une quarantaine de dessins, de panneaux, de toiles, M. Raffaëlli a montré son originale individualité sous toutes ses faces. Ici, dans d’adorables et funèbres paysages, passe toute la détresse des pauvres hères, tout l’éreintement des chiffonniers fourbus qui picotent l’ordure ou charrient des sacs; là, dans la mélancolie coutumière du peintre, jaillit soudain un éclat perlé de rire, une bouffée de nature joyeuse, des poules caquetant près d’un âne, en un bain de soleil, une oeuvre claire, lumineuse et charmante, avec sa vue d’Asnières et ses petits arbres grêles si particuliers aux terrains des villes; puis, partout ce sont des types de cantonniers, de commissionnaires, de balayeurs, un ou deux tenant peut-être trop du Jean Valjean, tous les autres surprenants de vérité et de vie. Je l’ai déjà énoncé, M. Raffaëlli est le peintre des pauvres gens et des grands ciels; et j’ajouterai, pour qu’on ne l’accuse pas de ne s’éprendre que des loqueteux, qu’il expose encore une tête ravissante de petite fille qui se joue, toute rose, sur une gamme de gris d’ablette et de jaune soufre, un portrait de vieille femme, un pastel d’un terrible caractère et un dessin à la plume : Maire et conseiller municipal, un souvenir de la méthode d’Albert Durer, interprétée par un dessinateur anglais du Graphic, avec, dans tout cela, l’énergie et le décidé qui appartiennent en propre à cet artiste.
En 1879, à l’exhibition de la rue Lepeletier, j’avais été frappé par l’apparition d’un nouveau peintre, M. Zandomeneghi. Sous l’intitulé un peu fade de Violette d’hiver, il exposait un très joli portrait de femme; cette année, il nous montre quelques toiles, dont une, appelée Mère et fille, représente une vieille maman, une bonne tête de femme de ménage qui coiffe madame sa fille, assise devant la fenêtre, en peignoir, et se regardant, avec un mouvement de femme bien observé, dans un miroir. Il faut voir les attentives précautions de la mère dont les gros doigts, à la peau dindonneuse et grenue, déformés par le travail, osent à peine tenir les boules d’or du peigne, et le joli sourire de la petite Parisienne, levant son bras orné d’un bracelet de corail ou plutôt d’un serpent de celluloïd rose ! C’est piqué sur place, exécuté sans ces grimaces si chères aux barbouilleurs ordinaires du genre, et c’est peint dans une tonalité un peu lilacée, sans minuties et sans négligences. Un portrait d’homme, le chapeau sur la tête, appuyé contre la tablette d’une cheminée, dans une chambre pleine de cages d’oiseaux, est intéressant aussi par la sincérité qu’il dégage. C’est une précieuse recrue que les indépendants ont faite avec le consciencieux artiste qu’est M. Zandomeneghi.
Un autre curieux peintre de certains coins de la vie contemporaine, c’est M. Forain. Pas un pour saisir comme lui le pourtour des Folies-bergère, pour en traduire toute l’attirante pourriture, toute l’élégance libertine.
L’an dernier, en sus de ses vues des Folies, il exposait des coulisses avec des danseuses, au petit bec retroussé, d’affolantes et célestes arsouilles, causant avec de gros messieurs paternels et obscènes, les Crevel de notre époque, et de jeunes pantins gourmés dans leurs cols droits et leurs habits noirs; tous s’agitant, vivant, exhalant l’odeur de l’atmosphère qui les entoure.
Mais la plus surprenante peut-être de ces aquarelles, c’était celle représentant un cabinet particulier de restaurant, vu au moment où le monsieur et la dame s’apprêtent à partir.
Dans la rouge cabine, meublée d’un divan fatigué, d’une cheminée embellie par une pendule ne marchant pas, le monsieur tend les bras au garçon qui, l’oeil un peu narquois dans l’indifférence affectée de sa face, se hausse derrière lui, et lui passe les manches de son paletot, pendant que la femme se pose son chapeau devant la glace, égratignée de paraphes et rayée de noms.
A droite, tout un coin de table, l’addition dans une assiette, la boîte à cigares, des petits verres, des dos de chaises coupés par le cadre; par terre, les pieds vernis du garçon, luisant dans l’ombre.
C’est, prise sur le fait, la tristesse des cabinets particuliers, alors que la femme, les bras levés, un bout de museau sortant entre les deux coudes, se trifouille attentivement la tête, sans plus s’occuper du monsieur qui, après avoir soldé la dépense du refuge et des sauces, regarde, devant lui, abêti par les propos du tête-à-tête, par la chaleur, par le travail interrompu de la digestion, harassé par le larbin qui lui secoue et les bras et le dos.
Comme elle sent, à plein nez, l’extrait concentré de boulevard, cette aquarelle dont la couleur s’anime et s’injecte de lumière, le soir ! Dans le jour, les étoffes et les papiers des banales pièces où l’on vit la nuit, ont le ton des choses fanées par l’ivresse ou par le sans-gêne. Un regain de luxe se lève avec le gaz. Eh bien ! Dans cette aquarelle comme dans une autre, dont je parlerai plus loin, M. Forain a résolu ce problème de suivre la vérité pas à pas, d’ordonner son oeuvre de telle sorte qu’elle soit d’une exactitude d’éclairage égale, qu’on l’examine aux lueurs des bougies ou aux lueurs du jour. Encore qu’il se soit souvent complu à donner l’impression des salons du monde et qu’il ait aussitôt saisi la grâce des toilettes, le vide des sourires jabotants des femmes, l’empressement de quelques-uns des hommes, la timidité ou l’ennui de la plupart, M. Forain est encore plus spontané, plus original, quand il s’attaque à la fille.
Elle a trouvé en lui son véritable peintre, car nul ne l’a plus profondément observée, nul n’a plus scrupuleusement fixé son rire impudent, ses yeux provocants et son air rosse; nul n’a mieux compris les plaisants caprices de ses modes, les seins énormes, jetés en avant, les bras grêles comme des allumettes, la taille amenuisée, le buste craquant sous l’effort de l’armure comprimant et diminuant la chair, d’un côté, pour la distendre et l’augmenter, d’un autre.
Et, riches et lancées, ou besogneuses et pauvres, cocottes à traînes ou vadrouilles en cheveux, il les a enlevées avec la même dextérité, avec la même audace; il y a de lui de suspects salons, dont un surtout vous conquiert et vous fascine.
Dans une pièce tendue de rouge pourpre, un monsieur est assis sur un divan, le menton appuyé sur la pomme de son parapluie. Devant lui, debout, entr’ouvrant leurs peignoirs pour montrer leurs ventres, des femmes cherchent à le décider; une grosse brune, aux chairs tapotées et blettes, résignée aux insuccès, une grande aux cheveux noirs, la belle Juive, qui regarde, indifférente, sans faire l’article, une blonde aux jambes cagneuses filant dans des bas vert pomme balafrés de rouge, une roulure décrassée de barrière, qui rigole, et à défaut d’une brève expédition, s’apprête à solliciter du champagne. Efforts vains, peines perdues ! — le monsieur ne montera pas et il ne payera pas davantage à boire. S’il n’est point capable de frapper une polka sur le piano, on va poliment l’inviter à prendre Madeleine, c’est-à-dire la porte.
Ce qui est prodigieux dans cette oeuvre, c’est la puissance de réalité qui s’en dégage; ces filles sont des filles de maison et pas d’autres filles, et si leurs postures, leur irritante odeur, leur faisandé de peau, sous les flambes du gaz qui éclaire cette aquarelle lavée de gouache, avec une précision de vérité vraiment étrange, sont, pour la première fois sans doute, aussi fermement, aussi carrément rendus, leur caractère, leur humanité bestiale ou puérile ne l’est pas moins. Toute la philosophie de l’amour tarifié est dans cette scène où, après être volontairement entré, poussé par un désir de bête, le monsieur réfléchit et, devenu plus froid, finit par demeurer insensible aux offres.
Dans un ordre différent d’idées, un cahier d’aquarelles, illustrant un poème de Verlaine, est singulier et sinistre.
Cela s’appelle la Promenade du voyou à la campagne. Un homme trapu, court, à longue blouse, les rouflaquettes cornant sous le trois-ponts, se promène avec sa dame, une grande pierreuse, aux seins ballottants, au ventre en avant faisant remonter la robe, dans une campagne qui n’est autre qu’un chemin de ronde perpétuellement borné par l’horizon des remparts.
C’est une traduction ramenant à la réalité la fantaisie de l’écrivain qui prête à un marloupier cette strophe :
Paris j’crache pas d’ssus, c’est rien chouette,
Et comme j’ai une âme de poète,
Tous les dimanches je quitte ma boète
Et j’m’en vas, avec ma compagne,
A la campagne.
Le canaille trop fabriqué de M. Verlaine a été esquivé par M. Forain, qui a grandi la scène et en a fait une funèbre idylle. Un petit frisson vous court lorsqu’on examine l’épouvantable dégaine de ces deux êtres.
Elève de Gérôme qui ne lui a pas appris grand’chose, M. Forain a étudié son art auprès de Manet et de Degas, ce qui ne veut nullement dire qu’il les décalque ou les copie ; car il a un tempérament très particulier, une vision très spéciale. Dans ses bons jours, quand il veut bien ne pas se contenter trop aisément et que son dessin ne se penche pas un peu vers la charge, M. Forain est l’un des peintres de la vie moderne les plus incisifs que je connaisse.
Il ne me reste plus maintenant, avant d’arriver à l’oeuvre de M. Degas que j’ai gardée pour la fin, qu’à dire quelques mots des deux peintresses du groupe, Mlle Cassatt et Mme Berthe Morizot.
Elève de Degas, — je le vois dans ce charmant tableau où une femme rousse, vêtue de jaune, reflète son dos dans une glace sur le fond pourpre d’une loge. — Mlle Cassatt est élève évidemment aussi des peintres anglais, car son excellente toile, deux dames qui prennent le thé, dans un intérieur, me fait songer à certaines des oeuvres exposées, en 1878, dans la section anglaise.
Ici, c’est la bourgeoisie encore, mais ce n’est déjà plus celle de M. Caillebotte, c’est un monde à l’aise aussi, mais plus affiné, plus élégant. En dépit de sa personnalité qui ne s’est pas complètement dégagée encore, Mlle Cassatt a cependant une curiosité, un attrait spécial, car un fouetté de nerfs féminins passe dans sa peinture plus équilibrée, plus paisible, plus savante, que celle de Mme Morizot, une élève de M. Manet.
Laissées à l’état d’esquisses, les oeuvres exhibées par cette artiste sont un pimpant brouillis de blanc et de rose. C’est du Chaplin manétisé, avec en plus une turbulence de nerfs agités et tendus. Les femmes que Mme Morizot nous montre en toilette fleurent le new mown hay et la frangipane; le bas de soie se devine sous ses robes bâties par des couturiers en renom. Une élégance mondaine s’échappe, capiteuse, de ces ébauches morbides, de ces surprenantes improvisations que l’épithète d’hystérisées qualifierait justement, peut-être.
Je passe maintenant devant la molle et blanchâtre peinture de Mme Bracquemond, devant le portrait d’Edmond de Goncourt, exécuté par M. Bracquemond, un portrait traité à la Holbein, mais d’une dureté excessive dans les chairs surtout dont les pores sont des grains de marbre, un portrait intéressant toutefois par la saisie de l’artiste dans son intérieur, au milieu de ses collections d’oeuvres précieuses; et, négligeant une série d’eaux-fortes sur chine destinées à orner un service de table, curieuses, il est vrai, mais presque absolument tirées des albums d’Okou-saï, je fais halte enfin dans la salle où rayonnent les Degas.
Je ne me rappelle pas avoir éprouvé une commotion pareille à celle que je ressentis, en 1876, la première fois que je me fus mis en face des oeuvres de ce maître. Pour moi qui n’avais jamais été attiré que vers les tableaux de l’école hollandaise où je trouvais la satisfaction de mes besoins de réalité et de vie intime, ce fut une véritable possession. Le moderne que je cherchais en vain dans les expositions de l’époque et qui ne perçait, çà et là, que par bribes, m’apparaissait tout d’un coup, entier. Dans une feuille de chou, cultivée par M. Bachelin-Deflorenne, la Gazette des Amateurs, où je débutais alors, j’écrivis ces lignes :
« M. Degas expose deux toiles représentant des danseuses de l’opéra : trois femmes en jupes de tulle jaune se tiennent enlacées; au fond, le décor se soulève et laisse entrevoir les maillots roses du corps de ballet; ces trois femmes sont campées sur les hanches et sur leurs pointes avec une prodigieuse vérité. »
« Point de charnures crémeuses et factices, mais de vraies chairs un peu défraîchies par la couche des pâtes et des poudres. C’est d’une réalité absolue et c’est vraiment beau. Je recommande également, dans le tableau qui surmonte celui-ci, le torse de la femme penchée en avant et deux dessins sur papier rose, où une ballerine vue de dos et une autre qui rattache son soulier, sont enlevées avec une souplesse et une vigueur peu communes. »
La joie que j’éprouvai, tout gamin, s’est depuis accrue à chacune des expositions où figurèrent les Degas.
Un peintre de la vie moderne était né, et un peintre qui ne dérivait de personne, qui ne ressemblait à aucun, qui apportait une saveur d’art toute nouvelle, des procédés d’exécution tout nouveaux. Blanchisseuses dans leurs boutiques, danseuses aux répétitions, chanteuses de café-concert, salles de théâtre, chevaux de course, portraits, marchands de coton en Amérique, femmes sortant du bain, effets de boudoirs et de loges, tous ces sujets si divers ont été traités par cet artiste qui est réputé cependant n’avoir jamais peint que des danseuses !
Cette année, les ballets dominent pourtant, et cet homme d’un tempérament si fin, d’un nervosisme si vibrant, dont l’oeil est si curieusement hanté et rempli par la figure humaine en mouvement dans la lumière factice du gaz ou dans le jour blafard des pièces éclairées par la triste lueur des cours, s’est surpassé, s’il est possible.
Voyez cet examen de danse, une danseuse pliée qui renoue un cordon et une autre, la tête sur l’estomac, qui bombe sous une crinière rousse un nez busqué. Près d’elles, une camarade en tenue de ville, au type populacier, aux joues criblées de son, à la tignasse refoulée sous un caloquet hérissé de plumes rouges, et une mère quelconque, en bonnet, en châle à ramages, une trogne de vieille concierge, causent pendant les intermèdes. Quelle vérité ! Quelle vie ! Comme toutes ces figures sont dans l’air, comme la lumière baigne justement la scène, comme l’expression de ces physionomies, l’ennui d’un travail mécanique pénible, le regard scrutant de la mère dont les espoirs s’aiguisent quand le corps de sa fille se décarcasse, l’indifférence des camarades pour des lassitudes qu’elles connaissent, sont accusés, notés avec une perspicacité d’analyste tout à la fois cruel et subtil.
Un autre de ses tableaux est lugubre. Dans l’immense pièce où l’on s’exerce, une femme gît, la mâchoire dans ses poings, une statue de l’embêtement et de la fatigue, pendant qu’une camarade, les jupes de derrière bouffant sur le dossier de la chaise où elle est assise, regarde, abêtie, les groupes qui s’ébattent, au son d’un violon maigre.
Mais les voici maintenant qui reprennent leurs dislocations de clowns. Le repos est fini, la musique regrince, la torture des membres recommence et, dans ces tableaux où les personnages sont souvent coupés par le cadre, comme dans certaines images japonaises, les exercices s’accélèrent, les jambes se dressent en cadence, les mains se cramponnent aux barres qui courent le long de la salle, tandis que la pointe des souliers bat frénétiquement le plancher et que les lèvres sourient, automatiques. L’illusion devient si complète, quand l’oeil se fixe sur ces sauteuses, que toutes s’animent et pantellent, que les cris de la maîtresse semblent s’entendre, perçant l’aigre vacarme de la pochette : « Avancez les talons, rentrez les hanches, soutenez les poignets, cassez-vous », alors qu’à ce dernier commandement, le grand développé s’opère, que le pied surélevé, emportant le bouillon des jupes, s’appuie, crispé, sur la plus haute barre.
Puis, la métamorphose s’est accomplie. Les girafes qui ne pouvaient se rompre, les éléphantes dont les charnières refusaient de plier, sont maintenant assouplies et brisées. Le temps d’apprentissage est terminé et les voilà qui paraissent, en public, sur la scène, qui pirouettent, voltigent, avancent et reculent sur les pointes, dans des coups de gaz, dans des jets de lumière électrique, et ici encore, M. Degas, en attendant qu’elles deviennent ouvreuses, chiromanciennes ou marcheuses, les pique, toutes vives, devant la rampe, les attrape à la volée pendant qu’elles bondissent ou font la révérence des deux côtés, envoyant avec les mains des baisers au public.
L’observation est tellement précise que, dans ces séries de filles, un physiologiste pourrait faire une curieuse étude de l’organisme de chacune d’elles. Ici, l’hommasse qui se dégrossit et dont les couleurs tombent sous le misérable régime du fromage d’Italie et du litre à douze ; là les anémies originelles, les déplorables lymphes des filles couchées dans les soupentes, éreintées par les exercices du métier, épuisées par de précoces pratiques, avant l’âge; là encore les filles nerveuses, sèches, dont les muscles saillent sous le maillot, de vraies biquettes construites pour sauter, de vraies danseuses, aux ressorts d’acier, aux jarrets de fer.
Et combien sont charmantes, parmi elles, charmantes d’une beauté spéciale, faite de salauderie populacière et de grâce ! Combien sont ravissantes, presque divines, parmi ces petits souillons qui repassent ou portent du linge, parmi ces chanteuses qui bâillent, en gants noirs, parmi ces saltimbanques qui s’élèvent dans le ciel d’un cirque !
Puis, quelle étude des effets de la lumière ! — je signale à ce point de vue, une loge, au pastel, une loge vide touchant à la scène, avec le rouge cerise d’un écran à moitié levé et le fond purpurin plus sombre du papier de tenture ; un profil de femme se penche, au balcon, au-dessus, regardant les cabots qui jappent; le ton des joues chauffées par la chaleur de la salle, du sang monté aux pommettes, dont l’incarnat, ardent aux oreilles encore, s’atténue aux tempes, est d’une singulière exactitude dans le coup de lumière qui les frappe.
L’exposition de M. Degas comprend, cette année, une dizaine de pièces; j’en ai cité déjà plusieurs, je désignerai encore deux superbes dessins, dont une tête de femme qui serait absolument digne de figurer près des dessins de l’école française, au Louvre, et je vais m’arrêter, pendant quelques minutes, devant le portrait du regretté Duranty.
Il va sans dire que M. Degas a évité les fonds imbéciles chers aux peintres, les rideaux écarlates, vert olive, bleu aimable, ou les taches lie de vin, vert brun et gris de cendre, qui sont de monstrueux accrocs à la vérité, car enfin il faudrait pourtant peindre la personne qu’on portraiture chez elle, dans la rue, dans un cadre réel, partout, excepté au milieu d’une couche polie de couleurs vides.
M. Duranty est là, au milieu de ses estampes et de ses livres, assis devant sa table, et ses doigts effilés et nerveux, son oeil acéré et railleur, sa mine fouilleuse et aiguë, son pincé de comique anglais, son petit rire sec dans le tuyau de sa pipe, repassent devant moi à la vue de cette toile où le caractère de ce curieux analyste est si bien rendu.
Il est difficile avec une plume de donner même une très vague idée de la peinture de M. Degas; elle ne peut avoir son équivalent qu’en littérature; si une comparaison entre ces deux arts était possible, je dirais que l’exécution de M. Degas me rappelle, à bien des points de vue, l’exécution littéraire des frères de Goncourt.
Ils auront été, les uns et les autres, les artistes les plus raffinés et les plus exquis du siècle.
De même que pour rendre visible, presque palpable, l’extérieur de la bête humaine, dans le milieu où elle s’agite, pour démonter le mécanisme de ses passions, expliquer les marches et les relais de ses pensées, l’aberration de ses dévouements, la naturelle éclosion de ses vices, pour exprimer la plus fugitive de ses sensations, Jules et Edmond de Goncourt ont dû forger un incisif et puissant outil, créer une palette neuve des tons, un vocabulaire original, une nouvelle langue; de même, pour exprimer la vision des êtres et des choses dans l’atmosphère qui leur est propre, pour montrer les mouvements, les postures, les gestes, les jeux de la physionomie, les différents aspects des traits et des toilettes selon les affaiblissements ou les exaltations des lumières, pour traduire des effets incompris ou jugés impossibles à peindre jusqu’alors, M. Degas a dû se fabriquer un instrument tout à la fois ténu et large, flexible et ferme.
Lui aussi a dû emprunter à tous les vocabulaires de la peinture, combiner les divers éléments de l’essence et de l’huile, de l’aquarelle et du pastel, de la détrempe et de la gouache, forger des néologismes de couleurs, briser l’ordonnance acceptée des sujets.
Peinture audacieuse et singulière s’attaquant à l’impondérable, au souffle qui soulève la gaze sur les maillots, au vent qui monte des entrechats et feuillette les tulles superposés des jupes, peinture savante et simple pourtant, s’attachant aux poses les plus compliquées et les plus hardies du corps, aux travaux et aux détentes des muscles, aux effets les plus imprévus de la perspective, osant, pour donner l’exacte sensation de l’oeil qui suit miss Lola, grimpant à la force des dents jusqu’aux combles de la salle Fernando, faire pencher tout d’un côté le plafond du cirque !
Puis quelle définitive désertion de tous les procédés de relief et d’ombre, de toutes les vieilles impostures de tons cherchés sur la palette, de tous les escamotages enseignés depuis des siècles ! Quelle nouvelle application depuis Delacroix du mélange optique, c’est-à-dire du ton absent de la palette, et obtenu sur la toile par le rapprochement des deux autres.
Ici, dans le portrait de Duranty, des plaques de rose presque vif sur le front, du vert dans la barbe, du bleu sur le velours du collet d’habit ; les doigts sont faits avec du jaune bordé de violet d’évêque. De près, c’est un sabrage, une hachure de couleurs qui se martèlent, se brisent, semblent s’empiéter ; à quelques pas, tout cela s’harmonise et se fond en ton précis de chair, de chair qui palpite, qui vit, comme personne, en France, maintenant ne sait plus en faire.
Il en est de même pour ses danseuses. Celle dont j’ai parlé plus haut, la rousse qui penche sur sa gorge un bec d’aigle, a le cou ombré par du vert et les tournants du mollet cernés par du violet; de près, le maillot est un écrasis de crayon rose; à distance, c’est du coton tendu sur une jambe qui muscle.
Aucun peintre, depuis Delacroix qu’il a étudié longuement et qui est son véritable maître, n’a compris, comme M. Degas, le mariage et l’adultère des couleurs ; aucun actuellement n’a un dessin aussi précis, et aussi large, une fleur de coloris aussi délicate; aucun n’a, dans un art différent l’exquisité que les Goncourt mettent dans leur prose; aucun n’a ainsi fixé, dans un style délibéré et personnel, la plus éphémère des sensations, la plus fugace des finesses et des nuances.
Une question peut se poser maintenant. Quand la haute place que ce peintre devrait occuper dans l’art contemporain sera-t-elle reconnue ? Quand comprendra-t-on que cet artiste est le plus grand que nous possédions aujourd’hui en France ? Je ne suis pas prophète, mais si j’en juge par l’ineptie des classes éclairées qui, après avoir longtemps honni Delacroix, ne se doutent pas encore que Baudelaire est le poète de génie du XIXe siècle, qu’il domine de cent pieds tous les autres, y compris Hugo, et que le chef-d’oeuvre du roman moderne est l’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert, — et pourtant la littérature est soi-disant l’art le plus accessible aux masses ! — je puis croire que cette vérité que je suis le seul à écrire aujourd’hui sur M. Degas ne sera probablement reconnue telle que dans une période illimitée d’années.
On peut dire cependant qu’un changement s’est produit dans l’attitude du public qui se tordait jadis aux expositions des intransigeants, sans tenir compte des efforts ratés, des ravages du daltonisme et des autres affections de l’oeil, sans s’apercevoir que les cas pathologiques ne sont pas risibles, mais simplement intéressants à étudier. Maintenant il parcourt paisiblement les salles, s’effarant et s’irritant encore devant des oeuvres dont la nouveauté le déroute, ne soupçonnant même pas l’insondable abîme qui sépare le moderne tel que le conçoivent M. Degas et M. Caillebotte et celui que fabriquent MM. Bastien-Lepage et Henri Gervex, mais en somme, malgré son originelle bêtise, il s’arrête, regarde, étonné et poigné quand même un peu par la sincérité que ces oeuvres dégagent.
On peut même ajouter aujourd’hui que le rire des visiteurs irait de préférence à certaines toiles égarées dans cette exposition, à de médiocres toiles ni impressionnistes, ni modernes ; et je souhaite, à ce propos, que le groupe se dépure et balaye au plus vite ces fruits secs échappés, on ne sait pourquoi, des salons officiels.
Il faut bien espérer aussi qu’en même temps que s’effectuera l’éloignement des non-valeurs, de nouveaux talents surgiront et viendront se joindre au groupe. Toute la vie moderne est à étudier encore; c’est à peine si quelques-unes de ses multiples faces ont été aperçues et notées. Tout est à faire : les galas officiels, les salons, les bals, les coins de la vie familière, de la vie artisane et bourgeoise, les magasins, les marchés, les restaurants, les cafés, les zincs, enfin, toute l’humanité, à quelque classe de la société qu’elle appartienne et quelque fonction qu’elle remplisse, chez elle, dans les hospices, dans les bastringues, au théâtre, dans les squares, dans les rues pauvres ou dans ces vastes boulevards dont les américaines allures sont le cadre nécessaire aux besoins de notre époque.
Puis, si quelques-uns des peintres qui nous occupent ont, çà et là, reproduit plusieurs des épisodes de l’existence contemporaine, quel artiste rendra maintenant l’imposante grandeur des villes usinières, suivra la voie ouverte par l’Allemand Menzel, en entrant dans les immenses forges, dans les halls de chemin de fer que M. Claude Monet a déjà tenté, il est vrai, de peindre, mais sans parvenir à dégager de ses incertaines abréviations la colossale ampleur des locomotives et des gares ; quel paysagiste rendra la terrifiante et grandiose solennité des hauts fourneaux flambant dans la nuit, des gigantesques cheminées, couronnées à leur sommet de feux pâles ?
Tout le travail de l’homme tâchant dans les manufactures, dans les fabriques; toute cette fièvre moderne que présente l’activité de l’industrie, toute la magnificence des machines, cela est encore à peindre et sera peint pourvu que les modernistes vraiment dignes de ce nom consentent à ne pas s’amoindrir et à ne pas se momifier dans l’éternelle reproduction d’un même sujet.
Ah ! la belle partie qu’ils ont à jouer ! — Les derniers élèves de Cabanel et de Gérôme continuent à rabibocher les fripes mangées de l’antique, pour atteindre une médaille ; parmi les hommes les plus arrivés, un certain nombre se sont fait mettre dans leurs meubles comme des filles et ils se livrent, au profit d’un marchand de toiles, à de vulgaires passes de peinture.
D’autres encore font la fenêtre, pour leur propre compte, et prodiguent des agaceries au bourgeois qu’ils réveillent, en lui prodiguant les singeries sentimentales qu’il adore.
En somme, l’art français est par terre; tout est à reconstruire; jamais plus glorieuse tâche n’a été réservée à des artistes de talent comme ceux dont je viens de parcourir les envois, dans la salle des pyramides.